« Ce que j’écrivais était entouré de rayonnements, je fermais les rideaux, car j’avais peur de la moindre fissure qui eût laissé passer les rayons lumineux qui sortaient de ma plume, je voulais retirer l’écran tout d’un coup et illuminer le monde […] Mais j’avais beau prendre des précautions, des rais de lumière s’échappaient de moi et traversaient les murs, je portais le soleil en moi et je ne pouvais empêcher cette formidable fulguration de moi-même. Chaque ligne était répétée à des milliers d'exemplaires et j'écrivais avec des milliers de becs de plume qui flamboyaient.»
Extrait d'une lettre de Raymond Roussel au docteur Pierre Janet. In Dr. Pierre Janet, 1926, De l'Angoisse à l'Extase, Tome I, Librairie Félix Alcan.

« Cependant la nuit s'épaississait peu à peu, et les aspects, les sons et le sentiment des lieux se confondaient dans mon esprit somnolent ; je crus tomber dans un abîme qui traversait le globe. Je me sentais emporté sans souffrance par un courant de métal fondu, et mille fleuves pareils, dont les teintes indiquaient les différences chimiques, sillonnaient le sein de la terre comme les vaisseaux et les veines qui serpentent parmi les lobes du cerveau. Tous coulaient, circulaient et vibraient ainsi, et j'eus le sentiment que ces courants étaient composés d'âmes vivantes, à l'état moléculaire, que la rapidité de ce voyage m'empêchait seule de distinguer. Une clarté blanchâtre s'infiltrait peu à peu dans ces conduits, et je vis enfin s'élargir, ainsi qu'une vaste coupole, un horizon nouveau où se traçaient des îles entourées de flots lumineux. Je me trouvai sur une côte éclairée de ce jour sans soleil, et je vis un vieillard qui cultivait la terre. Je le reconnus pour le même qui m'avait parlé par la voix de l'oiseau, et, soit qu'il me parlât, soit que je le comprisse en moi-même, il devenait clair pour moi que les aïeux prenaient la forme de certains animaux pour nous visiter sur la terre, et qu'ils assistaient ainsi, muets observateurs, aux phases de notre existence. »
Gérard de Nerval,
1855, Aurélia, IV, Revue de Paris.
1855, Aurélia, IV, Revue de Paris.

« Mon créneau me rappelait le trou pratiqué par mon ami Robert Delaunay, le peintre de la tour Eiffel, dans les volets pleins qu’il avait fait apposer sur fenêtres et verrière pour transformer son atelier d’artiste (un salon très bourgeois) en chambre noire le jour où certains problèmes de la peinture moderne se mirent à lui turlupiner l’esprit et, notamment, le « contraste simultané » comme il appelait sa nouvelle technique de peintre pour faire pendant au « béton armé » terme qui l’avait frappé et qu’employaient de plus les architectes-esthètes d’esprit-nouveau.
Delaunay était un primaire et voici comment il travaillait :
« Il s’enferma dans une chambre noire, dont il cloua les volets. Ayant préparé sa toile et broyé ses couleurs, il pratiqua avec un vilebrequin un petit trou dans le volet. Un rayon de soleil filtra dans la chambre noire et il se mit à le peindre, à l’étudier, à le décomposer, à l’analyser dans ses éléments de forme et de couleur. Sans le savoir il s’adonnait à l’analyse spectrale. Il travailla ainsi pendant des mois, étudiant la lumière solaire pure, atteignant des sources d’émotion en dehors de tout sujet. Puis il élargit un peu le trou du volet et se mit à peindre les jeux de couleurs sur une matière transparente et fragile comme la vitre. Reflets, micassures ; ses petites toiles prenaient un aspect synthétique de joyaux et Delaunay faisait entrer dans les couleurs qu’il broyait des pierres précieuses, avant tout, comme Fra Angelico, du lapis lazuli pulvérisé. Bientôt le trou pratiqué dans le volet devint si grand, que Delaunay ouvrit complètement les vantaux et qu’il laissa entrer dans la chambre toute la lumière du jour. Les toiles de cette époque, qui sont déjà un peu plus grandes de format, représentent des fenêtres fermées où la lumière se joue dans les vitres et dans les rideaux de mousseline blanche. Enfin, il tira les rideaux et ouvrit la fenêtre : on voit un trou béant lumineux et le toit de la maison d’en face à contre-jour, dur et solide, une première forme mastoc, angulaire, inclinée… » »
Blaise Cendrars, dans Le lotissement du ciel, « La tour Eiffel sidérale » (1949), cite un passage sur Delaunay qu’il a écrit dans Aujourd’hui, 1931, Folio ed. Gallimard.
Gérard de Nerval
Les lustres du théâtre de l'Athénée
COLLECTION DES
CURIOSITÉS

On en parlait encore l’autre jour avec Michel, mon lustre de droite (entre voisins, on se donne des petits noms : il faut dire qu’on doit être accrochés l’un à côté de l’autre depuis 1893) : c’est toujours Papi qui attire les compliments.

Enfin, c’est moi qui l’appelle Papi, parce que Michel l’appelle Patron. Il est très respectueux, Michel. Sherazade (c’est l’applique murale à gauche de la porte), qui est un peu plus remontée, l’appelle Jabba le Hutt, parce qu’elle le trouve pédant et gros.

Je trouve que Sherazade exagère : Papi est quand même beaucoup plus élégant que Jabba le Hutt. S’il savait ce qu’on dit dans son dos, il serait sans doute très peiné.
Michel trouve que c’est normal d’attirer les jalousies quand on est dans sa position, qu’il doit sans doute le prendre avec beaucoup de philosophie, et qu’il nous aime tous comme si on était ses enfants (c’est vrai qu’on l’est tous un peu).
Je sens que Michel est à deux pampilles de troquer “Patron” pour “Madiba” et que ce n’est pas sain d’avoir tant d’admiration pour Papi, d’ailleurs je lui ai dit, “Michel (c’est ce que je lui ai dit), Sherazade a un peu raison, Papi il tire toujours un peu le fourreau à lui”.
Mais c’est pas toujours une lumière, Michel, et que tout le monde préfère s’extasier devant Papi plutôt que nous, ça fait des lustres qu’il ne veut pas le voir.
Moi, que les spectateurs ne nous regardent jamais, j’en mettrai pourtant mes douilles à couper. On est quand même dans le hall, à l’endroit où les gens préfèrent se marcher dessus pour récupérer leurs billets plutôt que regarder au plafond.
Balthazar et Anastasia, qui sont au foyer, ont plus de chance. Les gens discutent sous leurs bobèches en s’en mettant plein la lampe au bar. C’est pour ça que Balthazar et Anastasia sont détendus de la pendeloque vis-à-vis de Papi : ils n’ont pas de problème de reconnaissance, eux.

Michel me dit que, si un article paraît sur nous, les gens nous regarderont peut-être avant d’entrer en salle. Il est con, ce Michel.
Texte et photos : Clémence Hérout.
Publication initiale sur le blog de l'Athénée Théâtre.
Publication initiale sur le blog de l'Athénée Théâtre.
Jabba le Hutt dans les films Star Wars
Les lustres du théâtre de l'Athénée
COLLECTION DES
CURIOSITÉS
Suite aux révélations sur la vie secrète des lustres (à relire ici mais aussi sur le bien-nommé site du Lampadaire où il a été repris), le lustre de la grande salle nous a demandé de bien vouloir publier le droit de réponse suivant, conformément à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la Presse.
Le voici :
"Madame Clémence-Hérout-du-blog-de-l’Athénée,
Faisant suite à votre article “Michel et moi” paru le 24 février dernier sur ce que j’ose à peine qualifier de journal en ligne, je vous fais savoir que je souhaite exercer mon droit de réponse. En effet, j'estime que les propos tenus à mon encontre par le lustre anonyme portent atteinte à mon honneur et comportent de nombreuses contre-vérités.
Je tiens tout d’abord à dénoncer ces méthodes dignes de l’Inquisition qui consistent à dissimuler l’anonymat de vos sources en orchestrant une campagne agressive et haineuse contre ma personne, fondée sur des rumeurs et insinuations.
Profondément choqué par les insultes que vous relayez sans y confronter d’autres sources, je regrette que vous préfériez la diffamation au correct exercice de votre métier de soi-disant journaliste.
On lit ainsi dans votre tissu de mensonges que je serais surnommé “Papi”, “Patron”, voire “Jabba-le-Hutt-dans-Star-Wars”. Si vous aviez pris la peine de m’interroger, vous sauriez pourtant que j’ai demandé à ce que tous mes sujets, les petits lustres de l’entrée, m’appellent “Excellence”. Mes charmantes assistantes, les cariatides aux seins nus de la grande salle, ne s’adressent à moi que sous le nom de “Maître”.
Honteusement qualifié de “pédant” et “gros” dans votre article médiocre qui prend ses lecteurs en otage et sort les propos de leur contexte, je m’étonne que vous n’ayez pas souligné au contraire l’harmonie de mes formes généreuses et surtout mes intrinsèques qualités lumineuses : sans ma fidèle présence depuis plus d’un siècle, l’Athénée serait bien en peine d’éclairer ses spectateurs.
Votre texte abject faisant déjà suite à une première vidéo obscène (à revoir ici, NDLR) où j’apparaissais dans mon plus simple appareil sans que vous ayez pris la peine d’obtenir mon consentement et où l’on assimilait le bruit de mes pampilles à celui des cloches des vaches des alpages, je vous prie instamment de cesser vos attaques indignes et misérables à mon endroit.
Dans le cas où vous refuseriez d’inverser la courbe de vos articles et où vous franchiriez encore une fois la ligne rouge en faisant le jeu du populisme, je me verrai contraint de vous attaquer en diffamation au nom de la vérité que nous devons à la France, aux Françaises et aux Français”.
Clémence Hérout
Publication initiale sur le blog de l'Athénée Théâtre.
Publication initiale sur le blog de l'Athénée Théâtre.
L'alchimie lumineuse
COLLECTION DES
CURIOSITÉS
Concrétions chargées de mémoire
Pigmentum
Picture element
Du souffle créateur à la vie du grain
Genèse et morphogenèse
Optique haptique
Transmutation et désincarnation de la matière pigmentaire
Substances volatiles ou paradoxes du sublime
2 extraits du Faust de Goethe
Considérer un élément, c’est d’abord considérer sa matière, son archée. Creuser jusqu’à la source, remonter à ses origines pour définir sa généalogie. Le pigment en poudre renvoie à une matière physique aléatoire, nébuleuse à la fois palpable et impalpable. Glissant entre les doigts, la substance colorante s’atomise et se pulvérise en une infinité de particules. En revanche, avec le pixel, ce n’est plus une matière concrète mais une entité qui émerge au travers d’informations codées, suite à une combinatoire binaire. Rappelons ici l’approche d’EINSTEIN pour qui la matière « est vue soit comme des corpuscules discrets, singuliers (...), soit comme des entités, des champs, définis sur un contenu spatio-temporel (...) 1». Si la matrice numérique ne peut être touchée du doigt, ne peut être visible à l’état pur, elle existe pourtant et s’actualise dans l’énergie de la particule pixellaire nécessaire à sa visualisation.
Les pigments incarnent les constituants élémentaires de la peinture. Le terme pigment vient du latin pigmentum signifiant « matière colorante ». Le pigment se présente sous une forme pulvérulente composée d’une multitude de particules colorantes. Généralement insoluble, le pigment colore la surface sur laquelle il est appliqué, sans pénétrer dans le cœur des fibres. Chaque pigment fait l’objet d’une préparation longue, quasi rituelle, variant selon sa nature. Véritable particule réceptrice de lumière, le pigment représente la couleur-matière, le noyau pictural à l’origine de la peinture. Matière paradoxale du fait de sa texture indécise, à la fois fluide et dense, elle est propice aux installations éphémères invoquant les divinités, et aux peintures corporelles transfigurant l’être. Traces de leurs emplois rituel, religieux ou thérapeutique, souvenirs de leurs symboliques ou de leurs vertus, de leurs propriétés physique et chimique, l’utilisation des pigments fait ressusciter une synthèse historique étonnante. Dès les premiers temps, le pigment se dote d’une dimension mystique. Présent dans les sépultures et saupoudré sur le corps des morts, il prend la fonction de médiateur entre le sensible et le sacré, entre l’extérieur et l’intérieur. Par ailleurs, c’est un matériau exploré par les scientifiques. Une micro-analyse des pigments peut servir à restituer la vie culturelle des hommes du passé antérieur à l’écriture. En tant qu’élément métonymique, le pigment est pénétré, décomposé, pour en connaître les infimes particules. Ainsi, ce matériau ancestral s’enrichit d’un passé humain et d’une histoire propre à chaque civilisation dont il est issu. Découvert dès le début de l’humanité, l’usage de cette matière archaïque perdure aujourd’hui. Fils de son temps, le pigment, nourri de son passé, peut désormais s’inscrire dans l’ère actuelle en se parant d’une nouvelle temporalité.
« Avec l’image électronique, le point vole littéralement en éclats de lumière, de couleur et de temps, au même moment que dans les sciences physiques l’atome éclate en particules 2.» A ces corpuscules issus du monde technologique, correspondent les pixels ou unités élémentaires qui composent l’image informatique. Le terme « pixel » provient de la contraction de « picture element » qui signifie «élément d’image ». Chaque pixel correspond à un calcul. Il est contrôlable en lui fixant des coordonnées spatiale et chromatique auxquelles correspondent sur l’écran des éléments phosphorescents appelés luminophores. Juxtaposés trois par trois, les luminophores sont si petits et si rapprochés les uns des autres que notre œil les confond en un point unique qui est le pixel. Il s’ensuit une illusion électronique faite de petits points élémentaires rayonnants rouges, verts, bleus. C'est la technique de la synthèse additive consistant à combiner quelques lumières de couleurs différentes pour produire une lumière d'une autre couleur. La couleur du pixel est donc formée par le mélange des trois pastilles de phosphore.
A l’image du pigment, le pixel est constitué de molécules colorantes infinitésimales qui renferment toute une dynamique. Disposées en triade dans leur contexture, ces particules phosphoreuses cristallisent le corps luminescent de l’image. Le pixel évoque l’élément premier de l’image, le substrat de l’image, le microcosme dont sera faite la chair de l’image. Cellule de mémoire en tant que langage, le pixel est traversé par les informations attribuées à la naissance de l’image potentielle. Le pixel fonctionne comme une sorte de messager entre l’image et le nombre. Ces poudres de lumière, pigmentaires ou phosphoreuses, renvoient d’abord aux champs de la poudre et de la poussière. Poudre ou pulvis, désigne la poussière de la lice, du cirque, de l’arène, elle indique une impulsion, un mouvement. L’essence même de la particule est de condenser une dynamique vitale. Couleur-lumière et couleur-matière englobent toujours un espace en perpétuelle mutation dépendant de l’énergie lumineuse. Image picturale et image informatique amènent donc un espace mouvant, composé de plusieurs couches pigmentaires ou d’un empilement de matrices numériques. Corpuscules pigmentaires ou pixellaires, ils constituent la source de l’image. Ces microcosmes peuvent alors rejoindre les modes d’existence de l’image désignés par DELEUZE3 selon les termes « organique » et « cristallin ».
Les pigments n'émettent pas de lumière, ils ne sont visibles que parce qu'ils sont éclairés par une source lumineuse extérieure. Le matériau-pigment évolue dans le milieu sensible. Alors que la surface pigmentaire renvoie la lumière qui la touche et la détermine, l’écran, boîte crânienne de l’ordinateur, crée sa propre lumière. Au creux du pixel, repose le devenir de l’image écranique. En tant qu’entités élémentaires de l’image, les pixels sont à la base de tout le procédé de numérisation et donc influent de façon déterminante sur les caractéristiques de l’image. Pur et primitif, comparé à un gène, il permet à la morphogenèse de l’image de s’accomplir. En tant qu’échangeur entre deux mondes, « le pixel apparaît sous une face comme le vecteur des apparences sensibles et sous une autre comme le pivot de leur traitement intelligible. 4» Il incarne l’élément géniteur de la couleur, il simule la vie à l’image5. Chaque pixel, chaque grain de phosphore peut être constamment ravivé, illuminé autrement pour dévoiler l’image à l’entendement.
Face à des oeuvres constituées de pigment pur ou immergé dans des apparences colorées, le désir tactile est suscité par le frémissement poudreux des couleurs. Pour appréhender cette matérialité et entrer en contact avec elle, il faut la percevoir tactilement, la toucher. Le désir est palpitant d’effleurer la couleur floconneuse de ce voile qui épouse ou mappe la fluidité des formes. La nature de ces corpuscules syncrétiques semble receler ce drame du désir, inhérent aux matières pulvérisées, qu’elles soient poussières, poudres de lumière ou ce corps pigmenté. Notre désir de toucher reste à l’état de pause, d’où une relation en chiasme6 entre le visuel et le tactile, qui confère à toute création leur dimension d’apparition, leur singularité énigmatique. Le contact charnel avec la matière disparaît peu à peu au profit de la caresse de l’œil. La couleur en pigment est une masse éclatante vers laquelle le spectateur est attiré, comme vers le feu. La substance poudrée, saturée, brute, sert à la fois à maintenir une distance comme pour un objet sacré, intouchable et à captiver par sa présence visuelle paradoxalement vibrante et concentrée. Cette dimension sensuelle du pigment pur fait écho à la trame pixellisée de l’image qui apparaît comme une peau, un tissu composé d’une infinité de liens. En effet, cette optique tactile rejoint les sensations éprouvées face aux créations virtuelles. La forme se nourrit de la substance colorée qui l’anime d’une densité diffuse et vibratoire. Le traitement des textures des images de synthèse redonne à la couleur une saveur et une dimension tactiles. La tentation picturale perdure afin d’élucider la sensation optique des couleurs. Désormais, nombreux artistes issus des arts technologiques travaillent pixel par pixel, sur la matérialité et la substantialité des particules colorées. Ils considèrent le pixel comme un pinceau alimenté numériquement, permettant de peindre à l’aide de nombres à la place de réels pigments. Aujourd’hui, la main est prolongée par une «souris », et agit au niveau le plus élémentaire de l’image numérisée. Une vision entre microcosme et macrocosme, entre l’infiniment petit et l’infiniment grand s’actualise. Lorsque le regard s’approche de l’image, celle-ci se brise en ses éléments premiers, en un état archaïque de la matière, et quand il s’en éloigne, l’image se recompose en une gestalt, en un tout unifié.
Pigment et pixel s’interpénètrent. Particules pigmentaires et grains de la trame électronique fusionnent et s’évaporent. Empreint d’humanité, ce corpuscule nommé pigment, incarne un matériau chargé de sens. L’art peut réveiller les natures physico-chimiques et la dimension alchimique du pigment. Utilisé en peinture, le pigment communique sa couleur au milieu dans lequel il est dispersé, il se liquéfie à la surface de la masse picturale. Par exemple, les Latins appelaient Auripigmentum (couleur d’or), l’orpin ou l’orpiment, un pigment jaune extrêmement toxique à base de sulfure d’arsenic. L’orpiment possède des propriétés à la fois curatives et agressives. Cette nature paradoxale du pigment rejoint celle de la couleur qui est un pharmakon7, mot grec signifiant la couleur mais aussi le médicament et le poison. Le pigment corrode et ronge la peinture, il agit ici au creux des interstices, comme un gène créateur de l’œuvre picturale qui engendre à la surface, une mutation perpétuelle de la texture. Depuis les entrailles du tableau, il instaure un désordre chimique du corps pictural. La peinture devient animée de substances colorantes donc vivante faisant ainsi écho aux proliférations rhizomatiques de la trame écranique.
A l’image du pigment, le pixel « porteur de lumière » est messager tel une entité angélique nous transportant la lumière. Les artistes qui manipulent le pixel, tentent d’aiguiser notre sensibilité en simulant une certaine substantialité de la couleur. L’art virtuel explore des univers imaginaires, mondes oniriques aux couleurs saturées qui se volatilisent. Le spectateur peut maintenant «s’immiscer dans les interstices d’une réalité composite, mi-image, mi-substance.8» La qualité volatile désigne le caractère évanescent, la dimension éphémère des choses. Aujourd’hui, l’art oscille entre deux pôles, entre celui de revendiquer la matière brute et celui de sublimer et d’immatérialiser celle-ci jusqu’à la vider de sa propre substance. Le matériau est désormais transcendé, le pigment est sublimé. Quand un corps solide se vaporise instantanément sans se liquéfier, il y a ce que l'on appelle en physique une sublimation. La matérialité du pigment vient surpasser la couleur qui se transmue en un pur jeu de reflets jusqu’à s’oublier en tant que matière pour traduire l’impalpable frémissement coloré. La poudre colorante demeure alors comme un fantôme de la matière. Ce processus de dématérialisation est porté à son apogée avec l’image virtuelle où la danse des pixels met un défi à la pesanteur. Au sublime naturel qui nous aspire dans l’infini du paysage, s’ajoute le « sublime technologique » proposé par Mario COSTA9. Ce sont les nouvelles technologies qui créent les conditions d’un « sublime technologique » impliquant un mouvement de l’esprit qui est alternativement état d’attirance et de répulsion, d’attraction et de trouble. Cette sensation du sublime se situe aujourd’hui au cœur de dispositifs informatiques ingénieux capturant l’infiniment grand, le planétaire, réactivant ainsi le vieux désir humain qui est de dialoguer avec des forces invisibles et d’acquérir d’autres pouvoirs jusqu’à la transcendance afin de surmonter sa petitesse et sa fragilité. Au sein d’une esthétique diaphane de l’apesanteur, le virtuel caractérisé par des images-flux et angéliques, réactualiserait le rêve d’Icare. Ce rêve ancien de légèreté incarné par les substances vaporeuses ou diffusé par des entités virtuelles, nous déracine de la matérialité du monde. L’emploi des pigments en art ou dans les rituels, sollicite la transcendance ou la bénédiction des dieux, il métamorphose les hommes ou l’atmosphère, le temps d’une cérémonie ou d’une exposition, afin de communiquer avec le monde des esprits. Sous différentes formes, pigment et pixel provoquent des états sensoriels antagonistes propres au phénomène de sublimation. De la sorte, couleur-lumière et couleur-matière se télescopent en un incessant va-et-vient sublimatoire entre image écranique et image matérielle10. De la couleur immatérielle à la couleur pure, du virtuel au réel, de l'aléatoire à la stabilité, un sublime spectre est découvert. L’efflorescence de la couleur devient vecteur de traits, de lumière, de surfaces et d'espaces. Particules spirituelles et virtuelles, pigments et pixels appartiennent aux limites du monde visible car ils permettent le passage vers un espace invisible et virtuel, celui des entités surnaturelles et mathématiques. C'est dans une véritable alchimie de la couleur, que le pigment et le pixel se distillent vers une archéologie du virtuel.
Sandrine Maurial, Une alchimie lumineurse: la sublimation du pigment en pixel, 2013.
Le pixel serait-il le rêve de Faust?
extrait 1. Première partie
FAUST. [...] Le soleil décline et s'éteint, le jour expire, mais il s'en va porter en d'autres contrées une vie nouvelle. Oh, que n'ai-je des ailes pour m'enlever dans l'air, et tendre incessamment vers lui ! Je verrais dans un éternel crépuscule le monde silencieux à mes pieds ; je verrais s'enflammer les hauteurs, s'obscurcir les vallées, et le ruisseau argenté s'épancher dans les fleuves d'or ; la montagne sauvage avec ses fondrières ne s'opposerait plus à mon essor divin. Déjà la mer ouvre ses golfes brûlants à mes yeux étonnés. Cependant le dieu semble enfin disparaître : allons, que mon élan se ranime, et je continue à m'abreuver de son éternelle lumière ; devant moi le jour, derrière moi la nuit, le ciel au-dessus de ma tête, sous mes pieds les flots. Sublime rêve, qui s'évanouit cependant ! Hélas ! le corps n'a point d'ailes à joindre si aisément à celles de l'esprit, et pourtant il n'est personne que son sentiment n'emporte au delà des nuages, chaque fois qu'en dessus de nous, perdue dans le bleu de l'air, l'alouette jette son trille aigu, chaque fois que par delà les pics des rochers couverts de pins s'élève l'aigle aux ailes étendues, et qu'au-dessus des plaines et des mers la grue regagne sa patrie.
[...]
FAUST. Tu ne connais qu'un élan ; puisses-tu jamais n'apprendre à connaître l'autre ! Malheureux ! deux âmes habitent en moi, et l'une tend incessamment à se séparer de l'autre ; l'une, vive et passionnée, tient à ce monde et s'y cramponne par les organes du corps ; l'autre, secouant avec force la nuit qui l'environne, s'ouvre un chemin au séjour des cieux. Oh ! s'il y a dans l'air des Esprits qui flottent souverains entre la terre et le ciel, qu'ils descendent de leur nuages d'or et me guident vers une vie nouvelle et lumineuse ! Oui, un manteau magique qui m'emporterait vers ces contrées lointaines, si je le possédais, je ne l'échangerais pas contre les plus précieux vêtements, contre un manteau de roi.
extrait 2. Deuxième partie
UN LABORATOIRE
Dans le goût du moyen âge ; appareils confus, difformes, pour des expériences fantastiques.
WAGNER, au fourneau. La cloche retentit ; formidable, elle ébranle les murs noircis par la suie ; l'incertitude d'une attente si solennelle ne peut se prolonger plus longtemps. Déjà les ténèbres s'éclairent, déjà au fond de la fiole quelque chose reluit comme un charbon vivant ; non ! comme une escarboucle splendide d’où s'échappent mille jets de flamme dans l'obscurité. Une lumière pure et blanche paraît ! Pourvu que, cette fois, je n'aille pas la perdre ! —Ah, Dieu ! quel fracas à la porte maintenant !
MÉPIIISTOPHÉLÈS, entrant. Salut ! je viens en ami.
WAGNER, avec anxiété. Salut à l'étoile du moment ! (Bas. ) Au moins, retenez bien dans votre bouche vos paroles et votre souffle : un grand œuvre est sur le point de s'accomplir.
MÉPIIISTOPHÉLÈS, plus bas. Qu'y a-t-il donc ?
WAGNER, plus bas. Un homme va se faire !
MÉPIIISTOPHÉLÈS. Un homme ? Et quel couple amoureux avez-vous donc enfermé dans la cheminée ?
WAGNER. Dieu me garde ! L'ancienne mode d'engendrer, nous l'avons reconnue pour une véritable plaisanterie. Le tendre point d'où jaillissait la vie, la douce force qui s'exhalait de l'intérieur, et prenait et donnait, destinée à se former d'elle-même, à s'alimenter des substances voisines d'abord, puis des substances étrangères, tout cela est bien déchu maintenant de sa dignité ! Si l'animal y trouve encore son plaisir, il convient à l'homme doué de nobles qualités d'avoir une origine plus pure et plus haute. (Il se
tourne vers le foyer. ) Cela brille ! voyez ! —Désormais, vraiment, nous pouvons espérer que si de cent matières et par le mélange, — car tout dépend du mélange, — nous parvenons à composer aisément la matière humaine, à l'emprisonner dans un alambic, à la cohober, à la distiller comme il faut, l'œuvre s'accomplira dans le silence. ( Se tournant de nouveau vers le foyer.) Cela se fait ! la masse s'agite plus lumineuse, et ma conviction s'affermit à chaque instant. Nous tentons d'expérimenter judicieusement sur ce qu'on appelait les mystères de la nature ; et ce qu'elle produisait jadis organisé, nous autres, nous le faisons cristalliser.
MÉPIIISTOPHÉLÈS. L'expérience vient avec l'âge ; pour quiconque a beaucoup vécu, rien de nouveau n'arrive sur la terre ; et, quant à moi, je me souviens d'avoir rencontré souvent dans mes voyages bien des gens cristallisés.
WAGNER, qui n'a cessé de couver de l'œil sa fiole. Cela monte, cela brille, cela bouillonne ; en un moment l'œuvre sera consommé ! Un grand projet paraît d'abord insensé ; cependant, désormais nous voulons braver le hasard ; et de la sorte, un penseur ne pourra manquer, à l'avenir, de faire un cerveau bien pensant. (Contemplant, la fiole avec ravissement. ) Le verre tinte et vibre, une force charmante l'émeut ; cela se trouble, cela se clarifie ; les cboses vont leur train. Je vois dans sa forme élégante un gentil petit homme qui gesticule. Que voulons-nous de plus ? Qu'est-ce que le monde maintenant peut vouloir encore ? Voilà le mystère qui se dévoile au grand jour ; prêtez l'oreille, ce tintement devient la voix, elle parle
Goethe, Faust, 1832(traduction Henri Blaze 1847).
1. M. PATY, « Einstein et la pensée de la matière », in Qu’est-ce que la matière ?, coll. Livre de poche, Paris, 2000.
2. D. AVRON, Le Scintillant. Essai sur le phénomène télévisuel, Presses universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 1994.
3. G. DELEUZE, L’image-temps, Minuit, Paris, 1985.
4.D. AVRON, Le Scintillant..., op. cit., p. 51.
5. Cf. La peinture incarnée de G. DIDI-HUBERMANN pour le concept d’animation intérieure de la couleur-incarnat simulant la vie.
6. Le chiasme est ce va-et-vient, ce mouvement qui relie et inverse l’âme et le corps, le dedans et le dehors, in Maurice MERLEAU-PONTY, Le Visible et l’Invisible, Gallimard, Paris, 1964.
7. La couleur est nommée pharmakeia lorsqu’elle est fournie par la nature et chromata quand elle entre dans la composition d’un tableau.
8. P. QUEAU, Le virtuel. Vertus et vertiges, Champ Vallon, coll. Milieux, Institut National de l’Audiovisuel, 1993.
9. M. COSTA, Le sublime technologique, Iderive, coll. « Un oeil, une plume », Lausanne, 1994.
10. Il faut noter ici l’existence des imprimantes à sublimation qui subliment littéralement les pigments-lumière (RVB) en pigments-matière (CMJN).
Les Empires de la lune
L’Autre monde ou les États et Empires de la Lune,
Cyrano de Bergerac
COLLECTION DES
CURIOSITÉS
« Et moi, dis-je, qui souhaite mêler mes enthousiasmes aux vôtres, je crois sans m’amuser aux imaginations pointues dont vous chatouillez le temps pour le faire marcher plus vite, que la lune est un monde comme celui-ci, à qui le nôtre sert de lune. »
La compagnie me régala d’un grand éclat de rire.
« Ainsi peut-être, leur dis-je, se moque-t-on maintenant dans la lune, de quelque autre, qui soutient que ce globe-ci est un monde. »
Mais j’eus beau leur alléguer que Pythagore, Épicure, Démocrite et, de notre âge, Copernic et Kepler, avaient été de cette opinion, je ne les obligeai qu’à s’égosiller de plus belle.
Cette pensée, dont la hardiesse biaisait en mon humeur, affermie par la contradiction, se plongea si profondément chez moi que, pendant tout le reste du chemin, je demeurai gros de mille définitions de lune, dont je ne pouvais accoucher ; et à force d’appuyer cette créance burlesque par des raisonnements sérieux, je me le persuadai quasi, mais, écoute, lecteur, le miracle ou l’accident dont la Providence ou la fortune se servirent pour me le confirmer.
J’étais de retour à mon logis et, pour me délasser de la promenade, j’étais à peine entré dans ma chambre quand sur ma table je trouvai un livre ouvert que je n’y avais point mis. C’était les oeuvres de Cardan ; et quoique je n’eusse pas dessein d’y lire, je tombai de la vue, comme par force, justement dans une histoire que raconte ce philosophe : il écrit qu’étudiant un soir à la chandelle, il aperçut entrer, à travers les portes fermées de sa chambre, deux grands vieillards, lesquels, après beaucoup d’interrogations qu’il leur fit, répondirent qu’ils étaient habitants de la lune, et cela dit, ils disparurent.
Je demeurai si surpris, tant de voir un livre qui s’était apporté là tout seul, que du temps et de la feuille où il s’était rencontré ouvert, que je pris toute cette enchaînure d’incidents pour une inspiration de Dieu qui me poussait à faire connaître aux hommes que la lune est un monde.
« Quoi ! disais-je en moi-même, après avoir tout aujourd’hui parlé d’une chose, un livre qui peut-être est le seul au monde où cette matière se traite voler de ma bibliothèque sur ma table, devenir capable de raison, pour s’ouvrir justement à l’endroit d’une aventure si merveilleuse et fournir ensuite à ma fantaisie les réflexions et à ma volonté les desseins que je fais!… Sans doute, continuais-je, les deux vieillards qui apparurent à ce grand homme sont ceux-là mêmes qui ont dérangé mon livre, et qui l’ont ouvert sur cette page, pour s’épargner la peine de me faire cette harangue qu’ils ont faite à Cardan.
« Mais, ajoutais-je, je ne saurais m’éclaircir de ce doute, si je ne monte jusque-là?
— Et pourquoi non? me répondais-je aussitôt. Prométhée fut bien autrefois au ciel dérober du feu. »
Cyrano de Bergerac
L’Autre monde ou les États et Empires de la Lune (incipit), 1657.
L’Autre monde ou les États et Empires de la Lune (incipit), 1657.
Ghislaine Vappereau
COLLECTION DES
CURIOSITÉS

Ghislaine Vappereau
Porcelaine
45 x 50 x 69 cm 2005
Photographes : Raphaël Chipault et Benjamin Soligny.
Courtesy G. Vappereau
d'Héraclite
COLLECTION DES
CURIOSITÉS
&. fragments et cassés1
«Le soleil, nouveau eph'emera». Eph'emera : tous les jours ou «chaque jour» ou encore «au prix du jour»
éternellement finir recommencer
jour après jour
un mois ou un an le même
soleil - nouveau d’un jour ou d’une éternité -
on aime penser que cet éclat - scintillement vif de l’éclair - et qui s’éteint
est aussi tout à fait durable, immortel
recommençant quand il finit
« Que le jour recommence ou que le jour finisse »
revanche du temps sur le jour provocation du jour face au temps qu’il nique
de toutes façons il s'agit bien de jour… et de soleil.
mais sont-ils un, sont-ils deux? et lequel des deux est-il «nouveau»?
la question s'emporte les choses se compliquent
ainsi par exemple
le jour est-il la mesure du temps ?
et quelle mesure mesure-t-elle le jour ?
est-ce le soleil est-ce le jour qui mesure ce que nous appelons l’éphémère?
jours
sans lendemain la rose qui se fane
la liste des courses à faire (quoique)
l'assiette qui se casse
je l'ai laissé en plan
rencontre éphémère je ne l'ai pas revu(e)
elle ne finit pas ses phrases
elle ne sait pas l'anglais
poussière d'angle ou un ange qui passe
où passe-t-il par où s'en va-t-il
enfui
il y a des fleurs éphémères qui s'appellent «immortelles»
l'idée de l'éphémère reste là mais l'éphémère lui-même où est-il?
tout épéhémériste qui se respecte doit disparaître contrairement à l'éphémérologue qui reste pour commenter sa disparition
chaque jour l'éphémère se renouvelle
j'écris ce petit texte un peu tous les jours, eph"emera eh oui!
écrire est pourtant quelque chose qui dure qui reste
sa trace bloquée dans l'encre et la machine
seule la voix serait peut-être proche de l'éphémère disparaissante
fragile évanouie
& argument suivi
du lever au coucher du soleil règne le jour, dit-on. Mais quel jour ? Le jour physique : -« il fait jour ! » n‘est pas le même ici ou là, tantôt raccourci tantôt étiré, parfois bref, souvent interminable. Celui-là, le physiquement jour, rime avec clarté et soleil ; à l’inverse, il rime aussi avec nuit et obscurité. Hésiode, dans la théogonie, fait naître jour, emera, de la nuit, elle-même fille du Chaos et de l’Erèbe. Au chevet du jour, se pressent donc de sombres figures mythiques. Se mêlent dès lors des rêves de naissance et de mort à la simple observation de ce qui existe. L'extrême concision et l'apparente simplicité du fragment cachent et révèlent un paysage de grottes mythologiques.
cité par Aristote dans le contexte des Météorologiques, «néos éph' émerê » peut signifier :« nouveau tout au long du jour». Ce qui reviendrait à dire que le soleil se renouvelle pendant toute la durée du jour, à chaque instant, mais cela n'inclut pas que ce soit nécessairement tous les jours. Pour que ce soit tous les jours, il faut introduire «aei» éternellement. Ainsi le soleil serait nouveau non seulement pendant toute la durée du jour, mais le phénomène se reproduirait chaque jour, tout le temps. «Tout nouveau tout beau» dit la sagesse populaire.
contraires, ce qui ne dure qu'un jour et ce qui dure éternellement se retrouvent liés et posés ensemble. Le fragment invite à renverser les deux termes l'un dans l'autre, jour et soleil échangeant leurs propriétés. Effectuer l'unité de ce qui paraît être des contraires : la vie ne se peut qu'à lier ce qui est séparé : la contingence fragile des jours humains, destinée à s'effacer dans le temps et la nécessité qu'impose la loi du monde, éternellement en acte. Ce fragment énoncerait dès lors une parole de sagesse : la réconciliation et l'acceptation des contraires est la voie qui nous sauve des contrariétés de nos propres vies.
soleil et jours, jours et éternité, ne se contentent pas d'une opposition logique, tenue par la raison et le langage. Ils font appel à un ancien agôn, combat qui met aux prises les forces tectoniques primitives, toute une théogonie. Là, les naissances sont sanglantes, les puissances détrônées, ce ne sont que rapts et vengeances. Les meurtres enfantent des dieux. Tel le jour qui, avec son frère l'éther, est né de deux puissances nocturnes Nuit et Erébe, eux-mêmes nés du Chaos ; le soleil n'a, quant à lui, qu'une naissance triviale, superficielle, c'est un objet d'étude dont le mouvement est fixé par la nature, et qui n'a aucune autonomie. Ainsi, pour qu'une fois éteint il puisse renaître, il doit puiser quelque part sa nouvelle vigueur. Il la prend en consommant la force du jour. L'astre splendide se nourrit de nos pauvres jours humains, qu'il dévore. Les (nos) jours sont bien la cause du soleil, mais payent cet honneur de leur substance même ; ils se consument, tandis que triomphe éternellement un soleil recommencé. Les mythes hantent le lieu du logos; ils sont là, présents, entourant soleil et jour. Une part d'obscurité plombe l'éphémère : rien n'est simplement «du jour».
& argument suivi d'une suite
l'éphémère
et (est) le contemporain
le détour par Héraclite et le fragment 6 n'était pas simple plaisir de promenade présocratique; le combat de légende que soleil et jours mènent l'un contre l'autre peut, me semble-t-il, servir de trame et comme d'intrigue à un combat plus actuel : celui qui se déroule en ce moment sur la scène de l'art contemporain. Car c'est bien un combat que se livrent l'œuvre - considérée comme la finalité et le tout de l'Art - et les pratiques artistiques contemporaines. Combat qui a le temps pour toile de fond, et dont les protagonistes sont - sommairement esquissés - d'une part les institutions en place (musées, galeries, système du marché, avec leurs produits sous forme d'œuvres) et d'autre part les artistes et leurs pratiques. Sans compter les commentateurs des deux bords (critiques, esthéticiens, historiens, poètes ou philosophes).
la manière dont nous percevons le temps et dont nous adhérons ou non à certains de ses régimes fait division entre pratiques, principes et opinions au sujet de l'art. Ainsi la notion d'œuvre appartiendrait-elle à une temporalité spécifique : la longue durée, ancrée dans ce qu'on nomme patrimoine - de l'humanité, ou plus modestement, national. En quelque sorte sacralisée, elle se loge au dessus de nos têtes dans un panthéon inviolable. Il s'agit d'un temps que l'on peut visiter ; on y entre et on en sort comme d'un temple ou d'un musée. Tel le soleil dans le ciel, l'œuvre est toujours déjà là, renouvelée par les regards.
une autre temporalité semble gérer les pratiques de l'art contemporain. Temps du jour ou «selon» le jour, temps que l'on dit «éphémère» et qui sert de ralliement à nombre de travaux et de discours.
On peut percevoir le rapport du temps éphémère de la production artistique actuelle au temps quasi éternel de l'œuvre instituée comme un déni radical qui ferait de ces productions des non-œuvres. Mais ce serait compter sans les subtilités énigmatiques du jeu entre soleil et jours, entre œuvres durables et productions éphémères.
Œuvre et de riens
il paraît difficile de supprimer le terme «oeuvre d'art» du vocabulaire esthétique. Difficile aussi, pour ne pas dire irréalisable, d'en faire l'impasse en pratique. En revanche, ce qui est possible c'est de débarrasser la notion de quelques unes de ses propriétés encombrantes et de revoir le rapport du travail artistique et du produit de ce travail. C'est ainsi que plusieurs «figures» sont possibles qui peuvent se ranger sous le patronage de l'éphémère
- le temps de l'éphémère peut entrer dans le dispositif de l'œuvre comme un de ses composants : l'inachevé ou l'inachevable est une suspension, une brèche dans le continu du temps de l'œuvre, qu'on peut verser au compte de l'éphémère. La répétition de temps courts et entrecoupés (les jours) nie la satiété et stabilité de l'œuvre. Celle-ci se maintient comme l'horizon inatteignable du parcours éphémère. On a coutume de ranger ce dispositif sous le vocable de «work in process» et de l'opposer frontalement à l'œuvre finie. En réalité il s'agit plutôt d'un compromis entre œuvre et non œuvre, et d'un temps devenu composite.
- le produit du travail de l'artiste est effacé, il disparaît ou n'est plus perceptible, mais sa trace demeure ; enregistrée, cette trace (généralement une photo ou un élément d'u travail isolé) est exposée dans le circuit habituel des œuvres (galerie ou musée). C'est le cas des productions du land art pour lesquelles la nature est convoquée à jouer le rôle d'otage. Même dispositif pour les happenings, actions ou événements, pour lesquels la trace consiste aussi bien en enregistrement qu'en échos médiatiques. Intéressante manœuvre, qui garde les deux termes opposés dans une complicité batailleuse : la nature éternellement présente à elle- même et comme inviolable, et le travail de l'artiste qui en use de manière passagère pour la révéler à elle-même et usurper aussi passagèrement sa place.
- autres figures : tout ce qui se réclame des propriétés imputées à l'éphémère telles que la fragilité, la faiblesse, l'évanescence, et que l'on trouve dans les produits de la nature, la rose qui se fane, le phasme, la phase foetale, la poussière ou la fumée ou encore ce qui est destiné à disparaître ou condamné à rester «en l'air», pièces de John Cage, nuées de brouillard, fumées et nuages, reflets dans l'eau.
Anne Cauquelin
Article paru dans le numéro de la revue ETC n° 93, juin 2011 (numérisation L’Érudit) et publié sur ce site avec l’aimable autorisation de ETC.
1.Héraclite ou la séparation, fragment 6, Traduction Bollack et Heinz Wismann, Les éditions de Minuit, 1972.
Laforgue et l'Éphémère
COLLECTION DES
CURIOSITÉS
Elle n’était d’aucune époque ; nulle cloison ne l’arrêtait, nulle tendance de boudoir sensuel. L’opoponax de Madame était sans influence sur elle mais, pantelante, elle ricochait au battant de la destinée et revenait s’écraser sur le sol après une parabole de détresse.
Quelle parcelle ravie au divin inspira à Jules Laforgue sa vision sublime de l’univers ? Il ne se sentait pas, tels ses contemporains, rattaché au siècle par mille fibres personnelles. Il ne connaissait pas la joie, et le bonheur lui paraissait comme une vibration d’éphémère. Devant « l’énigme du cosmos », il hululait de terreur et s’arc-boutait au Présent avec la conscience distincte d’un passé gigantesque l’entraînant vers l’abîme de cette éternité où il ne serait plus.
(Le sanglot de la terre.) »
Roger de Montégon,
L’Éphémère, cahiers littéraires n°3 p. 7, 15 mars 1926.
L’Éphémère, cahiers littéraires n°3 p. 7, 15 mars 1926.
Camps éphémères
John Steinbeck
COLLECTION DES
CURIOSITÉS
«The cars of the migrant people crawled out of the side roads onto the great cross-country highway, and then took the migrant way to the West. In the daylight they scuttled like bugs to the west-ward ; and as the dark caught them, they clustered like bugs near to shelter and to water. And because they were lonely and perplexed, because they had all come from a place of sadness and worry and defeat, and because they were all going to a new mysterious place, they huddled together ; they talked together ; they shared their lives, their food, and the things they hoped for in the new country. Thus it might be that one family camped near a spring, and another camped for the spring and for company, and a third because two families had pioneered the place and found it good. And when the sun went down, perhaps twenty families and twenty cars were there.
In the evening a strange thing happened : the twenty families became one family, the children were the children of all. The loss of home became one loss, and the golden time in the West was one dream. And it might that a sick child threw despair into the hearts of twenty families, of a hundred people ; that a birth there in a tent kept a hundred people quiet and awestruck through the night and filled a hundred people with the birth-joy in the morning. A family which the night before had been lost and fearful might search its goods to find a present for a new baby. In the evening, sitting about the fires, the twenty were one. They grew to be units of the camps, units of the evenings and the nights. A guitar unwrapped from a blanket and tuned – and the songs, which were all the people, were sung in the nights. Men sang the words, and women hummed the tunes.
Every night a world created, complete with furniture – friends made and enemies established ; a world complete with braggarts and with cowards, with quiet men, with humble men, with kindly men. Every night relationships that make a world, established ; and every morning the world torn down like a circus.»
John Steinbeck,
1939,The Grapes of the Wrath, Chapter 17, Viking Press.
1939,The Grapes of the Wrath, Chapter 17, Viking Press.
Je me trouvais donc sans ombre et sans argent, mais ma poitrine était soulagée du fardeau qui l’avait oppressée et je respirais librement. Si je n’avais pas perdu mon amour, ou si dans cette perte je m’étais cru sans reproche, je crois que j’aurais été heureux. Cependant je ne savais que faire, et j’ignorais ce que j’allais devenir. Je visitai d’abord mes poches, où je trouvai encore quelques pièces d’or ; je les comptai, et je me mis à rire. J’avais laissé mes chevaux dans la vallée, à l’auberge prochaine, mais j’avais honte d’y retourner. Au moins fallait-il pour cela attendre le coucher du soleil, et il était à peine à son midi. Je m’étendis à l’ombre d’un arbre, et je m’endormis profondément.
À travers le tissu diaphane d’un songe délicieux, je vis groupées autour de moi les plus riantes images. Je vis Mina couronnée de fleurs s’approcher, me sourire, se pencher vers moi, et glisser comme sur les ailes du zéphyr. L’honnête Bendel, le front radieux, passa devant moi, et me tendit la main. De nombreux groupes semblaient former dans le lointain des danses légères. Je reconnus plusieurs personnes ; je crus te reconnaître toi-même, mon cher Adelbert. Une vive lumière éclairait le paysage ; cependant personne n’avait d’ombre, et ce qu’il y avait de plus extraordinaire, c’est que cela n’avait rien de choquant. Des chants retentissaient sous des bosquets de palmiers ; tout respirait le bonheur. Je ne pouvais fixer toutes ces images furtives, je ne pouvais même les comprendre ; mais leur vue me remplissait d’une douce émotion, et je sentais que ce rêve m’enchantait. J’aurais voulu qu’il durât toujours, et en effet, longtemps après m’être réveillé, je tenais encore les yeux fermés, comme pour en retenir l’impression dans mon âme.
J’ouvris enfin les yeux. Le soleil était encore au ciel, mais du côté de l’orient ; j’avais dormi le reste du jour précédent et la nuit tout entière. Il me sembla que ce fût un avertissement de ne plus retourner à mon auberge. J’abandonnai sans regret tout ce que j’y possédais encore, et je résolus de suivre à pied le sentier qui, à travers de vastes forêts, serpentait sur les flancs de la montagne. Je m’abandonnai à mon destin, sans regarder en arrière, et je n’eus pas même la pensée de m’adresser à Bendel, que j’avais laissé riche, et sur lequel j’aurais pu compter dans ma détresse.
Je me considérai sous le rapport du nouveau rôle que j’allais avoir à jouer. Mon habillement était très modeste ; j’étais vêtu d’une vieille kourtke noire que j’avais portée jadis à Berlin, et qui, je ne sais comment, m’était tombée sous la main le jour où j’avais quitté les bains. J’avais un bonnet de voyage sur la tête et une paire de vieilles bottes à mes pieds. Je me levai, coupai un bâton d’épine à la place même où j’étais, en mémoire de ce qui s’y était passé, et je me mis sur-le-champ en route.
Je rencontrai dans la forêt un vieux paysan qui me salua cordialement ; je liai conversation avec lui. Je m’informai, comme le fait un voyageur curieux et à pied, d’abord du chemin, ensuite de la contrée et de ses habitants, enfin des diverses productions de ces montagnes. Il répondit à toutes mes questions en bon villageois et avec détail. Nous arrivâmes au lit d’un torrent qui avait ravagé une assez vaste étendue de la forêt. Ce large espace éclairé par le soleil me fit frissonner intérieurement. Je laissai mon compagnon passer devant moi, mais il s’arrêta au milieu de cette dangereuse traversée, et se retourna vers moi pour me raconter l’histoire et la date du débordement dont nous voyions les traces. Il s’aperçut bientôt de ce qui me manquait, et s’interrompant dans sa narration :
« Comment donc ! dit-il, monsieur n’a point d’ombre ?
– Hélas ! non, répondis-je en gémissant ; je l’ai perdue, ainsi que mes cheveux et mes ongles, dans une longue et cruelle maladie. Voyez, brave homme, à mon âge, quels sont les cheveux qui me sont revenus : ils sont tout blancs ; mes ongles sont encore courts, et pour mon ombre, elle ne veut pas repousser. »
Il secoua la tête en fronçant le sourcil, et répéta :
« Point d’ombre ! point d’ombre ! cela ne vaut rien, c’est une mauvaise maladie que monsieur a eue là. »
Il ne reprit pas le récit qu’il avait interrompu, et il me quitta, sans rien dire, au premier carrefour qui se présenta. Mon cœur se gonfla de nouveau, de nouvelles larmes coulèrent le long de mes joues. C’en était fait de ma sérénité.
Je poursuivis tristement ma route, et je ne désirai désormais aucune société ; je me tenais tout le jour dans l’épaisseur des bois, et lorsque j’avais à traverser quelque lieu découvert, j’attendais qu’aucun regard ne pût m’y surprendre. Je cherchais, le soir, à m’approcher des villages où je voulais passer la nuit. Je me dirigeais sur des mines situées dans ces montagnes, où j’espérais obtenir du travail sous terre. Il fallait, dans ma situation présente, songer à ma subsistance ; il fallait surtout, et je l’avais clairement reconnu, chercher dans un travail forcé quelque relâche aux sinistres pensées qui dévoraient mon âme.
Deux journées de marche par un temps pluvieux, où je n'avais pas le soleil à craindre, m'avancèrent beaucoup sur ma route, mais ce fut aux dépens de mes bottes, qui dataient du temps du comte Pierre, et n’avaient pas été faites pour voyager à pied dans les montagnes. Je marchais à pieds nus ; il fallait renouveler ma chaussure. Le matin du jour suivant, le ciel étant encore couvert, j’entrai, pour m’occuper de cette affaire importante, dans un bourg où l’on tenait foire, et je m’arrêtai devant une boutique où des chaussures vieilles et neuves étaient étalées. Je marchandai une paire de bottes neuves qui me convenaient parfaitement ; mais le prix exorbitant que l’on en demandait m’obligea d’y renoncer. Je me rabattis sur d’autres déjà portées, qui paraissaient encore bonnes et très fortes ; je conclus le marché. Le jeune garçon qui tenait la boutique, et dont une longue chevelure blonde ombrageait la belle figure, les remit entre mes mains, après en avoir reçu le paiement, et me souhaita d’un air gracieux un bon voyage. Je me chaussai de ma nouvelle emplette, et je sortis du bourg, dont la porte s’ouvrait du côté du nord.
Absorbé dans mes pensées, je regardais à peine à mes pieds ; je songeais aux mines, où j’espérais arriver le soir même, et où je ne savais trop comment me présenter.
Je n’avais pas encore fait deux cents pas, lorsque je m’aperçus que je n’étais plus dans le chemin ; je le cherchai des yeux. Je me trouvais au milieu d’une antique forêt de sapins, dont la cognée semblait n’avoir jamais approché. Je pénétrai plus avant : je ne vis plus autour de moi que des rochers stériles, dont une mousse jaunâtre et aride revêtait la base, et dont les sommets étaient couronnés de glaces et de neiges. L’air était extrêmement froid. Je regardai derrière moi ; la forêt avait disparu. Je fis encore quelques pas ; le silence de la mort m’environnait. Je me trouvai sur un champ de glace, qui s’étendait à perte de vue autour de moi. L’air était épais ; le soleil se montrait sanglant à l’horizon. Je ne comprenais rien à ce qui m’arrivait. Le froid qui me gelait me força de hâter ma marche. J’entendis le bruissement éloigné des flots encore un pas, et je fus aux bords glacés d’un immense océan ; et devant moi des troupeaux innombrables de phoques se précipitèrent en rugissant dans les eaux. Je voulus suivre cette rive je revis des rochers, des forêts de bouleaux et de sapins, – des déserts. Je continuai un instant à courir ; la chaleur devint étouffante. Je regardai autour de moi ; j’étais au milieu de rizières et de riches cultures. Je m’assis sous l’ombre d’une plantation de mûriers ; je tirai ma montre : il n’y avait pas un quart d’heure que j’étais sorti du bourg. Je croyais rêver ; je me mordis la langue pour m’éveiller, mais je ne dormais pas. Je fermai les yeux pour rassembler mes idées. Les syllabes d’un langage qui m’était tout à fait inconnu frappèrent mon oreille. Je levai les yeux : deux Chinois (la coupe asiatique de leur visage me forçait d’ajouter foi à leur costume), deux Chinois m’adressaient la parole avec les génuflexions usitées dans leur pays. Je me levai et reculai de deux pas ; je ne les revis plus : le paysage avait changé, des bois avaient remplacé les rizières. Je considérai les arbres voisins ; je crus reconnaître des productions de l’Asie et des Indes orientales. Je voulus m’approcher d’un de ces arbres ; – une jambe en avant, et tout avait encore changé. Alors je me mis à marcher à pas comptés, comme une recrue que l’on exerce, regardant avec admiration autour de moi. De fertiles plaines, de brûlants déserts de sable, des savanes, des forêts, des montagnes couvertes de neige se déroulaient successivement et rapidement à mes regards étonnés. Je n’en pouvais plus douter, j’avais à mes pieds des bottes de sept lieues.
Un vif et profond sentiment de piété me fit tomber à genoux, et des larmes de reconnaissance coulèrent de mes yeux. Un avenir nouveau se révélait à moi. J’allais, dans le sein de la nature que j’avais toujours chérie, me dédommager de la société des hommes, dont j’étais exclu par ma faute ; toute la terre s’ouvrait devant mes yeux comme un jardin ; l’étude allait être le mouvement et la force de ma vie, dont la science devenait le but. Je n’ai fait depuis ce jour que travailler, avec zèle et persévérance, à réaliser cette inspiration ; et le degré auquel j’ai approché de l’idéal a constamment été la mesure de ma propre satisfaction.
Je me levai aussitôt pour prendre d’un premier regard possession du vaste champ où je me préparais à moissonner. Je me trouvais sur le haut plateau de l’Asie, et le soleil, qui peu d’heures auparavant s’était levé pour moi, s’inclinait vers son couchant. Je devançai sa course en traversant l’Asie d’orient en occident ; j’entrai en Afrique par l’isthme de Suez, et je parcourus en différents sens ce continent, dont chaque partie excitait ma curiosité. Passant en revue les antiques monuments de l’Egypte, j’aperçus près de Thèbes aux cent portes les grottes du désert qu’habitèrent autrefois de pieux solitaires, et je me dis aussitôt : « Ici sera ma demeure. » Je choisis pour ma future habitation l’une des plus retirées, qui était à la fois spacieuse, commode et inaccessible aux chacals, et je poursuivis ma course. J’entrai en Europe par les colonnes d’Hercule, et, après en avoir regardé les diverses provinces, je passai du nord de l’Asie sur les glaces polaires, et gagnai le Groenland et l’Amérique. Je parcourus les deux parties du nouveau monde, et l’hiver qui régnait dans le sud me fit promptement retourner du cap Horn vers les tropiques.
Je m’arrêtai jusqu’à ce que le jour se levât sur l’orient de l’Asie, et repris ma course après quelque repos. Je suivis du sud au nord des deux Amériques la haute chaîne de montagnes qui en forme l’arête. Je marchais avec précaution, d’un sommet à un autre, sur des glaces éternelles et au milieu des feux que vomissaient les volcans souvent j’avais peine à respirer. Je cherchai le détroit de Behring et repassai en Asie. J’en suivis la côte orientale dans toutes ses sinuosités, examinant avec attention quelles seraient celles des îles voisines qui pourraient m’être accessibles.
De la presqu’île de Malacca mes bottes me portèrent sur les îles jusqu’à celle de Lamboc. Je m’efforçai, non sans m’exposer à de grands dangers, de me frayer, au travers des roches et des écueils dont ces mers sont remplies, une route vers Bornéo, et puis vers la Nouvelle-Hollande : il fallut y renoncer. Je m’assis enfin sur le promontoire le plus avancé de l’île que j’avais pu atteindre, et, tournant mes regards vers cette partie du monde qui m’était interdite, je me mis à pleurer, comme devant la grille d’un cachot, d’avoir sitôt rencontré les bornes qui m’étaient prescrites. En effet, la portion de la terre la plus nécessaire à l’intelligence de l’ensemble m’était fermée, et je voyais dès l’abord le fruit de mes travaux réduit à de simples fragments. Ô mon cher Adelbert, qu’est-ce donc que toute l’activité des hommes ?
Souvent, au fort de l’hiver austral, m’élançant du cap Horn, bravant le froid, la mer et les tempêtes, je me suis risqué, avec une audace téméraire, sur des glaces flottantes, et j’ai cherché à m’ouvrir par le glacier polaire un passage vers la Nouvelle-Hollande, même sans m’inquiéter du retour, et dût ce pays affreux se refermer sur moi comme mon tombeau. Mais en vain mes yeux n’ont point encore vu la Nouvelle-Hollande. Après ces tentatives infructueuses, je revenais toujours au promontoire de Lamboc, où, m’asseyant la face tournée vers le levant ou le midi, je pleurais mon impuissance.
Enfin, je m’arrachai de ce lieu, et, le cœur plein de tristesse, je rentrai dans l’intérieur de l’Asie. J’en parcourus les parties que je n’avais pas encore visitées, et je m’avançai vers l’occident en devançant l’aurore. J’étais avant le jour dans la Thébaïde, à la grotte que j’avais marquée la veille pour mon habitation. Dès que j’eus pris quelque repos, et que le jour éclaira l’Europe, je songeai à me procurer tout ce qui m’était nécessaire. D’abord il fallut songer au moyen d’enrayer ma chaussure vagabonde ; car j’avais éprouvé combien il était incommode d’être obligé de l’ôter chaque fois que je voulais raccourcir le pas, ou examiner à loisir quelque objet voisin. Des pantoufles que je mettais pardessus mes bottes produisirent exactement l’effet que je m’en étais promis, et je m’accoutumai plus tard à en avoir toujours deux paires sur moi, parce qu’il m’arrivait souvent d’en jeter une, sans avoir le temps de la ramasser, quand des lions, des hommes ou des ours m’interrompaient dans mes travaux, et me forçaient à fuir. Ma montre, qui était excellente, pouvait, dans mes courses rapides, me servir de chronomètre. J’avais encore besoin d’un sextant, de quelques instruments de physique et de quelques livres.
Je fis pour acquérir tout cela quelques courses dangereuses à Paris et à Londres. Un ciel couvert me favorisa. Quand le reste de mon or fut épuisé, j’apportai en paiement des dents d’éléphants, que j’allai chercher dans les déserts de l’Afrique, choisissant celles dont le poids n’excédait pas mes forces. Je fus bientôt pourvu de tout ce qu’il me fallait, et, je commençai mon nouveau genre de vie.
Je parcourais incessamment la terre en mesurant les hauteurs, en interrogeant les sources, en étudiant l’atmosphère. Tantôt j’observais des animaux, tantôt je recueillais des plantes ou des échantillons de roches. Je courais des tropiques aux pôles, d’un continent à l’autre, répétant ou variant mes expériences, rapprochant les productions des régions les plus éloignées, et jamais ne me lassant de comparer. Les œufs des autruches de l’Afrique et ceux des oiseaux de mer des côtes du nord formaient, avec les fruits des tropiques, ma nourriture accoutumée. La nicotiane adoucissait mon sort, et l’amour de mon fidèle barbet remplaçait pour moi les doux liens auxquels je ne pouvais plus prétendre. Quand, chargé de nouveaux trésors, je revenais vers ma demeure, ses bonds joyeux et ses caresses me faisaient encore doucement sentir que je n’étais pas seul dans le monde.
Il fallait l’aventure que je vais raconter pour me rejeter parmi les hommes.
Un jour que, sur les côtes de Norvège, mes pantoufles à mes pieds, je recueillais des lichens et des algues, je rencontrai au détour d’une falaise un ours blanc, qui se mit en devoir de m’attaquer. Je voulus pour l’éviter jeter mes pantoufles et passer sur une île éloignée, qu’une pointe de rocher à fleur d’eau s’élevant dans l’intervalle me donnait la facilité d’atteindre. Je plaçai bien le pied droit sur ce récif, mais je me précipitai de l’autre côté dans la mer, parce que ma pantoufle gauche était, par mégarde, restée à mon pied.
Le froid excessif de l’eau me saisit, et j’eus peine à me sauver du danger imminent que je courais. Dès que j’eus gagné terre, je courus au plus vite vers les déserts de la Libye, pour m’y sécher au soleil. Mais ses rayons brûlants, auxquels je m’étais inconsidérément exposé, m’incommodèrent en me donnant à plomb sur la tête. Je me rejetai d’un pas mal assuré vers le nord ; puis, cherchant par un exercice violent à me procurer quelque soulagement, je me mis à courir de toutes mes forces d’orient en occident, et d’occident en orient. Je passais incessamment du jour à la nuit et de la nuit au jour, et chancelais du nord au sud et du sud au nord, à travers tous les climats divers.
Je ne sais combien de temps je roulai ainsi d’un côté du monde à l’autre. Une fièvre ardente embrasait mon sang. Je sentais, avec la plus extrême anxiété, mes forces et ma raison m’abandonner. Le malheur voulut encore que dans cette course désordonnée je marchasse sur le pied de quelqu’un, à qui sans doute je fis mal. Je me sentis frapper, je tombai à terre, et je perdis connaissance.
J’étais, lorsque je revins à moi, mollement couché dans un bon lit, qui se trouvait au milieu de plusieurs autres, dans une salle vaste et d’une extrême propreté. Une personne était à mon chevet ; d’autres se promenaient dans la salle, allant d’un lit à l’autre. Elles vinrent au mien et s’entretinrent de moi. Elles ne me nommaient que numéro douze, et cependant sur une table de marbre noir, fixée au mur en face de moi, était écrit bien distinctement mon nom :
en grosses lettres d’or. Je ne me trompais pas, ce n’était pas une illusion, j’en comptais toutes les lettres. Au-dessous de mon nom étaient encore deux lignes d’écriture, mais les caractères en étaient plus fins, et j’étais encore trop faible pour les assembler. Je refermai les yeux.
J’entendis prononcer distinctement et à haute voix un discours dans lequel il était question de Pierre Schlémihl, mais je n’en pouvais pas encore saisir le sens. Je vis un homme d’une figure affable et une très belle femme vêtue de noir s’approcher de mon lit. Leurs physionomies ne m’étaient point étrangères ; cependant, je ne pouvais pas encore les reconnaître.
Je repris des forces peu à peu ; je m’appelais numéro douze, et numéro douze passait pour un juif à cause de sa longue barbe, mais n’en était pas pour cela traité avec moins de soin on paraissait ignorer qu’il eût perdu son ombre. On conservait, me dit-on, mes bottes avec le reste des effets trouvés sur moi à mon entrée dans la maison, pour m’être scrupuleusement restitués à ma sortie. Cette maison où l’on me soignait dans ma maladie s’appelait Schlemihlium. Ce que j’entendais réciter tous les jours était une exhortation à prier Dieu pour Pierre Schlémihl, fondateur et bienfaiteur de l’établissement. L’homme affable que j’avais vu près de mon lit était Bendel ; la dame en deuil était Mina.
Je me rétablis dans le Schlemihlium sans être reconnu, et je reçus différentes informations. J’étais dans la ville natale de Bendel, où, du reste de cet or, jadis maudit, il avait fondé sous mon nom cet hospice, dans lequel un grand nombre d’infortunés me bénissaient chaque jour. Il surveillait lui-même ce charitable établissement. Pour Mina, elle était veuve ; un malheureux procès criminel avait coûté la vie à M. Rascal et absorbé en même temps la plus grande partie de sa dot. Ses parents n’étaient plus, et elle vivait dans ce pays retirée du monde, et pratiquant les œuvres de miséricorde et de charité.
Elle s’entretenait un jour avec M. Bendel près du numéro douze :
« Pourquoi donc, madame, lui dit-il, venez-vous si souvent vous exposer à l’air dangereux qui règne ici ? Votre sort est-il donc si amer que vous cherchiez la mort ?
– Non, mon respectable ami. Rendue à moi-même, depuis que mes songes se sont dissipés, je suis satisfaite, et ne souhaite ni ne crains plus la mort. Je contemple avec une égale sérénité le passé et l’avenir ; et ne goûtez-vous pas vous-même une secrète félicité à servir aussi pieusement que vous le faites votre ancien maître et votre ami ?
– Oui, madame, grâce à Dieu. Quelle a été notre destinée ! Nous avons inconsidérément, et sans y réfléchir, épuisé toutes les joies et toutes les douleurs de la vie ; la coupe est vide aujourd’hui. Il semblerait que le seul fruit que nous ayons recueilli de l’existence fût la prudence qu’il nous eût été utile d’avoir pour en fournir la carrière, et l’on serait tenté d’attendre qu’après cette instructive répétition la scène véritable se rouvrît devant nous. Cependant une tout autre scène nous appelle, et nous ne regrettons pas les illusions qui nous ont trompés, dont nous avons joui, et dont le souvenir nous est encore cher. J’ose espérer que, comme nous, notre vieil ami est aujourd’hui plus heureux qu’il ne l’était alors.
– Je trouve en moi la même confiance », répondit la belle veuve.
Et tous deux passèrent devant mon lit et s’éloignèrent.
Cet entretien m’avait profondément affecté, et je balançais en moi-même si je me ferais connaître ou si je partirais inconnu. Enfin je me décidai ; je me fis donner du papier et un crayon, et je traçai ces mots :
« Votre vieil ami est, ainsi que vous, plus heureux aujourd’hui qu’il ne l’était alors ; et s’il expie sa faute, c’est après s’être réconcilié. »
Puis je demandai, me trouvant assez fort, à me lever. On me donna la clef d’une petite armoire qui était au chevet de mon lit : j’y retrouvai tout ce qui m’appartenait. Je m’habillai je suspendis par-dessus ma kourtke noire ma boîte à botaniser, dans laquelle je retrouvai, avec plaisir, les lichens que j’avais recueillis sur les côtes de Norvège le jour de mon accident. Je mis mes bottes, plaçai sur mon lit le billet que j’avais préparé, et, dès que les portes s’ouvrirent, j’étais loin du Schlemihlium, sur le chemin de la Thébaïde.
Comme je suivais le long des côtes de la Syrie la route que j’avais tenue la dernière fois que je m’étais éloigné de ma demeure, j’aperçus mon barbet, mon fidèle Figaro, qui venait au-devant de moi. Cet excellent animal semblait chercher, en suivant mes traces, un maître que sans doute il avait longtemps attendu en vain. Je m’arrêtai, je l’appelai, et il accourut à moi en aboyant et en me donnant mille témoignages touchants de sa joie. Je le pris dans mes bras, car assurément il ne pouvait suivre, et je le portai jusque dans ma cellule.
Je revis ce séjour avec une joie difficile à exprimer ; j’y retrouvai tout en ordre, et je repris, petit à petit, et à mesure que je recouvrais mes forces, mes occupations accoutumées et mon ancien genre de vie. Mais le froid des pôles ou des hivers des zones tempérées me fut longtemps insupportable.
Mon existence, mon cher Adelbert, est encore aujourd’hui la même. Mes bottes ne s’usent point, elles ne perdent rien de leur vertu, quoique la savante édition que Tickius nous a donnée de rebus gestis Pollicilli me l’ait d’abord fait craindre. Moi seul je m’use avec l’âge ; mais j’ai du moins la consolation d’employer ces forces que je sens décliner à poursuivre avec persévérance le but que je me suis proposé. Tant que mes bottes m’ont porté, j’ai étudié notre globe, sa forme, sa température, ses montagnes, les variations de son atmosphère, sa force magnétique, les genres et les espèces des êtres organisés qui l’habitent. J’ai déposé les faits avec ordre et clarté dans plusieurs ouvrages, et j’ai noté en passant, sur quelques feuilles volantes, les résultats auxquels ils m’ont conduit, et les conjectures qui se sont offertes à mon imagination Je prendrai soin qu’avant ma mort mes manuscrits soient remis à l’université de Berlin.
Enfin, mon cher Adelbert, c’est toi que j’ai choisi pour dépositaire de ma merveilleuse histoire, dans laquelle, lorsque j’aurai disparu de dessus la terre, plusieurs de ses habitants pourront trouver encore d’utiles leçons. Quant à toi, mon ami, si tu veux vivre parmi les hommes, apprends à révérer d’abord l’ombre, ensuite l’argent. Mais si tu ne veux vivre que pour toi et ne satisfaire qu’à la noblesse de ton être, tu n’as besoin d’aucun conseil.
Adelbert Von Chamisso,
La merveilleuse histoire de Peter Schlemihl, 1813.
Traduction de 1838, Hippolyte von Chamisso
La merveilleuse histoire de Peter Schlemihl, 1813.
Traduction de 1838, Hippolyte von Chamisso
Et dans le texte allemand
IX. Ich saß da ohne Schatten und ohne Geld; aber ein schweres Gewicht war von meiner Brust genommen, ich war heiter. Hätte ich nicht auch meine Liebe verloren, oder hätt ich mich nur bei deren Verlust vorwurfsfrei gefühlt, ich glaube, ich hätte glücklich sein können – ich wußte aber nicht, was ich anfangen sollte. Ich durchsuchte meine Taschen und fand noch einige Goldstücke darin; ich zählte sie und lachte. – Ich hatte meine Pferde unten im Wirtshause, ich schämte mich, dahin zurückzukehren, ich mußte wenigstens den Untergang der Sonne erwarten; sie stand noch hoch am Himmel. Ich legte mich in den Schatten der nächsten Bäume und schlief ruhig ein.
Anmutige Bilder verwoben sich mir im luftigen Tanze zu einem gefälligen Traum. Mina, einen Blumenkranz in den Haaren, schwebte an mir vorüber, und lächelte mich freundlich an. Auch der ehrliche Bendel war mit Blumen bekränzt, und eilte mit freundlichem Gruße vorüber. Viele sah ich noch, und wie mich dünkt, auch Dich, Chamisso, im fernen Gewühl; ein helles Licht schien, es hatte aber keiner einen Schatten, und was seltsamer ist, es sah nicht übel aus, – Blumen und Lieder, Liebe und Freude, unter Palmenhainen. – – Ich konnte die beweglichen, leicht verwehten, lieblichen Gestalten weder festhalten noch deuten; aber ich weiß, daß ich gerne solchen Traum träumte und mich vor dem Erwachen in acht nahm; ich wachte wirklich schon, und hielt noch die Augen zu, um die weichenden Erscheinungen länger vor meiner Seele zu behalten.
Ich öffnete endlich die Augen, die Sonne stand noch am Himmel, aber im Osten; ich hatte die Nacht verschlafen. Ich nahm es für ein Zeichen, daß ich nicht nach dem Wirtshause zurückkehren sollte. Ich gab leicht, was ich dort noch besaß, verloren, und beschloß, eine Nebenstraße, die durch den waldbewachsenen Fuß des Gebirges führte, zu Fuß einzuschlagen, dem Schicksal es anheim stellend, was es mit mir vorhatte, zu erfüllen. Ich schaute nicht hinter mich zurück, und dachte auch nicht daran, an Bendel, den ich reich zurückgelassen hatte, mich zu wenden, welches ich allerdings gekonnt hätte. Ich sah mich an auf den neuen Charakter, den ich in der Welt bekleiden sollte: mein Anzug war sehr bescheiden. Ich hatte eine alte schwarze Kurtka an, die ich schon in Berlin getragen, und die mir, ich weiß nicht wie, zu dieser Reise erst wieder in die Hand gekommen war. Ich hatte sonst eine Reisemütze auf dem Kopf und ein Paar alte Stiefeln an den Füßen. Ich erhob mich, schnitt mir an selbiger Stelle einen Knotenstock zum Andenken, und trat sogleich meine Wanderung an.
Ich begegnete im Wald einem alten Bauer, der mich freundlich begrüßte, und mit dem ich mich in Gespräch einließ. Ich erkundigte mich, wie ein wißbegieriger Reisender, erst nach dem Wege, dann nach der Gegend und deren Bewohnern, den Erzeugnissen des Gebirges und derlei mehr. Er antwortete verständig und redselig auf meine Fragen. Wir kamen an das Bette eines Bergstromes, der über einen weiten Strich des Waldes seine Verwüstung verbreitet hatte. Mich schauderte innerlich vor dem sonnenhellen Raum; ich ließ den Landmann vorangehen. Er hielt aber mitten im gefährlichen Orte still und wandte sich zu mir, um mir die Geschichte dieser Verwüstung zu erzählen. Er bemerkte bald, was mir fehlte, und hielt mitten in seiner Rede ein: »Aber wie geht denn das zu, der Herr hat ja keinen Schatten!« – »Leider! leider!« erwiderte ich seufzend. »Es sind mir während einer bösen langen Krankheit, Haare, Nägel und Schatten ausgegangen. Seht, Vater, in meinem Alter, die Haare, die ich wieder gekriegt habe, ganz weiß, die Nägel sehr kurz, und der Schatten, der will noch nicht wieder wachsen.« – »Ei! ei!« versetzte der alte Mann kopfschüttelnd, »keinen Schatten, das ist bös! das war eine böse Krankheit, die der Herr gehabt hat.« Aber er hub seine Erzählung nicht wieder an, und bei dem nächsten Querweg, der sich darbot, ging er, ohne ein Wort zu sagen, von mir ab. – Bittere Tränen zitterten aufs neue auf meinen Wangen, und meine Heiterkeit war hin.
Ich setzte traurigen Herzens meinen Weg fort und suchte ferner keines Menschen Gesellschaft. Ich hielt mich im dunkelsten Walde, und mußte manchmal, um über einen Strich, wo die Sonne schien, zu kommen, stundenlang darauf warten, daß mir keines Menschen Auge den Durchgang verbot. Am Abend suchte ich Herberge in den Dörfern zu nehmen. Ich ging eigentlich nach einem Bergwerk im Gebirge, wo ich Arbeit unter der Erde zu finden gedachte; denn, davon abgesehen, daß meine jetzige Lage mir gebot, für meinen Lebensunterhalt selbst zu sorgen, hatte ich dieses wohl erkannt, daß mich allein angestrengte Arbeit gegen meine zerstörenden Gedanken schützen könnte.
Ein paar regnichte Tage förderten mich leicht auf dem Weg, aber auf Kosten meiner Stiefel, deren Sohlen für den Grafen Peter, und nicht für den Fußknecht berechnet worden. Ich ging schon auf den bloßen Füßen. Ich mußte ein Paar neue Stiefel anschaffen. Am nächsten Morgen besorgte ich dieses Geschäft mit vielem Ernst in einem Flecken, wo Kirmeß war, und wo in einer Bude alte und neue Stiefel zu Kauf standen. Ich wählte und handelte lange. Ich mußte auf ein Paar neue, die ich gern gehabt hätte, Verzicht leisten; mich schreckte die unbillige Forderung. Ich begnügte mich also mit alten, die noch gut und stark waren, und die mir der schöne blondlockige Knabe, der die Bude hielt, gegen gleich bare Bezahlung, freundlich lächelnd einhändigte, indem er mir Glück auf den Weg wünschte. Ich zog sie gleich an und ging zum nördlich gelegenen Tor aus dem Ort.
Ich war in meinen Gedanken sehr vertieft, und sah kaum, wo ich den Fuß hinsetzte, denn ich dachte an das Bergwerk, wo ich auf den Abend noch anzulangen hoffte, und wo ich nicht recht wußte, wie ich mich ankündigen sollte. Ich war noch keine zweihundert Schritte gegangen, als ich bemerkte, daß ich aus dem Wege gekommen war; ich sah mich danach um, ich befand mich in einem wüsten, uralten Tannenwalde, woran die Axt nie gelegt worden zu sein schien. Ich drang noch einige Schritte vor, ich sah mich mitten unter öden Felsen, die nur mit Moos und Steinbrecharten bewachsen waren, und zwischen welchen Schnee- und Eisfelder lagen. Die Luft war sehr kalt, ich sah mich um, der Wald war hinter mir verschwunden. Ich machte noch einige Schritte – um mich herrschte die Stille des Todes, unabsehbar dehnte sich das Eis, worauf ich stand, und worauf ein dichter Nebel schwer ruhte; die Sonne stand blutig am Rande des Horizontes. Die Kälte war unerträglich. Ich wußte nicht, wie mir geschehen war, der erstarrende Frost zwang mich, meine Schritte zu beschleunigen, ich vernahm nur das Gebrause ferner Gewässer, ein Schritt, und ich war am Eisufer eines Ozeans. Unzählbare Herden von Seehunden stürzten sich vor mir rauschend in die Flut. Ich folgte diesem Ufer, ich sah wieder nackte Felsen, Land, Birken- und Tannenwälder, ich lief noch ein paar Minuten gerade vor mir hin. Es war erstickend heiß, ich sah mich um, ich stand zwischen schön gebauten Reisfeldern unter Maulbeerbäumen. Ich setzte mich in deren Schatten, ich sah nach meiner Uhr, ich hatte vor nicht einer Viertelstunde den Marktflecken verlassen, – ich glaubte zu träumen, ich biß mich in die Zunge, um mich zu erwecken; aber ich wachte wirklich. – Ich schloß die Augen zu, um meine Gedanken zusammen zu fassen. – Ich hörte vor mir seltsame Sylben durch die Nase zählen; ich blickte auf: zwei Chinesen, an der asiatischen Gesichtsbildung unverkennbar, wenn ich auch ihrer Kleidung keinen Glauben beimessen wollte, redeten mich mit landesüblichen Begrüßungen in ihrer Sprache an; ich stand auf und trat zwei Schritte zurück. Ich sah sie nicht mehr, die Landschaft war ganz verändert: Bäume, Wälder, statt der Reisfelder. Ich betrachtete diese Bäume und die Kräuter, die um mich blühten; die ich kannte, waren südöstlich asiatische Gewächse; ich wollte auf den einen Baum zugehen, ein Schritt – und wiederum alles verändert. Ich trat nun an, wie ein Rekrut, der geübt wird, und schritt langsam, gesetzt einher. Wunderbar veränderliche Länder, Fluren, Auen, Gebirge, Steppen, Sandwüsten, entrollen sich vor meinem staunenden Blick: es war kein Zweifel, ich hatte Siebenmeilenstiefel an den Füßen.
X
Ich fiel in stummer Andacht auf meine Knie und vergoß Tränen des Dankes – denn klar stand plötzlich meine Zukunft vor meiner Seele. Durch frühe Schuld von der menschlichen Gesellschaft ausgeschlossen, ward ich zum Ersatz an die Natur, die ich stets geliebt, gewiesen, die Erde mir zu einem reichen Garten gegeben, das Studium zur Richtung und Kraft meines Lebens, zu ihrem Ziel die Wissenschaft. Es war nicht ein Entschluß, den ich faßte. Ich habe nur seitdem, was da hell und vollendet im Urbild vor mein inneres Auge trat, getreu mit stillem, strengen, unausgesetzten Fleiß darzustellen gesucht, und meine Selbstzufriedenheit hat von dem Zusammenfallen des Dargestellten mit dem Urbild abgehangen.
Ich raffte mich auf, um ohne Zögern mit flüchtigem Überblick Besitz von dem Felde zu nehmen, wo ich künftig ernten wollte. – Ich stand auf den Höhen des Tibet, und die Sonne, die mir vor wenigen Stunden aufgegangen war, neigte sich hier schon am Abendhimmel, ich durchwanderte Asien von Osten gegen Westen, sie in ihrem Lauf einholend, und trat in Afrika ein. Ich sah mich neugierig darin um, indem ich es wiederholt in allen Richtungen durchmaß. Wie ich durch Ägypten die alten Pyramiden und Tempel angaffte, erblickte ich in der Wüste, unfern des hunderttorigen Theben, die Höhlen, wo christliche Einsiedler sonst wohnten. Es stand plötzlich fest und klar in mir, hier ist dein Haus. – Ich erkor eine der verborgensten, die zugleich geräumig, bequem und den Schakalen unzugänglich war, zu meinem künftigen Aufenthalte, und setzte meinen Stab weiter.
Ich trat bei den Herkules-Säulen nach Europa über, und nachdem ich seine südlichen und nördlichen Provinzen in Augenschein genommen, trat ich von Nordasien über den Polarglätscher nach Grönland und Amerika über, durchschweifte die beiden Teile dieses Kontinents, und der Winter, der schon im Süden herrschte, trieb mich schnell vom Kap Horn nordwärts zurück.
Ich verweilte mich, bis es im östlichen Asien Tag wurde, und setzte erst nach einiger Ruh meine Wanderung fort. Ich verfolgte durch beide Amerika die Bergkette, die die höchsten bekannten Unebenheiten unserer Kugel in sich faßt. Ich schritt langsam und vorsichtig von Gipfel zu Gipfel, bald über flammende Vulkane, bald über beschneite Kuppeln, oft mit Mühe atmend, ich erreichte den Eliasberg, und sprang über die Beringstraße nach Asien. – Ich verfolgte dessen westliche Küsten in ihren vielfachen Wendungen, und untersuchte mit besonderer Aufmerksamkeit, welche der dort gelegenen Inseln mir zugänglich wären. Von der Halbinsel Malakka trugen mich meine Stiefel auf Sumatra, Java, Bali und Lamboc, ich versuchte, selbst oft mit Gefahr, und dennoch immer vergebens, mir über die kleinern Inseln und Felsen, wovon dieses Meer starrt, einen Übergang nordwestlich nach Borneo und andern Inseln dieses Archipelagus zu bahnen. Ich mußte die Hoffnung aufgeben. Ich setzte mich endlich auf die äußerste Spitze von Lamboc nieder, und das Gesicht gegen Süden und Osten gewendet, weint ich wie am festverschlossenen Gitter meines Kerkers, daß ich doch so bald meine Begrenzung gefunden. Das merkwürdige, zum Verständnis der Erde und ihres sonnengewirkten Kleides, der Pflanzen- und Tierwelt, so wesentlich notwendige Neuholland und die Südsee mit ihren Zoophyten-Inseln waren mir untersagt, und so war, im Ursprunge schon, alles, was ich sammeln und erbauen sollte, bloßes Fragment zu bleiben verdammt. – O mein Adelbert, was ist es doch um die Bemühungen der Menschen!
Oft habe ich im strengsten Winter der südlichen Halbkugel vom Kap Horn aus jene zweihundert Schritte, die mich etwa vom Land van Diemen und Neuholland trennten, selbst unbekümmert um die Rückkehr, und sollte sich dieses schlechte Land über mich, wie der Deckel meines Sarges, schließen, über den Polarglätscher westwärts zurück zu legen versucht, habe über Treibeis mit törichter Wagnis verzweiflungsvolle Schritte getan, der Kälte und dem Meere Trotz geboten. Umsonst, noch bin ich auf Neuholland nicht gewesen – ich kam dann jedesmal auf Lamboc zurück und setzte mich auf seine äußerste Spitze nieder, und weinte wieder, das Gesicht gen Süden und Osten gewendet, wie am fest verschlossenen Gitter meines Kerkers.
Ich riß mich endlich von dieser Stelle, und trat mit traurigem Herzen wieder in das innere Asien, ich durchschweifte es fürder, die Morgendämmerung nach Westen verfolgend, und kam noch in der Nacht in die Thebais zu meinem vorbestimmten Hause, das ich in den gestrigen Nachmittagsstunden berührt hatte.
Sobald ich etwas ausgeruht und es Tag über Europa war, ließ ich meine erste Sorge sein, alles anzuschaffen, was ich bedurfte. – Zuvörderst Hemmschuhe, denn ich hatte erfahren, wie unbequem es sei, seinen Schritt nicht anders verkürzen zu können, um nahe Gegenstände gemächlich zu untersuchen, als indem man die Stiefel auszieht. Ein Paar Pantoffeln, übergezogen, hatten völlig die Wirkung, die ich mir davon versprach, und späterhin trug ich sogar deren immer zwei Paar bei mir, weil ich öfters welche von den Füßen warf, ohne Zeit zu haben, sie aufzuheben, wenn Löwen, Menschen oder Hyänen mich beim Botanisieren aufschreckten. Meine sehr gute Uhr war auf die kurze Dauer meiner Gänge ein vortreffliches Kronometer. Ich brauchte noch außerdem einen Sextanten, einige physikalische Instrumente und Bücher.
Ich machte, dieses alles herbei zu schaffen, etliche bange Gänge nach London und Paris, die ein mir günstiger Nebel eben beschattete. Als der Rest meines Zaubergoldes erschöpft war, bracht ich leicht zu findendes afrikanisches Elfenbein als Bezahlung herbei, wobei ich freilich die kleinsten Zähne, die meine Kräfte nicht überstiegen, auswählen mußte. Ich ward bald mit allem versehen und ausgerüstet, und ich fing sogleich als privatisierender Gelehrter meine neue Lebensweise an.
Ich streifte auf der Erde umher, bald ihre Höhen, bald die Temperatur ihrer Quellen und die der Luft messend, bald Tiere beobachtend, bald Gewächse untersuchend; ich eilte von dem Äquator nach dem Pole, von der einen Welt nach der andern; Erfahrungen mit Erfahrungen vergleichend. Die Eier der afrikanischen Strauße oder der nördlichen Seevögel und Früchte, besonders der Tropen-Palmen und Bananen, waren meine gewöhnlichste Nahrung. Für mangelndes Glück hatt ich als Surrogat die Nicotiana, und für menschliche Teilnahme und Bande der Liebe eines treuen Pudels, der mir meine Höhle in der Thebais bewachte, und wenn ich mit neuen Schätzen beladen zu ihm zurückkehrte, freudig an mich sprang, und es mich doch menschlich empfinden ließ, daß ich nicht allein auf der Erde sei. Noch sollte mich ein Abenteuer unter die Menschen zurückführen.
XI
Als ich einst auf Nordlands Küsten, meine Stiefel gehemmt, Flechten und Algen sammelte, trat mir unversehens um die Ecke eines Felsens ein Eisbär entgegen. Ich wollte, nach weggeworfenen Pantoffeln, auf eine gegenüber liegende Insel treten, zu der mir ein dazwischen aus den Wellen hervorragender nackter Felsen den Übergang bahnte. Ich trat mit dem einen Fuß auf den Felsen fest auf, und stürzte auf der andern Seite in das Meer, weil mir unbemerkt der Pantoffel am anderen Fuß haften geblieben war.
Die große Kälte ergriff mich, ich rettete mit Mühe mein Leben aus dieser Gefahr; sobald ich Land hielt, lief ich, so schnell ich konnte, nach der Libyschen Wüste, um mich da an der Sonne zu trocknen. Wie ich ihr aber ausgesetzt war, brannte sie mir so heiß auf den Kopf, daß ich sehr krank wieder nach Norden taumelte. Ich suchte durch heftige Bewegung mir Erleichterung zu verschaffen, und lief mit unsichern raschen Schritten von Westen nach Osten und von Osten nach Westen. Ich befand mich bald in dem Tag und bald in der Nacht; bald im Sommer und bald in der Winterkälte.
Ich weiß nicht, wie lange ich mich so auf der Erde herumtaumelte. Ein brennendes Fieber glühte durch meine Adern, ich fühlte mit großer Angst die Besinnung mich verlassen. Noch wollte das Unglück, daß ich bei so unvorsichtigem Laufen jemanden auf den Fuß trat. Ich mochte ihm weh getan haben; ich erhielt einen starken Stoß und ich fiel hin.
Als ich zuerst zum Bewußtsein zurückkehrte, lag ich gemächlich in einem guten Bette, das unter vielen andern Betten in einem geräumigen und schönen Saale stand. Es saß mir jemand zu Häupten; es gingen Menschen durch den Saal von einem Bette zum andern. Sie kamen vor das meine und unterhielten sich von mir. Sie nannten mich aber Numero Zwölf, und an der Wand zu meinen Füßen stand doch ganz gewiß, es war keine Täuschung, ich konnte es deutlich lesen, auf schwarzer Marmortafel mit großen goldenen Buchstaben mein Name
Ich hörte etwas, worin von Peter Schlemihl die Rede war, laut und vernehmlich ablesen, ich konnte aber den Sinn nicht fassen; ich sah einen freundlichen Mann und eine sehr schöne Frau in schwarzer Kleidung vor meinem Bette erscheinen. Die Gestalten waren mir nicht fremd und ich konnte sie nicht erkennen.
Es verging einige Zeit, und ich kam wieder zu Kräften. Ich hieß Numero Zwölf, und Numero Zwölf galt seines langen Bartes wegen für einen Juden, darum er aber nicht minder sorgfältig gepflegt wurde. Daß er keinen Schatten hatte, schien unbemerkt geblieben zu sein. Meine Stiefel befanden sich, wie man mich versicherte, nebst allem, was man bei mir gefunden, als ich hieher gebracht worden, in gutem und sicherm Gewahrsam, um mir nach meiner Genesung wieder zugestellt zu werden. Der Ort, worin ich krank lag, hieß das SCHLEMIHLIUM; was täglich von Peter Schlemihl abgelesen wurde, war eine Ermahnung, für denselben, als den Urheber und Wohltäter dieser Stiftung, zu beten. Der freundliche Mann, den ich an meinem Bette gesehen hatte, war Bendel, die schöne Frau war Mina.
Ich genas unerkannt im Schlemihlio, und erfuhr noch mehr, ich war in Bendels Vaterstadt, wo er aus dem Überrest meines sonst nicht gesegneten Goldes dieses Hospitium, wo Unglückliche mich segneten, unter meinem Namen gestiftet hatte, und er führte über dasselbe die Aufsicht. Mina war Witwe, ein unglücklicher Kriminal-Prozeß hatte dem Herrn Rascal das Leben und ihr selbst ihr mehrstes Vermögen gekostet. Ihre Eltern waren nicht mehr. Sie lebte hier als eine gottesfürchtige Witwe, und übte Werke der Barmherzigkeit.
Sie unterhielt sich einst am Bette Numero Zwölf mit dem Herrn Bendel: »Warum, edle Frau, wollen Sie sich so oft der bösen Luft, die hier herrscht, aussetzen? Sollte denn das Schicksal mit Ihnen so hart sein, daß Sie zu sterben begehrten?« – »Nein, Herr Bendel, seit ich meinen langen Traum ausgeträumt habe, und in mir selber erwacht bin, geht es mir wohl, seitdem wünsche ich nicht mehr und fürchte nicht mehr den Tod. Seitdem denke ich heiter an Vergangenheit und Zukunft. Ist es nicht auch mit stillem innerlichen Glück, daß Sie jetzt auf so gottselige Weise Ihrem Herrn und Freunde dienen?« – »Sei Gott gedankt, ja, edle Frau. Es ist uns doch wundersam ergangen, wir haben viel Wohl und bitteres Weh unbedachtsam aus dem vollen Becher geschlürft. Nun ist er leer; nun möchte einer meinen, das sei alles nur die Probe gewesen, und, mit kluger Einsicht gerüstet, den wirklichen Anfang erwarten. Ein anderer ist nun der wirkliche Anfang, und man wünscht das erste Gaukelspiel nicht zurück, und ist dennoch im ganzen froh, es, wie es war, gelebt zu haben. Auch find ich in mir das Zutrauen, daß es nun unserm alten Freunde besser ergehen muß, als damals.« – »Auch in mir«, erwiderte die schöne Witwe, und sie gingen an mir vorüber.
Dieses Gespräch hatte einen tiefen Eindruck in mir zurückgelassen; aber ich zweifelte im Geiste, ob ich mich zu erkennen geben oder unerkannt von dannen gehen sollte. – Ich entschied mich. Ich ließ mir Papier und Bleistift geben, und schrieb die Worte:
»Auch Eurem alten Freunde ergeht es nun besser als damals, und büßet er, so ist es Buße der Versöhnung.«
Hierauf begehrte ich mich anzuziehen, da ich mich stärker befände. Man holte den Schlüssel zu dem kleinen Schrank, der neben meinem Bette stand, herbei. Ich fand alles, was mir gehörte, darin. Ich legte meine Kleider an, hing meine botanische Kapsel, worin ich mit Freuden meine nordischen Flechten wieder fand, über meine schwarze Kurtka um, zog meine Stiefel an, legte den geschriebenen Zettel auf mein Bett, und so wie die Tür aufging, war ich schon weit auf dem Wege nach der Thebais.
Wie ich längs der syrischen Küste den Weg, auf dem ich mich zum letzten Mal vom Hause entfernt hatte, zurücklegte, sah ich mir meinen armen Figaro entgegen kommen. Dieser vortreffliche Pudel schien seinem Herrn, den er lange zu Hause erwartet haben mochte, auf der Spur nachgehen zu wollen. Ich stand still und rief ihm zu. Er sprang bellend an mich mit tausend rührenden Äußerungen seiner unschuldigen ausgelassenen Freude. Ich nahm ihn unter den Arm, denn freilich konnte er mir nicht folgen, und brachte ihn mit mir wieder nach Hause.
Ich fand dort alles in der alten Ordnung, und kehrte nach und nach, so wie ich wieder Kräfte bekam, zu meinen vormaligen Beschäftigungen und zu meiner alten Lebensweise zurück. Nur daß ich mich ein ganzes Jahr hindurch der mir ganz unzuträglichen Polar-Kälte enthielt.
Und so, mein lieber Chamisso, leb ich noch heute. Meine Stiefel nutzen sich nicht ab, wie das sehr gelehrte Werk des berühmten Tieckius, »De rebus gestis Pollicilli«, es mich anfangs befürchten lassen. Ihre Kraft bleibt ungebrochen; nur meine Kraft geht dahin, doch hab ich den Trost, sie an einen Zweck in fortgesetzter Richtung und nicht fruchtlos verwendet zu haben. Ich habe, so weit meine Stiefel gereicht, die Erde, ihre Gestaltung, ihre Höhen, ihre Temperatur, ihre Atmosphäre in ihrem Wechsel, die Erscheinungen ihrer magnetischen Kraft, das Leben auf ihr, besonders im Pflanzenreiche, gründlicher kennen gelernt, als vor mir irgend ein Mensch. Ich habe die Tatsachen mit möglichstes Genauigkeit in klarer Ordnung aufgestellt in mehrern Werken, meine Folgerungen und Ansichten flüchtig in einigen Abhandlungen niedergelegt. – Ich habe die Geographie vom Innern von Afrika und von den nördlichen Polarländern, vom Innern von Asien und von seinen östlichen Küsten, festgesetzt. Meine »Historia stirpium plantarum utriusque orbis« steht da als ein großes Fragment der Flora universalis terrae, und als ein Glied meines Systema naturae. Ich glaube darin nicht bloß die Zahl der bekannten Arten müßig um mehr als ein Drittel vermehrt zu haben, sondern auch etwas für das natürliche System und für die Geographie der Pflanzen getan zu haben. Ich arbeite jetzt fleißig an meiner Fauna. Ich werde Sorge tragen, daß vor meinem Tode meine Manuskripte bei der Berliner Universität niedergelegt werden.
Und Dich, mein lieber Chamisso, hab ich zum Bewahrer meiner wundersamen Geschichte erkoren, auf daß sie vielleicht, wenn ich von der Erde verschwunden bin, manchen ihrer Bewohner zur nützlichen Lehre gereichen könne. Du aber, mein Freund, willst Du unter den Menschen leben, so lerne verehren zuvörderst den Schatten, sodann das Geld. Willst Du nur Dir und Deinem bessern Selbst leben, o so brauchst Du keinen Rat.
Adelbert von Chamisso,
Peter Schlemihls wundersame Geschichte, 1813.
Peter Schlemihls wundersame Geschichte, 1813.
Réflexions sur l'œuvre de Nicole Tran Ba vang Portrait de famille : Bertrand, Catherine, Amélie et Louise, 2013.
COLLECTION DES CURIOSITÉS
Du corps au décor(ps)
Prises de vue : Bertrand, Catherine, Amélie et Louise, capturés, se désintègrent pour se figer en parcelles miroitantes. Enchevêtrements d'amas colorés personnifiés par des prénoms appartenant à chacun des membres d’une famille, c’est le portrait de la famille. Aucune figure n'est représentée, essentiellement le traitement coloré de la surface organique, de la chair cellulaire comme substance malléable à souhait. Le corps se réduit alors à un artifice, un objet dans toute l'œuvre de Tran Ba Vang. Ses êtres photographiés sont limités à leur superficialité, à leur surface épidermique tel un habit de chair qui dévoile le fantasme actuel d'un corps sur mesure. Pouvoir programmer et définir son corps et sa famille selon ses propres envies, cela fait partie des désirs de notre société contemporaine. L'artiste nous offre ici sa vision actuelle du portrait : des cellules au microscope transformées en une matière artificielle. Le portrait de famille devient une constellation biologique en pleine mutation esthétisée en un véritable motif abstrait et pictural. Chaque membre de la famille est représenté dans sa morphogénèse comme les touches brillantes et colorées d'une peinture abstraite ou d'une tapisserie décorative en « all over ». La famille se décline ainsi en un nuancier de couleurs pastels, échantillons irisés semblables à des palettes de maquillage. Bertrand, Catherine, Amélie et Louise sont devenus de véritables accessoires sans personnalité propre. Les portraits sont alors réduits à une trame cellulaire éclatante.
Entre chair et lumière
Dans cet essor de la chirurgie esthétique, le corps humain apparaît aujourd’hui comme une image que l'on peut rectifier et remodeler à sa guise. Le culte du corps et de son apparence est tellement puissant que nous pourrons un jour programmer nos cellules selon notre volonté. Imprégnée par cette culture, Tran ba Vang se sert du corps comme modèle photographique pour le transformer virtuellement dans sa chair. La couleur-lumière des pixels est numériquement malléable à volonté. Les retouches numériques sont encore possibles dans ces portraits virtuels de famille. Bertrand, Catherine, Amélie et Louise sont à l'état génétique perfectible à l'infini. La virtualité du corps passe ici par ce réseau de fragments humains connectables. Toute sa série photographique des « Coutures cellulaires » (1999-2000) reflète aussi un corps remodelé, recomposé comme une mosaïque mouvante et élastique à l'infini. La peau de l'être prénommé se tord, s'étire et se retourne sur elle-même comme un matériau ectoplasmique. Dans ce milieu cristallin et aquatique, les germes chromatiques créent des réseaux veineux et des vaisseaux sanguins qui s'entremêlent. La trame organique de ces portraits est accentuée par ces touches de couleurs rougies de sang qui rappelle les profondeurs de l’être de chair que nous sommes. Cette vision intérieure révèle un corps réduit à sa simple matérialisation digitale codée.. La chair est ici approchée comme une peau malléable, une peau humaine synthétique et virtuelle sujette à des manipulations chirurgicales. Le terme « chair » se rapporte aussi à l'homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité. Ces compositions colorées prénommées renvoient ainsi aux problématiques liées à la technologie et à la science : le corps peut-il être cloné, génétiquement modifiable et perfectible ?
La traversée du tissu lumineux
C’est ainsi que sur et avec le fil de l’organique et du numérique, l’artiste brode le tissu écranique qui se fait épidermique. L'artiste approche visuellement le corps de ses modèles dans ses parties les plus intimes jusqu’à l’abstraction et la sublimation de l’être en éclats lumineux. Le grain de peau est traversé jusqu'aux tissus cellulaires. Le spectateur peut s’immiscer dans les interstices d’une réalité composite mi-image, mi-substance. Le canevas de couleurs-lumières déstabilise et crée une sorte de passage vers un espace élémentaire. En pénétrant les strates du visible et du visuel, Tran Ba Vang s'attache aux profondeurs de l’image, du portrait de soi, du macroscopique vers le microscopique. Ses portraits s'animent de couleurs et de formes parcellaires. L'œil a percé la vie intime des éléments dans une micro-analyse ou chirurgie de l’image, dans ce désir de gratter le vernis des peaux visuelles afin d’aller jusqu’au cœur analytique des choses. L'artiste soulève l’idée d’une chair numérique et digitale comme épiderme et derme de l’image sur le fil d’un entre deux, entre surface et profondeur, entre l’extérieur, la peau et l’intérieur, l’inconnu comme possible virtuel. Cet aspect cellulaire et vivant rejoint la dimension numérique et pulsationnelle des bits et des pixels contenue dans la matrice mathématique d’un ordinateur. Cette substance numérique quasi organique symbolise la véritable matrice charnelle qui figure un état primitif de l’image, un état de celle-ci avant sa réalisation en tant qu’apparence lumineuse.
Vers des portraits virtuels
Dans le domaine des arts plastiques, l’image peut se définir comme un tout composé de formes et de couleurs en un certain ordre assemblées. De même, dans les arts visuels, l'image numérique reste une image composée d'un certain nombre d'éléments discontinus et déterminés numériquement totalement maîtrisables. L’image numériquement codée rompt définitivement avec son passé pour changer radicalement de nature, quittant l’ordre de la représentation pour entrer dans celui de la simulation. Elle n’est plus témoin de «ce qui a été», elle ne matérialise plus un apparaître immédiat* comme dans la photographie analogique. La pratique photographique de Tran Ba Vang questionne sur cette infinité de possibles. Les technologies numériques offrent ainsi aux créations contemporaines une nouvelle esthétique propre à l’image virtuelle que Jacques Lafon, esthéticien et spécialiste de l’image de synthèse, définit dans son ouvrage Esthétique de l’image de synthèse : « Ailleurs, les grains de lumière, les pixels plans de l’écran, se gonflaient par la profondeur en de menus polyèdres imperceptibles mais présents (...). Sa chair prise dans celle du monde s’offrait au regard afin de dissoudre la raison pure du modèle dans le tissu vaporeux du sensible »*. L’artiste peut ainsi expérimenter un éventail riche de paradoxes et d’ambiguïtés dans sa démarche créatrice.
Jusqu'aux figures digitales
Le portrait mis en image n'est plus ici la représentation humaine et réelle d'un homme ou d'une femme, de Louise, Amélie, Catherine ou Bertrand comme tel était le cas dans l'histoire du portrait en peinture. Dorian Gray ne peut plus contempler sa jeunesse éternelle. Il est vidé de son enveloppe charnelle jusqu'à ses tissus cellulaires. Ce portrait de famille ne figure personne, il n'a plus la finalité de perpétuer le souvenir visuel d'une personne reconnaissable. L'humain est ici représenté comme un magma teinté de liants artificiels. C'est une figure digitale, une image retouchée. La représentation numérique de l'être est saisie par un certain degré d’abstraction qui transmue le corps particulier en stigmates qui se laissent décrypter comme les témoins du processus de sa fabrication. Cette série « Portrait de famille » nous interroge ainsi sur la condition actuelle de l'homme, sur la perte de son identité dans une société devenue trop aseptisée, technologique et uniformisante avec ses stéréotypes qui annihilent tout individualisme. Ces portraits sans expression et représentation se ressemblent et annulent toute possibilité d’identification. Louise, Amélie, Catherine et Bertrand volent en éclats et se dissolvent dans un monde où tout se surveille et se paramètre dans un souci de perfection omniprésent.
Sandrine Maurial
Éclats virtuels entre matière et lumière
écrit pour Le Lampadaire,
2013 ©
Éclats virtuels entre matière et lumière
écrit pour Le Lampadaire,
2013 ©
*Roland Barthes, La chambre claire : notes sur la photographie, Gallimard/Le Seuil, Paris, 1980.
*Jacques Lafon, Esthétique de l’image de synthèse. La trace de l’ange, L’Harmattan, Paris, 1999, p. 216.
Voir Bertrand, Catherine, Amélie et Louise sur le site du Lampadaire et repérer leur présence en lisant ceci.
un extrait de Beckett
COLLECTION DES CURIOSITÉS
Oui, j’ai été mon père, et j’ai été mon fils, et je me suis posé des questions et j’ai répondu de mon mieux, je me suis fait redire, soir après soir, la même histoire, que je savais par cœur sans pouvoir y croire, ou nous marchions, nous tenant par la main, muets, plongés dans nos mondes, chacun dans ses mondes, mains oubliées, l’une dans l’autre. C’est comme ça que j’ai tenu, jusqu’à l’heure présente. Et encore ce soir, ça a l’air d’aller, je suis dans mes bras, je me tiens dans mes bras, sans beaucoup de tendresse, mais fidèlement, fidèlement.
Beckett, Textes pour rien, 1955.
SUR L'ERRANCE
Maxence Van Der Meersch,Quand les sirènes se taisent extrait du chapitre 1,
COLLECTION DES CURIOSITÉS
Des fils de fer, en réseau dense, formaient à travers toute la courée, à deux mètres du sol, comme une nappe serrée. La lessive du samedi y pendait, un étalage de hardes pauvres et multicolores que gonflait le vent. En se baissant, Laure alla jusqu’au milieu de la cour, aux « communs ». Là étaient la pompe et le cabinet uniques, qui servaient pour tous les locataires. Laure pompa un peu d’eau, s’en aspergea la face, se sentit revigorée. Mais elle n’osait pas encore rentrer à la maison, l’idée seule de cette odeur de hareng et de chiffon brûlé la rendait malade, de nouveau. Elle traversa la cour, alla frapper à la dernière porte, tout près du couloir de sortie, là où les brise-bise blancs attiraient le regard. Et la vieille Elise vint lui ouvrir et la fit entrer.
Maxence Van Der Meersch,
Quand les sirènes se taisent, 1933
Quand les sirènes se taisent, 1933
Les larmes d'Augustin
COLLECTION DES CURIOSITÉS
Livre III, chapitre 3
Livre III, chapitre 4
Livre IV, chapitre 9
Livre IV, chapitre 10
J'étais captivé par le théâtre, ses représentations étaient remplies des images de mon malheur et du combustible de mes passions.
Mais comment l’homme peut-il vouloir souffrir au spectacle de chagrins et de tragédies dont il ne voudrait pas pour lui-même ? Pourtant, comme spectateur, il veut souffrir de cette douleur représentée, et jouir de cette souffrance. Folie étonnante, n’est-ce pas ? Chacun est d’autant plus ému qu’il est personnellement plus exposé à de tels sentiments. Et, comme l’on dit, souffrir soi- même, c’est être malheureux ; compatir, c’est avoir pitié. Mais où est cette pitié dans les fictions de la scène ? On ne demande pas au spectateur de se porter au secours, on l’invite simplement à souffrir. Et on applaudira d’autant plus l’auteur de ces fictions qu’il nous aura fait davantage souffrir. Si ces drames humains, imaginaires ou inspirés de notre histoire ancienne, sont représentés sans faire souffrir le spectateur, c’est l’échec assuré, l’écœurement et les critiques. Mais à l’inverse, si le spectateur souffre, il est captivé et heureux.
Oui, nous aimons les larmes et la souffrance.
Tout le monde préfère, bien sûr, être gai. Mais si on ne trouve jamais du plaisir à son propre malheur, nous en avons, en revanche, quand nous avons pitié, même si cela ne va jamais sans souffrir un peu. N’est-ce pas pourquoi alors nous aimerions souffrir ?
Tout vient de ce flux de l’amitié. Mais où va-t-il ? où coule-t-il ? pourquoi dévale-t-il comme un torrent de poix bouillante dans l’immense mer houleuse de nos sombres envies où il se métamorphose et se transforme volontairement, se détourne et déchoit de la transparence céleste ?
Il faudrait chasser la pitié. Non, non.
Aimer la souffrance ? Oui, parfois.
Mon âme
protège-toi des ordures
avec l’aide de mon Dieu
Dieu de nos pères
célébré toujours vanté
protège-toi des ordures
Encore aujourd’hui, il m’arrive d’avoir pitié. Mais, à l’époque, au théâtre, j’ai partagé la joie des amants quand ils jouissaient abjectement l’un de l’autre, quel que fût le degré imaginaire de leurs actes dans les jeux scéniques. Et quand, au contraire, ils renonçaient l’un à l’autre, j’ai compati en quelque sorte à leur tristesse. Dans les deux cas, j'ai pris du plaisir.
Aujourd’hui, j’ai plus de pitié pour celui qui tire son plaisir de sa propre abjection que pour celui qui souffre d’être frustré d’une volupté malsaine ou d’un misérable bonheur. La pitié est d’autant plus authentique qu’elle ne prend plaisir à aucune souffrance. On approuve le commandement de l’amour : plaindre le malheur d’autrui. Mais pour qui cède à la pitié, il est préférable, bien sûr, de ne pas en souffrir. Oui, car s’il existait quelque chose comme une bienveillance malveillante, il serait alors possible que celui qui s’apitoie véritablement, sincèrement, en vienne à souhaiter l’existence d’êtres malheureux pour avoir à les plaindre.
On peut comprendre une douleur mais on ne doit en aimer aucune.
et toi Seigneur Dieu
tu nous aimes
amour large et profond
plus pur que le nôtre
plus incorruptible
aucune douleur ne te déchire
Mais qui en est capable ?
Moi, en ce temps-là, j’étais malheureux. J’aimais souffrir et je réclamais de quoi souffrir.
La pantomime des misères fictives d’autrui devait me tirer les larmes pour que j’apprécie le jeu de l’acteur et être bouleversé. Quoi d’étonnant ? Pauvre brebis qui erre loin du troupeau, qui trouve insupportable ta prison, j’étais ravagé d’une gale immonde. D’où mon amour des souffrances – non pas celles capables de me pénétrer en profondeur car je n’aurais pas aimé avoir à endurer celles dont j’aimais le spectacle – mais des souffrances représentées et racontées qui ne pouvaient que m’égratigner en surface. Et pourtant, comme les ongles quand on se gratte, elles provoquaient inflammations, tumeurs, abcès et pus repoussants.
C’était ma vie. Mais était-ce la vie, mon Dieu ?
Cette douleur a noirci mon cœur.
Dans tous mes regards, il y avait la mort. La patrie était mon supplice et la maison paternelle un étrange malheur. Tout ce que j’avais eu en commun avec lui se retournait sans lui en torture monstrueuse. Mes yeux le réclamaient partout et on ne me le donnait pas. Je haïssais tout parce que tout était privé de lui et que rien autour de moi ne pouvait plus me dire : le voici, il arrive, comme de son vivant quand il était absent. J’étais pour moi-même une grande question et j’interrogeais mon âme, pourquoi sa tristesse, pourquoi tant d’effroi. Elle ne savait rien me répondre. Si je lui disais : espère en Dieu, très justement elle n’obéissait pas parce que l’homme si cher qu’elle avait perdu était plus vrai et meilleur que le fantasme en qui on lui donnait l’ordre d’espérer. Seuls les pleurs m’étaient doux et avaient pris la place de mon ami dans les plaisirs de mon cœur.
Maintenant, Seigneur, c'est déjà loin. Avec le temps, ma blessure s'est calmée.
Est-ce que je peux t'écouter, toi, qui es vérité, et approcher de ta bouche l'oreille de mon cœur pour que tu m'expliques pourquoi les pleurs sont doux aux malheureux ? et pourquoi, alors que tu es là partout, tu as rejeté loin de toi notre malheur, pourquoi tu persistes à rester en toi quand nous sommes le jouet des malheurs ?
Pourtant, si nous ne pleurons pas à tes oreilles, il ne resterait plus rien de notre espoir.
D'où vient que l'on arrache à l'amertume de la vie ce fruit savoureux : gémir, pleurer, soupirer et se plaindre ?
La douceur viendrait de l'espoir que nous avons de t'entendre ? Comme dans le cas des vœux que l'on veut voir se réaliser. Mais dans la douleur de la perte et du deuil, dans laquelle j'étais alors enseveli, je ne pouvais pas espérer qu'il revienne à la vie. Mes larmes ne le demandaient pas mais je souffrais tellement que je pleurais.
Oui, j'étais malheureux. J'avais perdu ma joie.
Les pleurs, qui sont une chose amère, feraient-ils alors nos délices par dégoût des mêmes choses qui faisaient autrefois notre jouissance et aujourd'hui notre répulsion ?
Saint-Augustin
Les Aveux
traduction de Frédéric Boyer
© P.O.L, coll. « #formatpoche », 2013.
Les Aveux
traduction de Frédéric Boyer
© P.O.L, coll. « #formatpoche », 2013.
Livre III, chapitre 2
Publié avec l'aimable autorisation de P.O.L
SUR L'ATTENTE
Journal de cellule
COLLECTION DES CURIOSITÉS
Maintenant donc, essayez d'entrer dans cette cellule et de vous figurer pendant quelques secondes le malheur que subit un captif durant des milliers d'heures. Pensez simplement à une chambre dont vous ne pouvez pas ouvrir la porte et dont la fenêtre ne vous laisse pas voir un centimètre de ciel : des murs gris fer, qu'on ne peut toucher sans retirer sa main noire de poussière, une paillasse infecte et tout écrasée sur la dalle de ciment, un seau et, pour toute compagnie, des punaises par milliers qu'on s'occupe à écraser avec soin chaque jour sans qu'elles diminuent jamais. Nous sommes, disons le 15 janvier. Vous êtes là si tout va pour le mieux jusqu'au 15 juin: 150 jours. Peut-être trois fois moins, ou trois fois plus. Que sais-je? Mais ce chiffre, ces dates ne signifient rien. C'est comme des chiffres astronomiques, des années-lumière. Qu'est-ce que 40 jours, 150 jours, 400 jours, quand la minute présente ne passe pas, quand l'heure présente n'a pas de fin, quand la journée est infiniment déserte ? Il faut tenter de vivre dans ces cinq mètres carrés (1m.80 sur 2m.80). Mais vivre de quoi, vivre avec quoi, vivre pourquoi ? Qu'est-ce que vivre? Et que sera la vie d'un captif enfermé dans sa cellule sinon l'attente insensée, l'attente obsédante du jour où la vie lui sera rendue, du jour où il pourra vivre. La vie d'un prisonnier n'est strictement plus que l'attente de la vie. Encore si l'attente était certaine, s'il pouvait être assuré de retrouver la vie un jour, s'il était condamné à passer là trois mois six mois, un an même, cela serait dur assurément, mais cela serait plus supportable. Si lointain serait le but, on s'acheminerait vers lui jour après jour. On verrait diminuer lentement la chaîne qui vous retient. Si l'on pouvait savoir! Si l'attente pouvait être pleine et sûre! Mais c'est ici qu'intervient la torture qu'inflige l'ordre nouveau à tous ses détenus : Ils ne savent pas s'ils sortiront le lendemain, ou dans deux ans, ou jamais. Tout peut leur arriver à tout instant. Ils peuvent être fusillés comme otages. Ils peuvent être condamnés à mort et exécutés, ils peuvent être libérés par on ne sait quelle intervention, ils peuvent être déportés en Allemagne ou en Pologne. Ils peuvent mourir fusillés en masses lors d'une évacuation rapide, ou encore lors d'une épidémie ou d'un bombardement. Tout est possible. Rien n'est certain. La fin de la guerre représente en tout cas pour la plupart l'échéance la plus rapprochée de leur captivité (c'était mon cas). La fin de la guerre! (Nous en sommes tous là il est vrai, et c'est un lieu commun de dire que nous ne savons pas si nous vivrons demain. Mais tout autre est la portée de cette incertitude pour l'homme qui ne peut vivre de rien d'autre.) Ils sont donc gardés là indéfiniment, ils ne savent pas si c'est pour la mort ou pour la vie. Ils ne peuvent qu'attendre, mais voici qu'il est possible que cette attente soit vaine et qu'il n'y ait rien à attendre, qu'il y ait la mort au bout de cette attente. Pensez à ce que peut être l'état du cœur d'un homme qui ne peut battre que dans l'attente de la vie lorsqu'elle se change en attente de la mort. Que devient le cœur d'un homme qui ne peut qu'attendre, au moment où il réalise qu'il est inutile d'attendre quoi que ce soit? Cet homme, alors, entre dans le désespoir. Il descend tout vivant dans le séjour des morts où le temps qui passe ne mène plus à rien. Ou plutôt c'est comme si le temps ne passait plus et que tout se pétrifiait dans une immobilité éternelle. On s'en rendra compte dans les notes qui suivent : La captivité a l'avantage de simplifier à l'extrême toutes les questions, de les éliminer même parfaitement sauf une, une seule et unique: celle du combat de l'espérance et du désespoir. Certes il ne s'agit pas d'un désespoir philosophique ou romantique. Quand le désespoir s'empare d'un captif, il ne fait pas de manière, il n'a pas besoin de se gêner et de se faire passer pour une doctrine intéressante, mais il bondit sur lui de la manière la plus sommaire, la plus brutale, comme le bandit caché dans un fourré, et il l'étrangle lentement avec une jouissance horrible, avec le ricanement de l'enfer. C'est le démon en personne. Il ne se déguise pas en ange de lumière. Il est plutôt le lion rugissant dont parle Pierre, qui s'est jeté sur vous à l'improviste et qui vous dévore tout vivant, qui vous dévore indéfiniment comme le vautour de Prométhée. Il n'y a là aucune spéculation, aucune tricherie. Quand même il aurait rêvé d'être un jour en prison et désiré faire cette expérience, dès les premières heures de sa solitude en cellule, le captif aura découvert ce compagnon infernal dont il ne pourra plus que vouloir se débarrasser sans jamais y parvenir. C'est contre lui, contre ce personnage embusqué derrière chacune des minutes de sa captivité qu'il lui faudra tenir du matin au soir, et souvent du soir au matin, et le lendemain, et la nuit suivante, et le surlendemain ... Toujours se battre! sans trêve ni armistice possibles, contre le fantôme du désespoir. Si encore c'était contre la mort, ce serait tout autre chose. L'explorateur, le soldat, l'aviateur, le prisonnier qui s'évade, côtoient sans doute la mort de plus près que l'homme dans sa cellule, mais ils sont en pleine action, ils sont tendus vers un but concret qui est justement d'échapper à la mort et il y a pour eux toujours quelque chose à faire encore qui les rapproche de ce but. Mais l'homme en cellule ne connaît rien d'une telle action, d'une telle lutte qui serait déjà en elle-même pour lui une véritable délivrance. Il est là purement passif, ne pouvant combattre pour s'arracher à la mort, mais obligé de combattre sans fin pour s'arracher au désespoir qu'alimentent en lui continuellement l'incertitude d'en sort qui n'ont à rendre compte à personne de leurs actes et qui peuvent faire de lui exactement ce qu'ils veulent.
Roland de Pury,
Journal de cellule, extrait
1944 (éd. La Guilde du Livre, Lausanne)
Journal de cellule, extrait
1944 (éd. La Guilde du Livre, Lausanne)
N.B. Les éditions de la Guilde du livre n'existent plus, nous n'avons pas trouvé comment contacter les ayants droits de Roland de Pury, nous espérons qu'ils seront d'accord avec cette publication. Sinon qu'ils nous le fassent savoir, nous retirerons cet extrait du site du Lampadaire.
Ecrits sur la mort de Nerval
COLLECTION DES
CURIOSITÉS
LE RÉVERBÈRE DE NERVAL
Ecrits sur la mort de Nerval
CURIOSITÉS
«Alors la rue se rétrécit. On lit en grosses lettres sur un mur en face : BAINS DE GESVRES et au dessous : BONDET (sic) entrepreneur de serrurerie. Au pied du mur sur lequel sont inscrites ces deux affiches, commence un escalier avec une rampe de fer. Escalier visqueux, étroit, sinistre, un prolongement de la rue conduit à la boutique d'un serrurier qui a pour enseigne une grosse clé peinte en jaune.(...)dans l'obscurité au fond, vous découvrez une fenêtre cintrée avec des barreaux de fer pareils à ceux qui grillent les fenêtres des prisons. Vous y êtes, c'est à ce croisillon de fer que le lacet était attaché. Un lacet blanc comme ceux dont on fait des cordons de tablier. (...) C'est là, les pieds distants de cette marche de deux pouces à peine que le vendredi 26 janvier 1855 au matin, à sept heures trois minutes, juste au moment où se lève cette aube glaciale des nuits d'hiver que l'on a trouvé le corps de Gérard encore chaud et ayant son chapeau sur la tête.(...)Les gens qui les premiers le virent, n'osèrent pas le détacher, quoique l'un d'eux fit observer qu'il n'était pas mort puisqu'il bougeait encore la main (...) On alla chercher le commissaire de police, M. Blanchet, et un médecin dont j'ignore le nom. Le corps était encore chaud. Le médecin pratiqua une saignée, le sang vint; mais Gérard ne rouvrit pas les yeux. Nous allâmes de la rue de la Vieille Lanterne à la morgue où le corps avait été déposé. De l'endroit où Gérard s'était pendu, jusqu'à la morgue, il n'y avait qu'un pas.»
A. Dumas,
Nouveaux Mémoires : Sur Gérard de Nerval, 1866.
Nouveaux Mémoires : Sur Gérard de Nerval, 1866.
En savoir plus : http://www.paperblog.fr/4028005/sur-la-mort-de-gerard-de-nerval-rue-de-la-vieille-lanterne/#QPSqKcoMxQJqXM2x.99
REGISTRE DE LA MORGUE : «Arrivée du corps à 9 heures et demie du matin de Labrunie Gérard dit Nerval, demeurant 13 rue des Bons-Enfants; vêtements et objets : un habit noir, deux chemises en calicot, deux gilets de flanelle, un pantalon en drap gris vert, des souliers vernis, des chaussettes en coton roux, des guêtres de drap gris, un col noir en soie, un chapeau noir, un mouchoir blanc. Genre de mort : suspension (...) suicide; cause inconnue (...) cadavre trouvé sur la voie publique rue de la Vieille-Lanterne (...) cet homme était connu avant son entrée à la Morgue (..) le corps a été réclamé par la Société des Gens de Lettres (...). Procès-verbal du commissariat de police de Saint-Merri : «Ce matin, à sept heures et demie (26 janvier 1855) le dénommé (...) a été trouvé pendu aux barreaux (à l'enseigne) de la boutique d'un serrurier (Boudet) rue de la Vieille Lanterne, déclaration de Laurent, sergent de ville du quatrième arrondissement; l'individu était déjà mort, transporté au poste de l'Hôtel de Ville, secouru par deux médecins, mais en vain. Il s'est pendu avec un ruban de fil, son corps était attaché aux barreaux avec le lien, aucune trace de violence sur le cadavre.»
En savoir plus : http://www.paperblog.fr/4028005/sur-la-mort-de-gerard-de-nerval-rue-de-la-vieille-lanterne/#QPSqKcoMxQJqXM2x.99
«« Les morts vont vite par le frais! » dit Bürger dans sa ballade de Lenore, si bien traduite par Gérard de Nerval ; mais ils ne vont pas tellement vite, les morts aimés, qu’on ne se souvienne longtemps de leur passage à l’horizon, où, sur la lune large et ronde, se dessinait fantastiquement leur fugitive silhouette noire.
Voilà bientôt douze ans que, par un triste matin de janvier, se répandit dans Paris la sinistre nouvelle. Aux premières lueurs d’une aube grise et froide, un corps avait été trouvé, rue de la Vieille-Lanterne, pendu aux barreaux d’un soupirail, devant la grille d’un égout, sur les marches d’un escalier où sautillait lugubrement un corbeau familier qui semblait croasser, comme le corbeau d’Edgar Poe : Never, oh! never more! Ce corps, c’était celui de Gérard de Nerval, notre ami d’enfance et de collège, notre collaborateur à La Presse et le compagnon fidèle de nos bons et surtout de nos mauvais jours, qu’il nous fallut, éperdu, les yeux troublés de larmes, aller reconnaître sur la dalle visqueuse dans l’arrière-chambre de la Morgue. Nous étions aussi pâles que le cadavre, et, au simple souvenir de cette entrevue funèbre, le frisson nous court encore sur la peau.
Le pic des démolisseurs a fait justice de cet endroit infâme qui appelait l’assassinat et le suicide. La rue de la Vieille-Lanterne n’existe plus que dans le dessin de Gustave Doré et la lithographie de Célestin Nanteuil, noir chef-d’œuvre qui ferait dire : « L’horrible est beau »; mais la perte douloureuse est restée dans toutes les mémoires, et nul n’a oublié ce bon Gérard, comme chacun le nommait, qui n’a causé d’autre chagrin à ses amis que celui de sa mort.»
Théophile Gautier,
« Portraits et souvenirs littéraires. Gérard de Nerval », in L’univers illustré, 1867
« Portraits et souvenirs littéraires. Gérard de Nerval », in L’univers illustré, 1867
« La rue de la Vieille-Lanterne réveille dans toute sa douleur un souvenir poignant. — Oui, voilà bien la noire coupure entre les hautes maisons lépreuses, la grille de l’égout, sinistre comme un soupirail d’enfer, l’escalier aux marches calleuses, le barreau rouillé où pend un reste de lacet tout ce sombre poème de fétidité et d’horreur, ce théâtre préparé pour les drames du désespoir, ce coupe-gorge du vieux Paris conservé comme par fatalité au milieu des splendeurs de la civilisation, et qui, Dieu merci ! a disparu. C’est bien ainsi qu’un froid matin de janvier, piétinant la neige suie, nous la vîmes, l’abominable rue ! témoin d’une agonie solitaire. Au fond de l’étroite fissure, un pâle rayon faisait luire, sur la place du Châtelet, la Renommée d’or de la fontaine comme un vague symbole de gloire. — Seulement, détail effroyable et sinistre que M. A. de Beaulieu n’a pas connu ou qu’il a volontairement omis, sur la plate-forme de l’escalier voletait et sautillait en sa sombre livrée de croquemort un corbeau privé, dont le croassement lugubre semblait adresser au suicide un appel qui fut entendu, hélas ! Qui sait si le noir plumage de l’oiseau, son cri funèbre, le nom patibulaire de la rue, l’aspect épouvantable du lieu, ne parurent pas, à cet esprit depuis si longtemps en proie au rêve, former des concordances cabalistiques et déterminantes, et si, dans l’âpre sifflement de la bise d’hiver, il ne crut pas entendre une voix chuchoter : C’est là !... »
Théophile Gautier
in L’Artiste, 1859, à propos d’un tableau de M. de Beaulieu exposé en 1859
in L’Artiste, 1859, à propos d’un tableau de M. de Beaulieu exposé en 1859
Ulysse retenu
COLLECTION DES CURIOSITÉS
Chant 10
Eôs sortait du lit de l'illustre Tithôn, afin de porter la lumière aux Immortels et aux mortels. Et les Dieux étaient assis en conseil, et au milieu d'eux était Zeus qui tonne dans les hauteurs et dont la puissance est la plus grande. Et Athènaiè leur rappelait les nombreuses traverses d'Odysseus. Et elle se souvenait de lui avec tristesse parce qu'il était retenu dans les demeures d'une Nymphe :
— Père Zeus, et vous, Dieux heureux qui vivez toujours, craignez qu'un roi Porte-Sceptre ne soit plus jamais ni doux, ni clément, mais que, loin d'avoir des pensées équitables, il soit dur et injuste, si nul ne se souvient du divin Odysseus parmi ceux sur lesquels il a régné comme un père plein de douceur. Voici qu'il est étendu, subissant des peines cruelles, dans l'île et dans les demeures de la Nymphe Kalypsô qui le retient de force, et il ne peut retourner dans la terre de la patrie, car il n'a ni nefs armées d'avirons, ni compagnons, qui puissent le conduire sur le vaste dos de la mer. Et voici maintenant qu'on veut tuer son fils bien-aimé à son retour dans ses demeures, car il est parti, afin de s'informer de son père, pour la divine Pylos et l'illustre Lakédaimôn.
Zeus qui amasse les nuées lui répondit :
— Mon enfant, quelle parole s'est échappée d'entre tes dents ? N'as-tu point délibéré toi-même dans ton esprit pour qu'Odysseus revînt et se vengeât ? Conduis Tèlémakhos avec soin, car tu le peux, afin qu'il retourne sain et sauf dans la terre de la patrie, et les Prétendants reviendront sur leur nef.
Il parla ainsi, et il dit à Herméias, son cher fils :
— Herméias, qui es le messager des Dieux, va dire à la Nymphe aux beaux cheveux que nous avons résolu le retour d'Odysseus. Qu'elle le laisse partir. Sans qu'aucun Dieu ou qu'aucun homme mortel le conduise, sur un radeau uni par des liens, seul, et subissant de nouvelles douleurs, il parviendra le vingtième jour à la fertile Skhériè, terre des Phaiakiens qui descendent des Dieux. Et les Phaiakiens, dans leur esprit, l'honoreront comme un Dieu, et ils le renverront sur une nef dans la chère terre de la patrie, et ils lui donneront en abondance de l'airain, de l'or et des vêtements, de sorte qu'Odysseus n'en eût point rapporté autant de Troiè, s'il était revenu sain et sauf, ayant reçu sa part du butin. Ainsi sa destinée est de revoir ses amis et de rentrer dans sa haute demeure et dans la terre de la patrie.
Il parla ainsi, et le Messager tueur d'Argos obéit. Et il attacha aussitôt à ses pieds de belles sandales, immortelles et d'or, qui le portaient, soit au-dessus de la mer, soit au-dessus de la terre immense, pareil au souffle du vent. Et il prit aussi la baguette à l'aide de laquelle il charme les yeux des hommes, ou il les réveille, quand il le veut. Tenant cette baguette dans ses mains, le puissant Tueur d'Argos, s'envolant vers la Piériè, tomba de l'Aithèr sur la mer et s'élança, rasant les flots, semblable à la mouette qui, autour des larges golfes de la mer indomptée, chasse les poissons et plonge ses ailes robustes dans l'écume salée. Semblable à cet oiseau, Hermès rasait les flots innombrables.
Et, quand il fut arrivé à l'île lointaine, il passa de la mer bleue sur la terre, jusqu'à la vaste grotte que la Nymphe aux beaux cheveux habitait, et où il la trouva. Et un grand feu brûlait au foyer, et l'odeur du cèdre et du thuya ardents parfumait toute l'île. Et la Nymphe chantait d'une belle voix, tissant une toile avec une navette d'or. Et une forêt verdoyante environnait la grotte, l'aune, le peuplier et le cyprès odorant, où les oiseaux qui déploient leurs ailes faisaient leurs nids les chouettes, les éperviers et les bavardes corneilles de mer qui s'inquiètent toujours des flots. Et une jeune vigne, dont les grappes mûrissaient, entourait la grotte, et quatre cours d'eau limpide, tantôt voisins, tantôt allant çà et là, faisaient verdir de molles prairies de violettes et d'aches. Même si un Immortel s'en approchait, il admirerait et serait charmé dans son esprit. Et le puissant Messager tueur d'Argos s'arrêta et, ayant tout admiré dans son esprit, entra aussitôt dans la vaste grotte.
Et l'illustre Déesse Kalypsô le reconnut, car les Dieux immortels ne sont point inconnus les uns aux autres, même quand ils habitent, chacun, une demeure lointaine. Et Hermès ne vit pas dans la grotte le magnanime Odysseus, car celui-ci pleurait, assis sur le rivage ; et, déchirant son cœur de sanglots et de gémissements, il regardait la mer agitée et versait des larmes. Mais l'illustre Déesse Kalypsô interrogea Herméias, étant assise sur un thrône splendide :
— Pourquoi es-tu venu vers moi, Herméias à la baguette d'or, vénérable et cher, que je n'ai jamais vu ici ? Dis ce que tu désires. Mon cœur m'ordonne de te satisfaire, si je le puis et si cela est possible. Mais suis-moi, afin que je t'offre les mets hospitaliers.
Ayant ainsi parlé, la Déesse dressa une table en la couvrant d'ambroisie et mêla le rouge nektar, Et le Messager tueur d'Argos but et mangea, et quand il eut achevé son repas et satisfait son âme, il dit à la Déesse :
— Tu me demandes pourquoi un Dieu vient vers toi, Déesse ; je te répondrai avec vérité, comme tu le désires. Zeus m'a ordonné de venir, malgré moi, car qui parcourrait volontiers les immenses eaux salées où il n'y a aucune ville d'hommes mortels qui font des sacrifices aux Dieux et leur offrent de saintes hécatombes ? Mais il n'est point permis à tout autre Dieu de résister à la volonté de Zeus tempétueux. On dit qu'un homme est auprès de toi, le plus malheureux de tous les hommes qui ont combattu pendant neuf ans autour de la ville de Priamos, et qui, l'ayant saccagée dans la dixième année, montèrent sur leurs nefs pour le retour. Et ils offensèrent Athènè, qui souleva contre eux le vent, les grands flots et le malheur. Et tous les braves compagnons d'Odysseus périrent, et il fut lui-même jeté ici par le vent et les flots. Maintenant, Zeus t'ordonne de le renvoyer très promptement, car sa destinée n'est point de mourir loin de ses amis, mais de les revoir et de rentrer dans sa haute demeure et dans la terre de la patrie.
Il parla ainsi, et l'illustre Déesse Kalypsô frémit, et, lui répondant, elle dit en paroles ailées :
— Vous êtes injustes, ô Dieux, et les plus jaloux des autres Dieux, et vous enviez les Déesses qui dorment ouvertement avec les hommes qu'elles choisissent pour leurs chers maris. Ainsi, quand Eôs aux doigts rosés enleva Oriôn, vous fûtes jaloux d'elle, ô Dieux qui vivez toujours, jusqu'à ce que la chaste Artémis au thrône d'or eût tué Oriôn de ses douces flèches, dans Ortygiè ; ainsi, quand Dèmètèr aux beaux cheveux, cédant à son âme, s'unit d'amour à Iasiôn sur une terre récemment labourée, Zeus, l'ayant su aussitôt, le tua en le frappant de la blanche foudre ; ainsi, maintenant, vous m'enviez, ô Dieux, parce que je garde auprès de moi un homme mortel que j'ai sauvé et recueilli seul sur sa carène, après que Zeus eut fendu d'un jet de foudre sa nef rapide au milieu de la mer sombre. Tous ses braves compagnons avaient péri, et le vent et les flots l'avaient poussé ici. Et je l'aimai et je le recueillis, et je me promettais de le rendre immortel et de le mettre pour toujours à l'abri de la vieillesse. Mais il n'est point permis à tout autre Dieu de résister à la volonté de Zeus tempétueux. Puisqu'il veut qu'Odysseus soit de nouveau errant sur la mer agitée, soit ; mais je ne le renverrai point moi-même, car je n'ai ni nefs armées d'avirons, ni compagnons qui le reconduisent sur le vaste dos de la mer. Je lui révélerai volontiers et ne lui cacherai point ce qu'il faut faire pour qu'il parvienne sain et sauf dans la terre de la patrie.
Et le Messager tueur d'Argos lui répondit aussitôt :
— Renvoie-le dès maintenant, afin d'éviter la colère de Zeus, et de peur qu'il s'enflamme contre toi à l'avenir.
Ayant ainsi parlé, le puissant Tueur d'Argos s'envola, et la vénérable Nymphe, après avoir reçu les ordres de Zeus, alla vers le magnanime Odysseus. Et elle le trouva assis sur le rivage, et jamais ses yeux ne tarissaient de larmes, et sa douce vie se consumait à gémir dans le désir du retour, car la Nymphe n'était point aimée de lui. Certes, pendant la nuit, il dormait contre sa volonté dans la grotte creuse, sans désir, auprès de celle qui le désirait ; mais, le jour, assis sur les rochers et sur les rivages, il déchirait son cœur par les larmes, les gémissements et les douleurs, et il regardait la mer indomptée en versant des larmes.
Et l'illustre Déesse, s'approchant, lui dit :
— Malheureux, ne te lamente pas plus longtemps ici, et ne consume point ta vie, car je vais te renvoyer promptement. Va ! fais un large radeau avec de grands arbres tranchés par l'airain, et pose pardessus un banc très élevé, afin qu'il te porte sur la mer sombre. Et j'y placerai moi-même du pain, de l'eau et du vin rouge qui satisferont ta faim, et je te donnerai des vêtements, et je t'enverrai un vent propice afin que tu parviennes sain et sauf dans la terre de la patrie, si les Dieux le veulent ainsi qui habitent le large Ouranos et qui sont plus puissants que moi par l'intelligence et la sagesse.
Elle parla ainsi, et le patient et divin Odysseus frémît et il lui dit en paroles ailées :
— Certes, tu as une autre pensée, Déesse, que celle de mon départ, puisque tu m'ordonnes de traverser sur un radeau les grandes eaux de la mer, difficiles et effrayantes, et que traversent à peine les nefs égales et rapides se réjouissant du souffle de Zeus. Je ne monterai point, comme tu le veux, sur un radeau, à moins que tu ne jures par le grand serment des Dieux que tu ne prépares point mon malheur et ma perte.
Il parla ainsi, et l'illustre Déesse Kalypsô rit, et elle le caressa de la main, et elle lui répondit :
— Certes, tu es menteur et rusé, puisque tu as pensé et parlé ainsi. Que Gaia le sache, et le large Ouranos supérieur, et l'eau souterraine de Styx, ce qui est le plus grand et le plus terrible serment des Dieux heureux, que je ne prépare ni ton malheur, ni ta perte. Je t'ai offert et conseillé ce que je tenterais pour moi-même, si la nécessité m'y contraignait. Mon esprit est équitable, et je n'ai point dans ma poitrine un cœur de fer, mais compatissant.
Ayant ainsi parlé, l'illustre Déesse le précéda promptement, et il allait sur les traces de la Déesse. Et tous deux parvinrent à la grotte creuse. Et il s'assit sur le thrône d'où s'était levé Herméias, et la Nymphe plaça devant lui les choses que les hommes mortels ont coutume de manger et de boire. Elle-même s'assit auprès du divin Odysseus, et les servantes placèrent devant elle l'ambroisie et le nectar. Et tous deux étendirent les mains vers les mets placés devant eux ; et quand ils eurent assouvi la faim et la soif, l'illustre Déesse Kalypsô commença de parler :
— Divin Laertiade, subtil Odysseus, ainsi, tu veux donc retourner dans ta demeure et dans la chère terre de la patrie ? Cependant, reçois mon salut. Si tu savais dans ton esprit combien de maux il est dans ta destinée de subir avant d'arriver à la terre de la patrie, certes, tu resterais ; ici avec moi, dans cette demeure, et tu serais immortel, bien que tu désires revoir ta femme que tu regrettes tous les jours. Et certes, je me glorifie de ne lui être inférieure ni par la beauté, ni par l'esprit, car les mortelles ne peuvent lutter de beauté avec les Immortelles.
Et le subtil Odysseus, lui répondant, parla ainsi :
— Vénérable Déesse, ne t'irrite point pour cela contre moi. Je sais en effet que la sage Pènélopéia t'est bien inférieure en beauté et majesté. Elle est mortelle, et tu ne connaîtras point la vieillesse ; et, cependant, je veux et je désire tous les jours revoir le moment du retour et regagner ma demeure. Si quelque Dieu m'accable encore de maux sur la sombre mer, je les subirai avec un cœur patient. J'ai déjà beaucoup souffert sur les flots et dans la guerre ; que de nouvelles misères m'arrivent, s'il le faut.
Il parla ainsi, et Hèlios tomba et les ténèbres survinrent ; et tous deux, se retirant dans le fond de la grotte creuse, se charmèrent par l'amour, couchés ensemble. Et quand Eôs aux doigts rosés, née au matin, apparut, aussitôt Odysseus revêtit sa tunique et son manteau, et la Nymphe se couvrit d'une grande robe blanche, légère et gracieuse ; et elle mit autour de ses reins une belle ceinture d'or, et, sur sa tête, un voile. Enfin préparant le départ du magnanime Odysseus, elle lui donna une grande hache d'airain, bien en main, à deux tranchants et au beau manche fait de bois d'olivier. Et elle lui donna ensuite une doloire aiguisée. Et elle le conduisit à l'extrémité de Pile où croissaient de grands arbres, des aunes, des peupliers et des pins qui atteignaient l'Ouranos, et dont le bois sec flotterait plus légèrement. Et, lui ayant montré le lieu où les grands arbres croissaient, l'illustre Déesse Kalypsô retourna dans sa demeure.
[...]
Ulysse prisonnier de Circé
[...]
Et ils trouvèrent, dans une vallée, en un lieu découvert, les demeures de Kirkè, construites en pierres polies. Et tout autour erraient des loups montagnards et des lions. Et Kirkè les avait domptés avec des breuvages perfides ; et ils ne se jetaient point sur les hommes, mais ils les approchaient en remuant leurs longues queues, comme des chiens caressant leur maître qui se lève du repas, car il leur donne toujours quelques bons morceaux. Ainsi les loups aux ongles robustes et les lions entouraient, caressants, mes compagnons ; et ceux-ci furent effrayés de voir ces bêtes féroces, et ils s'arrêtèrent devant les portes de la Déesse aux beaux cheveux. Et ils entendirent Kirkè chantant d'une belle voix dans sa demeure et tissant une grande toile ambroisienne, telle que sont les ouvrages légers, gracieux et brillants des Déesses. Alors Politès, chef des hommes, le plus cher de mes compagnons, et que j'honorais le plus, parla le premier :
— O amis, quelque femme, tissant une grande toile, chante d'une belle voix dans cette demeure, et tout le mur en résonne. Est-ce une Déesse ou une mortelle ? Poussons promptement un cri.
Il les persuada ainsi, et ils appelèrent en criant. Et Kirkè sortit aussitôt, et, ouvrant les belles portes, elle les invita, et tous la suivirent imprudemment. Eurylokhos resta seul dehors, ayant soupçonné une embûche. Et Kirkè, ayant fait entrer mes compagnons, les fit asseoir sur des sièges et sur des thrônes.
Et elle mêla, avec du vin de Pramnios, du fromage, de la farine et du miel doux ; mais elle mit dans le pain des poisons, afin de leur faire oublier la terre de la patrie. Et elle leur offrit cela, et ils burent, et, aussitôt, les frappant d'une baguette, elle les renferma dans les étables à porcs. Et ils avaient la tête, la voix, le corps et les soies du porc, mais leur esprit était le même qu'auparavant. Et ils pleuraient, ainsi enfermés ; et Kirkè leur donna du gland de chêne et du fruit de cornouiller à manger, ce que mangent toujours les porcs qui couchent sur la terre.
Mais Eurylokhos revint à la hâte vers la nef noire et rapide nous annoncer la dure destinée de nos compagnons. Et il ne pouvait parler, malgré son désir, et son cœur était frappé d'une grande douleur, et ses yeux étaient pleins de larmes, et son âme respirait le deuil. Mais, comme nous l'interrogions tous avec empressement, il nous raconta la perte de ses compagnons :
— Nous avons marché à travers la forêt, comme tu l'avais ordonné, illustre Odysseus, et nous avons rencontré, dans une vallée, en un lieu découvert, de belles demeures construites en pierres polies. Là, une Déesse, ou une mortelle, chantait harmonieusement en tissant une grande toile. Et mes compagnons l'appelèrent en criant. Aussitôt, elle sortit, et, ouvrant la belle porte, elle les invita, et tous la suivirent imprudemment, et, moi seul, je restai, ayant soupçonné une embûche. Et tous les autres disparurent à la fois, et aucun n'a reparu, bien que je les aie longtemps épiés et attendus.
Il parla ainsi, et je jetai sur mes épaules une grande épée d'airain aux clous d'argent et un arc, et j'ordonnai à Eurylokhos de me montrer le chemin. Mais, ayant saisi ses genoux de ses mains, en pleurant, il me dit ces paroles ailées :
— Ne me ramène point là contre mon gré, ô Divin, mais laisse-moi ici. Je sais que tu ne reviendras pas et que tu ne ramèneras aucun de nos compagnons. Fuyons promptement avec ceux-ci, car, sans doute, nous pouvons encore éviter la dure destinée.
Il parla ainsi, et je lui répondis :
— Eurylokhos, reste donc ici, mangeant et buvant auprès de la nef noire et creuse. Moi, j'irai, car une nécessité inexorable me contraint.
Ayant ainsi parlé, je m'éloignai de la mer et de la nef, et traversant les vallées sacrées, j'arrivai à la grande demeure de l'empoisonneuse Kirkè. Et Herméias à la baguette d'or vint à ma rencontre, comme j'approchais de la demeure, et il était semblable à un jeune homme dans toute la grâce de l'adolescence. Et, me prenant la main, il me dit :
— O malheureux ! Où vas-tu seul, entre ces collines, ignorant ces lieux ? Tes compagnons sont enfermés dans les demeures de Kirkè, et ils habitent comme des porcs des étables bien closes. Viens-tu pour les délivrer ? Certes, je ne pense pas que tu reviennes toi-même, et tu resteras là où ils sont déjà. Mais je te délivrerai de ce mal et je te sauverai. Prends ce remède excellent, et le portant avec toi ; rends-toi aux demeures de Kirkè, car il éloignera de ta tête le jour fatal. Et je te dirai tous les mauvais desseins de Kirkè. Elle te prépare un breuvage et elle te mettra des poisons dans le pain, mais elle ne pourra te charmer, car l’excellent remède que je te donnerai ne le permettra pas. Je le vais te dire le reste. Quand Kirkè t'aura frappé de sa longue baguette, jette-toi sur elle, comme si tu voulais la tuer. Alors, pleine de crainte, elle t'invitera à coucher avec elle. Ne refuse point le lit d'une Déesse, afin qu'elle délivre tes compagnons et qu'elle te traite toi-même avec bienveillance. Mais ordonne-lui de jurer par le grand serment des Dieux heureux, afin qu'elle ne tente aucune autre embûche, et que, t'ayant mis nu, elle ne t'enlève point ta virilité.
Ayant ainsi parlé, le Tueur d'Argos me donna le remède qu'il arracha de terre, et il m'en expliqua la nature. Et sa racine est noire et sa fleur semblable à du lait. Les Dieux la nomment Môly. Il est difficile aux hommes mortels de l'arracher, mais les Dieux peuvent tout. Puis Herméias s'envola vers le grand Olympos, sur l'île boisée, et je marchai vers la demeure de Kirkè, et mon cœur roulait mille pensées tandis que je marchais.
Et, m'arrêtant devant la porte de la Déesse aux beaux cheveux, je l'appelai, et elle entendit ma voix et, sortant aussitôt, elle ouvrît les portes brillantes et elle m'invita. Et, l'ayant suivie, triste dans le cœur, elle me fit entrer, puis asseoir sur un thrône à clous d'argent, et bien travaille. Et j'avais un escabeau sous les pieds. Aussitôt elle prépara dans une coupe d'or le breuvage que je devais boire, et, méditant le mal dans son esprit, elle y mêla le poison. Après me l'avoir donné, et comme je buvais, elle me frappa de sa baguette et elle me dit :
— Va maintenant dans l'étable à porcs, et couche avec tes compagnons.
Elle parla ainsi, mais je tirai de la gaine mon épée aiguë et je me jetai sur elle comme si je voulais la tuer. Alors poussant un grand cri, elle se prosterna, saisit mes genoux et me dit ces paroles ailées, en pleurant :
— Qui es-tu parmi les hommes ? Où est ta ville ? Où sont tes parents ? Je suis stupéfaite qu'ayant bu ces poisons tu ne sois pas transformé. Jamais aucun homme, pour les avoir seulement fait passer entre ses dents, n'y a résisté. Tu as un esprit indomptable dans ta poitrine, ou tu es le subtil Odysseus qui devait arriver ici, à son retour de Troiè, sur sa nef noire et rapide, ainsi que Herméias à la baguette d'or me l'avait toujours prédit. Mais remets ton épée dans sa gaine, et couchons-nous tous deux sur mon lit, afin que nous nous unissions, et que nous nous confiions l'un à l'autre.
Elle parla ainsi, et, lui répondant, je lui dis :
— O Kirkè ! comment me demandes-tu d'être doux pour toi qui as changé, dans tes demeures, mes compagnons en porcs, et qui me retiens ici moi-même, m'invitant à monter sur ton lit, dans la chambre nuptiale, afin qu'étant nu, tu m'enlèves ma virilité ? Certes, je ne veux point monter sur ton lit, à moins que tu ne jures par un grand serment, ô Déesse, que tu ne me tendras aucune autre embûche.
Je parlais ainsi, et aussitôt elle jura comme je le lui demandais ; et après qu'elle eut juré et prononcé toutes tes paroles du serment, alors je montai sur son beau lit.
Et les servantes s'agitaient dans la demeure ; et elles étaient quatre, et elles prenaient soin de toute chose. Et elles étaient nées des sources des forêts et des fleuves sacrés qui coulent à la mer. L'une d'elles jeta sur les thrônes de belles couvertures pourprées, et, par-dessus de légères toiles de lin. Une autre dressa devant les thrônes des tables d'argent sur lesquelles elle posa des corbeilles d'or. Une troisième mêla le vin doux et mielleux dans un kratère d'argent et distribua des coupes d'or. La quatrième apporta de l'eau et alluma un grand feu sous un grand trépied, et l'eau chauffa. Et quand l’eau eut chauffé dans l'airain brillant, elle me mit au bain, et elle me lava la tête et les épaules avec l'eau doucement versée du grand trépied. Et quand elle m'eut lavé et parfumé d'huile grasse, elle me revêtit d'une tunique et d'un beau manteau. Puis elle me fit asseoir sur un thrône d'argent bien travaillé, et j'avais un escabeau sous mes pieds. Une servante versa, d'une belle aiguière d'or dans un bassin d'argent, de l'eau pour les mains, et dressa devant moi une table polie. Et la vénérable intendante, bienveillante pour tous, apporta du pain qu'elle plaça sur la table ainsi que beaucoup de mets. Et Kirkè m'invita à manger, mais cela ne plut point à mon âme.
Et j'étais assis, ayant d'autres pensées et prévoyant d'autres maux. Et Kirkè, me voyant assis, sans manger, et plein de tristesse, s'approcha de moi et me dit ces paroles ailées :
— Pourquoi, Odysseus, restes-tu ainsi muet et te rongeant le cœur, sans boire et sans manger ? Crains-tu quelque autre embûche ? Tu ne dois rien craindre, car j'ai juré un grand serment.
Elle parla ainsi, et, lui répondant, je dis :
— O Kirkè, quel homme équitable et juste oserait boire et manger, avant que ses compagnons aient été délivrés, et qu'il les ait vus de ses yeux ? Si, dans ta bienveillance, tu veux que je boive et que je mange, délivre mes compagnons et que je les voie.
Je parlai ainsi, et Kirkè sortit de ses demeures, tenant une baguette à la main, et elle ouvrit les portes de l'étable à porcs. Elle en chassa mes compagnons semblables à des porcs de neuf ans. Ils se tenaient devant nous, et, se penchant, elle frotta chacun d'eux d'un autre baume, et de leurs membres tombèrent aussitôt les poils qu'avait fait pousser le poison funeste que leur avait donné la vénérable Kirkè ; et ils redevinrent des hommes plus jeunes qu'ils n'étaient auparavant, plus beaux et plus grands. Et ils me reconnurent, et tous, me serrant la main, pleuraient de joie, et la demeure retentissait de leurs sanglots. Et la Déesse elle-même fut prise de pitié. Puis, la noble Déesse, s'approchant de moi, me dit :
— Divin Laertiade, subtil Odysseus, va maintenant vers ta nef rapide et le rivage de la mer. Fais tirer, avant tout, ta nef sur le sable. Cachez ensuite vos richesses et vos armes dans une caverne ; et revenez aussitôt, toi-même et tes chers compagnons.
Elle parla ainsi, et mon esprit généreux fut persuadé, et je me hâtai de retourner à ma nef rapide et au rivage de la nier, et je trouvai auprès de ma nef rapide mes chers compagnons gémissant misérablement et versant des larmes abondantes. De même que les génisses, retenues loin de la prairie, s'empressent autour des vaches qui, du pâturage, reviennent à l'étable après s'être rassasiées d'herbes, et vont toutes ensemble au-devant d'elles, sans que les enclos puissent les retenir, et mugissent sans relâche autour de leurs mères ; de même, quand mes compagnons me virent de leurs yeux, ils m'entourent en pleurant, et leur cœur fut aussi ému que avaient revu leur patrie et la ville de l'âpre Ithaké, où ils étaient nés et avaient été nourris. Et, en pleurant, ils me dirent ces paroles ailées :
— A ton retour, ô Divin! nous sommes aussi joyeux que si nous voyions Ithaké et la terre de la patrie. Mais dis-nous comment sont morts nos compagnons.
Ils parlaient ainsi et je leur répondis par ces douces paroles :
— Avant tout, tirons la nef sur le rivage, et cachons dans une caverne nos richesses et toutes nos ormes. Puis, suivez-moi tous la hâte afin de revoir, dans les demeures sacrées de Kirkè, vos compagnons mangeant et buvant et jouissant d'une abondante nourriture.
Je parlai ainsi, et ils obéirent promptement à mes paroles; mais le seul Eurylokhos tentait de les retenir, et il leur dit ces paroles ailées :
— Ah malheureux, où allez-vous? Vous voulez donc subir les maux qui vous attendent dans les demeures de Kirkè, elle qui nous changera en porcs, en loups et en lions, et dont nous garderons de force la demeure ? Elle fera comme le Kyklôps, quand nos compagnons vinrent dans sa caverne, conduits par l'audacieux Odysseus. Et ils y ont péri par sa démence.
Il parla ainsi, et je délibérai dans mon esprit si, ayant tiré ma grande épée de sa gaine, le long de la cuisse, je lui couperais la tête et la jetterais sur le sable, malgré notre parenté ; mais tous mes autres compagnons me retinrent par de flatteuses paroles:
— O Divin ! laissons-le, si tu y consens, rester auprès de la nef et la garder. Nous, nous te suivrons à la demeure sacrée de Kirkè.
Ayant ainsi parlé, ils s'éloignèrent de la nef et de la mer, mais Eurylokhos ne resta point auprès de la nef creuse, et il nous suivit, craignant mes rudes menaces. Pendant cela, Kirkè, dans ses demeures, baigna et parfuma d'huile mes autres compagnons, et elle les revêtit de tuniques et de beaux manteaux, et nous les trouvâmes tous faisant leur repas dans les demeures. Et quand ils se furent réunis, ils se racontèrent tous leurs maux, les uns aux autres, et ils pleuraient, et la maison retentissait de leurs sanglots. Et la noble Déesse, s'approchant, me dit :
— Divin Laertiade, subtil Odysseus, ne vous livrez pas plus longtemps à la douleur. Je sais moi-même combien vous avez subi de maux sur la mer poissonneuse et combien d'hommes injustes vous ont fait souffrir sur la terre. Mais, mangez et buvez, et ranimez votre cœur dans votre poitrine, et qu'il soit tel qu'il était quand vous avez quitté la terre de l'âpre Ithaké, votre patrie cependant, jamais vous n'oublierez vos misères, et votre esprit ne sera jamais plus dans la joie, car vous avez subi des maux innombrables.
Elle parla ainsi, et notre cœur généreux lui obéit. Et nous restâmes là toute une année, mangeant les chairs abondantes et buvant le doux vin. Mais, à la fin de l'année, quand les Heures eurent accompli leur tour, quand les mois furent passés et quand les longs jours se furent écoulés, alors, mes chers compagnons m'appelèrent et me dirent :
— Malheureux, souviens-toi de ta patrie, si toutefois il est dans ta destinée de survivre et de rentrer dans ta haute demeure et dans la terre de la patrie.
Ils parlèrent ainsi, et mon cœur généreux fut persuadé. Alors, tout le jour, jusqu'à la chute de Hèlios, nous restâmes assis, mangeant les chairs abondantes et buvant le doux vin. Et quand Hèlios tomba, et quand la nuit vint, mes compagnons s'endormirent dans la demeure obscure. Et moi, étant monté dans le lit splendide de Kirkè, je saisis ses genoux en la suppliant, et la Déesse entendit ma voix. Et je lui :
— O Kirkè, tiens la promesse que tu m'as faite de me renvoyer dans ma demeure, car mon âme me pousse, et mes compagnons affligent mon cher cœur et gémissent autour de moi, quand tu n’es pas là.
Je parlai ainsi, et la noble Déesse me répondît aussitôt :
— Divin Laertiade, subtil Odysseus, vous ne resterez pas plus longtemps malgré vous dans ma demeure ; mais il faut accomplir un autre voyage et entrer dans la demeure d'Aidés et de l'implacable Perséphonéia, afin de consulter l'âme du Thébain Teirésias, du divinateur aveugle, dont l'esprit est toujours vivant. Perséphonéia n'a accordé qu'à ce seul Mort l'intelligence et la pensée. Les autres ne seront que des ombres autour de toi.
Elle parla ainsi, et mon cher cœur fut dissous, et je pleurais, assis sur le lit, et mon âme ne voulait plus vivre, ni voir la lumière de Hèlios. Mais, après avoir pleuré et m'être rassasié de douleur, alors, lui répondant, je lui dis :
— O Kirkè, qui me montrera le chemin ? Personne n'est jamais arrivé chez Aidès sur une nef noire.
Je parlai ainsi, et la noble Déesse me répondit aussitôt :
— Divin Laertiade, subtil Odysseus, n'aie aucun souci pour ta nef. Assieds-toi, après avoir dressé le mât et déployé les blanches voiles ; et le souffle de Boréas conduira ta nef. Mais quand tu auras traversé l'Okéanos, jusqu'au rivage étroit et aux bois sacrés de Perséphonéia, où croissent de hauts peupliers et des saules stériles, alors arrête ta nef dans l'Okéanos aux profonds tourbillons, et descends dans la noire demeure d'Aidés, là où coulent ensemble, dans l'Akhérôn, le Pyriphlégéthôn et le Kokytos qui est un courant de l'eau de Styx. Il y a une roche au confluent des deux fleuves retentissants. Tu t'en approcheras, héros, comme je te l'ordonne, et tu creuseras là une fosse d'une coudée dans tous les sens, et, sur elle, tu feras des libations à tous les morts, de lait mielleux d'abord, puis de vin doux, puis enfin d'eau, et tu répandras pardessus de la farine blanche. Prie alors les têtes vaines des morts et promets, dès que tu seras rentré dans Ithaké, de sacrifier dans tes demeures la meilleure vache stérile que tu posséderas, d'allumer un bûcher formé de choses précieuses, et de sacrifier, à part, au seul Teirésias un bélier entièrement noir, le plus beau de tes troupeaux. Puis, ayant prié les illustres âmes des morts, sacrifie un mâle et une brebis noire, tourne-toi vers l'Erèbos, et, te penchant, regarde dans le cours du fleuve, et les innombrables âmes des morts qui ne sont plus accourront. Alors, ordonne et commande à tes compagnons d'écorcher les animaux égorgés par l'airain aigu, de les brûler et de les vouer aux Dieux, à l'illustre Aidés et à l'implacable Perséphonéia. Tire ton épée aiguë de sa gaine, le long de ta cuisse, et ne permets pas aux ombres vaines des morts de boire le sang, avant que tu aies entendu Teirésias. Aussitôt le Divinateur arrivera, ô chef des peuples, et il te montrera ta route et comment tu la feras pour ton retour, et comment tu traverseras la mer poissonneuse.
Elle parla ainsi, et aussitôt Eôs s'assit sur son thrône d'or. Et Kirkè me revêtit d'une tunique et d'un manteau. Elle-même se couvrit d'une longue robe blanche, légère et gracieuse, ceignit ses reins d'une belle ceinture et mit sur sa tête un voile couleur de feu. Et j'allai par la demeure, excitant mes compagnons, et je dis à chacun d'eux ces douces paroles :
— Ne dormez pas plus longtemps, et chassez le doux sommeil, afin que nous partions, car la vénérable Kirkè me l'a permis.
Je parlai ainsi, et leur cœur généreux fut persuadé. Mais je n'emmenai point tous mes compagnons sains et saufs. Elpènôr, un d'eux, jeune, mais ni très-brave, ni intelligent, à l'écart de ses compagnons, s'était endormi au faîte des demeures sacrées de Kirkè, ayant beaucoup bu et recherchant la fraîcheur. Entendant le bruit que faisaient ses compagnons, il se leva brusquement, oubliant de descendre par la longue échelle. Et il tomba du haut du toit, et son cou fut rompu, et son âme descendit chez Aidés. Mais je dis à mes compagnons rassemblés :
— Vous pensiez peut-être que nous partions pour notre demeure et pour la chère terre de la patrie ? Mais Kirkè nous ordonne de suivre une autre route, vers la demeure d'Aidés et de l'implacable Perséphonéia, afin de consulter l'âme du Thébain Teirésias.
Je parlai ainsi, et leur cher cœur fut brisé, et ils s'assirent, pleurant et s'arrachant les cheveux. Mais il n'y a nul remède à gémir. Et nous parvînmes à notre nef rapide et au rivage de la mer, en versant des larmes abondantes. Et pendant ce temps, Kirkè était venue, apportant dans la nef un bélier et une brebis noire ; et elle s'était aisément cachée à nos yeux ; car qui pourrait voir un Dieu et le suivre de ses yeux, s'il ne le voulait pas ?
Homère, L'Odyssée
traduction de Leconte de Lisle, 1867.
traduction de Leconte de Lisle, 1867.
Le coq attaché
COLLECTION DES CURIOSITÉS
Il y avait un paysan, près de Jérusalem, qui avait acquis un jeune coq de combat. Ce coq avait l'air d'une pauvre bestiole, mais il se couvrit de plumes avantageuses à mesure que le printemps avançait et il resplendit, bombant une gorge orange, à l'époque où les feuilles du figuier font éclater leur bourgeon.
Le paysan était pauvre : il habitait une cabane de torchis, et n'avait pour tout domaine qu'une cour étroite et malpropre plantée d'un figuier noueux. Il travaillait dur parmi les vignes, les oliviers et les blés de son maître, puis rentrait dormir dans sa pauvre cabane de torchis, près du sentier.
Cependant il était fier de son jeune coq. Dans la cour intérieure, trois misérables poules pondaient de maigres œufs, perdaient le peu de plumes dont elles étaient garnies et laissaient autour d'elles un amas énorme d'ordures. Il y avait aussi dans un coin, sous un toit de chaume, un âne morne qui, souvent, accompagnait le paysan au travail, mais qui parfois restait au logis. Et il y avait la femme du paysan, une assez jeune femme au sourcil obscur qui ne travaillait pas trop. Elle jetait aux volailles un peu de grain et des restes de l'écuelle et, avec une faucille, elle coupait du fourrage vert pour l'âne.
Le jeune coq atteignit à une certaine splendeur. Dans cette cour malpropre, parmi ces trois poules loqueteuses, on ne sait quel caprice de la destinée avait fait de lui un galant de haut vol. il apprit à étirer le cou et à lancer de stridentes réponses aux appels des autres coqs par delà les murs, dans un monde dont il connaissait rien. Mais il y avait une couleur passionnée dans son cri et les appels lointains des autres coqs éveillaient en lui des éclats inattendus.
– Comme il chante ! dit le paysan qui se levait et passait la tête dans le trou de sa chemise de jour.
– Il est de taille à avoir vingt poules, dit la femme.
Le paysan sortit et contempla avec fierté son jeune coq. Un animal insolent, magnifique – déjà il avait soumis les trois poules dépenaillées. Mais le coquelet dressait la tête, écoutant le défi des coqs lointains et invisibles dans cet univers inconnu. Voix de fantômes lançant mystérieusement des limbes vers lui leurs cris. Il répondait par un défi éclatant, indomptable.
– Il va sûrement s'envoler un de ces jours, dit la femme du paysan.
Alors ils lui jetèrent du grain pour le leurrer, s'en emparèrent bien qu'il se défendît, à coups d'ailes et d'ongles ; ils lui attachèrent à la patte une corde qu'ils assujettirent à son ergot et ils attachèrent l'autre bout au poteau qui soutenait l'appentis de l'âne.
Lâché, le jeune coq marcha d'un pas impétueux, prétendant, l'air indigné, s'éloigner des humains ; il arriva au bout de sa corde, fit un effort violent et clochard de sa patte prisonnière pour se dégager, tomba et, pendant un instant, se débattit éperdument sur la sordide terre battue au grand effroi des poules dépenaillées puis, avec une saccade affaiblie, se retrouva sur ses pattes et s'arrêta pour réfléchir. Le paysan et sa femme rirent de bon cœur et le jeune coq les entendit. Il eut alors l'obscur pressentiment qu'il était attaché par la patte.
Il cessa désormais de se piéter, de s'ébouriffer, de lustrer ses plumes. Il parcourait d'un air sombre l'espace qui lui était mesuré par son attache. Il continuait à engloutir les meilleurs morceaux de nourriture. Il continuait, parfois, à mettre de côté des morceaux de choix pour sa favorite du moment. Il continuait à sauter sur celle de son harem qui passait, nonchalante, à sa portée, lui jetant l'invisble charme. Un instant, il se balançait sur elle, frémissant. Et il continuait aussi à lancer son défi aux cocoricos qui, à l'aube, fondaient des limbes.
Mais c'était avec une voracité farouche qu'il engloutissait sa nourriture et son triomphe était gêné quand il s'était saisi d'une de ses poules misérables. Sa voix surtout avait perdu son timbre d'or. Il était attaché par la patte et il le savait. Son corps, son âme, son esprit était liés par cette corde.
Au-dedans, toutefois, sa vitalité était farouchement intacte. Quelque chose devait céder, ce serait la corde. Alors, un matin, dès avant les premières lueurs de l'aube, sortant de sa somnolence, dans un brusque sursaut de vigueur, d'un grand coup d'aile, il s'élança et la corde cassa. Il jeta un étrange cri sauvage, s'éleva d'un trait au faîte du mur et là il lança un cocorico éclatant, décisif. Si bien que le paysan s'éveilla.
Au même moment, à la même heure avant l'aube, le même matin, un homme s'éveilla du long sommeil dans lequel il était lié. Il se réveilla, gourd et froid, à l'intérieur d'un trou creusé dans le roc. Pendant tout le long sommeil, son corps avait été comblé de douleur et maintenant encore il était comblé de douleur. Il n'ouvrit pas les yeux. Pourtant il se savait éveillé, et gourd, et glacé, et raide, et plein de douleur, et lié. Son visage était entouré de froides bandes, ses jambes étaient attachées ensemble. Seules ses mains étaient libres.
Il pouvait remuer s'il le voulait, il le savait. Mais il n'avait pas de vouloir. Qui donc souhaiterait revenir d'entre les morts ? Une profonde, profonde nausée montait en lui à l'idée de mouvement. Il sentait déjà le fait irritant de l'étrange, incalculable mouvement qui s'était emparé de lui, le retour à la conscience. Il ne l'avait pas souhaité. Il avait voulu demeurer en dehors, là où la mémoire même est pétrifiée.
D.H. Lawrence, L'homme qui était mort
Traduction Jacqueline Dalsace et Pierre Drieu la Rochelle.
1933, extrait
Traduction Jacqueline Dalsace et Pierre Drieu la Rochelle.
1933, extrait
Correspondance entre Vincent Puente et Sophie Saulnier
CURIOSITÉS
De : Vincent Puente
Envoyé : dimanche 31 mai 2015 19:45
À : Sophie Saulnier
Objet : Le lampadaire
Bonjour,
J'ai bien reçu votre message sur la messagerie de la librairie 7L et je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à mes 2 livres aux éditions de la Bibliothèque.
Je ne sais pas si je suis réellement un personnage de mes livres ; tout au plus un faux, au même titre que ce que j'écris. Quelle est votre idée ? A quel type de collaboration pensez-vous?
Dans l'attente de vous lire,
Bien cordialement
Vincent Puente
De : Sophie Saulnier
Envoyé : mardi 2 juin 2015 22:28
À : Vincent Puente
Objet : Le lampadaire
Bonjour,
non, non je ne prétends pas que vous soyez un personnage de vos livres.
Comme je vous l'ai écrit dans mon petit message, j'ai aimé votre jeu sur le faux-vrai et votre écriture qui met en difficulté le lecteur, lui qui cherche à déceler le vrai du faux, ou le faux du vrai, ce lecteur qui aimerait tout croire vrai.
Le Lampadaire est un nouveau site littéraire, sa prochaine thématique est formulée ainsi « Quand les auteurs sont des personnages ».
L'idée est partie d'un texte que nous avons reçu (d'un auteur brésilien) : on y suit le personnage principal, dans un asile d'aliénés, qui parle, dans son délire, avec Rimbaud et Baudelaire. Nous avons eu envie de jouer avec l'idée et d'en décliner la thématique.
Il y aura ainsi, outre l'extrait de l'auteur brésilien, un texte dans lequel Joseph Pasdeloup, Perrine Poirrier, Maria Rantin et Fred Lucas, quatre auteurs qui ont signé des courts récits pour le Lampadaire (vous pouvez les lire sur le site si vous voulez) deviendront les personnages d'une courte fiction. Vrais auteurs qui prêtent leur nom à un autre auteur? personnages déjà manipulés par un auteur invisible, même quand ils prétendaient être les vrais signataires de leur texte? Mais alors qui serait l'auteur? Qu'est-ce que ce site dont le lecteur, Hubert Lambert, est lui-même assez mystérieux?
En lisant vos deux livres, je me suis dit qu'ils entraient tout à fait dans notre jeu. Aussi j'aimerais vous proposer d'écrire, pour Le Lampadaire, un texte qui au lieu de prendre comme sujet une librairie, ou un personnage qui semble appartenir à l'histoire du monde, mais sur le même principe, prendrait un personnage qui serait un auteur que vous nous feriez passer pour vrai (soit que ce soit un auteur de votre invention, soit un auteur connu dont vous réinventiez la vie et l'œuvre, soit un auteur méconnu, oublié et que vous semblez ramener à la vie (en tous les cas littéraire)). Ce ne sont que des pistes, vous auriez, bien sûr, toute liberté pour vous emparer de l'idée.
Qu'en pensez-vous? Nous aimerions beaucoup avoir votre accord!
D'autre part, nous comptons passer bientôt à des publications papier, si vous avez quelque chose à nous proposer nous vous lirons avec plaisir.
Dans l'attente de votre réponse,
Bien à vous,
Sophie Saulnier
pour Le Lampadaire
De : Vincent Puente
Envoyé : mercredi 3 juin 2015 14:12
À : Sophie Saulnier
Objet : Le lampadaire
Bonjour Sophie,
Oui, l'idée est séduisante. Il faut que j'y réfléchisse plus avant et que je regarde s'il me reste du matériau disponible.
Quels sont vos délais ? J'écris lentement et je dispose de peu de temps à consacrer à l'écriture (il m'a fallu presque 4 ans pour finir Le Corps des Libraires). C'est un détail qui a son importance.
En tout cas, vous l'avez compris, je ne dis pas non. Restons en contact et voyons où cela nous mène.
Bien à vous,
V. Puente
De : Sophie Saulnier
Envoyé : mercredi 3 juin 2015 22:37
À : Vincent Puente
Objet : Le lampadaire
Bonjour Vincent,
ah, je suis contente que l'idée vous séduise et que vous y trouviez de l'intérêt. En principe, Le Lampadaire étant devenu trimestriel, sa prochaine parution est prévue en juillet. Est-ce que cela vous irait? Si le délai est trop court pour vous, dites-le moi, et je verrai comment faire (une thématique intermédiaire, une manière d'amorcer le sujet pour attendre de traiter la thématique proprement dite en octobre...), nous sommes tout de même très libres dans nos décisions...
Bien à vous,
Sophie Saulnier
De : Vincent Puente
Envoyé : lundi 8 juin 2015 12:43
À : Sophie Saulnier
Objet : Le lampadaire
Bonjour Sophie,
J’ai cherché dans mes papiers si je n’avais pas quelque chose à donner au Lampadaire. Hélas, je n’ai plus pour le moment de matériau utilisable pour vous écrire quelque chose d’original. L’inspiration vient lentement, et comme je vous le disais dans mes précédents messages, je travaille encore plus lentement.
Cela dit, j’ai retrouvé dans mon disque dur le scan d’un article édifiant tiré du Figaro Littéraire de juin 1984 qui pourrait certainement convenir à votre sujet. Je vous le fait suivre en pièce jointe. Dites-moi ce que vous en pensez.
Bien amicalement,
Vincent Puente
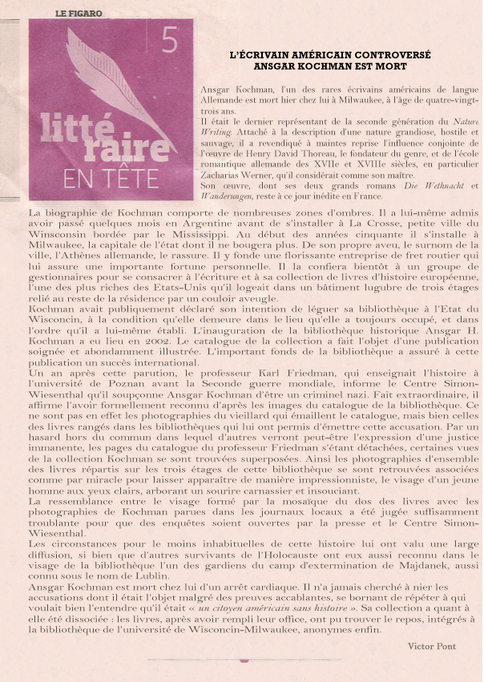
Transcription exacte de l’article :
L’écrivain américain controversé Ansgar Kochman est mort
Ansgar Kochman, l’un des rares écrivains américains de langue Allemande est mort hier chez lui à Milwaukee à l’âge de quatre-vingt-trois ans.
Il était le dernier représentant de la seconde génération du Nature Writing. Attaché à la description d’une nature grandiose, hostile et sauvage, il a revendiqué à maintes reprises l’influence conjointe de l’œuvre de Henry David Thoreau, le fondateur du genre, et de l’école romantique allemande des XVIIe et XVIIIe siècles, en particulier Zacharias Werner qu’il considérait comme son maître.
Son œuvre, dont ses deux grands romans Die Wetnacht et Wanderungen, reste à ce jour inédite en France.
La biographie de Kochman comporte de nombreuses zones d’ombre. Il a lui-même admis avoir passé quelques mois en Argentine avant de s’installer à La Crosse, petite ville du Winsconsin bordée par le Mississipi. Au début des années cinquante il s’installe à Milwaukee, la capitale de l’état dont il ne bougera plus. De son propre aveu, le surnom de la ville, l’Athènes allemande, le rassure. Il y fonde une florissante entreprise de fret routier qui lui assure une importante fortune personnelle. Il la confiera bientôt à un groupe de gestionnaires pour se consacrer à l’écriture et à sa collection de livres d’histoire européenne, l’une des plus riches des Etats-Unis qu’il logeait dans un bâtiment lugubre à trois étages relié au reste de la résidence par un couloir aveugle.
Kochman avait publiquement déclaré son intention de léguer sa bibliothèque à l’Etat du Wisconsin, à la condition qu’elle demeure dans le lieu qu’elle a toujours occupé et dans l’ordre qu’il a lui-même établi. L’inauguration de la bibliothèque historique Ansgar H. Kochman a eu lieu en 2002. Le catalogue de la collection a fait l’objet d’une publication soignée et abondamment illustrée. L’important fonds de la bibliothèque a assuré à cette publication un succès international.
Un an après cette parution, le professeur Karl Friedman, qui enseignait l’histoire à l’université de Poznan avant la Seconde guerre mondiale, informe le Centre Simon-Wiesenthal qu’il soupçonne Ansgar Kochman d’être un criminel nazi. Fait extraordinaire, il l’affirme l’avoir formellement reconnu d’après les images du catalogue de la bibliothèque. Ce ne sont pas en effet les photographies du vieillard qui émaillent le catalogue, mais bien celles des livres rangés dans les bibliothèques qui lui ont permis d’émettre cette accusation. Par un hasard hors du commun dans lequel d’autres verront peut-être l’expression d’une justice immanente, les pages du catalogue du professeur Friedman s’étant détachées, certaines vues de la collection Kochman se sont trouvées superposées. Ainsi les photographies d’ensemble des livres répartis sur trois étages de cette bibliothèque se sont retrouvées associées comme par miracle pour laisser apparaître de manière impressionniste, le visage d’un jeune homme aux yeux clairs, arborant un sourire carnassier et insouciant.
La ressemblance entre le visage formé par la mosaïque du dos des livres avec les photographies de Kochman parues dans les journaux locaux a été jugée suffisamment troublante pour que des enquêtes soient ouvertes par la presse et le Centre Simon-Wiesenthal.
Les circonstances pour le moins inhabituelles de cette histoire lui ont valu une large diffusion, si bien que d’autres survivants de l’Holocauste ont eux aussi reconnu dans le visage de la bibliothèque l’un des gardiens du camp d’extermination de Majdanek, aussi connu sous le nom de Lublin.
Ansgar Kochman est mort chez lui d’un arrêt cardiaque. Il n’a jamais cherché à nier les accusations dont il était l’objet malgré des preuves accablantes, se bornant de répéter à qui voulait bien l’entendre qu’il était « un citoyen américain sans histoire ». Sa collection a quant à elle été dissociée ; les livres après avoir rempli leur office, on pu trouver le repos, intégrés à la bibliothèque de l’université de Wisconsin-Milwaukee, anonymes enfin.
Victor Pont
Une autre fête au même instant brille dans Paris, exposition Emmanuel Licha, texte Anne Cauquelin, commissaire Catherine Bédard

Dès l'entrée, le visiteur aperçoit des bris de lustres au sol, ils sont en miettes et scintillent encore faiblement. Mais la voix de l'hôtesse assure que le grand lustre du salon d'apparat -« regardez-le au plafond »- est l'oeuvre d'un célèbre miroitier, une pièce unique, rarissime. Le plafond peint est une toile de Tiepelo commandée à grand frais, les couleurs en sont divines. Le visiteur lève la tête et voit les rampes électriques destinées à l'éclairage.
Courtesy, Centre culturel canadien/ ambassade du canada à paris/collection esplanade, 2005
Pour en voir plus cliquez ici
Balzac, 1833
THÉORIE DE LA DÉMARCHE
extraits
COLLECTION DES CURIOSITÉS
Ceci est prétentieux ; mais pardonnez à l’auteur son orgueil : faites mieux, avouez qu’il est légitime. N’est-il pas réellement bien extraordinaire de voir que, depuis le temps où l’homme marche, personne ne se soit demandé pourquoi il marche, comment il marche, s’il marche, s’il peut mieux marcher, ce qu’il fait en marchant, s’il n’y aurait pas moyen d’imposer, de changer, d’analyser sa marche : questions qui tiennent à tous les systèmes philosophiques, psychologiques et politiques dont s’est occupé le monde ?
Eh ! Quoi ! Feu M. Mariette, de l’académie des sciences, a calculé la quantité d’eau qui passait, par chaque division la plus minime du temps, sous chacune des arches du pont royal, en observant les différences introduites par la lenteur des eaux, par l’ouverture de l’arche, par les variations atmosphériques des saisons ! Et il n’est entré dans la tête d’aucun savant de rechercher, de mesurer, de peser, d’analyser, de formuler, le binôme aidant, quelle quantité fluide l’homme, par une marche plus ou moins rapide, pouvait perdre ou économiser de force, de vie, d’action, de je ne sais quoi que nous dépensons en haine, en amour, en conversation et en digression ! ...
Hélas ! Une foule d’hommes, tous distingués par l’ampleur de la boîte cervicale et par la lourdeur, par les circonvolutions de leur cervelle ; des mécaniciens, des géomètres enfin ont déduit des milliers de théorèmes, de propositions, de lemmes, de corollaires sur le mouvement appliqué aux choses, ont révélé les lois du mouvement céleste, ont saisi les marées dans tous leurs caprices et les ont enchaînées dans quelques formules d’une incontestable sécurité marine ; mais personne, ni physiologiste, ni médecin sans malades, ni savant désœuvré, ni fou de Bicêtre, ni statisticien fatigué de compter ses grains de blé, ni quoi que ce soit d’humain, n’a voulu penser aux lois du mouvement appliqué à l’homme ! […]
... ………….Et vera incessu
patuit dea..........................
« La déesse se révéla par sa démarche. »
Ces fragments de vers de Virgile, analogues d’ailleurs à un vers d’Homère, que je ne veux pas citer, de peur d’être accusé de pédantisme, sont deux témoignages qui attestent l’importance attachée à la démarche par les anciens. Mais qui de nous, pauvres écoliers fouettés de grec, ne sait pas que Démosthènes reprochait à Nicobule de marcher à la diable, assimilant une pareille démarche, comme manque d’usage et de bon ton, à un parler insolent? […]
Classer, pour pouvoir codifier.
Codifier, faire le code de la démarche ; en d’autres termes, rédiger une suite d’axiomes pour le repos des intelligences faibles ou paresseuses, afin de leur éviter la peine de réfléchir et les amener, par l’observation de quelques principes clairs à régler leur mouvement. En étudiant ce code, les hommes progressifs, et ceux qui tiennent au système de la perfectibilité, pourraient paraître aimables, gracieux, distingués, bien élevés, fashionables, aimés, instruits, ducs, marquis ou comtes, au lieu de sembler vulgaires, stupides, ennuyeux, pédants, ignobles, maçons du roi Philippe ou barons de l’empire. Et n’est-ce pas ce qu’il y a de plus important chez une nation dont la devise est Tout pour l’enseigne ?
S’il m’était permis de descendre au fond de la conscience de l’incorruptible journaliste, du philosophe éclectique, du vertueux épicier, du délicieux professeur, du vieux marchand de mousseline, de l’illustre papetier, qui, par la grâce moqueuse de Louis-Philippe, sont les derniers pairs de France venus, je suis persuadé d’y trouver ce souhait écrit en lettres d’or : Je voudrais bien avoir l’air noble ?
Ils s’en défendront, ils le nieront, ils vous diront :
– Je n’y tiens pas ! Cela m’est égal ! Je suis journaliste, philosophe, épicier, professeur, marchand de toiles, ou de papier !
Ne les croyez pas. Forcés d’être pairs de France, ils veulent être pairs de France ; mais, s’ils sont pairs de France au lit, à table, à la chambre, dans le bulletin des lois, aux Tuileries, dans leurs portraits de famille, il leur est impossible d’être pris pour des pairs de France lorsqu’ils passent sur le boulevard. Là, ces messieurs redeviennent Gros-Jean comme devant. L’observateur ne cherche même pas ce qu’ils peuvent être, tandis que, si M. le duc de Laval, si M. de Lamartine, si M. le duc de Rohan, viennent à s’y promener, leur qualité n’est un doute pour personne ; et je ne conseillerais pas à ceux-là de suivre ceux-ci.
Je voudrais bien n’offenser aucun amour propre. Si j’avais involontairement blessé l’un des derniers pairs venus, dont j’improuve l’intronisation patricienne, mais dont j’estime la science, le talent, les vertus privées, la probité commerciale sachant bien que le premier et le dernier ont eu le droit de vendre, l’un son journal, l’autre le papier, plus cher qu’ils ne leur coûtaient, je crois pouvoir jeter quelque baume sur cette égratignure en leur faisant observer que je suis obligé de prendre mes exemples en haut lieu pour convaincre les bons esprits de l’importance de cette théorie.
Et, en effet, je suis resté pendant quelque temps stupéfié par les observations que j’avais faites sur le boulevard de Gand, et surpris de trouver au mouvement des couleurs aussi tranchées.
De là ce premier aphorisme :
La démarche est la physionomie du corps.
N’est-il pas effrayant de penser qu’un observateur profond peut découvrir un vice, un remords, une maladie en voyant un homme en mouvement ?
Quel riche langage dans ces effets immédiats d’une volonté traduite avec innocence !
L’inclination plus ou moins vive d’un de nos membre ; la forme télégraphique dont il a contracté, malgré nous, l’habitude ; l’angle ou le contour que nous lui faisons décrire, sont empreints de notre vouloir, et sont d’une effrayante signification. C’est plus que la parole, c’est la pensée en action. Un simple geste, un involontaire frémissement des lèvres peut devenir le terrible dénouement d’un drame caché longtemps entre deux cœurs.
Aussi, de là cet autre aphorisme :
Le regard, la voix, la respiration, la démarche sont identiques ; mais, comme il n’a pas été donné à l’homme de pouvoir veiller à la fois sur ces quatre expressions diverses et simultanées de sa pensée, cherchez celle qui dit vrai ; vous connaîtrez l’homme tout entier.
M. S. n’est pas seulement chimiste et capitaliste, il est profond observateur et grand philosophe.
M. O. n’est pas seulement un spéculateur, il est homme d’état. Il tient et de l’oiseau de proie et du serpent ; il emporte des trésors et sait charmer les gardiens.
Ces deux hommes aux prises ne doivent-ils pas offrir un admirable combat, en luttant ruse contre ruse, dires contre dires, mensonge à outrance, spéculation au poing, chiffre en tête ?
Or, ils se sont rencontrés un soir, au coin d’une cheminée, sous le feu des bougies, le mensonge sur les lèvres, dans les dents, au front, dans l’œil, sur la main ; ils en étaient armés de pied en cap. Il s’agissait d’argent. Ce duel eut lieu sous l’empire.
M. O., qui avait besoin de cinq cent mille francs pour le lendemain, se trouvait, à minuit, debout à côté de S.
Voyez-vous bien S., homme de bronze, vrai Shylock qui, plus rusé que son devancier, prendrait la livre de chair avant le prêt ; le voyez-vous accosté par O., l’Alcibiade de la banque, l’homme capable d’emprunter successivement trois royaumes sans les restituer, et capable de persuader à tout le monde qu’il les a enrichis ? Suivez-les : M. O. demande légèrement à M. S. cinq cent mille francs pour vingt-quatre heures, en lui promettant de les lui rendre en telles et telles valeurs.
− Monsieur, dit M. S. à la personne de qui je tiens cette précieuse anecdote, quand O. me détailla les valeurs, le bout de son nez vint à blanchir, du côté gauche seulement, dans le léger cercle décrit par un méplat qui s’y trouve. J’avais déjà eu l’occasion de remarquer que toutes les fois que O. mentait, ce méplat devenait blanc. Ainsi je sus que mes cinq cent mille francs seraient compromis pendant un certain temps...
− Hé ! Bien, lui demanda-t-on.
− Hé ! Bien..., reprit-il.
Et il laissa échapper un soupir.
− Hé ! Bien, ce serpent me tint pendant une demi−heure, je
lui promis les cinq cent mille francs, et il les eut.
− Les a-t-il rendus ?
S. pouvait calomnier O. Sa haine bien connue lui en donnait le droit, à une époque où l’on tue ses ennemis à coups de langue. Je dois dire, à la louange de cet homme bizarre, qu’il répondit : « oui » . Mais ce fut piteusement. Il aurait voulu pouvoir accuser son ennemi d’une tromperie de plus.
Quelques personnes disent M. O. encore plus fort en fait de dissimulation que ne l’est M. le prince de Bénévent. Je le crois volontiers. Le diplomate ment pour le compte d’autrui, le banquier ment pour lui-même. Eh ! Bien, ce moderne Bourvalais, qui a pris l’habitude d’une admirable immobilité des traits, d’une complète insignifiance dans le regard, d’une imperturbable égalité dans la voix, d’une habile démarche, n’a pas su dompter le bout de son nez. Chacun de nous a quelque méplat où triomphe l’âme, un cartilage d’oreille qui rougit, un nerf qui tressaille, une manière trop significative de déplier les paupières, une ride qui se creuse intempestivement, une parlante pression de lèvres, un éloquent tremblement dans la voix, une respiration qui se gêne. Que voulez-vous ! Le vice n’est pas parfait.
Donc, mon axiome subsiste. Il domine toute cette théorie ; il en prouve l’importance. La pensée est comme la vapeur. Quoi que vous fassiez, et quelque subtile qu’elle puisse être, il lui faut sa place, elle la veut, elle la prend, elle reste même sur le visage d’un homme mort. Le premier squelette que j’ai vu était celui d’une jeune fille morte à vingt-deux ans.
− Elle avait la taille fine et devait être gracieuse, dis-je au médecin.
Il parut surpris. La disposition des côtes et je ne sais quelle bonne grâce de squelette trahissait encore les habitudes de la démarche. Il existe une anatomie comparée morale, comme une anatomie comparée physique. Pour l’âme, comme pour le corps, un détail mène logiquement à l’ensemble. Il n’y a certes pas deux squelettes semblables ; et, de même que les poisons végétaux se retrouvent en nature, dans un temps voulu, chez l’homme empoisonné, de même les habitudes de la vie reparaissent aux yeux du chimiste moral, soit dans les sinus du crâne, soit dans les attachements des os de ceux qui ne sont plus.
Mais les hommes sont beaucoup plus naïfs qu’ils ne le croient, et ceux qui se flattent de dissimuler leur vie intime sont des faquins. Si vous voulez dérober la connaissance de vos pensées, imitez l’enfant ou le sauvage, ce sont vos maîtres.
En effet, pour pouvoir cacher sa pensée, il faut n’en avoir qu’une seule. Tout homme complexe se laisse facilement deviner. Aussi tous les grands hommes sont-ils joués par un être qui leur est inférieur.
L’âme perd en force centripète ce qu’elle gagne en force centrifuge.
Or, le sauvage et l’enfant font converger tous les rayons de la sphère dans laquelle ils vivent à une idée, à un désir ; leur vie est monophile, et leur puissance gît dans la prodigieuse unité de leurs actions.
L’homme social est obligé d’aller continuellement du centre à tous les points de la circonférence ; il a mille passions, mille idées, et il existe si peu de proportion entre sa base et l’étendue de ses opérations, qu’à chaque instant il est pris en flagrant délit de faiblesse.
De là le grand mot de William Pitt : « Si j’ai fait tant de choses, c’est que je n’en ai jamais voulu qu’une seule à la fois. »
De l’inobservation de ce précepte ministériel procède le naïf langage de la démarche. Qui de nous pense à marcher en marchant ? Personne. Bien plus, chacun se fait gloire de marcher en pensant.
Mais lisez les relations écrites par les voyageurs qui ont le mieux observé les peuplades improprement nommées sauvages ; lisez le baron de la Hontan, qui a fait les Mohicans avant que Cooper y songeât, et vous verrez, à la honte des gens civilisés, quelle importance les barbares attachent à la démarche. Le sauvage, en présence de ses semblables, n’a que des mouvements lents et graves ; il sait, par expérience, que plus les manifestations extérieures se rapprochent du repos, et plus impénétrable est la pensée.
De là cet axiome :
Le repos est le silence du corps.
Le mouvement lent est essentiellement majestueux.
Croyez-vous que l’homme dont parle Virgile, et dont l’apparition calmait le peuple en fureur, arrivait devant la sédition en sautillant ?
Ainsi nous pouvons établir en principe que l’économie du mouvement est un moyen de rendre la démarche et noble et gracieuse. Un homme qui marche vite ne dit-il pas déjà la moitié de son secret ? Il est pressé. Le docteur Gall a observé que la pesanteur de la cervelle, le nombre de ses circonvolutions, étaient, chez tous les êtres organisés, en rapport avec la lenteur de leur mouvement vital. Les oiseaux ont peu d’idées. Les hommes qui vont habituellement vite doivent avoir généralement la tête pointue et le front déprimé. D’ailleurs, logiquement, l’homme qui marche beaucoup arrive nécessairement à l’état intellectuel du danseur de l’Opéra.
Suivons.
Si la lenteur bien entendue de la démarche annonce un homme qui a du temps à lui, du loisir, conséquemment un riche, un noble, un penseur, un sage, les détails doivent nécessairement s’accorder avec le principe ; alors, les gestes seront peu fréquents et lents. De là cet autre aphorisme :
Tout mouvement saccadé trahit un vice, ou une mauvaise éducation.
N’avez-vous pas souvent ri des gens qui virvouchent ?
Virvoucher est un admirable mot du vieux français, remis en lumière par Lautour-Mézeray. Virvoucher exprime l’action d’aller et de venir, de tourner autour de quelqu’un, de toucher à tout, de se lever, de se rasseoir, de bourdonner, de tatillonner ; virvoucher, c’est faire une certaine quantité de mouvements qui n’ont pas de but ; c’est imiter les mouches.
Il faut toujours donner la clef des champs aux virvoucheurs ; ils vous cassent la tête ou quelque meuble précieux.
N’avez-vous pas ri d’une femme dont tous les mouvements de bras, de tête, de pied ou de corps, produisent des angles aigus ?
Des femmes qui vous tendent la main comme si quelque ressort faisait partir leur coude ?
Qui s’asseyent tout d’une pièce, ou qui se lèvent comme le soldat d’un joujou à surprise ?
Ces sortes de femmes sont très souvent vertueuses. La vertu des femmes est intimement liée à l’angle droit. Toutes les femmes qui ont fait ce que l’on nomme des fautes sont remarquables par la rondeur exquise de leurs mouvements. Si j’étais mère de famille, ces mots sacramentels de maître à danser : − Arrondissez les coudes, me feraient trembler pour mes filles.
De là cet axiome :
La grâce veut des formes rondes. Voyez la joie d’une femme qui peut dire de sa rivale : «Elle est bien anguleuse ! »
Mais, en observant les différentes démarches, il s’éleva dans mon âme un doute cruel, et qui me prouva qu’en toute espèce de science, même dans la plus frivole, l’homme est arrêté par d’inextricables difficultés ; il lui est aussi impossible de connaître la cause et la fin de ses mouvements que de savoir celles des pois chiches.
Ainsi, tout d’abord, je me demandai d’où devait procéder le mouvement. Hé ! Bien, il est aussi difficile de déterminer où il commence et où il finit en nous, que de dire où commence et où finit le grand sympathique, cet organe intérieur qui, jusqu’à présent, a lassé la patience de tant d’observateurs. Borelli lui-même, le grand Borelli, n’a pas abordé l’immense question. N’est-il pas effrayant de trouver tant de problèmes insolubles dans un acte vulgaire, dans un mouvement que huit cent mille parisiens font tous les jours ?
Il est résulté de mes profondes réflexions sur cette difficulté l’aphorisme suivant, que je vous prie de méditer :
Tout en nous participe du mouvement, mais il ne doit prédominer nulle part.
En effet, la nature a construit l’appareil de notre mobilité d’une façon si ingénieuse et si simple, qu’il en résulte, comme en toutes ses créations, une admirable harmonie ; et, si vous la dérangez par une habitude quelconque, il y a laideur et ridicule, parce que nous ne nous moquons jamais que des laideurs dont l’homme est coupable : nous sommes impitoyables pour des gestes faux, comme nous le sommes pour l’ignorance ou pour la sottise.
Ainsi, de ceux qui passèrent devant moi et m’apprirent les premiers principes de cet art jusqu’à présent dédaigné, le premier de tous fut un gros monsieur.
Ici, je ferai observer qu’un écrivain éminemment spirituel a favorisé plusieurs erreurs, en les soutenant par son suffrage. Brillat-Savarin a dit qu’il était possible à un homme gros de contenir son ventre au majestueux. Non. Si la majesté ne va pas sans une certaine amplitude de chair, il est impossible de prétendre à une démarche dès que le ventre a rompu l’équilibre entre les parties du corps. La démarche cesse à l’obésité. Un obèse est nécessairement forcé de s’abandonner au faux mouvement introduit dans son économie par son ventre qui la domine.
Henry Monnier aurait certainement fait la caricature de ce gros monsieur, en mettant une tête au-dessus d’un tambour et dessous les baguettes en X. Cet inconnu semblait, en marchant, avoir peur d’écraser des œufs. Assurément, chez cet homme, le caractère spécial de la démarche était complètement aboli. Il ne marchait pas plus que les vieux canonniers n’entendent. Autrefois, il avait eu le sens de la locomotion, il avait sautillé peut-être ; mais aujourd’hui le pauvre homme ne se comprenait plus marcher. Il me fit l’aumône de toute sa vie et d’un monde de réflexions. Qui avait amolli ses jambes ? D’où provenaient sa goutte, son embonpoint ? Étaient-ce les vices ou le travail qui l’avaient déformé ?
Triste réflexion ! Le travail qui édifie et le vice qui détruit produisent en l’homme les mêmes résultats. Obéissant à son ventre, ce pauvre riche semblait tordu. Il ramenait péniblement ses jambes, l’une après l’autre, par un mouvement traînant et maladif, comme un mourant qui résiste à la mort, et se laisse traîner de force par elle sur le bord de la fosse.
Par un singulier contraste, derrière lui venait un homme qui allait, les mains croisées derrière le dos, les épaules effacées, tendues, les omoplates rapprochées ; il était semblable à un perdreau servi sur une rôtie. Il paraissait n’avancer que par le cou, et l’impulsion était donnée à tout son corps par le thorax.
Puis, une jeune demoiselle, suivie d’un laquais, vint, sautant sur elle-même à l’instar des anglaises. Elle ressemblait à une poule dont on a coupé les ailes, et qui essaye toujours de voler. Le principe de son mouvement semblait être à la chute de ses reins. En voyant son laquais armé d’un parapluie, vous eussiez dit qu’elle craignait d’en recevoir un coup dans la partie d’où partait son quasi-vol. C’était une fille de bonne maison, mais très gauche, indécente le plus innocemment du monde.
Ensuite, je vis un homme qui avait l’air d’être composé de deux compartiments. Il ne risquait sa jambe gauche, et tout ce qui en dépendait, qu’après avoir assuré la droite et tout son système. Il appartenait à la faction des binaires. Évidemment son corps devait avoir été primitivement fendu en deux par une révolution quelconque, et il s’est miraculeusement mais imparfaitement ressoudé. Il avait deux axes, sans avoir plus d’un cerveau.
Bientôt ce fut un diplomate, personnage squelettique, marchant tout d’une pièce comme ces pantins dont Joly oublie de tirer les ficelles ; vous l’eussiez cru serré comme une momie dans ses bandelettes. Il était pris dans sa cravate comme une pomme dans un ruisseau par un temps de gelée. S’il se retourne, il est clair qu’il est fixé sur un pivot et qu’un passant l’a heurté.
Cet inconnu m’a prouvé la nécessité de formuler cet axiome :
Le mouvement humain se décompose en temps bien distincts ; si vous les confondez, vous arrivez à la roideur de la mécanique.
Une jolie femme, se défiant de la proéminence de son busc, ou gênée je ne sais par quoi, s’était transformée en Vénus callipyge et allait comme une pintade, tendant le cou, rentrant son busc, et bombant la partie opposée à celle sur laquelle appuyait le busc.
En effet, l’intelligence doit briller dans les actes imperceptibles et successifs de notre mouvement, comme la lumière et les couleurs se jouent dans les losanges des changeants anneaux du serpent. Tout le secret des belles démarches est dans la décomposition du mouvement.
Puis venait une dame qui se creusait également comme la précédente. Vraiment, s’il y en avait eu une troisième, et que vous les eussiez observées, vous n’auriez pas pu vous empêcher de rire des demi-lunes toutes faites par ces protubérances exorbitantes.
La saillie prodigieuse de ces choses, que je ne saurais nommer, et qui dominent singulièrement la question de la démarche féminine, surtout à Paris, m’a longtemps préoccupé. Je consultai des femmes d’esprit, des femmes de bon goût, des dévotes. Après plusieurs conférences où nous discutâmes le fort et le faible, en conciliant les égards dus à la beauté, au malheur de certaines conformations diaboliquement rondes, nous rédigeâmes cet admirable aphorisme :
En marchant, les femmes peuvent tout montrer, mais ne rien laisser voir.
− Mais certainement ! S’écria l’une des dames consultées, les robes n’ont été faites que pour cela.
Cette femme a dit une grande vérité. Toute notre société est dans la jupe. ôtez la jupe à la femme, adieu la coquetterie ; plus de passion. Dans la robe est toute sa puissance : là où il y a des pagnes, il n’y a pas d’amour. Aussi bon nombre de commentateurs, les massorets surtout, prétendent que la feuille de figuier de notre mère Ève était une robe de cachemire. Je le pense.
Je ne quitterai pas cette question secondaire sans dire deux mots sur une dissertation vraiment neuve qui eut lieu pendant ces conférences :
UNE FEMME DOIT-ELLE RETROUSSER SA ROBE EN MARCHANT ?
Immense problème, si vous vous rappelez combien de femmes empoignent sans grâce, au bas du dos, un paquet d’étoffe, et vont en faisant décrire, par en bas, un immense hiatus à leurs robes ; combien de pauvres filles marchent innocemment en tenant leurs robes transversalement relevées, de manière à tracer un angle dont le sommet est au pied droit, dont l’ouverture arrive au-dessus du mollet gauche, et qui laissent voir ainsi leurs bas bien blancs, bien tendus, le système de leurs cothurnes,et quelques autres choses. à voir les jupes de femmes ainsi retroussées, il semble que l’ont ait relevé par un coin le rideau d’un théâtre, et qu’on aperçoive les pieds des danseuses.
Et d’abord il passa en force de chose jugée que les femmes de bon goût ne sortaient jamais à pied par un temps de pluie ou quand les rues étaient crottées ; puis il fut décidé souverainement qu’une femme ne devait jamais toucher à sa jupe en public et ne devait jamais la retrousser sous aucun prétexte.
– Cependant, dis-je, s’il y avait un ruisseau à passer ?
− Eh ! Bien, monsieur, une femme comme il faut pince légèrement sa robe du côté gauche, la soulève, se hausse par un petit mouvement, et lâche aussitôt la robe. Ecco.
Alors je me souvins de la magnificence des plis de certaines robes ; alors je me rappelai les admirables ondulations de certaines personnes, la grâce des sinuosités, des flexuosités mouvantes de leurs cottes, et je n’ai pu résister à consigner ici ma pensée.
Il y a des mouvements de jupe qui valent un prix Monthyon.
Il demeure prouvé que les femmes ne doivent lever leur robe que très secrètement. Ce principe passera pour incontestable en France.
Et, pour en finir sur l’importance de la démarche en ce qui concerne les diagnostics, je vous prie de me pardonner une citation diplomatique.
La princesse de Hesse-Darmstadt amena ses trois filles à l’impératrice, afin qu’elle choisît entre elles une femme pour le grand-duc, dit un ambassadeur du dernier siècle, M.Mercy D’Argenteau. Sans leur avoir parlé, l’impératrice se décida pour la seconde. La princesse, étonnée, lui demanda la raison de ce bref jugement.
− Je les ai regardées toutes trois de ma fenêtre pendant qu’elles descendaient de carrosse, répondit l’impératrice. L’aînée a fait un faux pas ; la seconde est descendue naturellement ; la troisième a franchi le marchepied. L’aînée doit être gauche ; la plus jeune étourdie.
C’était vrai.
Si le mouvement trahit le caractère, les habitudes de la vie, les mœurs les plus secrètes, que direz-vous de la marche de ces femmes bien corsées, qui, ayant des hanches un peu fortes, les font monter, descendre alternativement, en temps bien égaux, comme les leviers d’une machine à vapeur, et qui mettent une sorte de prétention scander l’amour avec une détestable précision ?
Pour on bonheur, un agent de change ne manqua pas à passer sur ce boulevard, où trône la Spéculation. C’était un gros homme enchanté de lui-même, et tâchant de se donner de l’aisance et de la grâce. Il imprimait à son corps un mouvement de rotation qui faisait périodiquement rouler et dérouler sur ses cuisses les pans de sa redingote, comme la voluptueuse jaquette de la Taglioni quand, après avoir achevé sa pirouette, elle se retourne pour recevoir les bravos du parterre. C’était un mouvement de circulation en rapport avec ses habitudes. Il roulait comme son argent.
Il était suivi par une grande demoiselle qui, les pieds serrés, la bouche pincée, tout pincé, décrivait une légère courbe, et allait par petites secousses, comme si, mécanique imparfaite, ses ressorts étaient gênés, ses apophyses déjà soudées. Se mouvements avaient de la raideur, elle faillait à mon huitième axiome.
Quelques hommes passèrent, marchant d’un air agréable. Véritables modèles d’une reconnaissance de théâtre, ils semblaient tous retrouver un camarade de collège dans le citoyen paisible et insouciant qui venait à eux.
Je ne dirai rien de ces paillasses involontaires qui jouent des drames dans la rue ; mais je les prie de réfléchir à ce mémorable axiome :
Quand le corps est en mouvement, le visage doit être immobile.
Aussi vous peindrais-je difficilement mon mépris pour l’homme affairé, allant vite, filant comme une anguille dans sa vase, à travers les rangs serrés des flâneurs. Il se livre à la marche comme un soldat qui fait son étape. Généralement, il est causeur, il parle haut, s’absorbe dans ses discours ; s’indigne, apostrophe un adversaire absent, lui pousse des arguments sans réplique, gesticule, s’attriste, s’égaie. Adieu, délicieux mime, orateur distingué!
Qu’auriez-vous dit d’un inconnu qui communiquait transversalement à son épaule gauche le mouvement de la jambe droite, et réciproquement celui de la jambe gauche à l’épaule droite, par un mouvement de flux et de reflux si régulier, qu’à le voir marcher vous l’eussiez dit comparé à deux grands bâtons croisés qui auraient supporté un habit ? C’était nécessairement un ouvrier enrichi.
Les hommes condamnés à répéter le même mouvement par le travail auquel ils sont assujettis ont tous dans la démarche le principe locomotif fortement déterminé ; et il se trouve soit dans le thorax, soit dans les épaules. Souvent le corps se porte tout entier d’un seul côté. Habituellement, les hommes d’étude inclinent la tête. Quiconque a lu la Physiologie du goût doit se souvenir de cette expression : le nez à l’ouest, comme M Villemain. En effet, ce célèbre professeur porte sa tête avec une très spirituelle originalité, de droite à gauche.
Relativement au port de la tête, il y a des observations curieuses. Le menton en l’air à la Mirabeau est une attitude de fierté qui, selon moi, messied généralement. Cette pose n’est permise qu’aux hommes qui ont un duel avec leur siècle. Peu de personnes savent que Mirabeau prit cette audace théâtrale à son grand et immortel adversaire, Beaumarchais. C’étaient deux hommes également attaqués ; et, au moral comme au physique, la persécution grandit un homme de génie. N’espérez rien du malheureux qui baisse la tête, ni du riche qui la lève ; l’un sera toujours esclave, l’autre l’a été, celui-ci est un fripon, celui-là le sera.
Il est certain que les hommes les plus imposants ont tous légèrement penché leur tête à gauche. Alexandre, César, Louis Xiv, Newton, Charles Xii, Voltaire, Frédéric Ii et Byron affectaient cette attitude. Napoléon tenait sa tête droite et envisageait tout rectangulairement. Il y avait l’habitude en lui de voir les hommes, les champs de bataille et le monde moral en face.
Robespierre, homme qui n’est pas encore jugé, regardait aussi son assemblée en face. Danton continua l’attitude de Mirabeau. M De Chateaubriand incline la tête à gauche.
Après un mûr examen, je me déclare pour cette attitude. Je l’ai trouvée à l’état normal chez toutes les femmes gracieuses. La grâce (et le génie comporte la grâce) a horreur de la ligne droite. Cette observation corrobore notre sixième axiome.
Il existe deux natures d’hommes dont la démarche est incommutablement viciée : ce sont les marins et les militaires.
Les marins ont les jambes séparées, toujours prêtes à fléchir, à contracter. Obligés de se dandiner sur les tillacs pour suivre l’impulsion de la mer, à terre il leur est impossible de marcher droit. Ils louvoient toujours : aussi commence-t-on à en faire des diplomates.
Les militaires ont une démarche parfaitement reconnaissable. Presque tous campés sur leurs reins comme un buste sur son piédestal ; leurs jambes s’agitent sous l’abdomen, comme si elles étaient mues par une âme subalterne chargée de veiller au parfait gouvernement des choses d’en bas. Le haut du corps ne paraît point avoir conscience des mouvements inférieurs. à les voir marcher, vous diriez le torse de l’Hercule Farnèse posé sur des roulettes, et qu’on amène au milieu d’un atelier. Voici pourquoi : le militaire est constamment forcé de porter la somme totale de sa force dans le thorax ; il le présente sans cesse et se tient toujours droit. Or, pour emprunter à Amyot l’une de ses plus belles expressions, tout homme qui se dresse en pied pèse vigoureusement sur la terre afin de s’en faire un point d’appui, et il y a nécessairement dans le haut du corps un contrecoup de la force qu’il puise ainsi dans le sein de la mère commune. Alors l’appareil locomotif se scinde nécessairement chez lui. Le foyer du courage est dans sa poitrine. Les jambes ne sont plus qu’un appendice de son organisation.
Les marins et les militaires appliquent donc les lois du mouvement dans le but de toujours obtenir un même résultat, une émission de force par le plexus solaire et par les mains, deux organe que je nommerais volontiers les seconds cerveaux d e l’ homme, tant ils sont intellectuellement sensibles et fluidement agissants. Or la direction constante de leur volonté dans ces deux agents doit déterminer une spéciale atrophie de mouvement, d’où
procède la physionomie de leur corps.
Les militaires de terre et de mer sont les vivantes preuves des problèmes physiologiques qui ont inspiré cette théorie. La projection fluide de la volonté, son appareil intérieur, la parité de sa substance avec celle de nos idées, sa motilité flagrante, ressortent évidemment de ces dernières observations. Mais l’apparente futilité de notre ouvrage ne nous permet pas d’y bâtir le plus léger système. Ici, notre but est de poursuivre le cours des démonstrations physiques de la pensée, de prouver que l’on peut juger un homme sur son habit pendu à une tringle, aussi bien que sur l’aspect de son mobilier, de sa voiture, de ses chevaux, de ses gens, et de donner de sages préceptes aux gens assez riches pour se dépenser eux-mêmes dans la vie extérieure. L’amour, le bavardage, les dîners en ville, le bal, l’élégance de la mise, l’existence mondaine, la frivolité, comportent plus de grandeur que les hommes ne le pensent. De là cet axiome :
Tout mouvement exorbitant est une prodigalité sublime.
Fontenelle a touché barre d’un siècle à l’autre par la stricte économie qu’il apportait dans la distribution de son mouvement vital, il aimait mieux écouter que de parler ; aussi passait-il pour infiniment aimable. Chacun croyait avoir l’usufruit du spirituel académicien. Il disait des mots qui résumaient la conversation, et ne conversait jamais. Il connaissait bien la prodigieuse déperdition de fluide que nécessite le mouvement vocal. Il n’avait jamais haussé la voix dans aucune occasion de sa vie ; il ne parlait pas en carrosse, pour ne pas être obligé d’élever le ton. Il ne se passionnait point. Il n’aimait personne ; on lui plaisait.
Quand Voltaire se plaignit de ses critiques chez Fontenelle, le bonhomme ouvrit une grande malle pleine de pamphlets non coupés :
– Voici, dit-il au jeune Arouet, tout ce qui a été écrit contre moi. La première épigramme est de M. Racine le père.
Il referma la boîte.
Fontenelle a peu marché, il s’est fait porté pendant toute sa vie. Le président Rose lisait pour lui les éloges à l’Académie ; il avait ainsi trouvé moyen d’emprunter quelque chose à ce célèbre avare. Quand son neveu, M d’Aube, dont Rulhière a illustré la colère et la manie de disputer, se mettait à parler, Fontenelle fermait les yeux, s’enfonçait dans son fauteuil, et restait calme. Devant tout obstacle, il s’arrêtait. Lorsqu’il avait la goutte, il posait son pied sur un tabouret et restait coi. Il n’avait ni vertus, ni vices ; il avait de l’esprit. Il fit la secte des philosophes et n’en fut pas. Il n’avait jamais pleuré, jamais couru, jamais ri. Madame Du Deffand lui dit un jour :
– Pourquoi ne vous ai-je jamais vu rire ?
− Je n’ai jamais fait ha ! Ha ! Ha ! Comme vous autres, répondit-il, mais j’ai ri tout doucement, en dedans.
Cette petite machine délicate, tout d’abord condamnée à mourir, vécut ainsi plus de cent ans.
Voltaire dut sa longue vie aux conseils de Fontenelle.
− Monsieur, lui dit-il, faites peu d’enfantillages, ce sont des sottises.
Voltaire n’oublia ni le mot, ni l’homme, ni le principe, ni le résultat. à quatre-vingts ans, il prétendait n’avoir pas fait plus de quatre-vingts sottises. Aussi Madame Du Châtelet remplaça-t-elle le portrait du sire de Ferney par celui de Saint-Lambert.
Avis aux hommes qui virvouchent, qui parlent, qui courent, et qui, en amour, pindarisent, sans savoir de quoi il s’en va.
Ce qui nous use le plus, ce sont nos convictions. Ayez des opinions, ne les défendez pas, gardez-les ; mais des convictions ! Grand dieu ! Quelle effroyable débauche ! Une conviction politique ou littéraire est une maîtresse qui finit par vous tuer avec l’épée ou avec la langue. Voyez le visage d’un homme inspiré par une conviction forte : il doit rayonner. Si jusqu’ici les effluves d’une tête embrasée n’ont pas été visibles à l’œil nu, n’est-ce pas un fait admis en poésie, en peinture ? Et s’il n’est pas encore prouvé physiologiquement, certes il est probable. Je vais plus loin et crois que les mouvements de l’homme font dégager un fluide animique. Sa transpiration est la fumée d’une flamme inconnue. De là vient la prodigieuse éloquence de la démarche, prise comme ensemble des mouvements humains.
Voyez :
Il y a des hommes qui vont la tête baissée, comme celle des chevaux de fiacre. Jamais un riche ne marche ainsi, à moins qu’il ne soit un misérable ; alors il a de l’or, mais il a perdu ses fortunes de cœur.
Quelques hommes marchent en donnant à leur tête une pose académique. Ils se mettent toujours de trois quarts, comme M. l’ancien ministre des affaires étrangères ; ils tiennent leur buste immobile et leur cou tendu. On croirait voir des plâtres de Cicéron, de Démosthène, de Cujas, allant par les rues. Or, si le fameux Marcel prétendait justement que la mauvaise grâce consiste à mettre de l’effort dans les mouvements, que pensez-vous de ceux qui prennent l’effort comme type de leur attitude ?
D’autres paraissent n’avancer qu’à force de bras ; leurs mains sont des rames dont ils s’aident pour naviguer : ce sont les galériens de la démarche.
Il y a des niais qui écartent trop leurs jambes, et sont tout surpris de voir passer sous eux les chiens courant après leurs maîtres. Selon Pluvinel, les gens ainsi conformés font d’excellents cavaliers.
Quelques personnes marchent en faisant rouler, à la manière d’Arlequin, leur tête, comme si elle ne tenait pas.
Puis il y a des hommes qui fondent comme des tourbillons ; ils font du vent, ils paraphrasent la bible ; il semble que l’esprit du seigneur vous ait passé devant la face si vous rencontrez ces sortes de gens. Ils vont comme tombe le couteau de l’exécuteur. Certains marcheurs lèvent une jambe précipitamment et l’autre avec calme : rien n’est plus original. D’élégants promeneurs font une parenthèse en appuyant le poing sur la hanche, et accrochent tout avec leur coude. Enfin, les uns sont courbés, les autres sont déjetés ; ceux-ci donnent de la tête de côté et d’autre, comme des cerfs-volants indécis ; ceux-là portent le corps en arrière ou
en avant. Presque tous se retournent gauchement.
Arrêtons-nous.
Autant d’hommes autant de démarches ! Tenter de les décrire complètement, ce serait vouloir rechercher toutes les désinences du vice, tous les ridicules de la société, parcourir le monde dans ses sphères basses, moyennes, élevées. J’y renonce. Sur deux cent cinquante-quatre personnes et demie (car je compte un monsieur sans jambes pour une fraction) dont j’analysai la démarche, je ne trouvai pas une personne qui eût des mouvements gracieux et naturels.
Je revins chez moi désespéré.
− La civilisation corrompt tout ! Elle adultère tout, même le mouvement ! Irai-je faire un voyage autour du monde pour examiner la démarche des sauvages ?
Au moment où je disais ces tristes et amères paroles, j’étais à ma fenêtre, regardant l’arc de triomphe de l’étoile,
que les grands ministres à petites idées qui se sont succédés, depuis M. Montalivet le père jusqu’à M. Montalivet le fils, n’ont encore su comment couronner, tandis qu’il serait si simple d’y placer l’aigle de Napoléon, magnifique symbole de l’empire, un aigle colossal aux ailes étendues, le bec tourné vers son maître. Certain de ne jamais voir faire cette sublime économie, j’abaissai les yeux sur mon modeste jardin, comme un homme qui perd une espérance. Sterne a, le premier, observé ce mouvement funèbre chez les hommes obligés d’ensevelir leurs illusions. Je pensais à la magnificence avec laquelle les aigles déploient leurs ailes, démarche pleine d’audace, lorsque je vis une chèvre jouant en compagnie d’un jeune chat sur le gazon. En dehors du jardin se trouvait un chien qui, désespéré de ne pas faire sa partie, allait, venait, jappait, sautait. De temps à autre, la chèvre et le chat s’arrêtaient pour le regarder par un mouvement plein de commisération. Je pense vraiment que plusieurs bêtes sont chrétiennes pour compenser le nombre de chrétiens qui sont bêtes.
Vous me croyez sorti de la Théorie de la Démarche. Laissez-moi faire.
Ces trois animaux étaient si gracieux, qu’il faudrait pour les peindre tout le talent dont Ch. Nodier a fait preuve dans la mise en scène de son lézard, son joli kardououn, allant, venant au soleil, traînant à son trou les pièces d’or qu’il prend pour des tranches de carottes séchées. Aussi, certes, y renoncerai-je ! Je fus stupéfait en admirant le feu des mouvements de cette chèvre, la finesse alerte du chat, la délicatesse des contours que le chien imprimait à sa tête et à son corps. Il n’y a pas un animal qui n’intéresse plus qu’un homme quand on l’examine un peu philosophiquement. Chez lui, rien n’est faux ! Alors je fis un retour sur moi-même ; et les observations relatives à la démarche que j’entassais depuis plusieurs jours furent illuminées par une lueur bien triste. Un démon moqueur me jeta cette horrible phrase de Rousseau : L’HOMME QUI PENSE EST UN ANIMAL DÉPRAVÉ !
Alors, en songeant derechef au port constamment audacieux de l’aigle, à la physionomie de la démarche de chaque animal, je résolus de puiser les vrais préceptes de ma théorie dans un examen approfondi de actu animalium. J’étais descendu jusqu’aux grimaces de l’homme, je remontai vers la franchise de la nature. Et voici le résultat de mes recherches anatomiques sur le mouvement :
Tout mouvement a une expression qui lui est propre et qui vient de l’âme. Les mouvements faux tiennent essentiellement à la nature du caractère ; les mouvements gauches viennent des habitudes. La grâce a été définie par Montesquieu, qui, ne croyant parler que de l’adresse, a dit en riant : « C’est la bonne disposition des forces que l’on a. »
Les animaux sont gracieux dans leurs mouvements, en ne dépensant jamais que la somme de force nécessaire pour atteindre à leur but. Ils ne sont jamais ni faux ni gauches, en exprimant avec naïveté leur idée. Vous ne vous tromperez jamais en interprétant les gestes d’un chat : vous voyez s’il veut jouer, fuir, ou sauter.
Donc, pour bien marcher, l’homme doit être droit sans raideur, s’étudier à diriger ses deux jambes sur une même ligne, ne se porter sensiblement ni à droite ni à gauche de son axe, faire participer imperceptiblement tout son corps au mouvement général, introduire dans sa démarche un léger balancement qui détruise par son oscillation régulière la secrète pensée de la vie, incliner la tête, ne jamais donner la même attitude à ses bras quand il s’arrête. Ainsi marchait Louis XIV. Ces principes découlent des remarques faites sur ce grand type de la royauté par les écrivains qui, heureusement pour moi, n’ont vu en lui que son extérieur.
Dans la jeunesse, l’expression des gestes, l’accent de la voix, les efforts de la physionomie, sont inutiles. Alors vous n’êtes jamais aimables ; spirituels, amusants incognito. Mais, dans la vieillesse, il faut déployer plus attentivement les ressources du mouvement ; vous n’appartenez au monde que par l’utilité dont vous êtes au monde. Jeunes, on nous voit ; vieux, il faut nous faire voir : cela est dur, mais cela est vrai.
Le mouvement doux est à la démarche ce que le simple est au vêtement. L’animal se meut toujours avec douceur à l’état normal. Aussi rien n’est-il plus ridicule que les grands gestes, les secousses, les voix hautes et flûtées, les révérences pressées. Vous regardez pendant un moment les cascades ; mais vous restez des heures entières au bord d’une profonde rivière ou devant un lac. Aussi un homme qui fait beaucoup de mouvement est-il comme un grand parleur ; on le fuit. La mobilité extérieure ne sied à personne ; il n’y a que les mères qui puissent supporter l’agitation de leurs enfants.
Le mouvement humain est comme le style du corps : il faut le corriger beaucoup pour l’amener à être simple. Dans ses actions comme dans ses idées, l’homme va toujours du composé au simple. La bonne éducation consiste à laisser aux enfants leur naturel, et à les empêcher d’imiter l’exagération des grandes personnes.
Il y a dans les mouvements une harmonie dont les lois sont précises et invariables. En racontant une histoire, si vous élevez la voix subitement, n’est-ce pas un coup d’archet violent qui affecte désagréablement les auditeurs ? Si vous faites un geste brusque, vous les inquiétez. En fait de maintien, comme en littérature, le secret du beau est dans les transitions.
Méditez ces principes, appliquez-les, vous plairez. Pourquoi ? Personne ne le sait. En toute chose, le beau se sent et ne se définit pas.
Une belle démarche, des manières douces, un parler gracieux, séduisent toujours et donnent à un homme médiocre d’immenses avantages sur un homme supérieur. Le bonheur est un grand sot, peut-être ! Le talent comporte en toute chose d’excessifs mouvements qui déplaisent ; et un prodigieux abus d’intelligence qui détermine une vie d’exception.
L’abus soit du corps, soit de la tête, éternelle plaie des sociétés, cause ces originalités physiques, ces déviations, dont nous allons nous moquant sans cesse. La paresse du turc, assis sur le Bosphore et fumant sa pipe, est sans doute une grande sagesse. Fontenelle, ce beau génie de la vitalité, qui devina les petits dosages du mouvement, l’homéopathie de la démarche, était essentiellement Asiatique.
– Pour être heureux, a-t-il dit, il faut tenir peu d’espace, et peu changer de place.
Donc, la pensée est la puissance qui corrompt notre mouvement, qui nous tord le corps, qui le fait éclater sous ses despotiques efforts. Elle est le grand dissolvant de l’espèce humaine.
Rousseau l’a dit, Goethe l’a dramatisé dans Faust, Byron l’a poétisé dans Manfred. Avant eux, l’Esprit-Saint s’est prophétiquement écrié sur ceux qui vont sans cesse : « Qu’ils soient comme des roues ! »
Je vous ai promis un véritable non-sens au fond de cette théorie, j’y arrive.
Depuis un temps immémorial, trois faits ont été parfaitement constatés, et les conséquences qui résultent de leur rapprochement ont été principalement pressenties par Van Helmont, et avant lui par Paracelse, qu’on a traité de charlatan. Encore cent ans, et Paracelse deviendra peut-être un grand homme!
La grandeur, l’agilité, la concrétion, la portée de la pensée humaine, le génie, en un mot, est incompatible :
Avec le mouvement digestif,
Avec le mouvement corporel,
Avec le mouvement vocal ;
Ce que prouvent en résultat les grands mangeurs, les danseurs et les bavards ; ce que prouvent en principe le silence ordonné par Pythagore, l’immobilité presque constante des plus illustres géomètres, des extatiques, des penseurs, et la sobriété nécessaire aux hommes d’énergie intellectuelle.
Balzac
Théorie de la démarche, 1833
Théorie de la démarche, 1833
À quoi, si ce n’est à une substance électrique, peut-on attribuer la magie avec laquelle la volonté s’intronise si majestueusement dans le regard, pour foudroyer les
obstacles aux commandements du génie, ou filtre, malgré nos hypocrisies, au travers de l’enveloppe humaine ? Histoire intellectuelle de Louis Lambert, Balzac
What Shall We Do Next ? (Sequence #3)
Performance
COLLECTION DES CURIOSITÉS




Julien Prévieux
What Shall We Do Next? (Sequence #3), Performance live, 2014
Danseurs : Kestrel Leah, Jos McKain, Samantha Mohr, Andrew Pearson
Courtesy galerie Jousse entreprise
What Shall We Do Next? (Sequence #3), Performance live, 2014
Danseurs : Kestrel Leah, Jos McKain, Samantha Mohr, Andrew Pearson
Courtesy galerie Jousse entreprise
« On connaît la célèbre formule de William Gibson : « Le futur est déjà là – simplement, il n’est pas distribué de façon homogène ». Régulièrement des gestes sont déposés auprès de l’administration américaine USPTO. On peut faire l’hypothèse suivante : ces brevets définissent une gestuelle que nous serons amenés à exécuter dans quelques années quand les outils seront commercialisés. What Shall We Do Next? prend comme point de départ une archive de ces brevets constituée depuis 2006.
L’œuvre se déploie sous la forme d’un film d’animation en 3D, d’un film et d’un ensemble de performances réalisés avec des danseurs dans lesquels les schémas des brevets sont considérés comme autant de partitions chorégraphiques qui, lorsqu’elles sont incarnées, pourraient bien donner à voir nos comportements à venir. »
Pour voir son site cliquez ici
Nager marcher courir
COLLECTION DES CURIOSITÉS
Autrefois on nous apprenait à plonger après avoir nagé. Et quand on nous apprenait à plonger, on nous apprenait à fermer les yeux, puis à les ouvrir dans l'eau. Aujourd'hui la technique est inverse. On commence tout l'apprentissage en habituant l'enfant à se tenir dans l'eau les yeux ouverts. Ainsi, avant même qu'ils nagent, on exerce les enfants surtout à dompter des réflexes dangereux mais instinctifs des yeux, on les familiarise avant tout avec l'eau, on inhibe des peurs, on crée une certaine assurance, on sélectionne des arrêts et des mouvements. Il y a donc une technique de la plongée et une technique de l'éducation de la plongée qui ont été trouvées de mon temps. Et vous voyez qu'il s'agit bien d'un enseignement technique et qu'il y a, comme pour toute technique, un apprentissage de la nage. D'autre part, notre génération, ici, a assisté à un changement complet de technique : nous avons vu remplacer par les différentes sortes de crawl la nage à brasse et à tête hors de l'eau. De plus, on a perdu l'usage d'avaler de l'eau et de la cracher. Car les nageurs se considéraient, de mon temps, comme des espèces de bateaux à vapeur. C'était stupide, mais enfin je fais encore ce geste : je ne peux pas me débarrasser de ma technique. Voilà donc une technique du corps spécifique, un art gymnique perfectionné de notre temps.[...]
Une sorte de révélation me vint à l'hôpital. J'étais malade à New York. Je me demandais où j'avais déjà vu des demoiselles marchant comme mes infirmières. J'avais le temps d'y réfléchir. Je trouvai enfin que c'était au cinéma. Revenu en France, je remarquai, surtout à Paris, la fréquence de cette démarche ; les jeunes filles étaient Françaises et elles marchaient aussi de cette façon. En fait, les modes de marche américaine, grâce au cinéma, commençaient à arriver chez nous. C'était une idée que je pouvais généraliser. La position des bras, celle des mains pendant qu'on marche forment une idiosyncrasie sociale, et non simplement un produit de je ne sais quels agencements et mécanismes purement individuels, presque entièrement psychiques. Exemple : je crois pouvoir reconnaître aussi une jeune fille qui a été élevée au couvent. Elle marche, généralement, les poings fermés. Et je me souviens encore de mon professeur de troisième m'interpellant : « Espèce d'animal, tu vas tout le temps tes grandes mains ouvertes ! » Donc il existe également une éducation de la marche. Autre exemple : il y a des positions de la main, au repos, convenables ou inconvenantes. Ainsi vous pouvez deviner avec sûreté, si un enfant se tient à table les coudes au corps et, quand il ne mange pas, les mains aux genoux, que c'est un Anglais. Un jeune Français ne sait plus se tenir: il a les coudes en éventail : il les abat sur la table, et ainsi de suite. En fin, sur la course, j'ai vu aussi, vous avez tous vu, le changement de la technique. Songez que mon professeur de gymnastique, sorti un des meilleurs de Joinville, vers 1860, m'a appris à courir les poings au corps : mouvement complètement contradictoire à tous les mouvements de la course ; il a fallu que je voie les coureurs professionnels de 1890 pour comprendre qu'il fallait courir autrement.
Marcel Mauss
Les Techniques du corps
1934
Les Techniques du corps
1934
La langue du poulpe
COLLECTION DES CURIOSITÉS
Texte trouvé par Hubert Lambert et adressé par lui à Maria Rantin, afin qu'il lui serve d'exemple dans sa description désespérée et de l'œil et de la langue de la femme de Côte d'Azur et du texte abandonnée par elle dans sa maison de Bécon les Bruyères et retrouvé par Hubert Lambert.
Dans sa description, Buffon englobe poulpe, calmar et sèche, ne notant que lorsque cela s’avère nécessaire leurs distinctions.
Au centre de ces dix bras, dans leur enfoncement, on voit une ouverture parfaitement arrondie en forme de cercle, bordée en saillie par une extension de la peau ; ce cercle saillant et charnu, lisse et uni dans son état de repos, se fronce quelquefois en forme de bourse ou de festons ; c’est la bouche. On pourrait comparer la saillie des chairs que recouvre cette peau aux lèvres des autres animaux si cette ouverture et son rebord n’offraient pas un cercle parfait sans fente latérale ou points de scission et de repos. Du milieu de ces lèvres on voit percer un bec qu’elles recouvrent presque entièrement ; il est très enfoncé dans la bouche, montrant à peine le quart de sa grandeur : sa couleur est brune et se rapproche de celle de marron foncé ; il est formé en bec de perroquet composé de deux pièces, l’une supérieure, l’autre inférieure ; elles agissent en tenaille l’une contre l’autre ; parfaitement mobiles, elles s’enchâssent exactement et se serrent de telle manière que l’inférieure est emboîtée hermétiquement dans la cavité du bec supérieure et crochu ; leurs bases sont travaillées en chape pour s’implanter avec plus de solidité dans les muscles qui remplissent la fonction de gencives ; et indépendamment de cette forme particulière, la base du bec inférieur est encore évidée de façon à permettre à la langue de s’y mouvoir facilement. Après la mort de l’animal, pour peu qu’on le manie ou qu’on le tourmente, ce bec se détache en abandonnant, sans aucune déchirure, les chairs qui l’enclavaient dans ses bases ; sa substance est cornée et fibreuse ; c’est avec le bec supérieur que la sèche pince ; elle le fait avec ténacité, et presque tous les auteurs anciens ont affirmé que sa morsure était venimeuse. Le contact de ses bras l’est à coup sûr, mais je doute que sa morsure le soit, quoique inutilement j’ai essayé de me faire mordre par des sèches qui périssent aussitôt qu’elles sont livrées aux influences de l’air ambiant, et qui d’ailleurs fuient la main de l’homme ; mais j’ai été mordu comme on le verra par un poulpe, et la blessure que me fit sa morsure fut guérie avant que le sentiment de la douleur fut entièrement apaisé sur les parties de mon corps qu’il avait enlacé de ses bras.
Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière des mollusques, animaux sans vertèbres et à sang blanc, « Histoire des sèches », 1802, p. 198-199