Fenêtre empêchée
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
SUR LA LUMIÈRE
Fenêtre empêchée
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
SUR LA LUMIÈRE
Fenêtre empêchée
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Une fois en prison, plus qu’à la couleur des murs, je me suis attaché à observer la fenêtre de la cellule. Rien d’étonnant. Déjà, du temps de ma liberté, quand je visitais des appartements, la première chose que je faisais c’était aller vers la fenêtre et regarder dehors, drôle de manière de visiter, mais ma manière. Je lisais les petites annonces, collocation ou pas collocation. Il y en avait une qui m’avait particulièrement attiré : « Je mets à dispo une chambre grande 15 m², deux fenêtres, parquet neuf, blanc, avec mobiliers, lit non compris. » C’étaient les deux fenêtres qui m’avaient plu. Ça avait l’air propre, clean. Là, c’était autre chose ; sans que j’aie eu besoin de chercher, on avait mis à ma disposition une cellule de 9 m² avec une seule fenêtre, si on pouvait appeler ça « fenêtre », il y avait un lit-couchette et tout était gris. Je n’étais plus en train de faire une visite d’appart.
Alors à quoi bon aller vers la fenêtre et regarder au dehors ; pour y voir quoi ? D’autres murs ? Je regardais la fenêtre de loin, c’est-à-dire que je regardais la fenêtre pour elle-même, pas pour ce qu’elle aurait pu permettre de voir si elle n’avait pas été une fenêtre de cellule de prison. Pas parce qu’elle représentait le symbole de la liberté, de l’aérien ; pas parce qu’elle aurait pu permettre de voir le ciel et de m’évader par l’esprit ; pas parce qu’elle permettait de voir les vols des oiseaux, des avions et d’échafauder des projets farfelus d’évasion ; pas parce qu’elle permettait de voir la pluie ou la neige tomber, ou le soleil éclater, ce qui aurait été la même chose que de partager un bout du monde avec le reste de l’humanité. Non, je laisse tout cela aux faiseurs de sentiments.
La fenêtre était un mur, différent des autres, mais un mur comme les autres. Je la regardais pour lui faire face et pour l’interroger sur la lumière qu’elle me donnait. Pour essayer de retrouver dans sa forme l’intention de la prison. A quelle part de ciel avions nous-droit ? Comment cette part avait-elle été calculée ? La hauteur par rapport au sol, par rapport au plafond disait quelque chose de ce que l’homme pensait de l’homme, sa taille, sa corpulence, sa capacité à se hausser sur la pointe des pieds et, ce, pendant quel laps de temps ; sa capacité à résister à la tentation de se pendre au barreau horizontal ou vertical selon ce que l’architecte avait désiré lui suggérer (la tentation est plus grande puisque l’acte est plus facile avec le barreau horizontal); à repasser dans sa tête toutes les sortes de fenêtres qu’il avait pu rencontrer dans sa vie ; fenêtre sur quel mur, dans quelle pièce, dans quel bâtiment ?
Elle me donnait une lumière chiche, ou plus exactement elle éclairait avec intensité une partie seulement de la pièce ; elle filtrait les rayons lumineux, elle les dirigeait sur un angle ou un autre suivant les moments du jour, mais jamais elle n’éclairait la pièce dans son entier. Même dans cette prison archi-moderne, elle continuait à prendre comme modèle le soupirail de cachot. Elle chichait sa lumière.
Sophie Saulnier,
Un roman moderne ou le manuscrit du massicot, ch. « Echappées »
(à paraître aux Éditions du Lampadaire).
Un roman moderne ou le manuscrit du massicot, ch. « Echappées »
(à paraître aux Éditions du Lampadaire).
EXTRAIT 2
Par exemple je me souviens encore de l’article 16 de je ne sais plus quel code.
« 16. Dans tout local où les détenus sont appelés à vivre ou à travailler :
a) les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que le détenu puisse notamment lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais, sauf s’il existe un système de climatisation approprié. En outre, les fenêtres doivent, compte tenu des exigences de sécurité, présenter par leurs dimensions, emplacement et construction, une apparence aussi normale que possible ;
b) la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques admises en la matière. »
Aucune mention de la couleur des murs ici. De la lumière et de l’air frais, certes, mais où est la couleur ? Où la pensée pourrait-elle se poser ? On dirait qu’ils parlent de plantes, de plantes sans âme : besoin d’air et de lumière, oui, mais où est la préoccupation du rythme de la pensée posée, du travail que le détenu doit effectuer sur lui-même, en lui-même, du poids de sa pensée, de la juste pesée qu’il doit enfin apprendre à faire de ses actes criminels. « Lire et travailler », c’est pour ça qu’on est en prison ? Ah quoi bon ? Je fais ça chez moi très bien, avec des vrais fenêtres qui ouvrent et qui ferment, qui laissent passer l’air, et les mouches, et qui me laissent sortir et aller dans le jardin. Mes fenêtres sont des portes, et mes portes des fenêtres. Aucune porte ne ferme à clé, et aucune porte n’est une vraie porte. Et j’ai le silence aussi chez moi, la couleur et le silence. Enfin parfois.
Cet article 16, c’était mon préféré, je me le récitais tous les soirs : « aussi normale que possible », cette formulation m’a plu d’emblée, je la répétais et la répétais « aussi normale que possible », « être aussi normale que possible ».
Comment vous adaptez ça à l’univers de la prison, vous ? Une fenêtre aussi normale que possible compte tenu de la situation. Une fenêtre qui fait semblant d’être normale, de faire comme si elle remplissait ses fonctions normales dans des conditions normales. Ma fenêtre ne faisait pas semblant d’être normale, c’était une fenêtre honnête, elle ne mentait pas, elle me disait : « Tu es en prison, et je suis une fenêtre de prison, alors pas touche ! Et ne fais pas comme l’autre pignouf d’à côté, le locataire de la cellule 230, un blanc bec délirant. Il a jugé bon de lancer un forum de discussion sur les fenêtres de prison ! ou plutôt, soyons précis, sur le rapport qu’entretiennent les détenus avec leur fenêtre. Quelle grandiloquence, quelle prétention dans la recherche ! Ne t’avise surtout pas de jouer à ce petit jeu, c’est un jeu mortel. Je suis ta fenêtre pour un bon bout de temps, et notre relation ne concerne que nous. Ne t’avise pas d’en parler. D’ailleurs, lui, le 230, qu’est-ce que ça lui a rapporté ? Il s’est fait insulter par tous ceux qui ont répondu à son forum pourri, et ils n’étaient pas nombreux ! Que du mépris, c’est tout ce que ça lui a rapporté. Et maintenant, le blanc bec est en quarantaine, personne ne lui adresse plus la parole, ni par oral ni par écrit, son matricule est supprimé du forum. Il n’existe plus. Anéanti. Fini.»
J’ai compris, et je l’ai étudiée en silence. Mais je l’ai étudiée oui, face à face. Front contre front. Et ne pensez pas que c’était moi que je cherchais à voir sur sa surface vitrée, ni que j’attendais le soir pour y voir mon reflet. Il n’y avait rien à voir ni au-dehors, ni au-dedans ; aucune vue sur les autres, aucune image de soi. Une fenêtre silencieuse ; silencieuse et aveugle, contrairement aux fenêtres ordinaires ; par ordinaires je veux dire normales, je veux dire pas des fenêtres de prison, mais les fenêtres que l’article 16 leur demande d’imiter, les fenêtres auxquelles celles de prison rêveraient de ressembler. Comprenez bien. La fonction qui leur est dévolue par l’administration pénitentiaire va contre leur essence même. En prison, dans leur cellule, elles deviennent des fenêtres contre-nature.
L’habitant d’une maison peut être trahi par ses fenêtres, ai-je entendu dire un jour. Vous vous rendez-compte ? Une traitresse fenêtre ! Mais qu’aurait-elle pu trahir de moi ? J’avais déjà été trahi. Trahir dans le sens où elle dirait quelque chose de moi ? Comme la fenêtre rustique trahit les goûts rustiques de son propriétaire ? Ma fenêtre n’avait rien à trahir, ce n’était pas moi qui l’avait choisie. Elle ne pouvait que dire « je suis une fenêtre de prison, si j’ai des choses à dire c’est sur la prison, c’est sur mon malheur, mais rien sur ce détenu là, ni sur quelque détenu que ce soit. »
La situation était inversée : c’était elle qui avait peur que je la trahisse. Et c’est en cela qu’elle représentait un danger pour moi.
Sophie Saulnier,
Un roman moderne ou le manuscrit du massicot, ch. « Echappées »
(à paraître aux Éditions du Lampadaire).
Un roman moderne ou le manuscrit du massicot, ch. « Echappées »
(à paraître aux Éditions du Lampadaire).
EXTRAIT 3
J’ai commencé la filature, devrais-je dire la surveillance ? Je me suis installée dans une pièce dont la fenêtre donnait sur votre maison. Pour vous surveiller. Et c’est là que mes problèmes ont commencé. Si ça ne vous fait rien, je les évoquerai rapidement ; ils me restent douloureux.
J’étais dans une chambre minuscule, rivée à ma fenêtre. Une persienne me permettait de voir sans être vue. On voit mieux à travers une persienne que par une fenêtre grande ouverte. La vision est plus nette, plus claire, comme le prouvent les nombreuses photos que j’ai prises et que je vous montrerai si vous le désirez ; ce sont des photos de vous, de votre vie, de votre maison. Peut-être entendiez-vous le déclic de l’appareil, et vous demandiez-vous ce qu’était ce bruit qui ne vous appartenait pas ; peut-être vous inquiétait-il.
Vous sortiez très peu. Je me suis retrouvée comme dans une prison, enfermée dans une cellule à espérer une libération qui ne venait pas, une levée d’écrou impossible. Je faisais l’expérience de la prison, de la prison dont vous feriez l’expérience plus tard, Steve. J’étais votre doublure, Steve ; en tous points identiques. Votre futur. Sauf pour l’usage de la fenêtre puisque, vous, vous l’avez tout de suite rejetée, alors qu’elle était indispensable à l’accomplissement de ma tâche. Techniquement indispensable. Elle voulait m’aider, jouer la transparence, me permettre la visibilité, mais je l’obturais, je voulais l’invisibilité. Elle me mettait hors de moi. Je voulais être en moi. C’était une lutte de tous les instants. Une contradiction insupportable. Une déchirure de tout mon être. Je ne devais pas faire de bruit, pas de gestes, même ma respiration risquait de troubler l’air qui nous entourait, car nous respirions le même air, Steve, le même air. Mais aussi immobile soit-on, rien n’empêche la pensée de divaguer. Ma cellule elle-même me faisait peur, comme si elle eût été le témoin de mes pensées. C’est ce que vous avez écrit, Saint Jérôme, et bien c’était tout pareil pour moi. Elle devenait vivante et de plus en plus hostile. Ce fut une vraie épreuve. Presque une traversée du désert. Je ne suis pas idiote, j’ai bien compris que je me retrouvais dans votre situation, Saint Jérôme, une épreuve dans la solitude face à ses péchés, aux péchés du monde.
De solitude à solitude, Steve.
De l’un à son double.
S’épier soi-même est-ce si facile ?
J’ai attendu ma vision.
Elle n’est pas venue. Pourtant j’ai souffert ce qu’il fallait. Mais elle n’est pas venue. Je vous envie SJ pour votre bastonnade et votre sainteté.
Puisque rien ne se passait, j’ai joué au destin et j’ai fait sortir SS de son trou par le procédé dont je vous ai parlé tout à l’heure.
La manière dont j’ai ramené les manuscrits à JC, je vous l’ai déjà dite.
Sophie Saulnier,
Un roman moderne ou le manuscrit du massicot,
ch. « Filatures » (à paraître aux Éditions du Lampadaire).
Un roman moderne ou le manuscrit du massicot,
ch. « Filatures » (à paraître aux Éditions du Lampadaire).
Portraits en pleine lumière
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
La photo
Lucie Pastureau,
Série, à contre-ciel 2011.
Le récit
Joseph Pasdeloup,
La défense de Pasiphaé 2013

LA DÉFENSE DE PASIPHAÉ
Elle tient son fil. Elle s’appelle bien sûr Ariane. Elle a le soleil en plein sur le visage. C’est sa mère, l’opulente Pasiphaé, qui en dirige les rayons droit sur elle parce que la mère ne veut pas que la fille voie Thésée, ni que Thésée ne la voie. Une gringalette, poussée trop vite et qui ne sait même pas s’habiller – moitié blanc moitié vert, quelle idée pour une crétoise ; d’où sort-elle ce vert ? D’où sort-elle cette folie de vouloir se couper en deux ? Nous qui n’aimions que les frises et les entrelacs géométriques. Où sont ses bijoux de princesse, l’or et les émeraudes que Minos lui a offerts ? Renierait-elle ses origines ? Ces deux modestes liens dont elle a entouré ses poignets et qui brillent à peine au soleil ne peuvent suffire à faire montre de sa gloire. Ne voudrait-elle plus être ma fille ? – et qui a des prétentions. Des prétentions à la séduction, une séduction à sa manière, toute plate, faite de naïveté et sans doute de bêtise.
Elle risquerait bien de me voler Thésée. Telle est la crainte de Pasiphaé.
Si je l’éblouis, pense Pasiphaé, si je l’éblouis suffisamment longtemps, elle deviendra aveugle, les yeux blancs tournés vers l’intérieur, et personne jamais ne l’aimera, ou ne fera semblant de l’aimer, et je garderai Thésée, et je garderai la petite Phèdre. J’ai inventé le Minotaure, je pourrai inventer un autre monstre. C’est bien de faire de ses enfants des monstres. Pour la petite Phèdre, je verrai après, j’ai encore le temps de trouver une idée. Occupons-nous d’Ariane et de son fil.
J’en ferai un monstre magnifique, c’est surtout ça qu’il faut réussir. Un monstre qui me magnifie. Et qu’il me faudra défendre envers et contre tous. C’est le rôle d’une mère de défendre ses enfants envers et contre tous, c’est sa noblesse, surtout quand c’est elle qui a décidé, en toute connaissance de cause, de leur destin. Je ne peux défendre que ce que j’ai voulu. Comment défendre une Ariane destinée à n’être qu’une ivrognesse abandonnée de son amant dans une île déserte, condamnée à l’oubli, réduite à son fil, ce pauvre peloton de fil qu’elle m’a dérobé et à partir duquel elle croit pouvoir construire sa légende. Il n’en est pas question. Ariane ne partira pas. Dionysos ne l’aura pas. Elle doit être défendable. Et tant pis pour Thésée.
Le Minotaure, oui, des bruits ont couru sur sa faiblesse. Je l’aurais fait enfermer non pas parce qu’il est redoutable, mais pour cacher aux yeux du monde ma faiblesse et sa faiblesse ; c’est idiot, tous – et, en premier, Minos, mon royal mari – ont eu connaissance de cet amour adultérin, pourquoi alors en cacher le fruit ? Il fait ma gloire. Et j’aurais voulu cacher la faiblesse de mon fils qui ne ferait peur à personne sauf à lui-même ? Non, mon fils est redoutable parce qu’il est une alliance entre l’homme et l’animal. En cela, il fait peur à tous, peut-être aussi à lui-même, mais surtout à tous, que vous le vouliez ou non. Je lui ai offert le labyrinthe ; pas pour le cacher, ni pour préserver le peuple de Crète de sa furie cannibale – qu’ai-je à faire du peuple de Crète ; non, je lui ai offert le labyrinthe parce que le labyrinthe le rend encore plus beau ; il l’isole et le rend inatteignable ; inatteignable et désirable. Que serait le Minotaure sans le labyrinthe ? Rien qu’un être hybride comme nous en voyons tous les jours, une chose étrange de plus, centaures, faunes, et autres sirènes. C’est le labyrinthe qui fait de mon fils un monstre sans pareil. La beauté de mon fils, c’est le labyrinthe ; et le labyrinthe est autant de mon invention que mon fils est de ma création. Dédale l’a fabriqué sur mes ordres, de même que c’est moi qui ai séduit le taureau fécondeur. De ma propre volonté. Mon fils est deux fois mon fils.
Mais pour mon fils, c’était facile. Dès sa conception, la volonté du terrible et le désir de l’exceptionnel étaient là. Pour Ariane, n’est-ce pas déjà trop tard ? Je me suis laissée prendre par la douceur du banal et de l’ordinaire; lassée de toujours devoir intervenir, j’ai laissé aller le cours des choses ; il est urgent de les reprendre en main. Que cela me serve de leçon pour la petite Phèdre. Il faudra vite songer à un plan, pour elle aussi. Que seraient mes enfants s’ils n’étaient des monstres royaux ?
Si je l’éblouis, pense Pasiphaé, si je l’éblouis. Le tout est qu’elle reste immobile suffisamment longtemps pour que le soleil accomplisse son œuvre. Là est la difficulté : l’immobilité et les yeux grand ouverts. L’immobilité volontaire et les yeux délibérément ouverts.
Pourquoi suis-je là ? se demande Ariane. Que fait ce fil dans ma main ? Ce fil de soie verte que j’avais soigneusement dérobé aux regards de Pasiphaé et de Minos, et qui devait servir à ma fuite et à celle de Thésée. J’étais déjà habillée pour le voyage. Un simple costume de marin qui m’aurait rendue invisible aux gardes de mon père.
Pourquoi suis-je là ? se demande Ariane. Que fait ce fil comme planté dans ma main ? Pourquoi cet éblouissement ? Quelle est cette lumière, et pourquoi ai-je si froid sous ce soleil ?
Il n’est que temps, dit Pasiphaé. Et je garderai même Ariane. Qui a dit que je voulais m’en débarrasser ? Jamais ! Ariane est ma fille, je ne veux pas qu’elle parte avec Thésée. Elle doit rester avec moi. Elle doit être deux fois ma fille, comme mon fils est deux fois mon fils. Et comme on verra ce que Phèdre sera.
Mais si je peux garder aussi Thésée, pense Pasiphaé, ça ne sera pas plus mal.
Elle m’a dit regardez-moi. Regardez-moi, je m’occupe d’animaux, je suis une éthologue. Jamais entendu parler de ça avant. Regardez-moi, pensez à la mer qui entoure l’île de Crète, entendez son mouvement, vous êtes au bord de l’eau, vous regardez le soleil, les yeux grand ouverts, regardez-moi. La liqueur que vous buvez vous envahit de bien-être. Vous lisez un livre, lequel ? Regardez-moi. Et ses yeux sont terribles, je ne vois qu’eux. C’est la mer de Crète. Pourquoi veut-elle que je la regarde, que craint-elle que je voie si je ne la vois pas.
Et Ariane lui répond : je ne peux pas, ça brûle dans mes veines, je vais mourir ; ça brûle et je ne vois que vos yeux terribles.
Et Ariane se débat. Ma mère, dites-moi, qui voulez-vous garder, moi ou Thésée ? Thésée ou le Minotaure. Phèdre ? Il faudra bien sacrifier l’un d’entre nous. Pourquoi avez-vous décidé que ce serait moi ? Pourquoi m’avez-vous condamnée ?
Et une voix lui dit : ne vous inquiétez pas, Ariane, on va bien s’occuper de vous. Ne quittez pas des yeux la lumière, ce grand réflecteur, ce grand projecteur, plus grand que le soleil, ne le quittez pas des yeux. Voyez-vous qui le maintient face à vous ? Voyez-vous son visage ? On vous attache les jambes, ne craignez rien, voyez comme vous êtes bien. On s’occupe bien de vous. Vos veines sont des filaments minuscules. Une voix susurre « attention micro-veines ». Un baiser vous effleure le front, comme une aile. Est-ce celle de votre cousin Icare ? Et toujours ce soleil.
Pourquoi ai-je voulu venir ici, se demande Ariane. Tout allait bien, je n’avais nul besoin de cet événement. J’étais prête pour un autre voyage. Qui donc déjà m’a mis cette idée en tête ? Pasiphaé ? Moi, je voulais partir, je voulais sacrifier mon demi-frère, cette moitié d’homme, pour mon amant Thésée. Mais pourquoi ce fil à ma main, pourquoi ce grand trou dans mon ventre, pourquoi ce vide dans ma tête, pourquoi cette brûlure et cet éblouissement ?
Si je l’éblouis, pense Pasiphaé, si je l’éblouis, j’aurai réussi.
Ma tête est un soleil tout rentré à l’intérieur de moi. Nul ne peut me voir sans en être aveuglé. Ma mère, ma mère, construisez-moi un lieu sans miroir. Mettez-moi hors du monde. J’étais une gentille fille, toute simple et toute plate ; et je suis devenue une lumière coupante, une béance concentrique. Je ne me comprends plus.
Ariane, ne t’inquiète pas, lui répond Pasiphaé. Ce lieu est déjà construit, il est construit à l’intérieur de toi. Je l’ai conçu pour toi. Ton regard est blanc, tu n’es qu’éblouissement superbe, déesse de la lumière qui ne reflète rien. Tu es maintenant la plus belle, aux traits inatteignables, comme est inatteignable ton frère, et comme le sera Phèdre.
Et tant pis pour Thésée. Qu’il tue son père, qu’il aille s’occuper de sa mère. Qu’il surveille sa descendance. Qu’il s’en aille. Qu’il s’en aille. Il n’aura pas mes filles.
Et ton fil n’est plus attaché à rien. Et tu tombes, Ariane, tu tombes, tu es avec Icare et vous ne savez pas si vous volez ou si vous tombez. Et tu penses être dans l’étroit couloir qui conduit à la mort. Et tu ne vois plus rien.
Je l’éblouis, se dit Pasiphaé, je l’éblouis. J’ai réussi.
Joseph Pasdeloup, La défense de Pasiphaé, 2013.
Court récit écrit pour le Lampadaire ©
Court récit écrit pour le Lampadaire ©
La lettre de la fille du soleil
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS


Je n’étais qu’espoir. Mais c’était un autre temps. Aujourd’hui c’est terminé. Je suis retombée à terre, de tout mon poids, se rappelle Lucile en ouvrant son courrier. Et quel poids ! de quoi faire tomber un échafaudage si tant est qu’elle eusse jamais pu se risquer à en escalader un. L’imaginer dans cette situation est impossible. Un spectacle navrant, car elle est navrante Lucile, qu’on l’imagine grimpant sur un échafaudage (et dans quelle intention, mon Dieu), ou qu’on l’observe aller et venir dans sa maison. Ce matin est comme tous les autres matins. Aussi lourd, aussi insipide, aussi désespérant qu’elle. On dirait qu’elle les contamine ces matins, ces journées. Elle les prend dans sa graisse et ils s’y perdent. Tous les matins, sur la balance, elle pèse le poids de l’attente. Elle n’attend rien de particulier, cela fait longtemps qu’elle n’attend plus rien de particulier, cela fait longtemps que tous ses espoirs se sont envolés, et qu’attendrait-elle, elle ne fait rien, elle entend juste le temps passer, même ça elle le fait de loin, le bruit du temps qui passe n’arrive plus à l’atteindre. Ce n’est pas un regret de ne plus l’entendre, elle a tout fait pour cela. C’est une habitude. En passant, ouvrir la boîte à lettre, voir son vide vert, en refermer la porte, et entrer chez elle. Sans une pensée. Parfois, de loin en loin, elle reçoit du courrier, des factures bien sûr, parfois une carte postale d’une lointaine amie qui ne connaît pas encore les vertus d’internet. Et ce courrier, quand elle le trouve dans sa boîte aux lettres, aucune émotion ne l’étreint, ni joie, ni angoisse, pas le moindre frémissement, encore moins la fébrilité ou l’excitation. Mais voilà qu’aujourd’hui, elle a une lettre. Ah, une lettre. Ça peut attendre. Si elle n’attend rien, la lettre peut attendre, c’est une sorte de vengeance, un prêté pour un rendu. Un « je te tiens par la barbichette » inutile. Un « je te tiens par la barbichette » qui s’éternise, aucun des deux ne rira, ah ça non pourquoi rirait-elle, et la lettre, si la condition de son ouverture est le rire, l’impatience, la joie de vivre, la lettre ne s’ouvrira pas. Même pas un sourire à l’idée de l’éventualité d’une lettre légèrement barbue, à l’idée qu’une lettre pourrait avoir une barbe, ou même un menton. Elle l’a compris, elle le comprend, elle ne se fait même plus rire, avant oui, elle s’en souvient encore, elle arrivait à se faire sourire de ses propres plaisanteries. Maintenant, c’est fini ; même quand, par le plus grand des hasards, une association d’idées saugrenues parvient à sa conscience, quand elle parvient à se l’énoncer, quand elle peut rencontrer une idée saugrenue, quand une idée lui fait signe et lui dit de venir jusqu’à elle, de faire une partie du chemin et qu’ensuite elle se donnera toute entière à son imagination, rien n’y fait, cela reste lettre morte. Elle refuse l’invitation, même pas avec dédain, même pas un refus. Un regard ailleurs, comme si elle ne l’avait pas vue, comme si ce n’était pas une idée, pas l’ombre d’une idée. Aucune connexion ne se fait dans son esprit qui cherche l’obscurité. Rien ne surnage dans ce glauque territoire. Aucune bouée, aucun sauvetage. Elle refuse de se sauver.
Tout cela n’est pas gai, se dit-elle, ouvrons la lettre. Tant pis, je l’ouvre.
C’est une photo, pas un mot, juste une photo. Pas une carte postale, non une photo, à l’ancienne sur du papier qui brille.
Une photo anonymée par le soleil.
Exprès ?
Qui est-ce ? Qui est-cette fille, car c’est une fille. Sa fille ? Car elle avait une fille. Pourquoi sa fille lui enverrait-elle une photo ? Elle a une fille. Qu’elle n’a pas vue depuis longtemps, depuis combien de temps déjà ?
Raphaëlle
Ça va, on me la fait pas, à moi la fille du soleil.
C’est la photo interdite. Ne fais pas les photos face au soleil. Tu ne peux pas, on ne verra pas le visage. Ne gâche pas la pellicule. C’est ce qu’on m’a toujours dit, mais moi qu’est-ce que ça me fait, à moi la fille du soleil. Comment faire des photos autrement qu’en plein soleil, quand on vit dans un pays de soleil. On ne va quand même pas se mettre à l’ombre, on ne va quand même pas se cacher.
Mais évidemment, avec le soleil tout le temps dans les yeux, comment voir la réalité en face. Même lire, on ne pouvait pas. Et surtout ne lis pas au soleil, la page blanche éclatante, c’est mauvais pour les yeux.
Raphaëlle veut bien le croire, mais maintenant qu’elle est plus vieille, elle doit bien admettre qu’elle voit mieux en plein soleil que dans la pénombre.
Raphaëlle
Alors qui avait raison, hein ?
À moins qu’elle n’ait trop lu au soleil, et que ceci soit la raison de cela.
La fille du soleil doit lire au soleil, affirme Raphaëlle.
La fille du soleil doit faire ses photos au soleil, en plein soleil, crie Raphaëlle à sa mère. Elle hurle, elle trépigne. Cette fille est folle, dit sa mère.
Raphaëlle
Et le portrait de qui, je devrais faire ? Est-ce que je sais qui j’ai photographié ?
Lucile
J’en ai toute une série de ces photos au visage annulé. Qui est-ce ? Il n’y a que le corps qui pourrait dire quelque chose, mais un corps sans visage, est-ce encore un corps ?
La lumière, la lumière, comme elle aimerait la pénombre, comme elle aimerait l’hiver si on le lui donnait, si on le lui permettait, si on le lui accordait, mais au lieu de cela non, elle n’a que cette lumière, mais comment peut-elle être si froide ? Sur ce point, elle est d’accord avec son ami Joseph, la lumière est froide, inexorablement froide. Comme lui, elle ne comprend pas pourquoi.
Qu’est-ce que tu vas faire avec ton fil, lui demande Joseph, broder ton corps ?
Ce fil que va-t-elle en faire ?
Et le fil de qui est-ce ?
Lucile
Pas question d’attraper le fil que l’autre me tend, ah ça non pas question. Pour qui se prend-elle celle-là ?
Joseph
le fil est vert
il ne tient à rien
il serait faux de croire qu’il tient à quelque chose
ni à un bout
ni à l’autre
il ne tient à rien
pas même à la main qui semble le tenir
du bout des doigts
ou en pleine main
il ne tient à rien
Lucile
Ce n’est pas une raison. Je ne le prendrai pas.
Lucile
Toute sa vie elle a attendu que quelque chose se passe, mais jamais il ne s’est rien passé, alors maintenant c’est fini, elle en a pris son parti.
Elle thésaurise l’attente.
Mais sa fille ne pèse rien, elle est éthérisée.
Raphaëlle
Un pèse-lettre pour Noël ? à quoi bon ? un pèse-mail ? avec le nombre de MO, c’est déjà prévu.
Lucile
Alourdie par la fatigue : la balance pèse la fatigue et la comptabilise, la rajoutant au poids des os et de la chair.
Joseph
Elle va l’envoyer à sa mère, sa photo, elle ne l’a pas vue depuis longtemps sa mère. C’est son autoportrait et elle n’y peut rien si elle a pris le flash en pleine gueule. Et je lui dirai, c’est ta fille, pas ton fils. Car il y a toujours eu ce problème.
Lucile
Celle-là ne bouge pas, c’est ça le problème.
Raphaëlle
Celle-là ne bouge pas, c’est ça le problème.
Joseph
Elles ne bougent pas. J’ai compris où est le problème.
Fred Lucas,
Pensées de la dame sur son banc, tenant en sa main une enveloppe contenant une photo sans un mot d’accompagnement
Pour le Lampadaire, 2014
Pensées de la dame sur son banc, tenant en sa main une enveloppe contenant une photo sans un mot d’accompagnement
Pour le Lampadaire, 2014
Corner, arrêt et soleil
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
La photo
Lucie Pastureau Série, à contre-ciel 2011.
Le récit
Maria Rantin
Puces de maison 2013

Je ne vais tout de même pas passer ma vie à faire le ménage, se dit Raphaele en contemplant, désespérée, sa maison. Une semaine d’absence, et ça y est, c’est la merde. Le chat a disparu, trop chaud, il a dû aller claquer dans un coin ; il a laissé derrière lui les puces, tu parles d’un héritage. Moi ou elles, s’est peut-être dit le chat, déjà cette chaleur, si en plus je dois subir l’assaut des puces, plutôt crever. Il est parti et elles, ces saloperies, au lieu de rester dehors tranquillement comme des puces qui se respectent, elles ont pris possession de la maison, ont proliféré en toute tranquillité et se sont mises en position d’attente : pattes sauteuses repliées en ressort, trompe acérée bien entretenue, tout l’arsenal prêt pour attaquer les premières jambes humaines à passer le seuil de la maison. Et ce sont les miennes ! Plus celles de mon mari et de mes fils. Tu parles d’un scandale, quand ils se sont aperçus de la présence des puces ! J’en ai encore les oreilles toutes révoltées.
Les puces, les poux, les morpions. Une sainte trinité démoniaque ! Trois saloperies qui ont été inventées et pourquoi ? J’aimerais bien le savoir ! Il y a des chaines alimentaires, d’accord ; une conception écologique du monde dans lequel le moindre vermisseau est utile à l’équilibre de la planète, d’accord, je veux bien. Et si on en enlevait un, de vermisseau, le monde en serait changé. D’accord, encore, je peux l’imaginer. Mais ces trois trucs là, franchement à quoi ça sert ? À occuper, à exaspérer l’être humain ? Est-ce que l’exaspération est utile à l’équilibre planétaire ? J’en doute. Admettons-le, admettons que l’impact psychologique causé par une de ces bestioles soit utile et prévu dans la grande organisation du monde. Dans ce cas, les morpions, c’est pour foutre la honte, rappeler que les parties sexuelles de l’homme sont sales et qu’il n’est pas bon de forniquer à tout va ; impact moral, et punition prévue par la grande sagesse divine, ok ; les poux, c’est pour stigmatiser les pauvres, tiens je croyais que Dieu les aimait ; promiscuité, misère, saleté, le tout associé ça donne des poux ; même si on sait que les poux sont maintenant le lot de tous, ou est-ce la pauvreté ? Mais, les puces bon Dieu, les puces à quoi ça sert ? C’est pour les animaux, que les hommes les soignent les emmènent chez le vétérinaire, c’est pour nourrir le vétérinaire ; mais quand elles s’attaquent aux hommes, c’est quoi leur vengeance ? Elles se vengent de quoi ?
Bon, se dit Raphaele, il faut que j’arrête de chercher du sens à tout. Les puces, ça n’a pas de sens, ça doit être comme beaucoup d’autres choses qui finalement, il faudra arriver à m’en convaincre, sont totalement dénuées de sens. Vaudrait mieux savoir comment s’en débarrasser.
En femme moderne qui connaît peu les techniques de décontamination, ce qu’elle avait vu dans les films catastrophe (les fourmis–les araignées–les abeilles–attaquent) ne lui semblant pas à sa portée, Raphaele se précipita sur Google, écrivit « puces maison » et trouva qu’elle n’était pas seule à avoir ce type d’invasion et que certains s’en réjouissaient ! Non pas qu’elle ait des problèmes de puces, ils ne la connaissaient pas, mais qu’ils ne soient pas seuls à être face à cette calamité ; le partage des puces, ça semblait les soulager. Et tous de se lamenter sur la difficulté à s’en débarrasser. Voilà qui n’arrange pas mes affaires, se lamenta à son tour Raphaele. Et puis, pourquoi cette invasion, ça fait 20 ans qu’on a acheté la maison, qu’on y habite, 20 ans qu’on a des chats, et jamais de puces dans la maison. Alors, quoi, c’est la faute à qui, qu’on le pende ! Il y a toujours un coupable, quelque chose qui déclenche la catastrophe, quelque chose qu’on n’a pas su identifier et qu’il aurait pourtant été fondamental de reconnaître à temps. Quelle plaie ces puces ! La combientième déjà ? Souriant à son jeu de mots et aux évocations bibliques qu’il suggérait, elle se rasséréna un moment. Tout de même, pas question de chercher un coupable dans la famille. Cette énième calamité (les temps récents n’avaient pas été tendres pour eux tous) était un acte de pure malveillance, une méchanceté gratuite, aléatoire, démotivée, le plaisir du mal, faire le mal sans raison, la représentation absolue du mal, celui qui ne se comprend pas, dont celui qui le fait ne retire aucun bénéfice. Le monstrueux. Les puces étaient l’expression de la monstruosité, de l’incompréhensible.
Elle secoua la tête pour essayer d’en faire tomber cet éparpillement de mots néfastes et se replongea dans le forum de discussion à la recherche de la bonne pratique. Il était temps de passer à la synthèse rapide de toutes ces informations qui, soit se répétaient avec des variantes, soit se contredisaient.
Un mot revenait sans cesse (Google ne faisait que confirmer ce qu’elle avait d’emblée compris), le ménage, il fallait faire le ménage sans arrêt. Tous l’écrivaient. Le truc c’était bien de faire le ménage, de fond en comble : d’abord, passer l’aspirateur dans tous les coins, puis jeter le sac de l’aspirateur (contenant la récolte de larves, d’œufs, cadavres de puces et poussières servant de nid) le plus loin possible de la maison. Ensuite, pulvériser les produits pucicides préalablement achetés, (les acheter demande déjà une journée entière de recherches) en prenant soin d’éloigner du brouillard meurtrier tous les aliments, ustensiles de cuisine, vaisselles (mais comment faire ça ? Elle ne pouvait tout de même pas tout sortir de la maison), et éloigner tout être vivant (humain, animal, végétal – et pour le gros ficus, comment elle allait faire ?) de cet air qui ne les tuerait pas sur le coup, mais qui provoquerait assurément maladies respiratoires, maladies digestives, ou, à échéance plus lointaine, cancers qu’on aurait, dans quelques années, du mal à mettre en relation avec cette consommation abusive d’insecticide (il faudra néanmoins s’en souvenir le moment venu, pour en informer les médecins, se dit Raphaele), revenir quelques heures plus tard, aérer en grand, et repasser l’aspirateur (sans oublier de mettre un sac neuf et d’aller le jeter après usage, quel gâchis de sacs, le côté économe de Raphaele se révoltait à cette idée), et cela un nombre incalculable de fois, puisque, les internautes le disaient, tout ce protocole était assez inefficace dans la mesure où, quelques temps après, les œufs que les produits n’avaient pas tués (on ne sait pas pourquoi, mais les produits ne tuent pas les œufs, pour les mites c’est pareil) écloraient, deviendraient puces adultes, attaqueraient les jambes humaines et tout serait à recommencer. Jusqu’à la fin des temps. Elle avait raison, c’était bien la huitième plaie d’Egypte qui s’était abattue sur cette maison, avec jardin, de la banlieue parisienne.
Elle dit à son mari, d’une voix qui tentait de passer sous silence tout ce que l’avenir leur réservait.
- Chéri, je crois qu’il faut aller acheter des fumigènes.
- Toujours aussi imprécise, ma pauvre ! lui répondit-il. Ce ne sont pas des fumigènes, mais des foggers (il avait dû regarder lui aussi sur internet, sans doute un autre site), le fog, tu connais ? le brouillard anglais. Des bombes qui propulsent du brouillard, les fumigènes c’est autre chose. Tu raconteras toujours n’importe quoi, il n’y a rien à faire !
Raphaele se boucha les oreilles pour ne pas entendre les insultes, le cours sur les différentes brouillards ou autres paroles aussi perverses qu’invasives, et continua sa lecture. Elle tomba sur la version écologique de l’extermination des puces, écologique pour les humains, pas pour les puces, à moins que la mort ne soit pas un problème d’écologie. Il y avait différents conseils, ou étaient-ce des consignes ? Se parfumer à la menthe, au vinaigre blanc ; oh horreur, à l’urine de jument. Planter des fleurs qui puent, des fleurs de Tanaisie, petites boules jaunes, minuscules pompons très serrés qui dégagent une odeur de fosse sceptique, Raphaele s’en souvient très bien, il y en avait sur le lieu de ses dernières vacances (et tout le monde se demandait d’où venait cette odeur, de la fosse sceptique ?). Une autre méthode était d’attendre la nuit ; une fois la nuit venue, il fallait mettre de l’eau dans une assiette avec quelques gouttes de produit vaisselle, installer une bougie au milieu de l’assiette, l’allumer ; résultat : les puces attirées par la lumière sautent dans l’eau ; il ne faut surtout pas oublier le liquide vaisselle, c’est ça qui les noie ; ces pestes savent nager et cherchent à rejoindre le bord des assiettes (leur terre ferme), mais le liquide vaisselle, on ne sait pas pourquoi, les fait sombrer et les entraîne au fond de l’eau.
En attendant la nuit et la lumière de la bougie, Raphaele testa la noyade avec savon. Elle remplit une assiette d’eau, rajouta une goutte de produit vaisselle, s’empara d’une puce qu’elle prit sur sa jambe (il faut d’abord s’humecter les doigts, sans ça elle risque de s’échapper), la plongea dans l’eau et la regarda, avec délectation, se noyer. Puis une autre, puis une autre. Il faut bien les observer se noyer dans leur assiette, certaines essayent encore de prendre de l’élan et de sauter, ah quel ridicule espoir ! Jouant à l’entomologiste, Raphaele les examina : elles sont toutes plates, elles n’ont qu’un profil, pas de face, et toutes les pattes quelles ont, et cette couleur plus rouge que noire alors qu’elles paraissent si noires sur la peau. Quelle expérience passionnante, se dit Raphaele, écologique et radicale, mais ça ne tue pas les œufs, alors dans tous les cas, même en admettant qu’on puisse exterminer la colonie en tuant les puces une par une (mon Dieu, de quelle patience il faudrait faire preuve !), on ne peut échapper au ménage. Dans tous les cas, option écologique ou radicale, il faut commencer par faire le ménage, et puis refaire le ménage, et encore refaire le ménage. Avoir une maison impeccablement propre, dans le moindre recoin. Désolée c’est impossible. Je ne peux pas, se lamenta une seconde fois Raphaele, j’ai autre chose à faire, je ne peux pas passer le reste de mes vacances à faire le ménage. Parce que faire le ménage toute la journée, c’est faire le ménage tous les jours toute la journée, tous les jours toute la vie. Et ça, non, Raphaele ne peut pas même l’envisager. Elle a tant de choses à faire, tant d’autres choses à faire, elle en énuméra la liste à voix basse ; non, le ménage à outrance n’était pas prévu, un peu de rangement certes, mais le ménage à outrance non, « C’est pas dans la liste, » hurla-t-elle dans sa tête. Peut-être qu’elles vont partir d’elles-mêmes. Il n’y en a pas tant, on aura juste quelques boutons, ça n’a jamais tué personne, et ça passera. Mais Raphaele sait bien que c’est faux, si on ne fait rien, ce sera de pire en pire. « Bon, il faut se secouer les puces ». Cette expression lui vint tout naturellement, « C’est ridicule, se dit-elle. Est-ce que je me mettrais à penser puce ? » et Raphaele se demanda tout d’un coup pourquoi, mais pourquoi dans toutes ces expressions idiotes, mettre la puce à l’oreille, je vais te secouer les puces, ou pire encore quand on appelle un enfant ma puce, ou quand un mari dit à sa géante de femme, tu n’as pas froid, ma puce, le nom de cette bestiole immonde peut prendre l’apparence d’un terme affectueux. Quelle hérésie ! Elle comprend maintenant pourquoi les gens qui disent «Embrassent tes puces », « Et comment vont les puces », pour parler des enfants, l’ont toujours horripilée. Embrasse tes puces, comme si elle pouvait embrasser ses puces ! Absolument ridicule !
Comment se débarrasser des puces ? Finalement, elle choisit la patience et le sacrifice d’elle-même, encore une fois, pensa-t-elle, encore une fois se sacrifier mais au moins avoir le choix du supplice ; elle préfère se donner en pâture aux puces plutôt que de s’adonner à la suractivité ménagère. Elle est rentrée de vacances, il fait beau et elle a les jambes nues. Elle se fera piège à puces. C’est la solution qu’elle a trouvée : rester les jambes nues au milieu de la pièce infestée, attraper une par une les puces qui se précipitent sur les jambes, et les tuer, une par une, même si cela doit durer trois semaines, trois semaines d’immobilité statufiée au milieu de la pièce (elle pourrait s’asseoir bien sûr), le temps que les œufs éclosent, que les générations se succèdent. Elle commença. Elle n’avait jamais autant regardé ses jambes, elle ne les avait jamais autant touchées, caressées; elles sont pleines de taches de rousseur, de petits points bruns ; elle ne savait pas qu’elle en avait tant, le charme de la peau des blondes, se dit-elle. Mais elle repéra aussi les marques du vieillissement, la sécheresse de la peau, le léger frisottis de sa surface, comme frisotte le sable quand la mer s’est retirée ; ça lui rappelle les vacances, la plage, les vagues, les photos qu’elle a faites, les dessins ; ou alors c’est le contraire, ce sont toutes ces images qui se sont fixées dans sa tête et à travers lesquelles, comme à travers un filtre, elle voit sa peau, son âge. Elle a décidemment trop tendance à laisser aller son imagination ; elle sait bien qu’elle n’est pas une plage, juste une femme en train de vieillir, à l’affût des puces et non à l’affût d’elle-même. Déprimant. Elle se reprit, mais sous son regard hypnotisé de chasseur de puces, elle se mit à voir toutes ses taches de rousseur, tous ces accidents qui habitaient sa peau, bouger, sauter ; elle les prenait pour des puces et cherchait à les attraper. Qu’est-ce qui est elle, qu’est-ce qui est la puce ? Non, décidemment non, ce n’est pas la bonne méthode, si elle continue Raphaele va s’arracher la peau. Elle stoppa l’expérience. Trop délirante. À tous points de vue.
« Il va falloir installer une barrière phytosanitaire », elle ne sait pas trop ce que veut dire ce mot, mais elle le trouve élégant et approprié à la situation. Elle a lancé cette phrase en direction de son mari qui s’était déjà mis à badigeonner le parquet avec de l’essence de térébenthine (les conseils du site qu’il consulte sans doute, un autre site que le sien). Ce n’est pas une mauvaise idée, pensa-t-elle. S’entourer d’essence de térébenthine et mettre le feu. Raphaele se souvint du Horla. Les puces c’est pareil, ça envahit la tête tout pareil, ça conditionne les gestes, on se refuse à y croire et pourtant c’est là. On sent leur présence, leur effleurement constant, leurs piqures, mais on peine à les voir, et on met en doute ses propres sensations. On cherche à vérifier, à avoir la preuve. La preuve c’est le bouton, c’est la piqure, c’est la marque sur la chair, se dit Raphaele, faut rester pragmatique ; une puce est une puce. Elle aimerait croire que c’est aussi simple que ça, mais elle se rend bien compte que non. Il faut leur mettre de la lumière la nuit, les attirer dans un piège, s’assurer de la vérité de leur présence, de leur mort. La preuve c’est la carafe et le verre d’eau, le niveau de l’eau dans l’assiette. On leur parle et on ne peut pas s’en débarrasser ; des puces horlesques ou horliques, s’exclama Raphaele, voilà ce qui nous est tombé dessus ! Lui, la victime du Horla, le fou, comment il s’appelait déjà, il voulait donner une existence matérielle à l’invisible, nier sa folie ; mais moi, se dit Raphaele, je suis en but à quelque chose qui existe, je le sais, et qui veut se faire invisible, qui veut me contourner et me rendre folle. Quelle histoire ! En tous les cas, elle a appris de sa lecture que mettre le feu à la maison ne résoudra pas le problème. À moins que le sacrifice extrême, l’immolation par le feu… Quel dommage, se dit-elle. Les solutions radicales ont du bon, mais elles sont le plus souvent impraticables. Quel dommage.
Et pendant ce temps, pendant tout ce temps de réflexion, d’irrésolution, de torture mentale, que font les garçons ? Ils jouent au ballon. Ils ont posé les valises, et hop le ballon. Les puces, quelles puces ? Occupe-toi de tes puces. Nous on a un ballon et des comptes à régler. Voilà ce qu’ils lui ont dit.
Ils sont deux. Et un ballon. Suffisant pour faire un foot ? Non, ils s’entraînent à, comment ils appellent ça déjà, au tir au but. Ils feraient mieux de s’occuper à m’aider, pensa-t-elle. Le plus jeune est dans le coin, là-bas à gauche, au fond du jardin. Elle a du mal à le voir à travers la fenêtre de la cuisine et ce soleil qui brouille tout. Il n’arrivera jamais à stopper le ballon, l’autre le lance avec une telle concentration, une telle violence, comme s’il visait son frère, exprès pour lui faire mal. Pourquoi il reste sur une patte comme ça, celui-là ? Il est encore sur son élan, le pied qui vient de frapper le ballon est en l’air, ses bras comme un balancier de funambule cherchent l’équilibre, ça lui fait le dos rond, il a toujours manqué d’élégance, tandis que le petit non, c’est peut-être ça les comptes qu’ils ont à régler.
Arrêt dans le coin. Corner arrêté. L’image s’imprima dans le cerveau de Raphaele. S’immobilisa. Corner. Arrêt. Soleil. Taper dans la gueule de l’autre. Ses deux fils, jamais ils n’arriveront à s’entendre. Putain de soleil qui l’empêche de voir. Feraient mieux de m’aider à génocider les puces au lieu de chercher à s’entretuer.
Ils ne le savent pas, Raphaele vient de le comprendre, c’est dans le jardin qu’elles sont les puces. Elle aura beau faire le ménage dedans, ça ne règlera pas le problème, elles se réintroduiront dès qu’on passera du jardin à la maison et de la maison au jardin. Il ne faut plus sortir, telle est la conclusion de Raphaele. L’autre, qui a déjà enlevé sa chemise, dans quel état il va être ? Un vrai régal pour les bestioles ; le plus grand, il a beau sauter en l’air, elles arriveront bien à se poser sur lui aussi.
- « Eh ! Gustave, hurle-t-elle, c’est pas le ballon qu’il faut frapper, c’est les puces. Venez m’aider. » Ils n’entendent rien. Quand est-ce qu’ils vont venir l’aider ? Il va tomber ce con, tomber dans l’herbe et ramasser tous les parasites. Et les ramener à la maison.
Maria Rantin, Puces de maison, 2013.
Récit écrit pour Le Lampadaire ©
Récit écrit pour Le Lampadaire ©
Les Empires de la Lune
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Et qui aurait pu penser que je te trouverais
même ici, assez proche
de l’Empire pour paraître
une compagne de son voyage à travers
le ciel. Et qui aurait pensé que tu t’arrêterais
pour regarder ces routes si encaissées
qu’un astre n’est presque jamais assez haut pour qu’on puisse
le voir. Pour te reconnaître il n’aurait pas suffi
de la lumière blanche que tu offres
aux plaines de la terre
et de la mer parce qu’ici elle se confond
avec les autres lumières et les couleurs que la nuit
libère. C’est pourquoi je t’ai attendue, soir
après soir, et j’ai laissé le temps s’enfuir
dans le quartier de ciel que je savais
être à toi et je t’ai vue monter et t’approcher
de l’antenne suspendue avec son phare
rouge là haut au dessus de la blancheur
des derniers étages de l’Empire illuminés
au point de paraître — oui, eux — un astre
amoureux de la terre, et je me suis senti
jaloux. Le plus difficile a été
de te retrouver chaque soir toujours un peu
plus tard. Le plus difficile a été
de m’arrêter dans ce coin où une esplanade
provisoire découvrait la vue et laissait
voir le quartier de ciel que je savais
être à toi tandis que tous se sauvaient
et c’était l’heure où les derniers
spectacles commençaient et nous ne pouvions
que nous aimer au milieu de la rue tels des amants
clandestins et l’attente chaque soir
était plus longue et ta nudité apparaissait
— quand enfin elle apparaissait — si blanche que
je me sentais mis à nu, gêné avec
mon appareil numérique à la main
comme un voyeur prêt à prendre toutes les photos possibles
du visible et à les garder
secrètes. Et ce fut ainsi jusqu’au dernier
soir où nous nous sommes rencontrés et la rue, toute entière,
était devenue nôtre, et de ceux
qui passaient nous ne nous sommes pas aperçus et pendant
ce temps commençait ton lent retour vers l’obscurité.
La Pensée prise au piège, Michele Tortorici,
édition bilingue, traduction Danièle Robert, Editions Vagabonde, 2010
LA LUNA E L'EMPIRE
E chi poteva pensare che ti avrei trovata
anche qui, così vicina
all’Empire da sembrare
una compagna del suo viaggio attraverso
il cielo. E chi pensava che ti saresti fermata
per guardare queste strade così sprofondate
che quasi mai un astro è alto tanto da potersi
vedere. Per riconoscerti non sarebbe bastata
la luce bianca che regali
alle pianure della terra
e del mare perché qui si confonde
con le altre luci e i colori che la notte
sprigiona. Per questo ti ho aspettata, sera
dopo sera, e ho lasciato scorrere il tempo
nello spicchio di cielo che sapevo
tuo e ti ho vista salire e avvicinarti
all’antenna sospesa con il suo faro
rosso lassù sopra il biancore
degli ultimi piani dell’Empire illuminati
tanto da sembrare – loro sì – un astro
innamorato della terra, e mi sono sentito
geloso. La cosa più difficile è stata
ritrovarti ogni sera sempre un poco
più tardi. La cosa più difficile è stata
fermarmi in quell’angolo dove uno spiazzo
provvisorio apriva la vista e lasciava
vedere lo spicchio di cielo che sapevo
tuo mentre tutti correvano
via ed era l’ora che gli ultimi
spettacoli cominciavano e non potevamo
che amarci in mezzo alla strada come amanti
clandestini e l’attesa ogni sera
era più lunga e la tua nudità appariva
– quando infine appariva – così bianca che io
mi sentivo scoperto, impacciato con la mia
macchina digitale tra le mani
come un voyeur pronto a scattare del visibile
le foto possibili e a tenerle
segrete. Ed è stato così fino all’ultima
sera che ci siamo incontrati e la strada, tutta,
era diventata nostra, e di quelli
che passavano non ci siamo accorti e intanto
cominciava il tuo ritorno lento verso il buio.
à lire ici un article de Danièle Robert sur Michele Tortorici
Le texte en italien
Les empires de la lune
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
LES EMPIRES
DE LA LUNE
L’Autre monde ou les États et Empires de la Lune,
Cyrano de Bergerac
Et qui aurait pu penser que je te trouverais
même ici, assez proche
de l’Empire pour paraître
une compagne de son voyage à travers
le ciel. Et qui aurait pensé que tu t’arrêterais
pour regarder ces routes si encaissées
qu’un astre n’est presque jamais assez haut pour qu’on puisse
le voir. Pour te reconnaître il n’aurait pas suffi
de la lumière blanche que tu offres
aux plaines de la terre
et de la mer parce qu’ici elle se confond
avec les autres lumières et les couleurs que la nuit
libère. C’est pourquoi je t’ai attendue, soir
après soir, et j’ai laissé le temps s’enfuir
dans le quartier de ciel que je savais
être à toi et je t’ai vue monter et t’approcher
de l’antenne suspendue avec son phare
rouge là haut au dessus de la blancheur
des derniers étages de l’Empire illuminés
au point de paraître — oui, eux — un astre
amoureux de la terre, et je me suis senti
jaloux. Le plus difficile a été
de te retrouver chaque soir toujours un peu
plus tard. Le plus difficile a été
de m’arrêter dans ce coin où une esplanade
provisoire découvrait la vue et laissait
voir le quartier de ciel que je savais
être à toi tandis que tous se sauvaient
et c’était l’heure où les derniers
spectacles commençaient et nous ne pouvions
que nous aimer au milieu de la rue tels des amants
clandestins et l’attente chaque soir
était plus longue et ta nudité apparaissait
— quand enfin elle apparaissait — si blanche que
je me sentais mis à nu, gêné avec
mon appareil numérique à la main
comme un voyeur prêt à prendre toutes les photos possibles
du visible et à les garder
secrètes. Et ce fut ainsi jusqu’au dernier
soir où nous nous sommes rencontrés et la rue, toute entière,
était devenue nôtre, et de ceux
qui passaient nous ne nous sommes pas aperçus et pendant
ce temps commençait ton lent retour vers l’obscurité.
La Pensée prise au piège, Michele Tortorici,
édition bilingue, traduction Danièle Robert, Editions Vagabonde, 2010
LA LUNA E L'EMPIRE
E chi poteva pensare che ti avrei trovata
anche qui, così vicina
all’Empire da sembrare
una compagna del suo viaggio attraverso
il cielo. E chi pensava che ti saresti fermata
per guardare queste strade così sprofondate
che quasi mai un astro è alto tanto da potersi
vedere. Per riconoscerti non sarebbe bastata
la luce bianca che regali
alle pianure della terra
e del mare perché qui si confonde
con le altre luci e i colori che la notte
sprigiona. Per questo ti ho aspettata, sera
dopo sera, e ho lasciato scorrere il tempo
nello spicchio di cielo che sapevo
tuo e ti ho vista salire e avvicinarti
all’antenna sospesa con il suo faro
rosso lassù sopra il biancore
degli ultimi piani dell’Empire illuminati
tanto da sembrare – loro sì – un astro
innamorato della terra, e mi sono sentito
geloso. La cosa più difficile è stata
ritrovarti ogni sera sempre un poco
più tardi. La cosa più difficile è stata
fermarmi in quell’angolo dove uno spiazzo
provvisorio apriva la vista e lasciava
vedere lo spicchio di cielo che sapevo
tuo mentre tutti correvano
via ed era l’ora che gli ultimi
spettacoli cominciavano e non potevamo
che amarci in mezzo alla strada come amanti
clandestini e l’attesa ogni sera
era più lunga e la tua nudità appariva
– quando infine appariva – così bianca che io
mi sentivo scoperto, impacciato con la mia
macchina digitale tra le mani
come un voyeur pronto a scattare del visibile
le foto possibili e a tenerle
segrete. Ed è stato così fino all’ultima
sera che ci siamo incontrati e la strada, tutta,
era diventata nostra, e di quelli
che passavano non ci siamo accorti e intanto
cominciava il tuo ritorno lento verso il buio.
La lune était en son plein, le ciel était découvert, et neuf heures du soir étaient sonnées lorsque nous revenions d’une maison proche de Paris, quatre de mes amis et moi. Les diverses pensées que nous donna la vue de cette boule de safran nous défrayèrent sur le chemin. Les yeux noyés dans ce grand astre, tantôt l’un le prenait pour une lucarne du ciel par où l’on entrevoyait la gloire des bienheureux; tantôt l’autre protestait que c’était la platine où Diane dresse les rabats d’Apollon ; tantôt un autre s’écriait que ce pourrait bien être le soleil lui-même, qui s’étant au soir dépouillé de ses rayons regardait par un trou ce qu’on faisait au monde quand il n’y était plus.
« Et moi, dis-je, qui souhaite mêler mes enthousiasmes aux vôtres, je crois sans m’amuser aux imaginations pointues dont vous chatouillez le temps pour le faire marcher plus vite, que la lune est un monde comme celui-ci, à qui le nôtre sert de lune. »
La compagnie me régala d’un grand éclat de rire.
« Ainsi peut-être, leur dis-je, se moque-t-on maintenant dans la lune, de quelque autre, qui soutient que ce globe-ci est un monde. »
Mais j’eus beau leur alléguer que Pythagore, Épicure, Démocrite et, de notre âge, Copernic et Kepler, avaient été de cette opinion, je ne les obligeai qu’à s’égosiller de plus belle.
Cette pensée, dont la hardiesse biaisait en mon humeur, affermie par la contradiction, se plongea si profondément chez moi que, pendant tout le reste du chemin, je demeurai gros de mille définitions de lune, dont je ne pouvais accoucher ; et à force d’appuyer cette créance burlesque par des raisonnements sérieux, je me le persuadai quasi, mais, écoute, lecteur, le miracle ou l’accident dont la Providence ou la fortune se servirent pour me le confirmer.
J’étais de retour à mon logis et, pour me délasser de la promenade, j’étais à peine entré dans ma chambre quand sur ma table je trouvai un livre ouvert que je n’y avais point mis. C’était les oeuvres de Cardan ; et quoique je n’eusse pas dessein d’y lire, je tombai de la vue, comme par force, justement dans une histoire que raconte ce philosophe : il écrit qu’étudiant un soir à la chandelle, il aperçut entrer, à travers les portes fermées de sa chambre, deux grands vieillards, lesquels, après beaucoup d’interrogations qu’il leur fit, répondirent qu’ils étaient habitants de la lune, et cela dit, ils disparurent.
Je demeurai si surpris, tant de voir un livre qui s’était apporté là tout seul, que du temps et de la feuille où il s’était rencontré ouvert, que je pris toute cette enchaînure d’incidents pour une inspiration de Dieu qui me poussait à faire connaître aux hommes que la lune est un monde.
« Quoi ! disais-je en moi-même, après avoir tout aujourd’hui parlé d’une chose, un livre qui peut-être est le seul au monde où cette matière se traite voler de ma bibliothèque sur ma table, devenir capable de raison, pour s’ouvrir justement à l’endroit d’une aventure si merveilleuse et fournir ensuite à ma fantaisie les réflexions et à ma volonté les desseins que je fais!… Sans doute, continuais-je, les deux vieillards qui apparurent à ce grand homme sont ceux-là mêmes qui ont dérangé mon livre, et qui l’ont ouvert sur cette page, pour s’épargner la peine de me faire cette harangue qu’ils ont faite à Cardan.
« Mais, ajoutais-je, je ne saurais m’éclaircir de ce doute, si je ne monte jusque-là?
— Et pourquoi non? me répondais-je aussitôt. Prométhée fut bien autrefois au ciel dérober du feu. »
L’Autre monde ou les États et Empires de la Lune (incipit), Cyrano de Bergerac, 1657.
à lire ici un article de Danièle Robert sur Michele Tortorici
Le texte en italien
COLLECTION DES CURIOSITÉS
SUR L'ERRANCE
Paysages de l'errance
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Les pelleteuses avaient peut-être emporté les débris des maisons insalubres situées sur le côté obscur de la place, dans ce dédale de ruelles et de courées qui descendaient vers le canal et les usines. Emporté aussi le cours des promenades improvisées et les causeries impromptues sur le pas d'une porte, écran de bois devant lequel on se montre ou derrière lequel on disparaît, comme au théâtre, dans les vieux quartiers des vieilles cités. De grands ensembles tout neufs les remplaçaient peut-être, trop grands ou trop neufs, aux arêtes trop coupantes, rassemblements discontinus d'habitations empilées cassant la ligne de vie des rues.
Pourquoi cette poussière, ces cendres, ces scories sur l'épure des sentiments, pourquoi cette poix, ce poids, ce poison qui tue le désir, pourquoi ce paysage désertique ou ce froid polaire comme un défi trop lourd à relever, pourquoi cette attirance vertigineuse pour le vide, l'inanité, la vacuité, l'envers ou le revers du monde, pourquoi l'ombre plutôt que la lumière, pourquoi les fantômes ou les phantasmes plutôt que les vivants, les bien portants, les bien pensants, pourquoi cette fêlure, cette brisure dans son propre reflet, pourquoi ce manque, cette absence, cette trahison peut-être, cet oubli, ce départ, cette séparation, cette solitude, cette disparition, cet effacement, pourquoi ces quelques souvenirs si dérisoires, pourquoi les esprits carrés parviennent-ils à le rester, pourquoi occuper sa vie à se leurrer, à oublier, à contempler une épaisseur factice dans des miroirs aux alouettes, pourquoi cet écart, ce fossé, cet abîme entre bonheur et malheur?
Elle l'avait regardé intensément. Les cheveux qu'elle avait toujours connus blancs. La déformation de son dos qui poussait sa tête en avant comme celle d'un héron en train de pêcher le cou ployé. Le mouvement lent de ses doigts noueux roulant une cigarette. Sa main droite réglée comme un métronome portant à ses lèvres, alternativement, la cigarette qui nimbait son visage de fumée ou le demi de bière qui luisait comme de l'or dans la pénombre du café. Le travail de la main gauche, animée du même mouvement de balancier que la droite, venant décharger celle-ci de la cigarette pour qu'elle puisse saisir le verre, l'ensemble formant une admirable mécanique de gestes décrivant un angle droit depuis le point de jonction des deux mains, la gauche suivant le sens horizontal de la table, la droite s'élevant ou s'abaissant perpendiculairement à celle-ci, au rythme d'un tempo immuable qu'il avait un jour fixé une fois pour toutes, trois à quatre inhalations de fumée pour une petite gorgée de liquide, invariablement, immanquablement, interminablement, gestes à la régularité cosmique et attitudes sibyllines qu'elle garderait gravés pour toujours dans la chambre noire de ses souvenirs...
Détournant enfin les yeux du flot de véhicules, de ces hommes et de ces femmes qui paraissaient accrochés avec détermination à leur volant, elle avait repris sa marche vers les longs parallélépipèdes de béton perpendiculaires à la tranche de champs abandonnés sur laquelle elle se trouvait, de telle sorte qu'elle apercevait face à elle les murs aveugles formés par le petit côté des barres ainsi que l'enfilade des fenêtres situées sur la longueur des immeubles les plus proches, qui coupaient de leur masse la perspective fuyante des bâtiments plus éloignés. Sur le flanc opposé, une large avenue qui traversait toute la cité était bordée par une autre série de barres plus petites plantées sur une pelouse pelée. Ici ou là, séparés par une distance trop raisonnable, quelques arbrisseaux appuyés sur leur tuteur signalaient que la nature avait encore quelques droits sur son ancien domaine. Elle dérapait parfois sur des mottes de terre boueuses ou des touffes d'herbe grasse que la pluie avait rendues glissantes. La cité se rapprochait d'elle au rythme lent de ses pas. C'était un lieu de vie apparemment très différent du quartier ouvrier où elle avait grandi, mais les gens étaient à peu près les mêmes et logeaient d'une certaine façon dans le même genre de casiers fabriqués pour eux à l'identique. Une rue ouvrière, c'était de chaque côté un mur de briques fait d'un seul tenant, le plus long possible, derrière lequel on avait construit un autre mur semblable, puis on avait cloisonné et obtenu des maisons avec chacune leur entrée et sans rien au-dessus, ce qui rendait ces cases anciennes plus conviviales que les nouvelles. Freiné par les blocs de béton, le vent qui s'était levé reprenait de la force en s'engouffrant avec fureur dans les voies qui les desservaient. Ses tourbillons imprévisibles faisaient dériver la trajectoire des gouttes de pluie qu'ils entraînaient avec violence dans les courants d'air froid. Aussi avançait-elle tête baissée, les yeux rivés sur l'asphalte noir du trottoir qui reflétait encore une maigre lumière projetée par des lampadaires démesurement effilés, inutiles et ridicules géants d'acier qui luttaient mal contre le jour grisâtre. Elle arrivait au centre commercial...
Elle avait tourné dans une rue qui ressemblait à un couloir, aux longs murs de briques rouge sombre noircis par la fumée d'une usine toute proche, avec une succession de fenêtres plus hautes que larges et des portes qui fendaient cet alignement de briques uniformes d'une façon si répétitive que le regard n'en retenait qu'une image brouillée de stries verticales dans lesquelles il arrivait qu'un homme, une femme ou un enfant fussent avalés comme des figurines de papier dans une boîte aux lettres. Le regard canalisé par les deux rangées de maisons qui semblaient se rejoindre au bout de cette rue étroite, elle prêtait attention au battement de ses pas sur le pavé luisant...
Souvent, le soir, elle revenait marcher à travers cet espace incertain, ni campagne ni ville, ces anciens champs devenus terrains vagues, en attente de projets urbains, entre la ZUP et l'autoroute. L'antidote de la peur était quelque part de l'autre côté de la brume, où finissaient par disparaître les feux arrière des véhicules. Il fallait quitter la rive connue, s'élancer à travers cet espace incertain, ces terrains en attente d'un emploi, d'une utilisation, d'une occupation au sens propre du terme, aussi vagues qu'elle se sentait velléitaire, aussi vides qu'elle se sentait creuse, bordés du côté de l'horizon par la fluidité, la mobilité de l'axe autoroutier, et du côté de la cité par la rigidité, l'inquiétante immobilité des grands murs de béton, aussi austères que ceux d'une prison. Mais une sorte de paralysie la maintenait sur place, dans la prison de ses désirs contradictoires et de sa conscience confuse, déboussolée, affolée...
Françoise Gérard,
Paysages de l'errance.
Paysages de l'errance.
2. Retour imaginaire
1. Pourquoi?
2. Mécanique des gestes
La cité
1. Pas à pas
2. Terre promise
Vous pouvez lire d'autres textes de Françoise Gérard en vous rendant sur son site.
SUR L'ERRANCE
Le monde de Rafael Sperling
Le texte dans sa traduction en français.
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
ÉCRITURES PARALLÈLES
SUR L'ERRANCE
Le monde de Rafael Sperling
Le texte dans sa langue originale.
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Un jour, voilà : je n’existais pas et soudain je me suis mis à exister. Il n’y a pas d’explication claire à cela. Soudain, je suis apparu. Mais je crois que c’est normal. Les choses viennent au monde puis s’en vont, sans aucune explication. Je suis ici et après je n’y suis plus. Je cesse d’exister et à un moment donné j’existe à nouveau.
Soudain, mon père apparaît. Il me dit « Salut » et puis disparaît. Ce qui veut dire qu’à un moment donné, je n’ai pas de père, ni rien et que pendant trois secondes, j’ai un père, qui me regarde et me dit « Salut » pour aussitôt disparaître, et les choses redeviennent comme avant.
De temps en temps, autre chose apparaît, un arbre ou un pylône, mais ces choses disparaissent aussitôt. Il en va de même pour le sol ; je passe la plus grande partie de mon temps à tomber dans un espace blanc et vide ; je dirais que c’est difficile de savoir si je tombe vers le haut ou vers le bas, vu qu’il n’existe rien ici, pas si simple de se faire une idée de ce genre de choses. De temps en temps, quand un objet quelconque apparaît, je pense quelque chose du genre « Ah, il vient d’en-bas, donc je viens d’en-haut. » Mais aussitôt apparaît un autre objet, qui « tombe » dans une autre direction, comme s’il allait de la droite vers la gauche par rapport à l’objet précédent, ce qui m’embrouille à nouveau. De rares fois, le sol apparaît. Je tombe dessus, mais je ne me fais pas mal. Généralement, il n’y a rien, c’est un sol blanc, apparemment très propre. Je me déplace un peu dessus, j’en profite tant qu’il y a un sol pour marcher. Jusqu’au moment où soudain, le sol disparaît et je tombe à nouveau dans une direction indéfinie.
Je n’ai pas très faim, vu que je ne dépense presque pas d’énergie. Je me nourris de la nourriture qui apparaît sporadiquement près de moi ; fruits, viandes, œufs, friandises.
Sincèrement, parfois je me demande comment je connais le nom des choses et leurs fonctions. Depuis que je sais que je suis quelqu’un, je suis ici, en train de tomber dans cet espace blanc, jamais personne ne m’a rien appris ; d’ailleurs, je n’ai jamais vraiment discuté avec personne, car les gens surgissent et disparaissent mystérieusement – on n’a pas le temps de devenir un tant soit peu intime. J’ai dû apprendre à parler (et à penser) au cours de ces brefs épisodes d’interactions humaines, et grâce aux quelques livres qui me sont arrivés dans les mains par hasard. J’ai eu l’occasion de lire quelques livres de grammaire et des dictionnaires, de sorte que j’ai pu rattacher toutes ces choses entre elles et commencer à formuler des pensées logiques, car auparavant, je pensais seulement à partir de mots et d’idées mélangées et d’objets errants, jusqu’alors sans nom, qui passaient devant moi.
J’aimerais savoir comment vivent les autres personnes : ce qu’elles font, ce qu’elles pensent... Est-ce qu’elles vivent comme moi, transitant de manière errante, dans leur dimension solitaire, isolées les unes des autres?
Je passe la plus grande partie de mon temps à penser au moyen de m’échapper d’ici. Quelqu’un qui est passé devant moi un jour m’a dit qu’il existe des passages vers d’autres dimensions, et qu’il faut y être attentif. J’ai entendu aussi des histoires sur la manière dont on y vit, sur leurs couleurs, leurs odeurs, leurs objets, leurs lois. Il en existe certaines où le sol est continu, on peut y marcher quand on veut, plutôt que de tomber dans le vide la plupart du temps, comme c’est mon cas. On dit que dans ces dimensions, il est possible de construire une société – quelque chose que je n’ai jamais vu de près – où les gens cohabitent et peuvent ensemble construire leur vie et progresser.
Dans d’autres dimensions en revanche, les gens naissent collés. Chaque personne en a une autre collée dans son dos ; elles ne s’entendent pas nécessairement bien, elles doivent apprendre à coexister harmonieusement. Les deux doivent s’entendre sur les endroits où aller et quelles activités réaliser, étant donné que l’une devra obligatoirement prendre part à ce que l’autre décide.
Il existe également des dimensions saturées. Dans la mienne, les choses apparaissent et disparaissent, de telle manière qu’il existe de fait peu d’objets physiques. Dans les dimensions saturées, les choses apparaissent et ne disparaissent plus jamais – les objets surgissent et s’accumulent, de sorte que les dimensions se transforment en un entassement de matière. À l’intérieur de ces dimensions, seulement quelques êtres microscopiques parviennent à survivre ; la tendance est l’extinction complète de la vie.
On m’a dit qu’il existait des dimensions, où les êtres naissaient toujours à l’intérieur d’autres êtres. Certains ont réussi à s’adapter, mais ce n’est pas le cas des êtres humains. Lorsqu’un être humain apparaît, il provoque la mort d’un autre. Ainsi, la population humaine de ces dimensions est extrêmement réduite, quelque chose comme trois ou quatre personnes seulement.
Il est difficile de dire quel est le nombre d’habitants de ma dimension. Les choses sont très fluctuantes par ici. Comment est-il possible d’obtenir des données statistiques d’un endroit où l’existence des choses est instable? Quelque chose qui existe maintenant peut ne plus exister cinq minutes après ; là où je vis, on ne peut compter sur rien.
Je m’approche d’un portail qui relie les dimensions. Je fais des efforts pour m’approcher de lui. Si le sol existait maintenant, je pourrais marcher jusque là ; nager dans l’air n’avance pas à grand chose. Je vois que derrière moi une personne s’approche à grande vitesse. Nous nous heurtons et je suis projeté très loin du portail, tandis qu’elle s’en approche ; mais malheureusement pour elle, le portail disparaît sous ses yeux ; cela l’attriste profondément et la désespère. À ma grande surprise, la personne disparaît aussitôt.
Je me demande où nous allons, lorsque nous ne sommes pas ici. C’est un peu comme si nous dormions ou que nous étions évanouis; je ne parviens pas à me souvenir de ce qui arrive lorsque je disparais. Est-ce que j’apparais dans une autre dimension? C’est bien possible, car j’ai lu dans un livre que dans certaine dimension, la mémoire n’existe pas, ou du moins elle est très courte, comme le souvenir d’un rêve que l’on oublie sitôt éveillé. D’où sont venus ces livres ? Il est impossible de fabriquer un livre ici, ils viennent sûrement d’ailleurs. Ces livres ont probablement disparu dans d’autres dimensions et ont resurgi ici – à moins que quelqu’un ait traversé un des portails avec un de ces livres à la main, ce qui est très improbable, étant donné qu’en faisant cela, nous apparaissons nus dans l’autre dimension ; c’est ce que j’ai lu un jour. Le problème, c’est que je ne connais personne qui ait traversé un portail. Ni personne qui ai rencontré quelqu’un qui l’ait déjà fait. Du coup, il se peut que l’histoire des portails ne soit qu’une légende, qu’ils ne servent vraiment à rien, et peut-être qu’il n’existe même pas d’autres dimensions ; les gens ont peut-être besoin de croyances sans fondement comme celle-là pour rester sains...
Les années passent, rien ne m’arrive. Et je ne peux rien faire pour qu'il m'arrive quelque chose. Je me demande quel sera le sens de mon existence, étant donné que tout ce que je fais se résume à errer dans cet espace vide. Je suis presque déjà mort ; éternellement à la dérive.
Rafael Sperling,
Un jour, quelque part,
Traduit du portugais (Brésil) par Emilie Audigier (première publication en France par le Lampadaire, 2014)
Un jour, quelque part,
Traduit du portugais (Brésil) par Emilie Audigier (première publication en France par le Lampadaire, 2014)
CERTO DIA, ELM ALGUM LUGAR
Certo dia foi assim. Eu não existia e então passei a existir. Não existe uma explicação muito clara. Do nada, apareci. Mas acho que é o normal. As coisas aparecem no mundo e depois desaparecem, sem nenhuma explicação. Eu estou aqui e depois não estou mais. Deixo de existir e em algum momento volto a existir outra vez.
Do nada, meu pai aparece. Ele diz « Oi » e depois desaparece. Isso quer dizer que num dado momento eu não tenho nem pai, nem nada, e que, durante três segundos, eu passo a ter pai, que me olha e diz « Oi », para logo depois sumir e as coisas voltarem a ser como antes.
Volta e meia surge alguma outra coisa, como uma árvore ou um poste, mas essas coisas somem logo depois. Até o chão faz isso; passo a maior parte do tempo caindo num espaço branco vazio; diria que é complicado saber se estou caindo para cima ou para baixo, uma vez que não existe nada aqui, não dá pra ter muita noção desse tipo de coisa. Volta e meia, quando surge algum objeto, eu penso algo como « Ah, ele está vindo lá de baixo, portanto, estou vindo de cima ». Mas logo depois surge outro objeto « caindo » numa outra direção, como se estivesse vindo da direita para a esquerda em relação ao objeto anterior, me confundindo novamente. Algumas raras vezes, o chão aparece. Caio nele, mas não me machuco. Geralmente não há nada, é um chão branco, muito limpo, aparentemente. Caminho um pouco sobre ele, aproveitando enquanto há chão para se andar. Até que, de repente, o chão some e passo a cair em alguma direção indefinida outra vez.
Não sinto muita fome, uma vez que quase não gasto energia. Alimento-me das comidas que esporadicamente surgem perto de mim: frutas, carnes, ovos, doces.
Sinceramente, às vezes me pergunto como sei o nome das coisas e suas funções. Desde que me dou por gente estou aqui caindo neste espaço branco, nunca ninguém me ensinou nada; aliás, nunca conversei direito com ninguém, pois as pessoas surgem e desaparecem misteriosamente — não há tempo de criar qualquer tipo de intimidade. Devo ter aprendido a falar (e pensar) com esses breves episódios de interação humana, além de alguns poucos livros que vieram parar por acaso em minhas mãos. Tive a oportunidade de ler algumas gramáticas e dicionários, de forma que pude juntar as coisas todas e começar a formular pensamentos lógicos, pois antes disso apenas pensava em palavras e ideias embaralhadas, e nos objetos errantes, até então sem nome, que passavam por mim.
Gostaria de saber como vivem as outras pessoas: o que fazem, o que pensam... Será que vivem como eu, transitando de forma errante em sua solitária dimensão, isoladas umas das outras?
Passo a maior parte do tempo pensando em como escapar daqui. Alguém que passou por mim, certa vez, disse que existem passagens para outras dimensões, e que se deve estar atento a elas. Também ouvi histórias de como é viver nelas, das suas cores, cheiros, objetos, leis. Existem algumas onde o chão é constante, pode-se caminhar sempre, ao invés de ficar caindo no vazio a maior parte do tempo, como no meu caso. Dizem que nessas dimensões é possível construir uma sociedade — algo que nunca pude ver de perto — onde pessoas convivem e, juntas, podem construir suas vidas e progredir.
Já em outras, as pessoas nascem coladas. Cada pessoa possui outra colada nas suas costas; não necessariamente elas se dão bem, deve-se aprender a conviver em harmonia. As duas devem negociar a que lugares ir e que atividades realizar, uma vez que uma terá, obrigatoriamente, que participar do que quer que a outra decida.
Também existem as dimensões saturadas. Na minha, as coisas aparecem e desaparecem, de forma que existem, de fato, poucos objetos físicos. Nas saturadas, as coisas aparecem e nunca mais somem — os objetos vão surgindo e se amontoando, fazendo com que as dimensões se transformem num aglomerado de massa. Nessas dimensões, apenas alguns seres microscópios conseguem sobreviver; a tendência nelas é a extinção da vida por completo.
Disseram-me que existem dimensões onde os seres nascem sempre dentro de outros. Alguns conseguiram se adaptar, mas no caso dos seres humanos isso não funciona. Quando um ser humano surge, ele causa a morte de outro. Dessa forma, a população humana dessas dimensões é extremamente reduzida, algo como três ou quatro pessoas apenas.
Na minha dimensão é difícil dizer a quantidade de habitantes. As coisas são extremamente inconstantes por aqui. Como se pode obter dados estatísticos de um lugar onde a existência das coisas é instável? Algo que existe agora pode não existir daqui a cinco minutos; onde vivo não se pode contar com nada.
Estou me aproximando de um portal que atravessa dimensões. Esforço-me para me aproximar dele. Se houvesse chão agora, poderia caminhar até lá; ficar nadando no ar não está adiantando de muita coisa. Vejo que atrás de mim uma pessoa se aproxima em alta velocidade. Nos chocamos e sou lançado para bem longe do portal, enquanto que ela se aproxima; mas para seu azar o portal some diante de seus olhos; ele fica realmente triste e desesperado. Para a minha surpresa, logo depois a pessoa desaparece.
Me pergunto para onde vamos quando não estamos aqui. É um pouco como se estivéssemos dormindo ou desmaiados; não consigo lembrar o que acontece quando sumo. Será que apareço em outra dimensão? É bem possível, pois li num livro que, em algumas dimensões, não existe a memória, ou pelo menos ela é muito curta, como a lembrança de um sonho que esquecemos logo após o despertar. De onde esses livros vieram? Não seria possível fabricar um livro por aqui, certamente vieram de outro lugar. Provavelmente esses livros desapareceram em outras dimensões e aqui ressurgiram — a não ser que alguém tenha cruzado um dos portais segurando um desses livros, o que é muito improvável, uma vez que, fazendo isso, aparecemos nus na outra dimensão; foi o que li certa vez. O problema é que não conheço ninguém que tenha cruzado um portal. Nem ninguém que tenha conhecido uma outra pessoa que já tenha feito isso. Sendo assim, é possível que a história dos portais seja apenas uma lenda, que eles não sirvam pra nada mesmo, e, quem sabe, que nem existam outras dimensões; talvez as pessoas necessitem de crenças injustificadas como essa para se manterem sãs...
Os anos passam, nada me acontece. E nada posso fazer para que algo aconteça. Penso qual será o meu sentido de existir, tendo em vista que tudo que faço é apenas vagar nesse espaço vazio. Já estou quase morto; eternamente solto.
Rafael Sperling,
« Certo dia, elm algum lugar », Festa na usina nuclear (Fête dans une usine nucléaire),
éditions Oito e meio, 2011.
« Certo dia, elm algum lugar », Festa na usina nuclear (Fête dans une usine nucléaire),
éditions Oito e meio, 2011.
Voyage en lampadaire
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Adeline Zoursdru était accro au Lampadaire et chaque soir elle lisait, relisait, dans son lit sur son smartphone les écrits en ligne. C’était un rituel hérité de l’enfance, quand elle lisait à la lampe électrique cachée sous ses draps parce que ses parents lui disaient : « Tu n’as pas autre chose à faire que de perdre ton temps à lire ? ». Elle prévoyait de partir et se disait, « Zut, c’est râpé pour les patronnes qui n’aiment que Laforgue et se tapent le coquillard du reste, mais peut-être que ça intéressera Hubert Lambert le voyage à la mer que je projette de faire ? Après tout c’est lui qui lit dans son cagibi. » Oui, elle était shooté au Lampadaire si bien qu’en pédalant elle les repérait instinctivement et en vit trois à l’intérieur des demeures.
Dans sa course deux fois elle voit la lune. Bof, ce n’est pas extraordinaire. Mais deux fois seulement, deux fois alors qu’elle passe son temps à regarder les étoiles, deux fois dont la première dans un jeu de mots foireux : Et lune et l’autre. Quand S. Freud écrivait Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient, il eut un problème avec ce mot, pas tant qu’il trouvait que ce mot manquât d’esprit, mais parce que la Zoursdru ne verbalisait pas et qu’intérieurement elle se récitait les vers de Michele Tortorici :
E chi poteva pensare che te avrei trovata
Même ici, assez proche
All Empire da sembrare
Une compagne de voyage à travers
Il cielo. E chi pen sava che ti saresti fermata
T’arrêterais pour regarder ces routes encaissées…
Se mélangeant les pédales avec la traduction de Danièle Robert. Laissant tomber l’italien car Freud n’y comprenait rien empêtré dans son allemand, elle se murmurait même ici, assez proche/ une compagne de voyage à travers/ t’arrêterais pour regarder ces routes encaissées : c’est tout ce que je veux faire, il a trouvé les mots pour mon voyage.
Du nord au sud elle en a suivi des routes encaissées en traversant la douce France pays de son enfance. Mais pas seulement dans les vallées, pas uniquement sur les chemins boisés ou encore les layons champêtres embourbés, non, ce qui la frappait c’est aussi les villes ou les hameaux qui se gonflaient, qui enflaient pour être ville. Où les murs vous enchâssaient. Petite elle était fascinée par ces murs, cette peau de la ville où il était inscrit défense d’afficher loi du 21 juillet 1881 et où pourtant, à travers l’histoire, chacun y mettait son tatouage. Elle s’arrêtait aux démolitions quand le bâtiment dépecé laissait voir le papier peint, la cheminée et la salle de bain. N’est-ce pas Hubert que c’est dégoûtant et fascinant ? Des murs, elle en a vu, mais tout particulièrement des murs de briques que l’on retrouve du nord au sud, des rangées de briques que l’on retrouve avec des teintes différentes. Et toujours parcourant le damier elle recherchait ce qu’écrivait Françoise Gérard : la teinte de cette brique, moins rouge que d’autres et éclairée de l’intérieur par quelques grains de sable qui se révélaient capables de transformer l’uniformité d’un simple mur en une symphonie de couleurs …Mais du nord au sud, elle n’a pas vu le Saint Graal, que des cases où l’on devait ranger ses devoirs de vie.
Même ici, proche/ une compagne de voyage à travers/ t’arrêterais pour regarder ces routes encaissées, murmurait-elle. Et cette compagne de voyage c’était la lumière. Anche qui, cosi vicina, clamait-elle en italien pour que Sigmund n’y comprenne rien. Anche qui, cosi vicina et la lumière s’enroulait sur son pédalier lui donnant la force de l’aventure. Cette lumière tantôt si fière, tantôt si discrète, cette lumière des pays de briques qui tantôt plombante écrasait la pierre, l’asséchait, tantôt caméléon se dissimulait dans le nuage, cette amie qui tant de fois lui avait permis, au coin de la fenêtre chère à Sophie Saulnier, de résoudre ses problèmes, parfois mathématiques, de lire tant de lettres et de cartes postales, tant de fois veillée sur le sommeil du chat qui se lovait sur ses journaux, cette amie pouvait être ennemie. Adeline était prévenue, toute petite on lui avait interdit de regarder le soleil et quand, en cachette, elle avait essayé, elle ne pouvait plus apercevoir l’arbre, elle ne pouvait plus voir sa poupée, ni la maison, le soleil recouvrait tout. Il avait fallu aussi qu’elle prenne des verres fumés à la bougie une fois pour regarder une éclipse du soleil. Anche qui, cosi vicina, c’est toujours surprenant, choquant, qu’une si tendre amie puisse devenir une ennemie intime. Ainsi sur la photo, Ariane était véritablement décapitée par un trait de soleil de Pasiphae. Pourquoi tant de haine ? Pourquoi faire de cette amie une arme si meurtrière ? C’est Joseph Pasdeloup qui explique le sinistre dessein : Si je l’éblouis, pense Pasiphae, si je l’éblouis suffisamment longtemps, elle deviendra aveugle, les yeux blancs tournés vers l’intérieur et jamais personne ne l’aimera, ou ne fera semblant de l’aimer, et je garderai Thésée, et je garderai la petite Phèdre … Le visage au soleil, au coin de la fenêtre, elle pleurait en regardant la photo, à chaudes larmes, ce n’était pas une larme de larmes, c’était un torrent de désespoir, une crue d’amertume devant la trahison, mais ses larmes sitôt sorties des glandes lacrymales s’évaporaient, si bien que l’on ne s’en apercevait pas. Elle paraissait insensible et pourtant, elle pleurait devant cet aveuglement.
De lampadaire en lampadaire, avec pour compagne la lumière et les larmes, Adeline arrivait au terme de son voyage: la mer, E chi poteva pensare che te avrei trovata. Elle se disait : « Adeline à la plage, ça ferait un beau titre, surtout pour un film. Adeline, qui veut dire « noble », a tout à fait une tête de conte moral. » De temps en temps, elle parlait d’elle à la troisième personne en raison de sa noblesse. Elle croyait être arrivée au bout du bout de ses larmes. Et pourtant, ce n’était pas fini. Ce n’était pas une plage banale qui vous laisse une droite d’horizon trompeur. En face il y avait une île. De loin, une île, c’est ce que l’on voit, ce qui vous saute à l’œil non embué, une forme qui saute de l’eau comme un dauphin ou une baleine et pourtant qu’on ne voit pas car trop lointaine avec sa face cachée comme la lune. Voilà, c’est une lune en pleine mer. C’est aussi une terre prisonnière de l’eau, embastillée comme un vulgaire voleur de pain. Une île, c’est, de loin toujours mystérieux quelle que soit la saison. C’est ce que traduit Anne Cauquelin : Sur l’île, l’hiver avait été particulièrement rude. Les brumes n’avaient pas quitté les hauteurs du F'Jou, d’où elles se répandaient, immobiles sur les plaines en bordure des forêts. Celles-ci restaient impénétrables, bien qu’on distinguât très nettement leurs masses sombres qui limitaient les nuages pesants, d’un jaune sulfureux que le F'Jou nous envoyait. Leur aspect même désespérait l’approche défendues comme elles l’étaient par cette barrière de brouillard. De la plage, voilà comment apparaît une île, floue à travers les larmes de joie et toujours trop loin, impénétrable comme un chagrin. C’est une distance qui nous met dans le brouillard et rend notre imagination contradictoire, on y voit des dragons et des chapeaux de Napoléon.
Alors, Adeline qui croyait en avoir terminé avec son voyage, son éphémère voyage malgré la longueur des plaines et les vagues des montagnes, vit qu’elle n’était pas arrivée au bout de ses alarmes. Maintenant il fallait traverser jusqu’à l’île. Les vers sont prophètes : Même ici, proche/ Une compagne de voyage à travers/ T’arrêterais pour regarder ces routes encaissées. Une compagne de voyage à travers ! Je ne sais si vous avez traversé en bateau pour aller sur une île, forcément en bateau, mais c’est un moment magique. La Zoursdru en avait fait des traversées pour aller à Tavira, Berlinghua, l’île d’Yeu, Formentera, ou encore traverser la Gironde, la baie d’Along ou le Mekong. A chaque fois c’était le même mystère. Sur le pont, obligatoirement, coincé d’un bord à l’autre, elle était muette, seuls l’ouïe et les yeux étaient en éveil, à ce moment, dans le chaudron chauffé par le soleil ou les traînées du ciel seul le corps peut parler comme le dit Agnès Jauffrès. D’un bord à l’autre, elle était l’immobilité animée, l’attente impatiente et en même temps l’embrassade des retrouvailles. Elle était en oblique, transversale, rien ne se mettait en travers de ses sens. Elle traversait l’air et la lumière coincée entre le chant du moteur et de la vague qui faisaient un bœuf. Là, dans ce nulle part enchanté lui revenait « le souvenir ». Elle le retrouvait seulement maintenant à cet instant de la musique jetée à travers la mer comme le dit si bien Marguerite Duras citée par Mme Jauffrès.
Michel Lansade
écrit pour le Lampadaire, mai 2014
écrit pour le Lampadaire, mai 2014
Michel Lansade
Le voyage à la mer
Chapitre 1
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Elle ne venait de nulle part en particulier.
Elle n’avait rien de particulier non plus.
Seulement les jours s’écoulent.
Elle n’est pas béate.
Elle ne se reconnaît pas dans le miroir.
Pas la peine de demander : suis-je la plus belle en ce miroir ?
Il reste muet et c’est une autre personne qu’il reflète.
Tout le jour son ombre varie
Et elle ne se reconnaît pas non plus dans cette silhouette élastique.
--Moi, mon moi d’Adeline m’est toujours étranger.
Elle n’est pas folle.
Elle ne se dédouble pas.
Elle connaît son identité.
Elle reconnaît ses caprices.
Elle sait distinguer le lundi du vendredi, le mercredi du jeudi.
Elle sait le prix de la baguette et du kilo de pommes de terre.
Elle aime les pensées, les jaunes, les mauves, les carmins et les blanches.
Elle peut nommer sa famille et en cherchant un peu donner les dates de naissance.
Elle a l’impression d’être sur une chaine d’emboutissage.
Elle regarde le ciel.
Vénus planète de Vulcain
Qui forge dans le volcan
Maat Mons.
Vénus qui alla voir Mars
Peut être sur les plateaux d’Aphrodite Terra.
Vénus devenue Klein.
-- Etoile du berger, guide, guide-moi, rassemble le troupeau que je suis, pendant que le ciel est encore gratuit.
Le problème du jour est d’être jour.
D’être en quelque sorte ajouré entre deux jours.
D’être souvent gris.
Un gris qui se délave de jour en jour
Tandis que la nuit il y a des ombres,
Des contours, des apparences
Et des fantômes qui sortent de l’ampoule, de la bougie, du lampadaire ou de la lune.
Bien sûr elle a une petite nostalgie pour l’âtre
Qui projetait sa lumière à un mètre cinquante
Et laissait la pièce à sa chimère dans le noir.
Il y a ce qui se fait dans le secret du noir et ce qui se fait dans l’évidence de la lumière.
Elle sait que la nuit même un cheveu a son ombre.
Qu’un soupçon fait une grande histoire.
Deux yeux brillent sous ma lampe :
Un lapin, un loup, un chevreuil, un lama, un ours ou un éléphant ?
Ami le souvenir qui revient, ou bien ennemi
Ce cauchemar qui s’insinue dans ma béatitude ?
Est-ce qu’un bon cauchemar qui vous réveille
Ne vaut pas mieux que deux beaux rêves dont on n’a pas le souvenir ?
Les jours s’en remettent aux planètes, mais en plein jour on ne les voit pas.
Elle ne les compte pas. Elle les regarde passer. Il est passé par ici, il ne repassera pas par là.
Ce n’est pas drôle un jour, ça a toujours la même forme :
Se lever, manger, manger et se coucher.
C’est une coquille vide qu’il faut farcir avec toujours les mêmes ingrédients.
Ce n’est pas drôle un jour, chaque jour il faut le mettre à jour.
-- Chaque jour il faut penser à deux mains. La tête bien serrée entre celles-ci.
Une nuit, elle a vu une couronne
Six pointes au dessus de la lune.
Une couronne comme dans un dessein animé.
Une couronne, une cour ? Pourquoi pas moi ?
-- Je veux tout, tout le soleil, et l’or du soleil de minuit. Tout le soleil, et lune et l’autre, et enfiler un cachemire sur les neiges du Bhoutan.
Je veux tout et plusieurs vies, l’une complétant l’autre, l’une complimentant l’autre. Je veux être rat et chat, étoile et voile qui se déploie au large.
Petit rat à l’Opéra pour me faufiler en ballerines dans des trous de souris. Chat pour voir la nuit et le hibou qui me dispute la souris. Et dormir tout le jour et ronronner.
Étoile pour être le bout d’une baguette magique et mettre des millions d’années à mourir. Être morte mais briller encore. Être une star.
Voile pour transporter le marin ailleurs, n’importe où hors de son monde. Aller de port en port, poussée vent debout de longs jours. Et dormir tranquillement dans un port de plaisance.
Je veux ce repas de saveurs ni uniques ni quotidiennes qui me laissera un souvenir de grand palais. A la tienne Etienne tu n’as pas été lapidé pour rien.
Je veux tout, même les riens du tout et toutes mes vies seront très bien.
Elle examine la grande Ourse.
-- Qu’est-ce que je vais mettre à mijoter dans cette casserole ? Ce qui est sûr, c’est qu’à cette queue je ne me brûlerai pas les doigts.
Elle s’est dépouillée de tout pour œuvrer à son plat.
Du travail, du ménage, des enfants, des livres,
Des films, du journal, de la revue, des lettres …
De tout ce qui était écrit au jour le jour.
Ils ont enfermé le ciel dans une boite.
Le temps du soleil et des étoiles
Est confié à une puce
Qui saute, saute, saute dans les horloges digitales.
Le monde est amnésique.
Il faut prendre rendez-vous avec sa mémoire.
Ils ont enfermé les jours de la lune et du soleil.
Le monde consulte pour l’intervalle.
Le monde consulte à intervalle régulier.
-- Je suis le milliardième de la seconde qui passe. La lumière, malgré sa vitesse, n’a plus le temps d’arriver jusqu’à moi.
Elle regarde son smartphone.,
Sous le jour qui ne dure qu’un temps.
Cette boite qui couvre le monde.
Ce moi autre.
Elle y voit la croissance du désert.
Elle regarde ce moi autrement pucé.
Court creuser la terre. Fait un petit trou,
--Qu’est-ce qui fait le trou, le vide ou la terre ?
Enterre son portable,
Rebouche
Et dépose une pierre dessus.
--Je me déporte
Elle est nue, enfin, comme un bébé,
Comme un cadavre qui prononce ses vœux.
Elle est ce grain de sable qui se déplace avec la marée et le vent,
Ce cristal taillé aux pans lisses.
Elle regarde la Grande-Ourse, si grande,
Si légère dans son pointillé, comme une dentelle
Lumineuse et qui bascule dans le ciel.
-- Il n’y a qu’une mer qui peut avoir la recette.
Elle n’a pas bu.
Elle n’a pas visité les vignes d’Icarus
Et ne pense pas être empoisonnée par le vin.
Juste elle a envie d’assassiner Chronos, pas ses enfants,
De tuer le temps minute par minute.
-- Pour tuer le temps, il suffit de suivre son plaisir.
Elle n’est pas malade, c’est un porteur sain
Comme vous et moi, qui sait que les cellules cancéreuses
Circulent en elle,
Tant qu’elles circulent…
Elle ne peut pas se résoudre à ce que les saisons passent
Toujours dans le même ordre.
Elle regarde Arcturus
Qui brille dans le Bouvier.
-- Finalement je ne scintille pas comme une étoile. Je suis une simple planète qui se demande ce qu’elle va faire de ce qu’on a fait d’elle.
Elle est elle.
Comme on ne peut pas aller nu dans le monde,
Elle a pris sa robe, sa tente, un pull, son butagaz,
Son duvet, son ciré, son vélo, de quoi se changer, de quoi manger…
Et son cerf-volant.
Il en faut des choses pour sortir de soi.
Elle ne sait pas si elle doit s’habiller en noir ou en blanc.
En blanc, c’est être un arc en ciel ambulant, mais c’est salissant, c’est être la lune qui se promène au matin, c’est être la feuille qui vole dans le courant d’air.
En noir, c’est porter le deuil de l’ancienne vie, c’est l’absence de couleur, c’est être l’acteur qui entre en scène et qui les prend toutes, c’est être la force d’un caractère.
Elle regarde le Bouvier,
Le laboureur et ses sept bœufs
Qui font la rotation des cieux.
-- Laboure, Bouvier, c’est le ciel qui manque le moins. Je pars, au diable l’économie !
Michel Lansade,
Le voyage à la mer, chapitre 1, publication 2014.
Le voyage à la mer, chapitre 1, publication 2014.
Les voyages forment la jeunesse.
Proverbe
La mer joint les régions qu’elle sépare.
A Pope, Windsor Forest, 400, 1713
Michel Lansade
Le voyage à la mer
Chapitre 2
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Elle a enterré son Smartphone avec cérémonie.
Elle n’a plus de GPS.
Elle dirige son parcours.
-- Je vais suivre les sept stations de la grande Ourse
Elle est sur son vélo, chargé de ses bagages à l’avant et à l’arrière.
Sur son vélo chargé, sur le paquetage arrière, vole son cerf volant,
Son dragon volant
C’est un samouraï en campagne.
Elle roule sur la route.
Des automobilistes la klaxonnent
Mécontents de son encombrement, d’autres admiratifs.
Le vélo c’est la renaissance.
La vitesse et le silence, sans lequel il n’y a pas de musique.
Richard III de retour dirait à Lear sorti de son délire
Mon empire pour un vélo.
Elle roule, souvent seule, dans le crissement de ses pneus.
A chaque tour de roue, ils disent je suis le silence le soupir
Au loin des bruits de tracteurs et d’oiseaux.
Rou rou rou rou, fait la palombe
Tu es devenue un pigeon voyageur ?
Rou rou quel est ton message ?
-- Je transporte des riens du tout mais je me transporte toute…
1) Sur un banc au soleil
Devant la bibliothèque municipale
Sur le fronton est inscrit
Une bibliothèque est un hôpital
Pour l’esprit
Le lecteur
Le crayon à la main
Souligne et surligne
Ça c’est bien
Ça c’est pas bien
Elle les voit lire
Dans leur antre
Dans leur chambre
Sous le lampadaire
Un gros livre
Ce grand mal
Qui va son destin
Elle les voit lire
Le crayon à la main
-- J’en sais rien, viens donne moi la main, prends, viens sur mon chemin.
Elle fredonne une vielle chanson
Mon pote le gitan
Sur son vélo chargé, son cerf-volant au vent.
Mon pote le gitan c’est un gars curieux
Lalala…
C’gars-là une roulotte, s’promène dans sa tête
Et quand elle voyage jamais ne s’arrête
Lalala… On a mal au-dedans
Mon pote le gitan, c’est pas un marrant
Lalala…
Au fond ta musique était pleine d’espoir
Elle suit des haies, des barrières, des ornières,
Des aubépines, des barbelés,
Gé fermée.
2) De l’autre côté
De la charmille
Il y a le jardin
L’hortillon
Qui sentait bon
Le sauvage
C’est un patchwork
De champs
Qui s’emboitent
Il est noir de labour
Vert de jachère
Jaune de colza
Vert et jaune
De tournesols
Blond du blé
Le paysage est beau
Sous le regard
Mais l’ivraie
Le dévore et
L’humus est
Un cactus
Qui manque d’air
L’humus est
Aussi dur qu’un cubitus
Le sol se dérobe
Le ver n’y trouve
Plus son la
Et chante en contre-ut
Il n’y a plus de sol
Il vit sous perfusion
Les fleurs ne s’aiment
Plus sous la pluie
L’eau ne gazouille plus
Au rivage
Le jardin est cultivé
Comme les enfants élevés
Dans le coffre d’une voiture
-- Je suis atterrée, la terre ne grouille plus. Le sol est déjà couvert de bitume. Comment vais-je faire pour cultiver mon jardin ?
Le plaisir de la descente.
Le vent au front, sur son vélo chargé.
Le cerf-volant qui se couche à l’arrière,
Oscille, vibre dans le vent.
Le plaisir de glisser, de rouler
C’est la lumière qui vient au front
Ce n’est pas Pasiphae unie au taureau de bois
Qui n’a engendré qu’un labyrinthe.
Elle, c’est l’évidence du soleil et du vent
L’éclair qui vient frapper le cerf-volant.
L’ivresse d’Icare.
Elle avance dans la neige, le vélo à la main.
C’est le silence.
Qui soutient l’autre ? Est-ce son bâton de vieillesse dans ce monde blanc où pas un oiseau ne chante ?
Elle fait des traces dans le silence : des pas et une ligne qui vont droit à la prochaine station.
3) Le salon de midi s’est déserté
Quand peu à peu le témoin
A parlé de faim
De prison et de bâillon
De mains coupées
De pieds coupés
Et grillés
Elle est restée seule
Avec le témoin
Et ses mots déchirés
L’air est gelé
Elle a mal
Elle est pétrifiée
C’est le désert
Elle a froid.
Un seau glacé
Lui est tombé dessus
Une boule s’est nouée
Dans son estomac
Elle est muette
Enfermée dans sa pierre
Elle prend un verre de Chinon.
C’est fruité, ça sent la mure le long des haies,
C’est boisé comme les arbres qui poussent au milieu des champs
Et font de l’ombre aux vaches.
La veine du marbre reprend vigueur comme un retour à la civilisation.
-- Le monde aboie et mord. Il déchire les chairs, prend les dents, broie les doigts, comme s’il se vengeait. Comme si petit, il n’avait jamais vu d’étoiles filantes ou de feux d’artifice.
Elle ne dort plus, elle sort le soir,
Regarder le Bouvier : plus besoin de rêves, elle est son rêve.
Juste ça et là, un somme pour se reposer les yeux.
Le sommeil est frère de la mort.
-- Zut, j’ai loupé Ison, qui est passé trop près du soleil. Elle n’a pas fait long feu la comète. Rien à faire de la comète, je suis une planète.
Elle a un harnais autour du buste pour fixer son parapluie qui la protège de la pluie et du soleil.
Les jours de canicule le bitume fond. Le pneu s’enfonce.
Le vélo semble éclabousser du bitume comme les jours de pluie.
La durée de vie du glaçon sur le bitume est courte. Il voudrait retrouver son frigo sans trémolo.
Il arrive parfois les jours de grand vent ou quand elle roule trop vite que le parapluie se retourne.
Elle longe des rangées de briques alignées,
Superposées les unes sur les autres.
Des murs, des cases pour caser la vie.
Ce ne sont pas des longères,
Mais des casiers d’écoliers pour ranger ses devoirs de vie.
Il y en a des roses de soleil
Des rouges teintes par la pluie noire.
L’argile fond, se creuse et le sable s’écoule,
Redevient plage.
Les cristaux sont ternes au soleil.
La vie d’hier devient château de sable
Emporté par la marée toujours renaissante.
4) J’ai épousé un veuf
Il avait une fille de 25 ans
Ma belle-fille
Mon père est tombé amoureux
Ils se marient
Ma belle fille devient ma belle-mère
Mon fils devient le beau frère
De mon père
C’est le demi-frère
De ma belle-mère
Un peu mon oncle
Je suis l’épouse
De mon beau-grand-père
…
-- La famille est devenue un problème mathématique. C’est un album de famille transmis de génération en génération où on ne sait plus qui est qui.
Elle ne dort plus, mais parfois le soir, enlève son T-shirt, sa robe, son pull, d’un seul coup.
Elle sort de sa gangue.
Le fruit s’enfile dans sa tente, son dedans-dehors.
Dans son dedans-dehors, elle parle à sa bouteille de Chinon.
Il faut être noir pour voir le blanc du jour gris.
-- Toi, le sang de la terre. Toi, qui a pris la mesure du temps dans ta cuve. Toi, toi. Peux-tu changer les couleurs du temps ? Peux-tu enlever le voile noir qui recouvre la cité, le théâtre de la cité, où ceux de taille médiocre se baissent aux portes de peur de se heurter.
Elle est dedans,
Dedans, elle entend les bruits du dehors.
L’aboiement du chevreuil, le cri du loir qui part pour une nuit de folie, le pas du sanglier qui écrase les feuilles sèches tombées de l’arbre.
Les hurlements du loup qui appelle ses petits. Ce n’est pas tout de s’amuser, mais maintenant il faut aller chasser.
5) Elle suit la manifestation
Dans la petite station
Les mots volent au vent
Comme son cerf-volant
Il y a des noms propres
Qui se roulent dans la boue.
Les drapeaux se dressent
Les mots ondulent au vent
Se gonflent et s’affaissent
Ca rit ça rote le patron
Le fuyant le désertant
L’ami des fonds de pension
Avec les cris les rires
Les mots claquent
Non à la fermeture
Travailler encore
Avec mes mains d’or
Et elle chante à l’unisson
-- Ne rien lâcher !
Elle rencontre l’autre. Celui qui est sédentaire entre quatre murs.
C’est celui qui lit sous le lampadaire, ou bien allongé sur son lit.
Elle le rencontre et il lui tend la main, lui offre un lit.
Il lui raconte son gros livre, celui où il ne s’est pas couché de bonne heure pour l’écrire.
Elle entre dans un autre monde.
Celui des bruissements, des succulents, des glissements et des errements, celui étincelant de goélands.
Celui du bruit de l’œuf dur sur le comptoir.
Celui de l’araignée royale qui tisse sa toile au crépuscule en travers du chemin. Toute la nuit elle remue et ingère les proies nocturnes. Au matin elle roule sa toile, libère le chemin et dort je ne sais où dans l’arbre.
Celui du monde, de la maison huitre.
Il suffit de hausser les sourcils pour que le monde ne soit pas pareil.
Le lit du dedans est doux et le toit amical aux orages.
Mais la colère c’est la vie.
-- Ne rien lâcher.
6) La marée chaussée
De clous torsadés
Est toujours là
A policer la surface
Quelle que soit
La station
La bibliothèque
Le jardin
La conférence
La famille
La manifestation
Ils contrôlent
Ils écoutent
Ils rapportent
Ils font le tapin
Au bord des routes
Et de nombreuses fois
En raison de son allure
De son vélo chargé
Et du cerf-volant
L’arrête illico
Scrogneugneu
Ils font le tapin
Pour des riens
Comme une pierreuse
Un vélo équipé
D’un cerf-volant
Pensez donc
Scrogneugneu
Vos papiers
Ils sont au fond du sac
Sous le duvet, sous le pull,
Le ciré, le butagaz, les noodles…
-- Je m’appelle Zoursdru, oui Zoursdru … sans zézaiement s’il vous plait et je vais où la casserole m’emporte.
Qui bat son chien bat les siens.
Il n’y a pas de place pour le nomade, aucune statue pour celui qui sur la voie veut trouver la voie.
On lui propose seulement de lui couper la tête.
Le voyage c’est aussi des récurrences de scrogneuneu
Une vie de latence où on ne sait pas où est l’anse.
Cependant on avance dans l’âge de l’espace.
Le voyage c’est aussi une suite de villages.
Une suite de plaines et de cols.
Une suite qui semble infinie.
Une suite de « di » ou revient la pluie de l’ennui.
7) La mer et la montagne
La mer et les fonds aériens
L’eau et la pierre
Deux faces de la même vague
L’un cache ses fonds
L’autre met ses coraux au soleil
Les deux ont un paysage libre
On y surfe sans manière
Sans barrières
L’eau vous submerge dans l’ascension
Au sommet de la vague
Il y a l’horizon long
Un marsouin ou une brebis accorte
Un poisson volant ou une Montbéliard
C’est du pareil au même
Tous épousent le milieu
En écoutant ce qu’il dit
Prévenant ses colères
Profitant des douceurs
Elles font la guerre à la plaine
Dans un même élan l’envahissent
Seulement la mer est restée mère
Tandis que la montagne
A dit non à l’obscurité
Elle s’est rebellée s’est soulevée
-- Encore ! Les voilà mes papiers. C’est un morceau de plastique. Suis-je du pétrole, une pétroleuse ? Ne suis-je qu’un visage alors que je suis un troupeau ? Ne suis-je quelques caractères dans le flot des écrits ?
Il y a la suée de la montée où tout vous pousse en arrière.
Le pas à pas, l’immobilité.
On regrette la Beauce.
Chaque poussée sur la pédale, chaque quart de tour est un effort.
J’avancerai, j’avancerai, c’est le seul désir qui vous pousse à continuer et l’espoir de la descente après le col.
Le cerf-volant, le dragon volant ne crache plus de feu et pend à l’arrière.
Elle traverse des ponts, c’est le chemin.
Des ponts volant, des ponts dormant.
Parfois il faut qu’elle se batte comme un âne pour faire le chemin, passer la passerelle.
Sous l’averse les gens courent, se plient, ploient les genoux sous la force de la pluie.
Les bateaux, les péniches, sont entre deux eaux.
Il passera de l’eau sous les ponts avant qu’ils repassent.
Sous l’orage les amours ne reviennent plus.
L’hiver, sous la neige, ils vont à petits pas. La marche garde ses empreintes jusqu’à la fin de l’arche. Longue est la traversée dans la poudre blanche qui fait un manteau au paysage.
Au printemps aussi on va à pas lent pour regarder la rivière qui changent de couleur, du bleu ciel au cyan. A pas lents pour respirer les bourgeons. Pont aux ânes des saisons.
L’été on descend sur la berge, le vélo à la main, au pavillon de la sérénité. Plus de dangers, elle se balade au bord de l’eau dans le vol des hannetons.
Elle en a traversé des ponts. Elle en a traversé de bois, de béton et de papier de soie.
Son vélo hésitait parfois, mais il fallait traverser, avancer.
Elle en a traversé des ponts comme si tout le voyage était un seul pont pour atteindre l’autre rive.
Michel Lansade,
Le voyage à la mer, chapitre 2, publication 2014.
Le voyage à la mer, chapitre 2, publication 2014.
Michel Lansade
Le voyage à la mer
Chapitre 3
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Enfin elle arrive en vue de la mer, aux abords de la plage.
La mer et le ciel, tant de bleu !
Comment ne pas être chaviré par cet air marin ? Alors c’est que vous êtes bon pour le désert.
Elle est un infans, muette, sidérée.
Elle n’a pas de mots pour dire ce qui s’offre à elle.
Tout.
L’éphémère et la permanence, le soleil et l’ombre sombre, l’évidence et l’herméneutique, la guerre et la réconciliation…
Surtout la réconciliation.
A la vue de la mer, brusquement vous êtes nu, c’est l’eau qui vous habille et son air salé, c’est le tambour de cérémonie qui vous rend à vous-même.
Elle met ses deux index dans la bouche et siffle.
Il n’y a pas de mots, que le sifflet des bis, encore, des hourras, un sifflet long d’admiration.
Elle laisse tomber, le vélo et ses bagages, le cerf-volant qui n’est plus qu’un piètre dragon. Court sur la plage se tremper les pieds.
-- Une plage ça vaut le coup de se taire.
En face, il y a une île.
C’est un bout de rocher en pain de sucre, comme un phare diurne, entouré de récifs.
Les algues pendent le long de ses flancs comme un manteau.
Là, il y avait une grotte sous-marine. Un dragon emportait à plusieurs kilomètres en mer les enfants qui s’y baignaient.
Ils se noyaient et les mères pleuraient.
Une sirène érudite, intelligente et compatissante décida d’épouser le dragon.
Il se civilisa et de leur union naquit l’île au manteau d’algues.
Il allait même jusqu’à rechercher les enfants qui perdaient pieds.
Dans ses grandes dents acérées, délicatement, il ramenait les enfants sur le rivage.
Depuis l’union, c’est une île où l’on peut se rendre sans dommage pourvu qu’on reste enfant.
L’île baigne dans l’outre-mer.
La mer, flux et reflux, un bleu toujours renaissant.
Le sang bleu qui à la face du ciel et de sa voie lactée, nourrice elle aussi toujours recommencée, crie ses parbleu, ses palsambleu, morbleu et autre sacrebleu.
Une eau qui vous lave des anciens volcans et rend la chimère paisible.
Un bleu que les égyptiens et les bohémiens gardaient secret, comme la vie et la mort.
L’eau bleu d’un coup de clapotis vous entraine dans son rêve d’ailleurs au-delà de son horizon long, vers le mariage avec le ciel.
Un blues rauque du flux et du reflux, de l’abandon et de la révolte toujours renouvelés. Je m’échoue mais je me joue. Le rire succède aux pleurs et se confondent, sans cesse.
Le pauvre marin de guerre revient.
Il se tient sur la vague comme sur un rocher ourlé d’écume.
L’écume se dresse comme un arbre fugitif couvert de neige.
La mouette est haute dans le ciel, loin de la furie.
Le sol est englouti, s’enfuit un moment, puis réapparait.
La vague sans arrêt joue à l’illusionniste.
Ses fils de pêche sont tendus, il les tient à deux mains.
Et la vague le recouvre à nouveau, inlassablement.
Il tient bon, il faut ramener du poisson à la maison.
-- Fluctuat nec mergitur.
Elle s’est installée sur la plage, là où il n’y a que le bruit de la marée, du flux et du reflux, voix rauque, blues qui éloigne tout et ramène en son centre tous nos pleurs.
Elle a posé sa tente, son dedans-dehors dans le vent de la marée.
Son cerf-volant est accroché à la tente.
Il fait des soubresauts, va à gauche et à droite.
Sa tente s‘affaisse sur la plage, c’est une bâche fatiguée et pleine de plis.
A l’aube, à huit heures, à vingt heures, il faut la retendre dans le sable meuble.
Chaque jour il faut la retendre pour qu’elle ne ressemble pas à un château de sable dévasté. C’est comme une geste de l’enfance, la course des escargots, le nettoyage du hérisson couvert de bave…
Une aventure avec les éléments, avec le vent qui dessine des vagues sur le sable.
Il y a des soirs où les mouettes mécontentes de sa proximité viennent frapper sa tente plissée.
-- chaque jour il faut refaire son toit. Nul abri stable, nulle permanence. Je suis là. Je suis là ne peut se dire qu’au présent. J’irai ailleurs, au-delà de mon toit qui remet en question mon moi.
Elle regarde Jupiter d’où vient la foudre.
Elle est joviale.
Elle regarde Jupiter et ses quatre lunes.
Il y a des taches rouges qui font le pourtour. Ce sont les tempêtes cycloniques qui peuvent durer un siècle.
-- Un siècle ! Un siècle d’orages désirés ça laisse songeur… Cependant le plaisir c’est une étincelle. Trop c’est trop.
Elle regarde la pipe du Bouvier qui fume tranquillement ses étoiles avant d’aller se coucher au-delà de son ciel.
Elle prend un bain de minuit.
Elle est nue dans la mer.
C’est tout bête mais un chiffon en moins et vous êtes poisson.
Plus rien ne vous sépare de la mer.
Elle la porte.
Un instant, un instant seulement, elle sent le liquide amniotique
Il suffirait d’un cri pour évacuer le souvenir des mots.
Il fait nuit.
Elle regarde la pipe du Bouvier qui fume tranquillement ses étoiles avant d’aller se coucher au-delà de son ciel.
Elle joue avec son cerf-volant.
Il commence au raz du sable, pataud, pas encore échauffé.
Il oscille à un mètre, hésitant.
Puis brusquement dépasse la dune.
Il vibre dans le ciel, claque au vent.
Pour un peu il cracherait du feu pour aller plus haut,
Pour quitter l’azur,
Pour piquer sur les ombres de la plage.
Elle le tient à deux mains comme le pécheur.
Il faut bien du volant au caïman.
Puis elle fait des huit avec le cerf-volant.
Une boucle qui est une prison.
Qui vous fait repasser éternellement par le même chemin
Par les mêmes faims inassouvies.
Un refrain qui ne connaîtrait que lui-même,
Une scie qui vous découpe le tympan.
Elle est allée sur son vélo devenu nu, acheter un cubi de dix litres de Chinon.
-- Je veux une mer de vin
Elle dîne, divine, d’une sardine, parfois dedans, parfois dehors.
Elle dîne d’une racine, d’une capucine ou d’un biscuit.
Elle dîne et se tourne vers le liquide.
Elle se souvient d’anciens vers du primaire.
Ceux qui ouvrent votre erre
Qui vous empêchent d’être par terre, terre à terre.
Des verres qui vous font grandir dans le cercle de famille.
Elle dîne et se tourne vers le liquide.
-- Chinon au grand renom, à la feuille rosée à maturité. Chinon sauvage qui dépose un baiser libertin à la maigre Adeline.
Chinon où il y a plus de cheminées que de maisons, renverse-moi à la flamme de ton poivre-vert.
Maintenant que j’ai l’éclat aux yeux, donne-moi Orphée et son chant hypnotique.
Fais-moi vivre le singe, l’ibis, le taureau et l’antilope. Fais-moi arbre qui pousse vers les
étoiles, là où les oiseaux viennent nicher.
Frappe-moi, Orphée, de ta lyre jusqu’au délire.
Frappe-moi ! Encore !
Fais de moi l’espoir, la jeunesse et la vie.
Fais de moi ces trois Parques qui font leurs Pâques à New-York.
Elle trace sur le sable lisse, foncé de la marée basse ses initiales.
A Z
Son doigt entre dans le sable. Quelques bulles d’air et les couteaux s’enfoncent plus
profond.
Elle grave le nappage de chocolat.
A Z
Elle forme des rigoles avec de petites dunes sur les bords.
L’eau de mer remonte dans les rigoles.
Elle ne sait plus si elle trace dans la mer ou dans le sable.
Deux lettres instables qui seront essuyées par la marée.
-- Noir sur blanc, je voudrai faire un poème de ma vie. J’irai l’accrocher aux branches des cerisiers. J’irai l’accrocher aux voiles des bateaux afin que ma vie aux vents traverse les océans. J’irai l’accrocher aux boutonnières afin que la vie soit un roseau rigolo.
Michel Lansade,
Le voyage à la mer, chapitre 3, publication 2014.
Le voyage à la mer, chapitre 3, publication 2014.
Fred Lucas
COLLECTION DES
NOUVEAUTÉS
Catherine Berindei
Photo Venise
hiver 2013
LE RÉVERBÈRE DE NERVAL
Pour en finir avec le réverbère de Nerval
CURIOSITÉS
Si on vous dit :
- Lampadaire, tu trouves ça joli comme nom ?
Vous dites oui, et après vous vous reprenez :
- Oui, mais c’est un peu sombre, un rien sinistre.
On vous demande pourquoi. Et vous dites que ça vous fait penser au réverbère auquel s’est pendu Nerval.
Ah oui, ce cher Nerval. Un moment de silence ému à sa mémoire, à la mémoire de toutes les bribes de poèmes et de textes qui vous reviennent à la vôtre de mémoire. Comment ne pas être ému ? Qui n’aimerait pas Nerval ? Et vous avez choisi en toute connaissance de cause le verbe « aimer » ; il ne suffit pas d’apprécier Nerval, le terme ne veut rien dire, Nerval on l’aime et c’est tout.
Mais après cette minute de silence obligatoire, votre interlocuteur manifeste des signes d’exaspération. Et voilà ce qu’il vous dit, ou à peu près.
- Certes, tu as de la culture, et tu es digne d’adhérer à l’association des amis du lampadaire. Mais voilà, tu es comme tout le monde, si on te dit lampadaire tu penses réverbère, si tu penses réverbère, tu penses mort de Nerval. Et bien tu te trompes. D’abord, un lampadaire n’est pas un réverbère, la preuve c’est qu’on ne pourrait pas dire « Nerval s’est pendu à un lampadaire » (imagine la scène, la lampe de salon qui s’écroule sous le poids du poète essayant vainement de s’y pendre, encore plus ridicule que le réverbère). Pire : Nerval ne s’est pendu ni à un lampadaire ni à un réverbère, mais au barreautage de la fenêtre d’une maison, une serrurerie ou un hôtel borgne, on ne sait pas trop.
Et vous vous récriez :
- Mais si ! je le sais, j’en suis sûr, je l’ai lu à maintes reprises. Il s’est pendu à un réverbère, comble d’ironie dans la rue de la Vieille-Lanterne, avec un lacet, la nuit du 25 au 26 janvier 1855. Son chapeau sur la tête, tout le monde le dit, il avait son chapeau sur la tête. Il s’est pendu à un réverbère !
Et votre interlocuteur, avec une patience et une suffisance qui vous exaspèrent, cette fois-ci c’est vous qui êtes exaspéré, vous explique qu’on ne doit jamais croire ce que l’on entend, que les bobards ça court les rues. Et il se lance dans la longue liste des faiseurs de bobards, ceux qui rapportent sans se donner la peine de vérifier ce qu’ils ont entendu ils ne savent plus trop où : les journalistes, les poètes, les éditeurs, les écrivailleurs de tout poil…
Il vous dit :
- Et encore, cette liste n’est qu’une récolte très incomplète.
Et il vous invite à la compléter par vous-même.
- Mais pourquoi cette même phrase inlassablement répétée, « Nerval s’est pendu à un réverbère », serait-elle fausse ? lui demandez-vous d’un air apparemment conciliant.
Vous réclamez des preuves, il vous les donne. Il les a consignés noir sur blanc : les témoignages des amis de Nerval arrivés sur les lieux du suicide, le procès-verbal de la police. Vous les lisez et vous êtes bien obligé de les croire. Mais vous ne voulez pas le montrer, alors vous faites un geste de dédain, un haussement d’épaule : on ne se défait pas si facilement d’une idée dont on ne connaît pas l’origine.
Et il insiste :
- Sois-en sûr, Nerval ne s’est pas pendu à un réverbère.
Désespéré, vous imaginez la scène en vous aidant de la gravure de Gustave Doré et de la lithographie de Célestin Nanteuil que votre interlocuteur vient de vous montrer.
C’est vrai, il n’y a aucun réverbère dans cette ruelle sordidement sombre, un coupe-gorge. Vous voyez bien la grille aux barreaux verticaux avec juste une barre horizontale qui permet d’y attacher la corde, le lacet. La fenêtre n’est pas haute, c’était nécessaire, sur quoi aurait-il pu grimper pour installer le nœud coulant, il ne pouvait tout de même pas se promener avec un tabouret ou une échelle. Il a dû s’élancer des quelques marches de l’escalier qui était juste à la droite de la fenêtre. Mais la barre de la fenêtre est basse. Malgré ses genoux repliés, ses pieds touchent presque terre. Cela aurait été si facile de se rattraper, de poser les pieds par terre et de vivre. Il a fallu être si volontaire pour s’astreindre jusqu’au dernier moment à maintenir les pieds repliés. Volonté acharnée de mourir. Surtout pas la terre, surtout pas la terre. Je ne veux pas toucher terre.
Vous qui n’aimez pas ne pas avoir le dernier mot vous exigez de savoir d’où vient la légende ; qui a été le premier à donner cette version de la mort de votre poète ? Pourquoi associer sa mort à un réverbère ?
- Bah, répond indifférent votre interlocuteur, c’est certainement plus romantique de mourir à la pale lueur d’un réverbère que pendu aux grilles d’une boutique, d’une sordide maison de passe. Quelqu’un qui a voulu préserver la réputation de Nerval, sans doute.
Devant la cruelle mesquinerie de cette réponse, vous vous décidez à vous lancer dans une enquête. Vous la savez longue et difficile. Et vous le dites à votre interlocuteur, ce briseur de rêves.
Et il vous répond :
- Comme tu veux, mais mon lampadaire, celui sur lequel je t’ai interrogé, n’est pas ce soi-disant macabre instrument de la mort de Nerval. Il s’en défend le lampadaire. Ce lampadaire n’est pas romantique. Il est juste un lampadaire. Il réclame, avec mauvaise foi peut-être, mais il la réclame, il réclame la plate évidence de l’objet.
Fred Lucas

ÉLÉMENTS DE L’ENQUÊTE DE FRED LUCAS : LA LONGUE LISTE DE CEUX QUI SOUTIENNENT QUE NERVAL S’EST PENDU AU RÉVERBÈRE : journalistes, poètes, éditeurs, écrivailleurs de tout poil.
« Né en 1808, Gérard Labrunie, qui se faisait appeler Nerval, s’est pendu dans la nuit du 25 et 26 janvier 1855 à un réverbère situé dans une rue de Paris que les travaux du baron Haussmann ont fait disparaître. Il n’avait plus de domicile fixe depuis plusieurs mois... »
Jean-Christophe Gruau, journaliste :
http://www.cubra.nl/PM/NervalDossierLanterne.htm
« Les réverbères africains » en 1927 : « [je] me souviens que Gérard de Nerval, prince de la Nuit, noctambule et somnambule, météore enchanteur, une nuit de désespoir, se pendit au bras tendu d’un bec de gaz, comme au poing surhumain d’un Dieu. » (Limbour 1972, 130) Un poète :
http://suite101.fr/article/les-cinq-grands-ecrivains-franais-qui-se-sont-suicides-a10908#axzz2JdZFGtHt
« Vers la fin de sa vie, les crises de folie se multiplient. Il se suicide en janvier 1855 : on le retrouve pendu à un réverbère rue de la Vieille-lanterne ».
Une maison d’édition qui édite les œuvres de Nerval :
http://www.editionsdelondres.com/Nerval-Gerard-de
« Entrer dans l'œuvre et la vie de Gérard de Nerval est pour Florence Delay une façon de renouer le dialogue avec son père au-delà de la mort. Durant son enfance elle a souvent entendu celui-ci réciter Les Chimères ou Les filles du feu. Psychiatre et écrivain, Jean Delay se sentait des affinités avec le poète, qui composa avec la folie avant de se pendre à un réverbère en 1855. Il lui consacra même une étude, "Aurélia et la maladie de Nerval". Citant l'un et l'autre, rapportant ses propres recherches, Florence Delay tente de dévoiler les ombres de la vie du poète, de balayer les contrevérités qui courent à son propos. Elle esquisse un portrait fragmenté du poète, personnage tendre à la gaieté contagieuse, attiré par les plaisirs du corps autant que par les illuminations de l'âme. »
Présentation du livre de Florence Delay Dit Nerval (publié chez Gallimard, dans la collection « l’un l’autre ») par L’Express.
http://www.lexpress.fr/culture/livre/dit-nerval_803595.html
« L’auteur, académicienne française, rend hommage à son père qui l’initia à son amour pour Nerval. Parallèlement, elle met aussi les pas du docteur Delay, psychiatre éminent et passionné de littérature, qui avait des relations difficiles avec son propre père, dans ceux de Nerval, fils d’un médecin des armées impériales qui ne comprit jamais les choix de vie de son fils. Et derrière cela, la souffrance des fils devant la déception des pères.
De fil en aiguille, au gré des souvenirs, des idées qui s’enchaînent sans toujours de lien logique, l’auteur brosse un portrait délicat de Gérard Labrunie, dit Nerval, que l’on retrouva pendu à un réverbère, son chapeau sur la tête, et qui laissait derrière lui une œuvre poétique et narrative toute empreinte de rêve, témoignage d’un monde intérieur d’une grande richesse. »
Présentation du livre de Françoise Delay : http://users.skynet.be/litterature/lecture/delay.htm
« Le lieu choisi pour réaliser son dessein présente, de l’avis de Richer, les caractéristiques d’un passage symbolique : un point d’intersection de deux grands axes de la cité, la tour-talisman toute proche (tour Saint-Jacques), le corbeau, l’escalier, le nom de la rue (rue du Massacre ou de la Vieille Lanterne), la date du 26 (deux fois 13), tout contribue à faire admettre que le cerveau détraqué de Nerval se laissa emporter par ces obscures coïncidences avec son horoscope. Le fait est qu’à l’aube de ce jour fatal on trouva son corps pendu à un réverbère ; le chapeau haut de forme gardé sur la tête et la redingote sale et déchirée ajoutaient au spectacle une note lugubre et tragiquement solennelle. »
Eduardo AUNOS, Gérard de Nerval et ses énigmes, Aryana et Gérard Vidal éditeur, 1956.
http://www.biblisem.net/etudes/aunogera.htm
« Ridiculement se pendre au réverbère», Mallarmé, dernier vers du «Guignon ».
« Un an plus tard, Gérard de Nerval, noctambule, est allé « ridiculement se pendre au réverbère ». Jésus romantique, Xavier Tilliette, p. 131, ed. Desclée, 2002
« Méticuleuse, exhaustive, révélatrice, la chronique par Ernst Pawel des huit dernières années de Heine à Paris, cloué sur ce qu'il appelait son «matelas-tombeau» (on pense, par comparaison, au «radeau-lit» de Colette), décrit un homme qui est tout sauf vaincu. Dans le regard plein de compassion de Pawel, Heine est plusieurs choses à la fois : animal politique, ami fidèle ou infidèle, polémiste, amant et, toujours, poète ; la maladie qui le tenaille et le pousse à écrire des vers rageurs confère aussi à sa poésie une profondeur et une portée qui ne se manifestaient pas avec autant d'évidence dans sa jeunesse. Nul doute que la proximité de la mort ne concentre la vision d'un poète. [...]
Il se peut que la mort rapide et dramatique d'un poète (Lord Byron combattant pour l'indépendance de la Grèce, Nerval se pendant à un réverbère parisien) soit plus facile à célébrer qu'une agonie prolongée (Rimbaud gagné par la gangrène tout au long de son voyage d'Abyssinie à Marseille, Oscar Wilde mourant «au-dessus de ses moyens» dans une chambre d'hôtel tapissée d'un papier affreux). Quoi qu'il en soit, avec ou sans compassion, la chronique de la mort de Heine (mourant comme Aristote et comme les rosés) constitue, sous la plume de Pawel, un digne mémorial au plus éternel des poètes allemands. »
ALBERTO MANGUEL (Le poète mourant 1. Les dernières années de Heinrich Heine à Paris. Actes Sud. extrait de la postface) http://www.actes-sud.fr/contributeurs/pawel-ernst
« Les premiers livres que je lis avec émotion, ce sont des livres mélancoliques, comme si, très tôt, j'avais compris que les plus belles années sont les premières. Je lis Rousseau, Les Rêveries d'un promeneur solitaire, Chateaubriand, les poètes en révolte contre la société, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire et surtout Nerval, qui se pend à un réverbère, sans oublier de garder son chapeau sur la tête Quel symbole. L'ordre libéral bourgeois fait porter le chapeau aux marginaux.»
Un professeur de lettres et écrivain : http://www.pascal-louvrier.com/jupe.pdf
‹‹Le square de la rue Payenne, on y vient méditer, pour se reposer d'un trekking dans le quartier, les bancs y sont souvent libres et certains s'y allongent pour regarder le peu de ciel qui passe entre les frondaisons. Généralement, deux ou trois minutes après, ils se glissent timidement une main dans le pantalon. Va savoir. On y vient parfois lire, de longs moments, pour cause de tranquillité, de silence et aussi de plénitude. Sans doute parce qu'il est circulaire, deux cercles concentriques de gravier, l'un haut, avec les bancs, et l'autre plus bas, à peine trois ou quatre marches y mènent, entourant la statue et ses rosiers qui poussent en hauteur, cherchant la lumière. Les mômes à tricycle n'y restent jamais longtemps, préférant les larges trajectoires rectilignes et poussiéreuses de la place des Vosges. J'ai toujours trouvé que ce jardin était un endroit à la Gérard de Nerval, juste avant le réverbère. Un lieu où l'on pourrait se pendre avec joie. ››
http://geopolar.pagesperso-orange.fr/europe/france/paris/noir-urbain/noir-urbain.html un photographe ?
« Ce ne sera pas une des moindres surprises de la nouvelle édition des œuvres de Gérard de Nerval, à laquelle une équipe de chercheurs de l’Université Libre du Haut-Verdon, sous la direction de Jeannette baronne Jambrun, met l’ultime touche, que la révélation de l’amitié qui unit, dans ses dernières années le doux Gérard à l’auteur de La Chartreuse de Parme. C’est la découverte par une brocanteuse, au fond d’une cave condamnée d’un ancien bar à putes de la rue des Lombards, d’un lot de manuscrits du poète des Chimères qui est à l’origine de cette sensationnelle découverte. Parmi eux, un pathétique poème, griffonné par Nerval sur un bout de chemise de nuit avec du sang, peu de temps sans doute avant son suicide, et adressé à “H.B.”. Le voici :
"Frappé de mégalomanie
Monomaniaque
Inutile que je le nie :
Je suis foutraque.
Serpent logé au creux du nid
De ma barbaque
Ma dinguerie danse et rugit
J’en ai ma claque
C’est un cas de schizophrénie
Paranoiaque
Si je me fie au diagnosti-
Ck du Docteur Knack
Du corps délectable d’Annie
Un lot de knack-
-ies je garde au fond de mon lit
Et des morbacks
Repu mais las de mon génie
Je vais au lac
Il ne sera pas pour les fli-
-cs mon dernier couac !
(3) : “Je vais au lac” : certains commentateurs ont supposé que Gérard avait d’abord projeté d’aller se noyer dans le lac du bois de Vincennes. Cette hypothèse est infondée. Outre la faible profondeur dudit lac, il suffit que se rappeler que “lac”, dans la langue poétique, est un substitut de “lacet” : claire allusion au bout de corde (ou au lacet de chaussure) auquel le poète eut recours pour se pendouiller au célèbre réverbère.
Un blogueur: http://lesorogeneseserogenesdeugene.blogspot.fr/2011/04/un-inedit-de-gerard-de-nerval.html
Et vous pouvez continuer la liste…………
Pour en finir avec le réverbère de Nerval
Fred Lucas
Pour en finir avec le réverbère de Nerval!
Quand la brune s'empare de la rue
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Et quand la brume,
Brunis.
Comme l'on passe du côté sombre et comme l'on passe du côté clair,
En un va-et-vient qui ne s'arrête qu'au grand sommeil,
Oh brunit le poète.
Il a défait la cravate, l'a tirée du col dans un frottement,
Défaire la cravate, la dénouer au halo du réverbère ;
la retourner au col.
Mourir.
Agnès Jauffrès
SUR L'ERRANCE
De l'errant
Chapitre 1
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Sujet
C’est en le mangeant qu’on fait l’épreuve du pudding.
Proverbe
Parenthèse
ÉCRITURES PARALLÈLES
SUR L'ERRANCE
De l'errant
Chapitre 2
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
ÉCRITURES PARALLÈLES
SUR L'ERRANCE
De l'errant
Chapitre 3
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
ÉCRITURES PARALLÈLES
SUR L'ERRANCE
De l'errant
Chapitre 4
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
L’errant est un homme.
L’errant est une silhouette, une ombre portée de profil. L’errant est une personne, mais impossible de s’en faire une image précise. C’est vous, c’est moi, car tout le monde est errant un moment ou un autre. Si ce n’est fait, ça viendra. Peut être il y a-t-il errant et errant, des errants professionnels en quelque sorte, mais dans l’ensemble tout le monde va errer au moins, au moins une fois dans sa vie, pour savoir ce qu’il voulait faire, à la recherche de son stylo ou de sa brosse à dents qu’on ne prête pourtant pas. (Certains disent même que si on n’a pas été errant à quarante ans, on a raté sa vie).
L’errant est un Homme.
Homme, l’errant est donc souvent en groupe. Plus exactement il est à mi-chemin d’autres errants. Il observe les autres qui sont vraiment autres parce que groupés et l’autre qui n’est pas vraiment autre car errant comme lui. Il observe, il hésite, réfléchit en regardant ses pieds. On sent la longue réflexion, le dilemme qui vous ronge jusqu’aux orteils. Parfois la décision est mûrement réfléchie et c’est avec calme, une paix bouddhique, qu’il se dirige vers l’autre que celui-ci soit vraiment autre ou un autre pareil. Parfois, alors que tout s’embrouille dans sa pensée, que le nœud gordien se tisse au lieu de se défaire, c’est dans un alea jacta est qu’il fait le premier pas. Peu importe la manière, l’essentiel dans le soi de l’errant est de faire ce pas. Il arrive que l’hésitation se prolonge, prenne racine, se fixe en quelque sorte dans le sol et l’errant devient alors une sorte de pivot, de point de repère pour les autres errants. Et c‘est important d’être et avoir un point de repère.
Homme, l’errant est souvent seul avec lui-même. Ce n’est pas une tâche facile d’être entre soi et soi, c’est même harassant. Il faut faire les questions et les réponses, concevoir et réaliser, être au four et au moulin, sans arrêt. Il n’y a que le soir ou cela cesse, mais alors la conscience prend le relai. Les jours de pluie sont de vrais dimanches…
Alors, quand l’errant est bien fourbu d’être entre soi et soi, il s’appuie contre son ombre pour se reposer et si elle vient à s’éloigner de lui, il s’assoie pour reprendre des forces et recommencer le chemin avec soi.
Il arrive parfois que l’Homme soit seul avec un objet, une chaise ou une échelle. Alors l’homme est comme avec un vrai autre, un autre différent. Il se demande par quel bout prendre l’échelle et dans quel sens il va grimper, jusqu’où ? Et la chaise, est-il convenable de s’asseoir dessus quand on sait qu’elle a des barreaux ? Ne vaudrait-il pas mieux la fumer ?
L’errant est un Homme.
Où est-elle ?
Brusquement il est bohémien dans sa salle de bain ou chez les chalaisiens.
Il perd ses pas, son monde, interroge des lieux improbables, mais l’intime se dérobe.
Il s’interroge, se remémore, pratique l’art divinatoire dans les lignes des objets ou des monticules.
Où est-elle ?
Les yeux errent.
Les angles et les courbes se décomposent, se recomposent, s’effacent et se reconstruisent, pour aussitôt se défaire.
L’intime est instable, bien fol qui s’y fie.
La peinture doucement change de couleur, des dégoulinures apparaissent, des bavures nouvelles envahissent la teinte.
Où est-elle, nom de dieu !
Il est toujours en train de préparer un sac pour partir en voyage, en rêve.
Que mettre dans ce sac ?
Quel que soit le voyage lointain ou immobile, que mettre dans ce sac ?
Ça dépend de sa destination, tropicale, nocturne, lointaine ou proche… il y a tellement de dépendances.
Comment sacquer ce sacos ?
Il faut y mettre l’indispensable !
Il est seul.
Il tourne autour du sac.
L’indispensable ?
C’est quoi l’indispensable? Sa salle de bain, son lit, du raisin, son couteau suisse, une poignée d’olives pour jeter au soleil, le souvenir de soi, ce pull bariolé qui vous mettra en position de repère ou celui caca d’oies qui vous signalera aux grenouilles de bénitier ?
La besace n’est pas un sachet mais c’est un monde fini qui doit servir tous les jours et sur lequel on pourra se reposer.
Quelle horreur que le choix !
Il est seul.
Il tourne autour du sac.
Alors il se dit que lorsque la peau du lion ne peut pas suffire, il faut coudre la peau du renard.
Il a plus d’un tour autour de son sac pour le remplir comme un hémisphère où les poches dessinent les continents.
De quoi peut-il se passer ?
De quoi faut-il se passer pour faire avec ce que l’on n’a pas ?
Le sac fait il sera une araignée qui dévidera son fil pour capturer les sentiments de son environnement. Il pourra rouvrir les portes de l’enfance.
Où est-il ?
Ce masaguin, ce campanile, ce fournil, ce parcours du futile, ce havre dans la quête ?
L’autre c’est ce passant égaré qui n’utilise pas son GPS et demande sa route à une femme qui fume sa cigarette sur le pas de sa porte.
Où est-il ?
Question lancinante de l’errance.
Où est-il ? Nom de dieu !
Il faut noter qu’il y a l’errant des champs et l’errant des villes.
Dans la ville aux portes closes il faut entrer par la fenêtre à demi ouverte qui éclaire des appartements vides. Tout s’est arrêté, tout attend, seule la lumière est vivante.
Les voitures sont définitivement garées.
Le passant ne passe plus, il est figé dans sa position, parfois un pied en l’air, courbé sur une table dont il ignore la matière, le chiffon à la main, le balai qui ramasse les feuilles jaunes est statufié.
L’errant se retrouve dans cette attente.
Tout est vide, même pas une araignée, tout est nettoyé par la lumière.
Tout est vide et il a soif de mots. Il ne peut converser qu’avec les publicités et les enseignes. Ce sont ces mots froissés, entrechoqués, sortis d’un vieux crapaud qui dominent la ville. Parfois ils clignotent en rouge et vert, mais ils sont glacés, figés dans le calcul.
Comment parler avec le silence ?
Le pire est dans les villes qui n’existent pas, certaines banlieues. Celles qui n’ont pas connu le désir de l’architecte. Celles à qui on a scotché de la pelouse, des lions à l’entrée, des rubans de bitumes et quelques supermarchés.
Celles où les voitures roulent sans fin dans le circuit.
Ici, il n’y a personne, pas de rencontre possible. Ce sont des déserts peuplés où l’on ne peut pas être.
Ici on ne peut même pas offrir des pe’les de pluie.
Ici on se demande même si on est ici.
Il sait que même si les poubelles sont pleines, même si les toits sont partout, qu’il aura faim et qu’il couchera sous une laide étoile trop lointaine, qu’il sera invisible.
L’errant des champs c’est différent, il a un vrai combat avec le paysage.
Il faut qu’il y entre totalement.
Il faut parfois qu’il se fasse petit comme une souris, parfois grand comme un éléphant.
Il faut qu’il y perde ses idées reçues pour être accepté, ses idées noires pour ne pas être pendu à une branche, rarement, mais quelque fois être dépossédé d’un bras ou une jambe en avançant le pas.
Il rentre dedans le dehors vert percé qui laisse le vent passer et parfois lui fait mal à ses deux dents cariées. Ici point de docteur, il faut faire avec ce qu’on n’a pas, la bouteille de gnole ou le fer à repasser.
C’est la montagne bleue, vague au reflux, qu’il faut atteindre.
Elle est loin et à portée de main.
Il faut traverser le lac rose,
Traverser le ciel rouge cœur,
Traverser le blanc de la neige qui étouffe le chant,
Traverser le blanc de la canicule qui écrase le relief,
Traverser l’usine transparente,
Traverser les ruines noires, voyage dans le passé qui lui font se demander si tout cela, le ciel la terre, son voyage, la limite,…ce n’est pas que du passé,
Traverser des colonnes de touristes gris,
Traverser sur le pont suspendu le ravin ocre,
Traverser la forêt noire sous tension qui n’a plus aucun animal sinon un ver de terre qui se languit sous la lune,
Traverser encore d’autres couleurs qui comme dans un délire se répètent jusqu'à plus soif.
Et il traverse les paysages ouverts les uns sur les autres, sans limites, sans jamais avoir le sentiment d’être cerné, au contraire, il fait l’expérience de l’infini sans un mot..
Parce que sans limites, son pas pourra voler s’il choisit la bonne musique sur son MP3 et que son bâton de marche marque le tempo.
De temps en temps il prend des photos, il sait que ce n’est pas bien cet écran entre lui et le paysage, qu’il met un cadre à l’infini, que ce ne sont pas des preuves, tout juste des marques pour quand il sera dépassé, qu’il ne peut pas ainsi entrer dans le tableau, que chaque visée réduit ses chances, mais il ne peut s’empêcher de faire des traces.
DE L'ERRANT, chapitre 2
L’errant est un voyageur absolu, participe au présent totalement.
Il voyage sans but précis apparent, ça et là.
Il visite ça, arpente là, il est errant ça et errant là. C’est le jour et la nuit, la pluie et le soleil, le feu et le vent, l’herbe qui pousse et les enfants qui meurent.
De ça il parcourt la solitude sinueuse aux cataractes vertigineuses, parfois les yeux bandés. Il voudrait en avoir gouvernance.
Par là, il assure l’ascension de la parole vive, débridée, impétueuse, qui asservit le geste dans un commandement bref.
Après tant, et tant de monts moutonneux et de vaux évasés, l’errant ne sait plus tellement où il en est. Ça regarde là dans le miroir et ne se reconnait plus.
Une fois, sur un pont, son ombre s’est cabrée et a refusé de rejoindre l’autre rive. Aucun ordre, aucune parole conciliante n’y a fait. Il a dû poursuivre seul.
Il ne sait plus s’il est en quête ou condamné à cette errance. Extérieur-jour, intérieur-nuit, il ne sait plus et se perd. Il tourne en rond dans une forêt trop grande pour lui, comme le pénitent dans le labyrinthe de la cathédrale de Chartres. Pas un elfe, pas un seul lutin en vue. Est-il bien ça ou est-il là ? Ses nuits sont-elles plus belles que vos jours non fériés ?
L’errant craint l’errata. Il a peur de se tromper de route, de se fondre dans le paysage si vaste et d’y disparaitre comme le peintre Wang Fô.
Il pense que les gestes répétés, les va et vient coutumiers, les paroles répétées et reportées écrasent.
Il se retrouve dans des vêtements trop grands, comme si brusquement Laurel se réveillait dans les habits de Hardy.
Que tout écrase comme si une ville météorite lui tombait dessus. Il n’aurait plus d’épaisseur.
Bohémien, on lui demande ses papiers plus souvent qu’un autre.
On lui demande des papiers de soi, alors qu’il n’a de papyrus que le journal, ce qui a lieu ici et maintenant.
Alors que ses papiers sont de Chine, d’Egypte, de Hollande, du Japon ou encore d’Arménie.
Ses papiers sont des lacs calmes, des fleuves qui avancent lentement mais irrémédiablement ou encore des torrents qui grondent.
Ses papiers n’indiquent jamais la source.
Ses papiers sont des aquarelles qu’il plie en cocottes pour être maître dans sa basse-cour.
Ce n’est pas le vagabond haï sous la voute des cieux qui en un rictus affamé crucifie dieu. Il a dans la paille le fusil, la mitraille.
Ce n’est pas le clochard, le clodo, le nouveau fou qui a sa place dans le paysage et à qui on prête facilement.
C’est une sorte de SDF de l’instant. Le temps de la chanson il n’a nul endroit pour se reposer. Nulle maison de thé à la lanterne accueillante.
Pour les champs il choisit un bâton.
Ni trop long, ni trop gros à sa main.
Droit et solide, en noisetier ou en murier de préférence.
Ecorcé au canif.
Epissuré en son bout.
Bref, ce qui peut soutenir et frapper.
Ce bâton est un os supplémentaire qui fait reculer le vice, un troisième pied si l’un d’eux manque de cœur. Ce bâton sera son grand bras pour rattraper son chapeau qui s’est envolé dans le pin ou sa main de fer pour casser la vitre et ne pas tuer le chien.
C’est un compagnon zélé dont il n’attend aucun retour, qui redresse sa raison.
Ce bâton lui donnera la profondeur du torrent.
Ce bâton le protégera de la vipère endormie et du chien de ferme qui veut mordre.
Ce bâton le retiendra quand la pierre à tant de mémoire roule sous son pied.
En ville il n’aura pas de bâton on a droit à la canne.
On ne marche pas pareil sur le trottoir lisse et endormi.
Besoin d’un bâton sur un trottoir roulant ?
En ville les arbres sont alignés comme à la parade, c’est un concours d’arbres le plus toiletté.
Il n’y a pas de fermes et de chiens sinon des chiens policés comme les arbres
En ville on craint d’être battu par son bâton..
DE L'ERRANT, chapitre 3
L’errant passe et manque le rouge et le noir, c’est un joueur de roulette, il mise tout sur la rencontre.
Ça peut être celle d’une montagne qui vous met à genoux et vous fait pleurer de beauté.
Celle de l’axolotl qui jamais de sa vie sera adulte et dont les membres coupés se régénèrent.
Celle de la personne qui rassemble tous les visages aimés et qu’il est juste d’attendre toute une vie.
Celle d’une maison, d’une cahute dont les larges paumes vous embrassent.
Ou, celle d’un groupe qui sera bien plus qu’une famille.
Si tant de ses souliers s’épuisent sur la route, si tant de jours il est dans la solitude du juif errant, c’est pour cette rencontre.
Mais parfois la pluie ne laisse aucun arc en ciel, il sent qu’il se ment.
Il s’arrête, se courbe, regarde ses pieds : il est tout entier un point d’interrogation. Est-il vraiment en quête ? N’est-il pas un simple mendiant du monde ? Ne se fuit-il pas avec ses pauvres bagages ?
Parfois il est enfermé dans sa solitude. Rempart qui ne craint pas le siège.
Aucun pas vers l’autre dans ce cas. Pas question d’alter ego.
Prisonnier d’un jour, il admire le paysage :
Le lac rose
Le ciel rouge cœur
La neige qui étouffe le chant
L’usine transparente.
La porte close de la maison
Et il hurle sur la colonne grise des touristes.
Parfois il voit le cyprès aux deux soleils tourbillonnant et l’arbre qui ondule comme un serpent qui danse.
Il voit au-delà du paysage.
Il sent qu’aujourd’hui à son arrivée les eaux du lac rose ne s’ouvriront pas.
Il sent que la montagne bleue franchie, il n’y aura pas un nouvel horizon.
Que ses pieds n’auront pas plus de cœur après.
Que ses mains ne seront pas plus intelligentes après avoir traversé l’usine transparente.
Au bout du compte que les colonnes grises de touristes auront noirci tout le paysage.
Qu’il n’y a aucune requête à cela.
Que sa quête bave dans sa tête et devient sénile.
DE L'ERRANT, chapitre 4
L’errant peut être las, ses souliers pleurer de fatigue, avoir la jambe si lourde qu’elle l’ancre sur un banc, une chaise ou une pierre.
L’errant devient un assis.
Il est immobile, nulle part, réduit à un point encerclé par un monde figé, pesant comme une nature morte.
Sa vie pivote.
Alors l’errant se rebelle, un point c’est important, s’exclame-t-il ! Il suspend les affaires qui trainent ; il est de repère, sans largeur ni épaisseur, mais bien niché dans la tanière du for intérieur.
A présent ses pas spirituels le mènent en arrière. Il parcourt les dix pays qui forment le Sahara et butte contre les pierres du désert de Gobi. Il compte les chemins d’hier, arpente la géométrie des endroits, triangule l’espace passé, additionne les fruits de la passion avec les rhumes, soustrait les fèves des pesos, divise le jour de ses ennuis, sort son smartphone pour lui faire prendre l’air –ça fait tant de bien- .
Il est comme entre deux vins de Moselle, trembleur comme une flamme, ivre de vitesse : qui a vu verra.
Il s’arrête sur le boulevard et se marre.
Il rit jaune, toujours, c’est son habitude.
Ce n’est pas la flaque ensoleillée qui le fait rire, ni ces avenues qui mènent à un point de vue. Ces avenues lignes de fuite.
Ce n’est pas qu’ailleurs ne soit pas ici, mais le sourire des sens interdits.
Il préfère les monts à la plaine
Il monte, il monte sur la roche glissante, sur les plateaux dallés, sur les cimes qui offrent l’horizon.
On le voit idéogramme sur la vague solide.
Au retour dans la plaine il a le sommeil lourd des pierres franchies.
Il a un point de vue,
Il répare la cabane essentielle
Celle à laquelle il faut sans cesse revenir
Pour garder les pieds sur terre.
Il a encore une petite parcelle de lui-même.
Les points cardinaux sont toujours là
Comme une source qui pique son souvenir.
Il a connu les points noirs que l’on évacue avec les deux les deux index
Les intersections
Le chaud et le froid
Les larmes de rire
Les alarmes
Jamais il n’a renoncé au point fondamental de sa course
Alpha et oméga de sa remembrance.
Il a fait avec force et faiblesse
Il a conservé la source
Avec un embonpoint certain
Immobile il cuit
Il faut encore se dresser
Pour mettre les points sur les i
Il n’a pas peur du point final.
Michel Lansade,
De l'errant, inédit, publication 2013 pour le Lampadaire.
De l'errant, inédit, publication 2013 pour le Lampadaire.
Un escalier se balaie par le haut.
Proverbe
Les larmes de Fatima
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Des larmes ? vous plaisantez ! vous ne croyez tout de même pas que je vais pleurer pour ce que vous venez de faire!
Dois-je en faire plus ?
Non, inutile, je ne pleurerai pas.
Pourtant, cela vous ferait du bien. Vous le savez, n'est-ce pas, pleurer soulage. Il le faut, il faut que vous pleuriez. Et il serra un peu plus la vis, celle que l'on serre quand on maltraite, qu'on interdit, qu'on humilie. Il lui serra la vis. Il leur serra la vis, à tous.
Des larmes ? Des larmes, pourquoi faire ? Pour dire J'ai pleuré ? Et pourquoi faudrait-il le dire, l'avouer ?
Des larmes, non.
Ce serait pourtant si joli, si reposant. Elles s'écouleraient en un flot tranquille, continu et serein, sans soubresaut, ni hoquet. Dans le calme du visage. Qui laisserait aller cette eau produite par on ne sait trop quelle partie du corps. Contenue dans quel réservoir ? Cachée où ? Renouvelable ? inépuisable ?
Épuisable. Tout être connaît son épuisement, est épuisable et il sait qu'il l'épuise, son être, à longueur de journée, cherchant à atteindre la limite, celle à partir de laquelle l'épuisement sera effectif, où l'épuisable ne sera plus. Plus rien à prendre, plus de réserve. Tout est épuisé.
Vous avez tout mangé, il n'y a plus rien. Il faudra faire les courses. Et n'oubliez pas le chocolat.
Réellement épuisée jusqu'au fond de tout, des dernières réserves. Quand sera-t-elle réellement épuisée. L'a-t-elle déjà été ?
Et quand vous mettrez-vous vraiment en colère ? Quand direz-vous C'est assez? Jusqu'où dois-je aller ? Dois-je en faire plus ? répéta-t-il. Où est votre limite ?
Oui, mais épuisable, à l'infini, n'est-ce pas ce qu'il faudrait être ? Ne jamais atteindre la limite, la chercher toujours, la tester, la faire frémir, trembler, toujours la reculer, chercher le fond des larmes, chercher où puiser toutes ces larmes, avec quoi, quel instrument, quelle cuillère, quel bol, quel casserole, quel vase, quelle péniche, quel reversoir. Comment les ramener à la surface.
Et n'oubliez pas de rapporter deux packs d'eau.
Ne pas déverser. Jamais.
Mais comment produire toute cette eau ? D’où viennent les larmes ? on les voit déborder de l’œil, mais ce n’est pas lui qui les produit, sa matière n’est pas liquide, pas plus qu’il ne baigne ni ne flotte dans un liquide, à peine un peu d’huile pour assurer la mobilité, pas plus qu’il n’y chavire ou n’y sombre quand le flot tumultueux le rencontre. Il rougit un peu, oui, c’est le sel des larmes qui l’irrite. L’eau qui rencontre le sel, l’eau salée qui baigne l’œil. D’où viennent tous ces liquides, toutes ces humeurs ? Les larmes provoquent l’œil, mais l’œil ne provoque pas les larmes.
Vous me faites chavirer, mais je ne sombrerai pas. Je ne verserai pas.
Je n’ai plus de stock, tout a été utilisé. C’est trop tard.
Mon cerveau est rempli d’eau. Mon cerveau n’est pas rempli d’eau, il est solide, pas liquide.
En moi nul réservoir.
Mais pleurer avec des mots ou sans mots ? Si vous voulez vraiment que je pleure, si c’est la seule solution pour que s’arrête la torture, dites-moi comment faire.
C'est à moi que vous osez poser la question ? Si vous pleurez avec des mots alors je vous répondrai, et alors on ne s'en sortira pas, vous voudrez toujours avoir raison, je voudrai toujours avoir raison. D’argutie en argutie, on ne s'en sortira pas. Pleurez sans mots, ce sera plus simple. Que rien ne filtre de votre gorge. Que rien ne s’ébruite. Et il serra encore un peu plus.
Juste les yeux. De vos yeux doivent s’écouler les larmes. Pas de votre gorge. Ni vociférations, ni hoquets, ni soubresauts, ni grimaces. Des larmes sur un visage lisse, c’est ce que je veux. Comme si elles coulaient d’elles-mêmes, de leur propre volonté. Sans vous. Des larmes qui vous dépassent, vous voilent, dans lesquelles vous disparaîtriez, vous vous dilueriez. Voilà pour vous.
Si vous me serrez encore un peu plus, comment voulez-vous que je pleure. Par où voulez-vous qu'elles sortent ces larmes que vous voulez me voir pleurer. Si le corps est trop serré, elles resteront coincées là où elles se terrent. Laissez leur de l'espace, que leur flot puisse s'étendre, faire nappe, se dégager de leur boue utérine, monter à la surface par un effet de la gravité peut-être. C'est le puits artésien, je crois.
Ne parlez pas, vous ne dites que des bêtises. Pleurez. Et ne confondez pas gravité et gravitation, gravité et pesanteur, grave et gravide, puits artésien et chauffage géothermique, car c’est bien cela, n’est-ce pas, que vous vouliez dire.
Je pensais que /
Ne pensez pas.
Je croyais que/
Ne croyez pas.
Pleurez.
Et Fatima se demanda, avec tout le sérieux rendu nécessaire par l’urgence de la situation, comment elle allait faire pour pleurer. Ne se connaissant aucun motif personnel qui la conduirait à fondre en larmes, à part la tyrannie du maître (elle était femme de ménage à ce moment précis) pour lequel elle travaillait, mais justement les efforts du maître étaient vains, tout allait bien pour elle, ni maladie, ni souci d’argent, ni souci d’enfant, il lui fallait en toute logique trouver des motifs non personnels. Car, elle en était persuadé, pour pleurer il faut des motifs. Et elle voyait bien tout le caractère contradictoire de sa recherche, pleurer c’est l’expression d’une émotion, l’émotion c’est personnel, c’est qu’on est touché aux tréfonds de soi comme dans un grand mouvement du corps, comme un grand remue-ménage qui va chercher l’eau dans les entrailles, qui va la puiser et la remonter avec efforts, avec saccades, avec secousses, dans un terrible tremblement sismique. Pleurer, pleurer beaucoup c’est tout ça. Comment provoquer cette secousse sans émotion préalable, comment pratiquer les larmes impersonnelles ?
Elle demanda autour d’elle, on lui répondit qu’elle n’avait qu’à penser à son enterrement, qu’elle ferait mieux de prévenir la police qu’elle était maltraitée par son employeur, qu’elle ne néglige pas de recourir au globe de l’oignon qui fait couler les larmes même quand on a envie de rire, qu’elle n’oublie pas de stimuler, son problème était peut-être tout bêtement mécanique, la minuscule glande lacrymale située sur le bord de la paupière inférieure, qui y fait une petite bosse à peine visible, avec une épingle toute fine, en faisant toutefois bien attention à ne pas toucher l’œil, elle pourrait sans doute déboucher le canal lacrymal qui, comme toute chose dont on ne sert pas suffisamment, avait dû se détériorer, voire se boucher. On lui dit que les larmes c’est en relation avec le lait, ça vient avec, une montée de lait et une montée de larmes c’est tout pareil, c’est pour ça que les femmes pleurent, bien plus que les hommes, leur liquide à eux ne dépassant pas le niveau du bas-ventre, et, elle, elle n’avait pas allaité ses enfants, elle avait pris des médicaments pour arrêter la montée de lait, elle avait eu tellement de fièvre par cet acte contre nature, et ça lui avait coupé le lait et les larmes, c’était bien fait pour elle, une punition de la nature, voire de Dieu, voire de la société toute entière, de l’humanité souffrante et affamée. Assoiffée. On lui dit que les hommes aiment voir les femmes pleurer, ça les calme, ça leur fait un effet bœuf, ça agit sur leur testostérone, ça en diminue le taux, fait fondre leur virilité agressive, que c’était sans doute pour ça que son maître insistait tant, parce qu’il l’aimait ou qu’il avait besoin de calmant, ou parce qu’il voulait l’aimer et qu’elle ne l’aidait pas beaucoup, vraiment elle pourrait faire un effort et verser une petite larme, qu’elle essaye et elle verrait bien qu’il desserrerait son étreinte. On lui dit Fatima, ne sois pas prisonnière de ce que ton maître projette sur toi, évade-toi, enfuis-toi, prends tes enfants et va-t-en, tu trouveras bien un autre emploi, un autre toi, une autre vie, garde ton moi, tout vaut mieux que ce qu’il te fait subir.
On lui dit tant de choses qu’elle en eut le tournis.
Il lui dit, prends ton seau, ton balai brosse et ta serpillère et va chercher des larmes. Ne reviens que si ce récipient est rempli. N’en profite pas pour partir Dieu sait où, tu dois revenir sinon je te chercherai, je te trouverai et la punition que je t’infligerai sera terrible, et ne crois pas que tu puisses m’échapper, je te retrouverai où que tu ailles. Tu connais ma malveillance et mon opiniâtreté. Je te retrouverai, toujours, crois-moi. J’ai une mémoire de sioux et ma rancune est tenace.
Tous les conseils, préconisations, exhortations, et autres discours de ceux à qui elle avait demandé de l’aide ne pouvaient lui être d’aucune utilité, elle le comprit. Des paroles pour ne rien dire. Elle comprit qu’elle devrait trouver le chemin des larmes par elle-même. Elle savait qu’elle avait raison, que son analyse était la bonne : il fallait de l’impersonnel pour pleurer sans bruit, sans grimace, pour pleurer sans manifester d’autre marque d’émotion que ces larmes, impersonnelles, neutres, insipides, nues. Alors, elle le comprit, il lui faudrait pleurer pour quelqu’un d’autre, pas pour elle, pas sur elle.
Et ils recommencèrent avec leurs conseils Va au cinéma, au théâtre, Mets-toi devant ta télévision, souffre avec les héros et les héroïnes, Mets-toi dans leur peau, Lis des romans tristes et pleure des torrents de larmes, pleure sur tes vrais malheurs, ceux que tu ne connaîtras sans doute jamais, pleure sur ce que tu n’as pas à pleurer, pleure de ne pas avoir à éprouver tous ces beaux sentiments, ces frayeurs, ces désirs, ces amours que jamais tu ne vivras, pleure sur ce que tu n’es pas et ne seras jamais, pleure par ce que tu ne seras jamais. Pour qui la prenait-on ? une niaiseuse ? Pourquoi devrait-elle pleurer à la place de, ou avec, ces personnages plus ou moins transparents ? S’était-elle jamais plainte de son sort ? pourquoi devrait-elle déléguer ainsi ses sentiments? Fatima n’avait jamais aimé lire, le cinéma ne l’intéressait pas, ça sentait le faux à plein nez, le factice, on ne lui racontait pas d’histoire à elle. Elle n’était pas gourde à ce point. S’identifier à ces pleureurs et ces pleureuses de fadaises, la larme à l’œil. Pour qui la prenait-on ?
Et tout d’un coup, elle comprit. Les enterrements, il fallait qu’elle aille assister aux enterrements d’inconnus, qu’elle parle aux familles des défunts, qu’elle compatisse à leur chagrin, qu’elle pleure avec eux.
Ce qu’elle fit .
Le premier enterrement auquel elle assista fut grandiose. Une très grande église, presque de la taille d’une cathédrale, très laide, bourrée à craquer de monde. On déplorait la mort d’une femme. Fatima comprit que sans être une personnalité reconnue du grand public, cette femme, encore assez jeune au moment de sa mort, avait été très appréciée, elle avait dû avoir un charisme, une aura. Elle comprit qu’elle avait été professeur, ses étudiants, ses collègues, ses amis remplissaient l’église. Il y en avait tant qu’ils ne trouvaient plus de place pour s’asseoir. De jeunes couples, sans doute ses étudiants venus là comme pour valider leur dernier séminaire, portaient leurs bébés hurlants dans les bras, ou dans des poussettes, que leurs proches voisins essayaient de faire taire à grands coup de Chut , Vous pourriez rester dehors Ce n’est pas la place des enfants hurleurs Laissez-nous nous recueillir en paix. Mais les jeunes parents restaient sur place, ils voulaient leur part de malheur et de larmes, ils voulaient qu’on les voit là, qu’on remarque leur présence pleine de dévotion et d’admiration pour cette personne remarquable qu’ils venaient de perdre, leur professeur, leur maître, et que leurs enfants et les enfants de leurs enfants le sachent, se souviennent à jamais de cet événement. D’autres, plus âgés, la quarantaine, la cinquantaine, écoutaient avec attention mais sans y croire les paroles du prêtre qui expliquait, avec tout l’art nécessaire, ce que c’est que la mort à un public qu’il savait être païen, athée, sensible, raisonneur, mystique. La famille, les amis proches assis aux premiers rangs, dans la travée centrale, là où il fallait qu’ils soient, se savaient sous le regard empli de curiosité de tous les participants : était-ce lui le père, était-ce elle la mère, la défunte était la première de leurs enfants qu’ils perdaient, comment supportaient-ils leur malheur, l’ex-mari, celui qui avait déserté la foyer conjugal, il l’avait abandonné pour une autre fille sans doute plus jeune, se sentait-il coupable, quelle tristesse ressentait-il, qu’éprouvait-il, et leurs enfants comment se tenaient-ils ? A quoi bon toute cette apparence de réussite pour en arriver là. Elle avait mal supporté la séparation d’avec le père de ses enfants, elle s’était fabriquée cette maladie et elle en était morte. Elle avait tant souffert. C’était injuste. Fatima entendait penser tous les spectateurs, elle pouvait suivre chacune de leur pensée. À tous. Un par un. Des hommes, des femmes, d’avantage de femmes que d’hommes, venaient au micro, devant l’autel, apporter leurs témoignages vibrants d’émotion, rapportant des détails de la vie quotidienne, des choses insignifiantes qu’elle savait transformer en moments de beauté pure, disaient-ils. Sa grâce, son charme, son intelligence, et toute cette jeunesse, cette vie, ces fêtes qu’ils avaient vécus ensemble. Tout ce qui était à jamais révolu, mais qui jamais, disaient-ils, ne s’effacerait de leur mémoire. Vie qu’ils vivraient dorénavant pour elle, elle qui les avait rendus assez forts pour supporter sa perte. Ils vivraient, nous vivrons disaient-ils.
Comment ne pas pleurer ?
Et Fatima pleura, de tout son corps, silencieuse, immobile, elle pleura.
Elle rapporta un plein seau de larmes à son maître. Les siennes exclusivement, elle n’avait pas voulu tricher en ramassant avec sa serpillère les larmes des autres participants qui pleuraient pourtant abondamment, elle n’avait pas voulu car toutes ces larmes qui roulaient à terre étaient impures, elles étaient souillées par l’amour, l’amitié, la rancœur, l’envie, la jalousie, ou tout autre sentiment que le pleureur éprouvait ou avait éprouvé pour la morte. Les larmes de Fatima étaient pures, des larmes pour des larmes. Le maître les goûta, content, elles étaient à peine salées, il s’en imprégna le visage, s’en humecta le cœur et lui ordonna d’en remplir la baignoire, qu’il y plonge son corps tout entier.
Fatima, dorénavant, assiste aux enterrements, elle pleure sans bruit anonymement, elle n’est pas une pleureuse professionnelle, elle ne réclame rien ni ne se mêle à la famille, elle ne se met pas en deuil, elle est là, elle entend, elle écoute, elle voit et elle pleure.
Elle a trouvé sa place, elle se met à l’entrée, à droite du porche des églises, ou des crématoriums, ou des cimetières, statue immobile vêtue de blanc et de bleu qui laisse glisser sur son visage lisse une après une les larmes de la douleur silencieuse, les larmes de compassion, de cette compassion qui ne l’atteint pas elle qui ne souffre pas. Son ancien maître est devenu son servant, son idolâtre, il porte les seaux qui recueillent les larmes-offrandes et dépose des fleurs à ses pieds. Il la porte, statue immobile, d’église en église, d’enterrement en enterrement, il la porte et la dépose avec précaution, il a desserré son étreinte, avec douceur, de peur de la casser, de la brusquer, il la porte devant l’entrée de chaque église, de chaque cimetière, il la porte et la dépose, il recueille les larmes qui coulent silencieusement de son visage lisse, de ses yeux immobiles et vides, de ces paupières sans cils. Il la porte et il l’aime.
Maria Rantin,
Des larmes,2014.
Court récit écrit pour le Lampadaire
Des larmes,2014.
Court récit écrit pour le Lampadaire
La biographie lambertienne de Maria Rantin est ici
Les larmes de Marguerite
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Le pastiche est une lecture.
À la fin de L'Amant, il y a ça : les larmes de la jeune fille. Et cette mention finale, « Neauphle-le-Château – Paris février-mai 1984 ». Ces larmes-là qui se déversent, larmes du départ, de l'amour jusque là défendu et enfin délivré, amour interdit pour le Chinois, scandaleux, étaient rendues impossibles par des règles tacites et intériorisées. Ces larmes, comment ne pas les lier à la solitude de Neauphle ? Marguerite à Neauphle, dans la grande maison de Neauphle, avec ses encres noires introuvables, avec la solitude qu'elle dit qu'elle s'est fabriquée à Neauphle, sa solitude à elle, à Duras, solitude et whisky. Avec les nuits qu'il faut affronter et le noir. Dans cette maison-là qu'on imagine immense, espace où l'on se perd, qui occupe presque tout dans Écrire, où Duras a trouvé les larmes de la jeune fille.
À la fin de L'Amant, les larmes ne viennent pas tout de suite. Le récit fait attendre. Le récit annonce les larmes puis les retire au lecteur. Elles sont inévitables pourtant, ces larmes contenues depuis la première ligne, ces larmes qui se sont glissées entre les mots et dont le texte s'est fait le gardien. Dans la maison de Neauphle, avec toute la force qu'elle doit déployer pour affronter l'écriture, Marguerite a pris le temps de les amener au lecteur.
Ce qu'elle dit d'abord, c'est l'amant qui sait le départ et qui ne peut plus faire l'amour. Il y a d'un côté le corps de l'amant qui le lâche, et il y a le désir insatiable de la jeune fille. Lui qui ne peut plus car elle part, elle qui le veut car elle part, et ce cadeau de l'homme qui la caresse pour la satisfaire. Comme depuis le début, les choses arrivent et se montrent par le corps, rien n'étant dicible, et rien ne pouvant être ressenti. Pas le droit. C'est hors sentiments et hors langage. Seul le corps peut dire ou ne pas dire, donner ou refuser. Le corps lie les amants quand tout les sépare et le corps les tient ensemble quand tout le reste est éloignement. Sauf à la fin, sauf avant les larmes. A la fin, le corps aussi ne peut plus. Il se met du côté du silence, il se met de côté. Impossibilité du corps, l'amant chinois ne peut plus ; besoin du corps, elle veut le corps de son amant chinois. Le départ se fait là d'abord. L'amant n'est déjà presque plus un amant. Voilà ce que Marguerite, Duras, a retrouvé en elle dans la solitude de Neauphle, encres rares et whisky, et au fond de ses nuits. Le Chinois l'a tellement prise, maintes fois. Il ne pleure même pas de ne pas y arriver. Les larmes du Chinois, ses larmes à lui, ont déjà eu lieu, au début, à la première rencontre des corps, quand la jeune fille avait dit qu'elle préférait qu'il ne l'aime pas, quand elle lui avait demandé de faire avec elle comme avec les autres femmes. Il faut relire ça, les vêtements arrachés, le désir fou qui commence, et au début comme à la fin, lui qui ne peut pas. Il faut comprendre que les larmes, c'est quelque chose qui est à lui au début. Elle ne pleure pas, la jeune fille. Elle affronte et ne pleure pas. Elle lui laisse les larmes et réclame le corps, inversant les rôles. Elle a toujours demandé le corps, au début et à la fin. Elle l'a toujours voulu comme en remplacement de l'amour, ou parce que ça lui suffisait, parce que paradoxalement seul le corps était acceptable. On ne sait pas quelle est l'interprétation qui est juste, ou si elles sont toutes justes, elle ne dit pas Marguerite. A part peut-être dans les larmes finales qui disent l'arrachement. Au début le bac puis ses larmes à lui quand il faut la prendre, à la fin le bateau et ses larmes à elle quand elle comprend qu'il ne la prendra plus.
Et pour Marguerite à Neauphle, ça c'est passé comment ? Ces larmes, comment lui sont-elles venues ? Revenues ?
Duras a écrit quelque chose sur le piano de Neauphle. Dans Écrire, Duras parle des objets dans la maison de Neauphle, du radiateur puis du piano. C'est un curieux glissement qui se fait, du radiateur inoffensif au piano qui contient toute la violence, du radiateur à la brutalité du piano. Duras dit qu'elle joue peu, elle répète le verbe « jouer », quatre fois elle le répète, comme elle sait le faire, avec cette écriture qui tourne sans cesse sur elle-même, avec cette écriture de la reprise. Mais elle répète pour nier. Dans Écrire comme dans L'Amant, il y a quelque chose qui se dit et qui se nie concernant le piano. Ça se fait et ça se défait, la musique fait et défait, c'est très dur. C'est dit avec une grande dureté, dans la répétition, comme une valse. Dans Ecrire, Duras dit et répète qu'elle ne joue pas. Ou peu. Elle dit que le piano, dans sa solitude de Neauphle, c'est comme quelque chose d'impossible, quelque chose d'insupportable, parce que, dans la solitude et le silence de Neauphle, ça paraît faire surgir un sens tout à coup. Le piano enferme les larmes, la musique les fait couler.
A la fin de L'Amant, quand les larmes enfermées de la jeune fille se mettent à couler, il y a aussi la musique qui fait sens, la musique impossible et le piano. La traversée a commencé il y a longtemps. Le départ, la rupture avec l'amant chinois, l'image de la voiture noire sur le quai avec sa silhouette affaissée dedans, toutes ces douleurs qui ont fait couler des larmes intérieures, invisibles par la mère et le petit frère, sont loin. Il faut rappeler ça. Sur le bateau au départ, quand elle voit le quai s'éloigner et disparaître, l'automobile noire du chinois s'éloigner et disparaître, et la terre s'éloigner et disparaître, tout ça étant interchangeable, la jeune fille ne pleure pas. Les larmes sont là, oui, au-dedans d'elle, mais elles ne viennent pas. Les larmes ne peuvent pas se montrer, elles ne se montrent pas, la présence de la mère et du petit frère les interdisent. C'est la musique qui fait couler les larmes, c'est la valse de Chopin, bien plus tard sur le bateau, au milieu de la traversée, c'est Chopin que la jeune fille s'était exercée, en vain, à jouer.
Dans Écrire, dans la grande maison de Neauphle, 1984, avec le radiateur et le piano qui se tait, Marguerite Duras écrit la fin de L'Amant : « elle avait pleuré parce qu'elle avait pensé à cet homme de Cholen et elle n'avait pas été sûre tout à coup de ne pas l'avoir aimé d'un amour qu'elle n'avait pas vu parce qu'il s'était perdu dans l'histoire comme l'eau dans le sable et qu'elle le retrouvait seulement maintenant à cet instant de la musique jetée à travers la mer. »
Agnès Jauffrès,
Les larmes de Marguerite, 2014,
écrit pour le Lampadaire
Les larmes de Marguerite, 2014,
écrit pour le Lampadaire
Les larmes de l'arbre
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Manuela Morgaine,
Journal de bois, livret.
Journal de bois, livret.
Manuela Morgaine,
Journal de bois, livret. «Feuilles volantes »
Journal de bois, livret. «Feuilles volantes »
Imaginons comment parlerait le bois mort. Une sorte de langue morte, entre latin et grec. Langue imaginaire, tas d'os de bois en brins dits.
le bois mort pleure le nom de ses feuilles mortes:
Sorbus terminalis
sorbus latifolia
quercius pubescens
rhododendron ferrugineum
erica carneas
empetrum nigrum
erica vagans
loiseleuria procumbens
vaccinium salix
retusa fagus
sylvatica hippophae
eleagnus daphne
eucalyptus punica
granatum viscum
pyrus salicifolia
prunus laurocerosus
ligustrum vulgare
olea europea
catalpa ouata
magnolia hypoleuca
arctostaphylos
lonicera caprifolium
lonicera caerulea
hedera helix
eunymus frangula
ainus ulex
europeus berberis
quercus ilex
castanea sativa
tilia platyphyllos
corylus aveliana
corylus colurna
populus nigra
aulnus betula
pendula dryas
octopetaia
ulnus minor
ulnus lacuis
celtis populus
myrica gaie
nothofagus antartica
rhamnus saxatilis
salix cinerea
pyrus communis
arbutus unedo
carpinus betulus
morus alba
rhamus pumilia
viburnum lantana
sorbus mespilus
salix fragilis
acernegundo
cytisus purpureus
aesculus parvifiora
liriodendron ribes
uva crispa
crataegus
platanus orientalis.
En bris, brisé mes axiomes
sur mes feuilles effacées par mes larmes
au corps de mes axes.
2 attentes
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
1. Attaque
Et les chiens dehors puent le crime et crient des putains.
Attendez, juste attendez.
Avec mon pote Victor, on tue les chiens dehors, et la merde s'en va.
Juste la merde s'en va.
Et les chiennes, dehors, hurlent aux abois. Et les chiennes, dehors, peuvent jouer aux émois.
Mais juste, attendez.
Mais juste, dites-moi.
Dites-moi comment cancaner des sauvages. Comment cahuter des obstacles. Comment culbuter des carnages.
Et dehors, les carnivores, dehors, puent le souffre et sulfatent en acier.
Et c'est l'orage vous savez, dans les têtes, c'est l'orage.
Et les chiennes, dehors, crient à la lucarne. Et les chiennes, là-bas, minaudent en fanfare.
Et ça sent la mouille, vous trouvez, dans les herbes, ça sent la moelle.
Mais attendez, juste, attendez.
Parce que la merde s'en va.
Juste, la merde s'en va. Et s'en détache, la merde.
C. Von Corda
Attaque,
inédit. Lampadaire 2014
Attaque,
inédit. Lampadaire 2014
2 attentes
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
2. Klezmer
C'est un grand bâtiment avec ouverture sur cour. Vous voyez. Les fenêtres y sont partout mais la lumière s'y fait passagère.
C'est un grand bâtiment avec ouverture des pattes arrière. Vous voyez. Les fenêtres y sont plutôt extérieures mais la lumière s'y fait couverte.
Et ça monte comme ça vient. D'un souffle d'un seul, ça monte. Et les aveugles aussi. Tout y passe.
J'y déambule ouverte et haut perchée. À l'affût, à l'aguet. Détendue de derrière. Humide de devant. Et chacun de mes pas élargit, écarte, chaque lèvre du bas.
Et j'ondule et transpire. Vous voyez. Je vous mate.
Les couloirs hostiles se font plutôt sombres dans les fins d'après midi.
Et je guette votre bureau. Et je guette la porte ouverte. Vous voyez. Nous nous regardons.
Les couloirs se font complices. Les couloirs se font dociles. Les couloirs se font possibles. Et les murs des vitres permettent le jeu du pas vu, prenez sur vous, pas pris, méprenez-vous.
Parce qu'à chacun de mes pas, je sens ma peau du bas qui frotte sur les coutures de mon jean.
Et ça me met en appel. Et ça me met en alerte.
Mais je continue ma parade vespérale. Et ondule du bassin et roule des épaules. Ma bouche entrouverte humecte les poils de la moquette sous mes pas. Et je marque le territoire du regard, qui note et retient les espaces à combler. Les espaces à tenter. Les espaces à soumettre.
Et quand la journée se termine tendue de rencontres qui n'en sont pas, de corps qui s'échappent et qui n'en sont pas, de propositions qui s'estompent et n'en sont pas, ça brûle dans le bas ventre.
Tout cet amalgame, toutes ces images, toutes ces idées-là, ça brûle.
Parce qu'à chacun de mes pas, je sens ma peau du bas qui frotte sur les coutures de mon jean. Et ça me met en appel. Et ça me met en alerte.
Alors je marche encore et plus souple. Et mon bassin, je le fais bouger mon bassin. Vous voyez.
Si vous me regardez de dos, vous verriez deux fesses rondes qui roulent haut perchées.
Et ça sent la noisette. Et ça sent le félin.
Entre mes cuisses, sur le tissu du jean. Ça se rend moins rêche. Et les pas se font plus serrés. Et les muscles sont parcourus de légères contractions. Et les muscles sont parsemés de légers spasmes.
Dans les couloirs aux lumières absentes, votre bureau reste éclairé. Vous n'en sortez pas. Je vous guette.
Toute la journée, à coups de sourires, je vous attends.
Toute la journée à coup de regards, je vous guette j'ai dis, vous, au bas ventre tendu dans votre pantalon.
Alors dans les couloirs désertés de vendredi de fin d'hiver, je sens votre odeur dans votre bureau encore éclairé. Je reste dans le couloir éteint. Vous ne pouvez me voir, je ne peux que vous penser. Alors je plaque mes fesses cambrées sur le mur en face. Et les vas et vient de mon corps sur le mur, trempent mon jean entre deux.
Désormais à chacun de mes mouvements vous me reconnaîtrez, vous reconnaîtrez l'odeur de l'animal.
Et j'envoie la tête en arrière un peu.
Et ça monte comme ça vient. D'un souffle d'un seul, ça monte. Et les aveugles aussi. Là où il fait chaud, là où c'est humide.
En attendant devant la lumière du bureau. En attendant devant au loin le bureau éclairé.
Et les couloirs-ennemis séparateurs m'enclavent dans un plaisir solitaire interdit.
Et les couloirs-barrières contre nous m'encerclent dans un plaisir monologue pas permis.
En attendant rien devant la lumière du bureau.
En attendant rien devant au loin le bureau éclairé.
Et ça frotte contre le mur. Et ça frotte entre le jean.
Et l'ouverture de mon corps ne vous appartient pas. Je languis de mon attente de vous. Je trempe dessus. Et ma marche d'excitation approche à sa fin et dévale ses chutes d'eau libre à la lumière que vous ne daignez éteindre, que vous ne daignez étreindre.
Et ça s'écarte les jambes en talons hauts et ça grandit, s'ouvre, les cuisses inhabitées de vous.
Tout ça pour finir la tête collée au mur dans un souffle de plaisir qui vous guettait, qui vous guette, qui ne vous guette plus.
C'est un grand bâtiment avec ouverture sur rue. Vous voyez. Les fenêtres y sont fermées mais la lumière s'y fait dehors.
C'est un grand bâtiment avec ouverture sur rien du tout. Vous voyez. Les fenêtres y sont plutôt tombantes mais la lumière s'y fait plutôt couvrante.
C. Von Corda
Klezmer,
inédit. Lampadaire 2014
Klezmer,
inédit. Lampadaire 2014
Portraits en pleine lumière
NOUVEAUTÉS
La photo
Lucie Pastureau,
Série, à contre-ciel 2011.
Le récit
Joseph Pasdeloup,
La défense de Pasiphaé 2013

LA DÉFENSE DE PASIPHAÉ
Elle tient son fil. Elle s’appelle bien sûr Ariane. Elle a le soleil en plein sur le visage. C’est sa mère, l’opulente Pasiphaé, qui en dirige les rayons droit sur elle parce que la mère ne veut pas que la fille voit Thésée, ni que Thésée ne la voit. Une gringalette, poussée trop vite et qui ne sait même pas s’habiller – moitié blanc moitié vert, quelle idée pour une crétoise ; d’où sort-elle ce vert ? D’où sort-elle cette folie de vouloir se couper en deux ? Nous qui n’aimions que les frises et les entrelacs géométriques. Où sont ses bijoux de princesse, l’or et les émeraudes que Minos lui a offerts ? Renierait-elle ses origines ? Ces deux modestes liens dont elle a entouré ses poignets et qui brillent à peine au soleil ne peuvent suffire à faire montre de sa gloire. Ne voudrait-elle plus être ma fille ? – et qui a des prétentions. Des prétentions à la séduction, une séduction à sa manière, toute plate, faite de naïveté et sans doute de bêtise.
Elle risquerait bien de me voler Thésée. Telle est la crainte de Pasiphaé.
Si je l’éblouis, pense Pasiphaé, si je l’éblouis suffisamment longtemps, elle deviendra aveugle, les yeux blancs tournés vers l’intérieur, et personne jamais ne l’aimera, ou ne fera semblant de l’aimer, et je garderai Thésée, et je garderais la petite Phèdre. J’ai inventé le Minotaure, je pourrais inventer un autre monstre. C’est bien de faire de ses enfants des monstres. Pour la petite Phèdre, je verrai après, j’ai encore le temps de trouver une idée. Occupons-nous d’Ariane et de son fil.
J’en ferai un monstre magnifique, c’est surtout ça qu’il faut réussir. Un monstre qui me magnifie. Et qu’il me faudra défendre envers et contre tous. C’est le rôle d’une mère de défendre ses enfants envers et contre tous, c’est sa noblesse, surtout quand c’est elle qui a décidé, en toute connaissance de cause, de leur destin. Je ne peux défendre que ce que j’ai voulu. Comment défendre une Ariane destinée à n’être qu’une ivrognesse abandonnée de son amant dans une île déserte, condamnée à l’oubli, réduite à son fil, ce pauvre peloton de fil qu’elle m’a dérobé et à partir duquel elle croit pouvoir construire sa légende. Il n’en est pas question. Ariane ne partira pas. Dionysos ne l’aura pas. Elle doit être défendable. Et tant pis pour Thésée.
Le Minotaure, oui, des bruits ont couru sur sa faiblesse. Je l’aurais fait enfermer non pas parce qu’il est redoutable, mais pour cacher aux yeux du monde ma faiblesse et sa faiblesse ; c’est idiot, tous – et, en premier, Minos, mon royal mari – ont eu connaissance de cet amour adultérin, pourquoi alors en cacher le fruit ? Il fait ma gloire. Et j’aurais voulu cacher la faiblesse de mon fils qui ne ferait peur à personne sauf à lui-même ? Non, mon fils est redoutable parce qu’il est une alliance entre l’homme et l’animal. En cela, il fait peur à tous, peut-être aussi à lui-même, mais surtout à tous, que vous le vouliez ou non. Je lui ai offert le labyrinthe ; pas pour le cacher, ni pour préserver le peuple de Crète de sa furie cannibale – qu’ai-je à faire du peuple de Crète ; non, je lui ai offert le labyrinthe parce que le labyrinthe le rend encore plus beau ; il l’isole et le rend inatteignable ; inatteignable et désirable. Que serait le Minotaure sans le labyrinthe ? Rien qu’un être hybride comme nous en voyons tous les jours, une chose étrange de plus, centaures, faunes, et autres sirènes. C’est le labyrinthe qui fait de mon fils un monstre sans pareil. La beauté de mon fils, c’est le labyrinthe ; et le labyrinthe est autant de mon invention que mon fils est de ma création. Dédale l’a fabriqué sur mes ordres, de même que c’est moi qui ai séduit le taureau fécondeur. De ma propre volonté. Mon fils est deux fois mon fils.
Mais pour mon fils, c’était facile. Dès sa conception, la volonté du terrible et le désir de l’exceptionnel étaient là. Pour Ariane, n’est-ce pas déjà trop tard ? Je me suis laissée prendre par la douceur du banal et de l’ordinaire; lassée de toujours devoir intervenir, j’ai laissé aller le cours des choses ; il est urgent de les reprendre en main. Que cela me serve de leçon pour la petite Phèdre. Il faudra vite songer à un plan, pour elle aussi. Que seraient mes enfants s’ils n’étaient des monstres royaux ?
Si je l’éblouis, pense Pasiphaé, si je l’éblouis. Le tout est qu’elle reste immobile suffisamment longtemps pour que le soleil accomplisse son œuvre. Là est la difficulté : l’immobilité et les yeux grand ouverts. L’immobilité volontaire et les yeux délibérément ouverts.
Pourquoi suis-je là ? se demande Ariane. Que fait ce fil dans ma main ? Ce fil de soie verte que j’avais soigneusement dérobé aux regards de Pasiphaé et de Minos, et qui devait servir à ma fuite et à celle de Thésée. J’étais déjà habillée pour le voyage. Un simple costume de marin qui m’aurait rendue invisible aux gardes de mon père.
Pourquoi suis-je là ? se demande Ariane. Que fait ce fil comme planté dans ma main ? Pourquoi cet éblouissement ? Quelle est cette lumière, et pourquoi ai-je si froid sous ce soleil ?
Il n’est que temps, dit Pasiphaé. Et je garderai même Ariane. Qui a dit que je voulais m’en débarrasser ? Jamais ! Ariane est ma fille, je ne veux pas qu’elle parte avec Thésée. Elle doit rester avec moi. Elle doit être deux fois ma fille, comme mon fils est deux fois mon fils. Et comme on verra ce que Phèdre sera.
Mais si je peux garder aussi Thésée, pense Pasiphaé, ça ne sera pas plus mal.
Elle m’a dit regardez-moi. Regardez-moi, je m’occupe d’animaux, je suis une éthologue. Jamais entendu parler de ça avant. Regardez-moi, pensez à la mer qui entoure l’île de Crète, entendez son mouvement, vous êtes au bord de l’eau, vous regardez le soleil, les yeux grands ouverts, regardez-moi. La liqueur que vous buvez vous envahit de bien-être. Vous lisez un livre, lequel ? Regardez-moi. Et ses yeux sont terribles, je ne vois qu’eux. C’est la mer de Crète. Pourquoi veut-elle que je la regarde, que craint-elle que je vois si je ne la vois pas.
Et Ariane lui répond : je ne peux pas, ça brûle dans mes veines, je vais mourir ; ça brûle et je ne vois que vos yeux terribles.
Et Ariane se débat. Ma mère, dites-moi qui voulez-vous garder, moi ou Thésée ? Thésée ou le Minotaure. Phèdre ? Il faudra bien sacrifier l’un d’entre nous. Pourquoi avez-vous décidé que ce serait moi ? Pourquoi m’avez-vous condamnée ?
Et une voix lui dit : ne vous inquiétez pas, Ariane, on va bien s’occuper de vous. Ne quittez pas des yeux la lumière, ce grand réflecteur, ce grand projecteur, plus grand que le soleil, ne le quittez pas des yeux. Voyez-vous qui le maintient face à vous ? Voyez-vous son visage ? On vous attache les jambes, ne craignez rien, voyez comme vous êtes bien. On s’occupe bien de vous. Vos veines sont des filaments minuscules. Une voix susurre « attention micro-veines ». Un baiser vous effleure le front, comme une aile. Est-ce celle de votre cousin Icare ? Et toujours ce soleil.
Pourquoi ai-je voulu venir ici, se demande Ariane. Tout allait bien, je n’avais nul besoin de cet événement. J’étais prête pour un autre voyage. Qui donc déjà m’a mis cette idée en tête ? Pasiphaé ? Moi, je voulais partir, je voulais sacrifier mon demi-frère, cette moitié d’homme, pour mon amant Thésée. Mais pourquoi ce fil à ma main, pourquoi ce grand trou dans mon ventre, pourquoi ce vide dans ma tête, pourquoi cette brûlure et cet éblouissement ?
Si je l’éblouis, pense Pasiphaé, si je l’éblouis, j’aurais réussi.
Ma tête est un soleil tout rentré à l’intérieur de moi. Nul ne peut me voir sans en être aveuglé. Ma mère, ma mère, construisez-moi un lieu sans miroir. Mettez-moi hors du monde. J’étais une gentille fille, toute simple et toute plate ; et je suis devenue une lumière coupante, une béance concentrique. Je ne me comprends plus.
Ariane, ne t’inquiète pas, lui répond Pasiphaé. Ce lieu est déjà construit, il est construit à l’intérieur de toi. Je l’ai conçu pour toi. Ton regard est blanc, tu n’es qu’éblouissement superbe, déesse de la lumière qui ne reflète rien. Tu es maintenant la plus belle, aux traits inatteignables, comme est inatteignable ton frère, et comme le sera Phèdre.
Et tant pis pour Thésée. Qu’il tue son père, qu’il aille s’occuper de sa mère. Qu’il surveille sa descendance. Qu’il s’en aille. Qu’il s’en aille. Il n’aura pas mes filles.
Et ton fil n’est plus attaché à rien. Et tu tombes, Ariane, tu tombes, tu es avec Icare et vous ne savez pas si vous volez ou si vous tombez. Et tu penses être dans l’étroit couloir qui conduit à la mort. Et tu ne vois plus rien.
Je l’éblouis, se dit Pasiphaé, je l’éblouis. J’ai réussi.
Joseph Pasdeloup, 2013, La défense de Pasiphaé
Court récit écrit pour le Lampadaire ©
Kolia a perdu
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
J’entends tout. Ils ont bien fait de me mettre là. J’entends tout, le cliquetis des couverts dans les assiettes, les verres qui tintinnabulent, les bouchons de champagne (je n’entends pas le bruit des bulles qui pétillent, ou alors peut-être en fermant les yeux... si, si si, je l’entends), j’entends la rumeur de leurs voix, le chant des grenouilles (le soir en août les reinettes sont folles), le rire des femmes, j’entends même leurs robes, ce léger froufrou d’étoffe, ce glissement délicat qui frôle leurs jambes hâlées...
Je me souviens de Sonia, sa voix grave et douce, elle pivotait sur ses petits talons, elle regardait sa silhouette dans le miroir en pied de la chambre, de profil, une main à plat sur son ventre, elle réajustait les pans de son corsage au dessus de la ceinture de sa jupe, et puis de dos, le visage tordu par-dessus l’épaule pour vérifier... pour vérifier quoi ? Que ses fesses étaient toujours là, mais pas trop là, mais tout de même toujours offertes à la caresse, toujours tendues vers ma main, rondes comme des pêches, douces... Sa voix grave : Kolia, viens voir, viens voir mon amour... Tu aimes, tu es sûr ? C’est joli comme ça ? Avec ces chaussures-là c’est mieux, tu ne trouves pas ?... Sa voix douce, tu m’aideras à marcher ? Je trébuche tout le temps, je ne sais pas marcher avec ça... Qui te demande de marcher, belle étoile ?... Je me souviens de Sonia et de son rire qui me réjouissait le cœur, me réchauffait l’âme et le ventre.
Toutes ces femmes, elles ont dû se préparer dans la torpeur ouatée et doucement parfumée de leurs salles de bain, j’aimerais tant les voir encore une fois, j’aimais tant les voir, les regarder, boire leurs visages, me nourrir de tous leurs gestes, contempler la ligne courbe de leur cou...
J’entends tout. Le gravier crisse toujours sous les pas et puis un peu plus encore sous les pneus des voitures. Enfant, j’adorais imaginer les invités de mes parents. J’entends le ronflement du moteur, la voiture vient de passer le portail, ils remontent l’allée, la voiture s’approche, ils descendent, j’imagine leurs toilettes, les portes qui claquent, ma mère accourt, les fleurs sont si belles, des pivoines, mes fleurs préférées, joufflues, éclatantes, et puis la voix de mon père, rugueuse et chaude, je sais qu’il porte un costume sombre, avec de toutes petites rayures, même en été, son visage maigre et dur, altier, les années passent, il est toujours aussi svelte, droit et raide comme la justice, ses traits se creusent, sa peau brune et ses yeux noirs, il marche avec une élégance qui m’effraie un peu, ma mère rit, tape des mains comme une enfant, les fleurs sont si belles, des pivoines, mes fleurs préférées, joufflues, éclatantes... Regarde, regarde comme c’est bien dans ce grand vase... Jeanne vous voulez bien les disposer dans le salon rose ? Je suis tellement contente que vous soyez là, et puis leurs voix s’éloignent, l’apéritif a toujours lieu sur la terrasse, de ma chambre je ne les entends plus, je lutte contre le sommeil, je voudrais entendre encore la rumeur de leurs voix entremêlées, leurs rires... Mais ce soir je suis puni, mon père a décidé que non Nikolaï ! ça suffit, trop de bêtises aujourd’hui, tu montes te coucher. Immédiatement.
Je ne pourrai pas descendre les saluer, je ne pourrai pas embrasser en pyjama les joues comme des pétales de rose des amies de maman, respirer leur parfum, fermer les yeux en déposant un petit baiser, les garder bien ouverts quand leurs doigts passent dans mes cheveux bouclés, la fraîcheur de leurs bagues, adorable petit diable va vite te coucher, Irina surtout, je reviens toujours lui dire bonne nuit une deuxième fois, elle rit, Encore bonne nuit ! Jolie crapule... Sa peau est dorée, elle sent la cannelle, je l’embrasse et j’ai l’impression de manger des petits sablés épicés, elle effleure de sa bouche le coin de mes yeux, et puis gomme avec son pouce les petits oiseaux de rouge à lèvres qui s’étaient posés là.
J’entends tout. Ils ont bien fait de me mettre là. Ils m’ont dit, comme ça tu seras un peu de la fête Kolia, tu veux ? Je passerai te voir pour être sûr que tu ne manques de rien, et puis, tu me diras s’il y a trop de bruit, alors tu iras dans la chambre jaune, d’accord ? Je viendrai t’aider... C’est la première fois de ma vie que je ne brûle pas de descendre les rejoindre pour me mêler à eux, pour me sentir vivant à leurs côtés. Même fatigué, je ne résistais jamais au bonheur de plonger dans cette ivresse.
Ce soir, j’ai hésité longuement, derrière la porte, je les entendais tous, il y avait beaucoup de voix inconnues, la soirée est organisée par Simon, une première. Simon qui déteste le monde, les réunions, les mondanités, comme mon père, Simon qui pourtant une cigarette et un verre à la main dégage la même sensualité discrète, tenue, irrésistible, Simon ce soir organise une petite soirée à la maison, viens Kolia, ça te changera les idées, la voix de ma mère au téléphone, excitée et joyeuse comme une petite fille, c’est-à-dire comme toujours, il y aura Antoine et puis Jean, ils n’ont pas changé tu sais ? C’est drôle, je les ai vus hier, ils sont passés me dire bonjour, j’ai cru revenir des années en arrière ! Ohlala ! Il ne manquait que toi, Kolia, viens mon chéri, et puis tu feras très plaisir à ton frère... Je suis venu, le traitement vient de commencer, je suis écœuré, tellement fatigué, une fatigue que je ne connaissais pas, une fatigue qui me laisse comme un cadavre gris sur mon lit, échoué, gisant. La petite Sarah m’a emmené, en voiture. Sa voix claire au téléphone, Nicolas je passe te prendre demain, oui, Papa m’a dit que tu viendrais pour la fête, alors il veut que je t’emmène, le train c’est trop long, tu vas être épuisé. Je suis assis à côté d’elle, elle conduit très bien, j’ai toujours aimé être conduit par de jolies femmes, elle sourit tendrement sans quitter des yeux la route, elle sourit aux petites phrases si prévisibles de son vieil oncle Kolia... Je me sens un peu pitoyable et en même temps rassuré d’être auprès d’elle. Son parfum sent la confiture de poire, il envahit la voiture et me berce. Je suis bien. Elle a les cheveux longs d’un blond très pâle, comme ceux de son père, elle a le timbre de la voix d’Ariel aussi, mais le rythme est celui de Paule, sa mère, une voix lente et douce, et si ferme. Sarah parle peu, et sourit. Comme tu leur ressembles... On est là, tous les deux et je n’ai plus la force de te faire rire, comme quand tu étais une petite fille, une petite cousine qui vénérait ma Juliette et ma Judith... Juliette et Judith que j’ai perdues.
J’ai dormi quelques heures dans la chambre bleue, c’est la musique de leurs voix entremêlées qui m’a réveillé. J’ai écouté distraitement la rumeur et puis à travers les volets fermés à l’espagnolette (j’adore cette expression, j’ai l’impression que mes fenêtres sont protégées par une petite gardienne andalouse, toute ronde, toute de noir vêtue, avec un foulard noué autour des cheveux, un ange brun qui me protège dans la pénombre), à travers les volets je les ai vus. L’envie de les rejoindre, de me mêler à eux a été plus forte, plus forte que cette odeur de mort que je garde sans cesse au fond de la gorge, plus forte que ces vertiges qui me saisissent en bas du ventre et remontent à une vitesse vertigineuse jusqu’au sommet de mon crâne, plus forte que tout. Je suis derrière la porte du vestibule. J’entends tout. J’hésite un peu. Pour la première fois, j’ai peur de leurs regards. Je ne suis plus aussi beau je le sais, j’ai le teint verdâtre, mais pas du tout Kolia, tu es bronzé, tu es magnifique mon petit garçon ! Ma mère qui me rassure comme si j’avais treize ans, envie et peur d’aller à une surprise party parce que la grippe est passée par là, je suçote des pastilles vichy, j’aurais honte si mon haleine sentait les médicaments, la maladie. J’entends tout. J’ai un peu peur, je respire un grand coup, je réajuste mes cheveux (un tic ridicule, il m’en reste si peu, je ne peux pas m’en empêcher, j’en ai eu tellement, et si longs et si bouclés), et puis j’ouvre la porte et c’est comme plonger dans l’eau tiède et salée d’une après midi d’août, sur la plage de Trousse-Chemise quand la marée descend, j’y suis, je nage en terrain conquis, tout est si simple au milieu d’eux, je les fais toujours rire, je leur plais toujours, ça marche, ça marche le charme opère, je suis toujours moi, ça va, ça va mieux.
Mais aujourd’hui, non. Aujourd’hui, je préfère me contenter de les entendre. De l’autre côté de la porte de ma chambre. J’entends les rires des infirmières, leurs pas dans les couloirs. La voix grave du médecin de garde se mêle au bruit des chariots. Il raconte des blagues qui font rire les infirmières. Il a du succès. Je n’en aurai plus. J’ai vieilli. La maladie a gagné du terrain comme ils disent. Elle a pris beaucoup de place. Elle a pris toute la place. Je suis allongé dans mon lit, les draps sont doux, en coton blanc, souple, l’oreiller à côté de moi offre un profil beaucoup trop parfaitement rebondi, aucun visage ne s’y pose, aucun visage ne viendra plus s’y poser.
Avant, autrefois, il y a des années, dans une autre vie ? avant, j’ai tant aimé regarder l’oreiller où dormaient encore quelques unes de ses mèches, longtemps après qu’elle se soit levée. J’ouvrais un œil, je regardais l’oreiller vide mais rempli d’elle, de son odeur de son parfum, des cheveux noirs ondulés, une barrette abandonnée par mégarde, une petite trace noire laissée par ses cils –comme sur mes chemises, ces toutes petites marques, comme des empreintes de pas d’oiseaux miniatures qui racontaient qu’elle s’était reposée sur mon épaule, que ses yeux avaient pleuré peut-être tout contre moi, Sonia je t’aimais follement, mais si mal.
J’enfouis ma tête dans cet oreiller pour étouffer toute envie de pleurer, la fraîcheur du tissu rassure mon sanglot, je ne suis plus un enfant, juste un vieux petit garçon qui a peur de mourir.
Françoise Sliwka
Dimanche matin peut-être
extrait ©
Dimanche matin peut-être
extrait ©
Dies irae
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
C’est le jour de toutes les colères. Il m’attendait ce jour-là, avec impatience, vigilance, amour presque. Il m’attendait.
Le soleil avait déployé ses rayons. Pas question d’attendre la nuit. Cela doit se faire en pleine lumière. Celle du jour.
Faut que ça pète a dit Maria.
On s’en tape a répondu l’imprimante.
Faut que ça pète. Les deux l’ont dit en même temps. Pour une fois qu’ils étaient d’accord.
Faut que ça pète.
Et derrière toute cette douceur, demande Jeus à Zunon, que fait-on ?
On s’amuse dit cette dernière, dont ce n’était pourtant pas la réputation, l’amusement.
On s’amuse ? s’étonnent en même temps Maria, l’imprimante, le mari de Maria et leurs deux enfants. Ben oui, on s’amuse répète Zunon, que voulez-vous faire d’autre dans de telles circonstances. Pleurer ? Ah non, Maria ça suffit. Tu ne vas pas recommencer.
Non, faut que ça pète, répète Maria. Jamais je n’ai parlé de pleurer.
Mais la question est la même, commença à se lamenter Maria : comment faire?
Trouve une solution, lui répond Zunon, flute alors, trouve une solution, et arrête de te lamenter.
Pourriez-vous m’aider, lui demanda humblement Maria, toi et ton mari ?
Ma pauvre, rien à attendre de Jeus, tu devrais le savoir, toi qui as fait des études.
……………….
L’histoire, le truc, le dialogue, la chose aurait pu s’arrêter là, mais je suis intervenu, et j’ai dit à Maria : inventons quelque chose. Laissons tomber les dieux, les vrais et les faux, et inventons quelque chose.
Amen, lui répondit Maria, qui décidément ne savait que répondre.
Bon, je vais encore faire tout le boulot, bouillonna Joseph, rajoutant ainsi sa propre fureur à la fureur ambiante.
Marions ton mari à une autre que toi. J’ai vu un film hier. C’est simple. Il y avait un couple, et une femme seule. La femme du couple commençait à en avoir assez de son mari, pourtant très gentil celui-là, dès qu’elle le voyait elle se grattait, et la fille toute seule lorgnait sur le mari.
Pourquoi est-ce que ça me gratte ? demande Maria.
Tais-toi Maria, écoute. La fille qui se grattait est partie, depuis elle ne se gratte plus, la fille sans mari a pris le mari de la femme qui se grattait et qui ne se gratte plus depuis qu’elle a quitté son mari. Et tout le monde est content. On attend juste de savoir si la fille qui a piqué le mari se grattera un jour. Mais ça on ne le sait pas, nom de Dieu, le film était déjà assez long comme ça. Ne me demande pas en plus comment il aurait pu finir.
Alors il faut trouver une femme seule et la mettre dans les bras de mon mari en lui disant qu’elle fait ça pour moi. Pour m’éviter les démangeaisons ?
Ça tourne cochon, Joseph, ton histoire. Jamais je n’aurais cru cela de toi, dit Maria.
Tais-toi, Maria, c’est moi qui raconte l’histoire. Pas toi.
………………….
Dies irae, le soleil étend sa main trigitale, il l’étend entre lui et la terre et ses rayons se transforment en ombre. Le soleil étend son ombre sur la terre, rappelant sa présence par la lumière qui passe à travers ses doigts écartés. Et quand il aura rapproché ses doigts les uns à côté des autres, l’ombre s’étendra sur la terre, car il ne laissera nul interstice. Tous ses efforts se concentreront là, que nul interstice ne se glisse entre les doigts qui petit à petit se rassembleront, et l’ombre s’étendra sur la terre. Sera-ce plus terrible que de voir l’ombre des doigts écartés ?
Jouez, jouons, en attendant ce jour.
Oui, Zunon, tu es sage. Et dans ta sagesse de mère éternelle, je t’écoute.
Mais tu ne m’as toujours pas dit ce que je devais faire de mon mari.
………………………….
Ne ris pas, Zunon, j’ai toujours su qu’ils allaient mourir. Et toi aussi, je le sais, tu l’as su. Avant tout le monde, tu l’as su.
Laisse-les jouer. Je ne dirai rien, et toi non plus tu ne diras rien. Laissons-les jouer.
………………………………….
Zunon surveille. Zunon, la jalouse Zunon, surveille car elle ne sait pas de qui sont ces enfants qui jouent au ballon sous l’ombre du soleil. Est-ce encore un sale coup de son dévergondé Jeus ? (Tu veux dire, les conséquences vivantes d’un de ses sales coups ? lui susurre Maria). Devra-t-elle les changer en mirliton, en casse-bonbon, en ballon rond. Devra-t-elle taper du pied en disant au dévergondé Jeus : nom de Dieu ça suffit, t’as plus seize ans, arrête les conneries si tu veux être un bon gardien de but. Ah zut, elle s’est trompée, dans la colère, elle s’est trompée. Mais que voulait-elle dire ? Jeus rigole. Gardien de but, c’est une idée.
Finis la vaisselle, Zunon, moi je vais entraîner les petits.
Une déesse, faire la vaisselle ! Mais il est fou ce gardien de but !
Oh, Joseph, tu l’as dit faut que ça pète, mais, s’il te plaît, pas dans tous les sens. Faut que ça pète droit, faut que ça éclate, pas que ça explose, faut que ça fonce droit vers le soleil, pas que ça se dissémine dans tous les sens, pas que ça s’éparpille, pas que ça papillote.
Faut que ça pète, nom de dieu, faut que ça pète.
……………………..
Stop, dit le soleil. Stoppez tout, sinon je vous brûle, je vous fige pour l’éternité dans cette posture ridicule que vous avez juste là en ce moment. Arrêtez de radoter, arrêtez de répéter. Réfléchissez.
Que voyez-vous ? Deux enfants jouent au ballon, l’un est plus grand que l’autre, et quelqu’un les regarde. Le tout est de savoir qui. Est-ce toi, Maria, est-ce toi Zunon, ou toi Jeus, ou toi Joseph ? Le tout est de savoir si ce regard est bienveillant. Si l’ombre est un danger, si la violence est un danger, si le ballon est une bombe, si l’un veut éclater l’autre, si le petit là-bas va pouvoir s’échapper. Ah voyez, vous m’entrainez dans votre violence, dans votre désir de pétarade, vous entrainez le monde entier.
………………………
Joseph aime la mythologie, il ne sait pas pourquoi, mais il aime la mythologie, il tourne tout à ça. N’est-ce pas un peu ridicule ? Dans cette histoire qu’il se raconte aujourd’hui, il est amoureux de la placide et sage et magnifique et irascible Zunon, il la voit partout, il la met à toutes les sauces, dans tous ses rêves. Jeus est-il jaloux de Zunon, de Joseph aimant Zunon, ou est-il content que quelqu’un, un mortel de préférence, cela ne saurait durer, contribue à détourner de lui l’attention de la divinité, le débarrasse du regard inquisiteur de la divine et tranchante et mesquine et magnifique Zunon ? Il veut la paix, il veut vaquer à ses occupations, ses adultères, mais il ne veut pas qu’elle le quitte, ça non, juste qu’elle détourne un peu son attention, qu’elle allège son regard, qu’elle en atténue le rayon. Il lui dit : si tu t’en vas, je me laisse pousser la barbe, j’aurai des plaques d’eczéma, je me gratterai jusqu’au sang, je ne supporterai plus aucun vêtement, et je me promènerai nu, la peau à vif, hurlant de douleur.
……………………….
Et le petit crie « Zunon, Zunon, à l’aide » ! C’est Joseph qui crie ainsi. Jeus pour se venger de lui l’a transformé en petit garçon à la chemise rose. Et pour se venger de l’infidélité de sa femme, de son manque d’attention à son égard, il a pris la place du frère aîné, et va lui régler son compte au petit, le ratatiner, cette mauviette mortelle qui a osé lever les yeux sur la mère déesse, qui l’a salie de son regard et de son désir. Ah Jeus, arrête de te déguiser comme ça. Ok, on le sait, tu sais te métamorphoser, en tout et rien, ton adresse, ton pouvoir n’ont pas de limites, tu es le dieu de la métamorphose. Mais y a pas de mérite. Tout est, a toujours été, si facile pour toi.
…………………..
Où est passée la vraie mère, où sont passés les vrais enfants ? Attendent-ils dans un monde parallèle qu’on les rétablisse dans leur corps ? Oui, mais si Jeus-frère-aîné écrabouille Joseph-petit-frère, que va-t-il advenir des corps des vrais enfants, ceux qui attendent on ne sait ni où ni sous quelle forme. Et Maria, sait-elle que dans le corps de ceux qu’elle croit être ses enfants ce sont d’autres êtres qui se battent ? Pourquoi cette complication Jeus ? Un bon coup de foudre aurait suffi pour te débarrasser de Joseph (tu t’y connais pourtant en coup de foudre, susurre Maria). Et laisse donc ces petits jouer tranquillement.
Mais Jeus ne m’entend plus, se lamente Zunon. Tout à son ballon, il ne m’entend plus.
……………………………
Tout cela ne tourne pas rond, dit le soleil. Calmez-vous, ce n’est pas la fin du monde. Je n’ai pas encore étendu mon ombre, ni refermé mes doigts. Qui vous a dit que l’allais le faire ? Calmez-vous. Je m’entraînais juste à créer la Grèce, je voudrais qu’elle ait la forme de ma main, j’écarterais les doigts et leur ombre portée dessinerait un pays. Ce sera la Grèce, fille du soleil. Je n’ai pas encore décidé si tout ceci, ô Zunon, s’accompagnera d’éclairs, de bruits et de tremblements chtoniques, ou de cuisson de la matière, ignifusation nucléaire, éblouissements et silence. Non, je n’ai pas encore décidé. Laissez-moi m’entrainer sur ces deux enfants-là que je vois frapper dans ce ballon. Laissez-moi tester sur eux la force et l’efficacité de mes rayons.
Non, crie Zunon, non. Ne vois-tu pas que c’est Jeus. Tu ne peux t’attaquer à lui. Sa colère sera terrible, et le monde en sera retourné.
Moins une, dit Maria, et ça y était, j’étais enfin débarrassée de mon mari. Pourquoi, mais pourquoi es-tu intervenue, Zunon ! Quel gâchis !
Mais Zunon lui dit : tu n’y es pas Maria, lui-là, c’est ou ton fils ou mon mari, ça ne peut pas être le tien de mari, à moins que Jeus et toi… à moins que le fils dans lequel il s’est introduit soit votre fils, le tien et le sien, que ton fils soit ton mari ou que ton mari soit ton fils. Maria, tu veux te débarrasser de Jeus ? Je ne peux le croire, je ne peux le croire.
……………………………
Ouf, l’orage a passé. Les enfants jouent dans le jardin, Zunon discute avec Maria tout en préparant le dîner pendant que Jeus regarde un match de foot à la télé. Joseph est rentré chez lui. Il a refusé l’invitation. Il n’a pas faim. Il sait que quelque chose ne tourne pas rond.
Il a bien fait de partir. Dans le jardin, les enfants ont maintenant disparu, les ballons de foot ont fondu. Il n’en reste que des flaques colorées. Quatre plaques colorées. Aussi insaisissables que du mercure.
……………………….
Le soleil a tout liquéfié, recoloré, distendu, recousu. Les ballons, solarisés, semblent frankensteinisés. Les coutures tiennent. On en voit les points. La mince pellicule de plastique similicuir a pris des couleurs qui ondoient les unes dans les autres, s’interpénétrant, se rejoignant puis se repoussant. Les plaques sont vivantes, mouvantes, ça veut peut-être parler, dire quelque chose, raconter la chaleur de la transmutation, le plaisir ou la peine.
C’est chimique dit Maria, regardant effondrée ce que sont devenus ses enfants.
Non, c’est écranique, lui répond l’imprimante.
Comment les reconstituer, dis, Zunon, toi la déesse, fais quelque chose rends-moi mes enfants.
Non, répond Zunon, ce ne sont pas tes enfants, ce sont les bâtards de Jeus, que le soleil a solarisé à ma demande.
Et pourquoi il y en quatre alors de ces flaques solarisées ? demande Maria.
Ce sont mes enfants. Sois logique, Zunon, il y a Jeus déguisé en mon fils aîné, il y a la carcasse de mon fils ainé, il y a Joseph emprisonné par Jeus dans la carcasse de mon fils cadet et il y a la carcasse de mon fils cadet. Ça fait quatre, les faux ont accouchés des vrais, sous l’effet du soleil, et ils sont tous les quatre là.
Non, répond Zunon, le compte est faux, Jeus ne peut mourir, ce sont les bâtards de Jeus, maintenant si tes enfants sont les bâtards de Jeus et que l’opération de solarisation ait révélé leur vérité, qu’y puis-je, ajoute la pernicieuse.
…………………….
Mais pourquoi Maria pleure-t-elle, demande Zunon, pourquoi ? Décidément les humains ne savent pas ce qu’ils veulent, on les exauce, on les écoute, on cherche des solutions pour leur venir en aide, pour eux on invente les imprimantes couleurs, les pixels, les écrans plats, les imprimantes 3D, les réseaux sociaux, les pommades apaisantes, les sites de rencontres, les téléphones portables, les miroirs déformants, les appareils photos, le digital, le trigital, les téléréalités, les ballons de football, de baseball, de handball, on leur peaufine les règles du jeu, on les fabrique, on les amuse, on les nourrit, on leur initie des suites à suivre, on leur donne le mode d’emploi, et jamais, jamais, ils ne sont contents. Que peut bien leur trouver Jeus pour les aimer autant, que peut-il leur trouver à ces pleurnicheuses de femmes ?
……………………………………..
Maria crache à la face du soleil, ce fondeur d’enfants, qui, dégoûté, revient à sa préoccupation première : se demander comment avec ses doigts, l’ombre portée de ses doigts, fabriquer la Grèce des hommes, car à cette époque, à l’époque dont parle Joseph, elle n’existait pas encore, ça n’intéressait pas les dieux de l’Olympe de chercher un asile pour ces fantasques humains, ils les laissaient errer à la surface de la terre, une terre molle, liquide sans contour, des espaces amibiens aux frontières tactiles, mal délimitées et mouvantes comme ces filaments qui vivent dans l’œil quand l’œil regarde le soleil. La vie était comme ça, filandreuse et Maria s’y perdait, elle confondait le reflet et la vitre, l’objet et l’image, le moucheron agile et le filament de l’œil qu’elle essayait en vain d’attraper, de tuer.
……………………………………………
En vain, oui.
En vain, le soleil lui dit : mais ce ne sont que les quatre photos du photomaton (je viens de l’inventer ce magnifique appareil à effet quadruplateur), c’est une illusion, une image écranique, un jeu de l’esprit, des peaux visuelles que le flash a fait exploser, Maria ne pleure pas, ce ne sont que des images.
En vain, Joseph lui dit, je suis là, ne pleure pas, déchire ces sales photos, ne pleure pas. On va chercher la matière de tes enfants. On les reconstituera, on leur remettra de l’épiderme, on consultera les meilleurs chirurgiens. Ne t’inquiète pas, on va trouver une solution, je vais chercher dans mes livres, je vais trouver une idée.
En vain, l’imprimante lui rappelle que c’est elle-même qui voulait que ça pète, et bien ça a pété, de quoi se plaint-elle ?
Et Maria répond, non ça n’a pas pété, ça a fondu. Tout a fondu, ce n’est pas ce que je voulais. Tant pis pour toi, Maria, fallait pas t’adresser aux dieux, tu aurais dû connaître leur duplicité, tu aurais dû le savoir, n’as-tu pas fait des études. Ils font semblant de t’aider, et ils chamboulent tout. C’est leur grand jeu, leur plaisir, leur occupation. Ils s’ennuient tellement.
Oh gémit, Maria, l’imprimante a raison, c’est de ta faute, Joseph, avec ton amour de la mythologie.
Tais-toi, Maria, lui répond Joseph, laisse-moi finir mon histoire, le soleil a encore son mot à dire.
... Réflexions du soleil ...
Qu’est-ce qu’un humain ? Un magma teinté de liants artificiels, une surface organique, une chair cellulaire, une constellation biologique, un composite mi-image mi-substance, des prises de tête numériquement malléables, perfectibles à l’infini sous mes rayons.
Mais quand ça fond, c’est dégoutant.
C’est tout un art, vous comprenez. La terre, pour la faire, j’utilise mon rayon solidificateur. Les hommes, c’est plus délicat, il ne faut ni les figer ni les dessécher, il me faut bien doser la chaleur, bien la répartir, si je veux garder leur surface mouvante et jouer encore un peu avec eux, les étirer, les aplatir, les polygoniser. J’y suis peut-être allé un peu fort, là. Il faut que je recommence.
Et l’image numériquement codée rompt définitivement avec son passé pour changer radicalement de nature.
... Réflexions du fabricant de ballons de foot ...
Qu’est-ce qu’un ballon de foot ?
Sa morphogénèse est complexe. Il faut plus de 4 heures pour le faire naître. Il est constitué de plusieurs couches de dermes ( le polyuréthane et le PVC) recouvertes d’un épiderme protecteur étanche. Une des couches dermiques est une feuille de gélatine sur laquelle on passe des couleurs, qu’on imprime, qu’on recolore, qu’on chauffe, qu’on moule, qu’on préforme, qu’on remplit d’air et qu’on fait chauffer à nouveau dans une sorte de couveuse, une grande nursery à ballons. Entre 1400 à 2000 points attachent les uns aux autres les polygones découpés.
Voici ce qui est arrivé.
La machine s’est emballée. Les ballons se sont dégonflés et remis à plat comme de vulgaires isocaèdres, comme un patron de ballon en 2D qu’il faudrait regonfler. Tout est à refaire. Tout s’est déformé sous nos yeux. Les couleurs ont glissé, bavé et, de couleurs viriles et sportives qu’elles étaient à l’origine, elles sont devenus des couleurs de gonzesses, de boites de maquillage. Tu parles d’une palette ! Tout s’est répandu sur le sol, on ne sait plus où mettre les pieds. C’est foutu. Les assurances ne vont pas rembourser. Il n’y a plus qu’à fermer. Putain de machine, y a eu un coup de chaud. C’est depuis qu’on a mis des ordinateurs à la fabrication. Font ce qu’ils veulent.
Et l’image numériquement codée rompt définitivement avec son passé pour changer radicalement de nature.
Tiens, je ne me gratte plus, dit Maria. Merci Joseph pour ton histoire.
Joseph Pasdeloup
Dies irae
Récit inédit écrit pour Le Lampadaire
septembre 2014 ©
Dies irae
Récit inédit écrit pour Le Lampadaire
septembre 2014 ©
Merci à Julie Pastureau, et Nicole Tran Ba Vang pour avoir prêté leurs photos au Lampadaire qui me les a prêtées. Merci à Sandrine Maurial dont le soleil a pillé le texte pour en prélever sa définition de l’humain.
La biographie lambertienne de Joseph Pasdeloup est ici
Le compromis
Chapitre 1. La place de la Concorde
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Au moment de m’enfuir, je fais machinalement un dernier geste vers lui il croit que je veux parler je n’ai rien à dire.
Puis il demande à rester seul avec Marie-Hélène, nous apprendrons
qu’il lui a confié la mission de le photographier « après », il ajoute :
« mais seulement si je suis présentable ». L’attitude à prendre devant un mort ne va pas de soi. Une personne commande le respect. Mais une chose ? Gaston gît dans la pénombre, sur un des deux lits jumeaux de la chambre conjugale. Nous hésitons. C’est mon frère Serge qui nous tire d'affaire, il entre, sans précautions, sans même baisser la voix (comme on a tendance à faire dans la chambre d’un mort), déclare qu'il faut faire de la lumière, ouvre grands les volets. La chambre est inondée de soleil,
la photographe peut se mettre au travail.
Gaston voulait que nous l’enterrions non dans le cimetière communautaire, mais tout près de chez lui, au pied de la chapelle Saint-Roch dont il avait entrepris la restauration dans les dernières années de sa vie. C'est donc là qu'on creusa sa tombe. Je pris moi-même une pelle pour aider les fossoyeurs, tant j’avais hâte de me défaire du cadavre. Nul monument, si ce n'est quelques fleurs et un morceau de schiste sur lequel furent gravés, un peu à la va-vite, son nom et la date de sa mort. Je me suis arrêté quinze ans plus tard devant cette sépulture à peine visible sous les herbes qui l'avaient envahie, je fis cette réflexion que si j'avais fouillé la terre à cet endroit j'aurais trouvé des os je n'aurais pas trouvé mon père.
(On a voulu donner une figure au deuil en déposant une lourde masse architecturale au milieu de l'ancien champ de bataille de Verdun. Puis, prenant sans doute conscience du mensonge, on a voulu montrer aussi la terrible réalité que l'emphase héroïque et patriotique avait pour fonction de sublimer, ou de cacher. Pour qui fait le tour du long édifice, des baies vitrées s'ouvrent à ras de terre, invitant le visiteur à se pencher pour mater les restes sans noms des 130.000 soldats morts. Je me souviens
de mon peu d'émotion devant l'entassement des os, qui, au lieu de
montrer la mort, en exposait seulement le résultat. Le nombre même avait perdu de son sens. À supposer que le cataclysme n'eût pas eu lieu, les 130.000 hommes, aujourd'hui, n'en seraient pas moins morts ! il ne resterait d'eux que les pièces détachées de leurs squelettes, lesquelles ne feraient que s'ajouter aux débris osseux de tous les morts depuis que l'homme existe. Les marques de la guerre inscrites dans le sol, la terre bouleversée, le paysage encore barré par les tranchées, encore éventré par d’énormes cratères de mines, sont plus éloquents et mieux aptes à suggérer la mort et l'horreur dans leur insupportable vérité, parce qu'ils mettent moins sur la voie de la mort elle-même que sur celle du combat et de l'agonie. On ne voit pas la mort. )(… Liste et description succincte des pièces…)
Question. Quels sont les événements de la vie d'un homme que l'autorité sociale entend certifier et authentifier ? Pourquoi ceux-là plutôt que d'autres? Quels sont les critères de son choix ?
Deuxième question. Quelle réalité biographique concrète est-il possible d'induire à partir de ces seules attestations ? Qu'en est-il de l'être de Henri Gaston F, mort à Crépol (Drôme), le 18 septembre 1983 ? Wie steht es mit dem Sein ? demande, dans son Introduction à la métaphysique, le philosophe fribourgeois Martin Heidegger
(que les autorités alliées placèrent sous Lehrverbot — « interdiction
d’enseigner » — à cause de ses compromissions avec le régime nazi).le long du train qui est à quai en partance pour Strasbourg et l’Allemagne occupée. Passant à la hauteur des première classe, il ne peut s’empêcher de goguenarder : « Il faut être au moins député pour voyager là-dedans ! »
À bas les voleurs ! criait-on le 6 février 1934, place de la Concorde. Une caricature de l’époque montre le Palais Bourbon comme secoué par un tremblement de terre, les colonnes se fissurent, chancellent, l’édifice tout entier va s’effondrer. Pris de panique, les députés — ridicules pantins en habit noir — dégringolent les degrés de pierre et se carapatent vite fait pour éviter d’être aplatis sous les décombres. Légende : « Le régime parlementaire s’écroule ». Les députés sont malhonnêtes, ne pensent qu’à s’enrichir, tous corrompus, tous compromis avec des financiers véreux, des escrocs façon Stavisky, des banquiers juifs, des métèques, des francs-maçons. Incapables par conséquent de lutter de manière efficace contre le danger communiste.
(… C’est la révolution ! Le peuple se soulève, il se venge en détruisant tout ! Des hommes comme des ouvriers en grève envahissent la maison, les salons, les chambres, pillant et saccageant, plusieurs d’entre eux cachent dans leurs poches des bibelots précieux, d’autres saisissent de lourds objets qu’ils lancent sur les tableaux, sur les glaces, le grand miroir du salon vole en éclats, une fumée âcre enveloppe la scène…)
Une note secrète, signée du Chef d’état major de la Région militaire de Paris et intitulée Note sur la défense de la Région parisienne contre l’ennemi intérieur en temps de guerre, a récemment été retrouvée dans les archives du Service Historique de l’Armée de Terre (château de Vincennes) par l’historien Georges Duval, qui m’apprend qu’elle fut, à la demande du Maréchal Pétain (alors Inspecteur de la Défense Aérienne du Territoire), adressée au ministre de la Guerre en novembre 1932. La haute autorité militaire est apparemment préoccupée davantage par le complot intérieur que par la montée en puissance de l’Allemagne nazie, — d’accord en cela avec le discours des Jeunesses Patriotes de Pierre Taittinger, qui se présentent (article premier de leurs statuts) comme « un groupement de citoyens français pour la défense du territoire national contre les dangers de la révolution intérieure… »
Le complot communiste menace la France derrière l’apparence légale d’un parti : sa préparation minutieuse et dépourvue de tout scrupule, sa rapidité de réaction, la violence contre l’ordre établi, la désagrégation sociale. Fort de la tradition et de l’expérience révolutionnaires de la France (dit le rapport), le prolétariat conduit naturellement au soulèvement insurrectionnel, la classe ouvrière est une classe dangereuse, plutôt campée qu’installée, mélangée aux déracinés de toutes origines, étrangers et gens de couleur, l’agglomération parisienne offrant à l’insurrection des facilités que Paris n’avait encore jamais connues, même aux pires moments de la Commune, une véritable armée secrète aux ordres de l’étranger…
(« Aujourd'hui, après notre voyage en Russie, je demande
en toute honnêteté à nos camarades français dans la bataille sociale où le prolétariat mondial est engagé, de venir prendre rang dans l'Internationale de Moscou... Notre devoir est de signifier à la bourgeoisie notre volonté d'aller là-bas nous mettre côte à côte avec la grande révolution russe… » Marcel Cachin, 1925 )… qui constitue indiscutablement un fait de trahison, le danger d’insurrection communiste est un problème de guerre, qui doit être résolu par l’armée, aidée seulement des autres forces de répression et faisant appel aux associations patriotiques dans le cadre légal de l’état de siège, puis de l’état de guerre, sous un commandement unique, et militaire. Les donneurs de conseils (poursuit le rapport) seront impitoyablement évincés, la répression d’une inflexible dureté : saisie des meneurs et des agitateurs et leur regroupement comme otages, expulsion des étrangers et des coloniaux indésirables, interdiction des publications et des réunions de nature à exciter ou à entretenir le désordre, invitation à la population d’avoir à quitter l’agglomération parisienne, organisation de l’appareil judiciaire militaire et d’une juridiction spéciale rapide dans la prison du Cherche-midi, douze régiments dotés massivement d’armements modernes diversifiés, des chars, des engins de transport blindés, une compagnie de projecteurs, une artillerie tractée équipée de canons de 15 et de 75, une demi-escadrille d’avions, des bombardements, des lance-flammes, des gaz suffocants…
J’essaie d’affronter aujourd’hui cette représentation, calmement : Gaston nationaliste (« patriote », anticommuniste et colonialiste), défilant au côté des ligues d’extrême droite (les Champs-Élysées et la place de la Concorde noirs de monde), réclamant un état fort, protestant contre le renvoi par Daladier du préfet de police Chiappe, etc. — tout cela inaudible
depuis l’espace construit par la famille C un jour d’été 1935
devant un rideau d’arbres dans un parc (paradis). Les deux joueurs (Gaston, René) assis l’un en face de l’autre, fauteuils en rotin, boîte du jacquet posée sur les quatre genoux, forment la base d’un triangle dans lequel s’inscrivent : Odette, au centre, cheveux noirs en bandeaux, légèrement penchée souriante vers son amie Nelly Spindler (laquelle appuie sa tête sur l’épaule d’Odette), Micheline (la femme de René), tricoteuse étendue sur un transat, et, debout auprès d’elle, un enfant blond qui est son fils. Ma grand-mère Berthe, fortuitement masquée par le premier plan, n’est pas visible (on aperçoit seulement un peu de son chapeau), alors que Léon, debout derrière sa fille Odette, occupe le sommet de la figure dont il apparaît comme la pièce maîtresse (il est le garant généreux d’une certaine forme de bonheur, il dit : « Pourquoi vous inquiéter, puisque je suis là ? »), auquel est accolé, sur le même plan que lui, mais très légèrement décalé vers la droite, un groupe de quatre personnages assis sur un banc (dit banc de square, siège et dossier cintrés en lattes de bois, pieds de fer incassables) : Henri Spindler (le collaborateur scientifique de René), Lisette (sœur de Nelly), sur qui affectueusement se penche son mari (André Bouteiller), elle-même tenant sur ses genoux un enfant : Serge, le premier fils de Gaston et d’Odette, né le 16 juin 1934. La photographie prend acte d’un bonheur paisible, sans menaces, à quelques mètres à peine de l’endroit où je me suis moi-même arrêté — on ne voit que mon dos, le tabouret sur lequel je suis assis disparaît dans les hautes herbes ; derrière moi l’allée qui s’enfonçait sous les arbres depuis longtemps s’est effacée, fouillis de chablis, de broussailles, le sol devient marécageux au fur et à mesure qu’on progresse vers l’étang, un gamin, sur l’autre rive, me voyant approcher, me demande si moi aussi je suis venu pêcher.
Pendant sept ans (1932-1939), Gaston F fut le secrétaire particulier de Charles Bianchini (de la maison Bianchini-Férier, Fabricants de Hautes Nouveautés en Soierie, Lyon et Paris, et succursales à Londres, Bruxelles, Genève...),
qu’une photographie représente sur fond noir, neutre, sans décor
ni contexte, posant dans l’absolu, et comme se suffisant à soi-même. Porte moustache et pince-nez avec une égale perfection. Les cheveux, blancs, sont plaqués sur le crâne, les traits sont réguliers, le regard sévère, autoritaire, dominateur. L’homme est sûr de lui (compétence) et d’une stricte distinction.La tâche de Gaston consiste à gérer les biens privés de M. Bianchini (une grande fortune), pas seulement le portefeuille mais les immeubles parisiens et la terre de Poigny-la-Forêt, entre Montfort-l'Amaury et Rambouillet, plusieurs centaines d'hectares à l'ouest de la forêt domaniale, en bois, plaines, étangs, marais, une vaste maison où recevoir de nombreux invités, des fermes… Au début de « la drôle de guerre », Gaston écrit à Odette, sa femme : « J’ai passé l’après-midi à refaire les comptes que Bianchini avait faits lui-même avant ma permission : il avait donné 11.500 francs au métayer, alors que c’est ce dernier qui en devait 3500 ! ! !… Rien que ça ! Et tout recours impossible. Tu vois la mauvaise foi des agriculteurs !… »
Alain Frontier
Le compromis, chapitre 1,
2014, éditions Sitaudis
Le compromis, chapitre 1,
2014, éditions Sitaudis
Publié avec l'autorisation de l'éditeur. Vous pouvez lire l'intégralité du Compromis sur le site de Sitaudis en cliquant
ici
PORTRAITS DE FAMILLE 2
Les enfants que j'ai eus
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS

Courtesy Malek Gnaoui
LES ENFANTS QUE J’AI EUS
Vous comprenez, je suis embêtée, je ne reconnais plus mes enfants. J’en ai, ou dois-je dire, j’en avais, quatre. Bertrand, Catherine, Amélie et Louise. Amélie et Louise, les deux dernières, des jumelles, je les ai eues au Canada, d’un mari comme il se doit canadien. Pour Bertrand, l’aîné, j’avais choisi l’Allemagne, et bien sûr le père de Catherine était français. Il en fallait bien un. Aujourd’hui je suis seule, je veux dire sans mari, j’ai arrêté là ma visite du monde, et, je crois sans enfants, je ne les retrouve plus.
Je n’ai que des lieux communs à vous communiquer. Je suis désolée, ce n’est que ma vie. Au Canada, il faisait froid, l’accent était charmant, mais un peu lassant. On ne peut passer ses journées à faire en sorte que ses enfants n’attrapent ni le rhume ni l’accent. De quoi aurais-je eu l’air avec des filles, toujours le nez dans le kleenex, parlant comme des paysans du XVI° siècle. Ah mon mari n’aimait pas ça quand nous nous engagions sur ce terrain. Lui, il voulait qu’elles parlent comme lui, moi je voulais qu’elles parlent comme moi. Je ne pensais pas qu’on se disputerait autant. Il m’accusait de ne prononcer que des bêtises, de ne m’attacher qu’aux surfaces des choses. Je lui répondais que c’était idiot, que les choses dont il parlait n’avaient pas plusieurs surfaces, qu’une seule leur suffisait bien, et que d’ailleurs chez lui toutes les surfaces gelaient. Des disputes idiotes, dénuées de sens. Et puis les deux premiers aussi il voulait me les voler, le Bertrand et la Catherine. Il les emmitouflait soi-disant pour les protéger du froid qui règne là-bas, en fait pour me les cacher. Je l’ai bien compris. Je les ai découverts et ramenés en France, tous les quatre.
Bertrand, l’aîné, je l’ai eu au cours d’un échange Erasmus. J’étais partie en Allemagne pour mes études. J’ai surtout étudié les allemands. On m’en avait dit tant de mal, que j’ai voulu voir de plus près ces êtres étranges. Du quel vraiment Bertrand est-il le fils, je ne saurais le dire. Même physiquement, il ne ressemble à aucun des souvenirs que j’ai de mes amants. Peut-être est-il une sorte de mélange, un condensé, une synthèse. Peut-être se sont-ils mélangés en moi, et lui, ce fils, fait de petits morceaux mal cousus ensemble, tout décousu, un décousu. Bertrand Décousu. Robert Unzusammenhängend, je me souviens maintenant, c’était le nom de son père. Je ne pouvais pas laisser le fils avec un nom pareil, alors à l’Etat Civil, j’ai dit qu’il s’appelait Décousu, ce n’était pas vraiment un mensonge.
C’est drôle comme le passé revient à la surface, comment il ressurgit.
Je suis dans le fauteuil, là, au bout de ce couloir, il fait un peu froid. Je m’efforce de répondre à vos questions. Je ne sais pas pourquoi je suis dans ce fauteuil, là dans ce couloir.
Je les ai eus tous ces enfants, oui. Et puis petit à petit, ils ont disparu.
On les a à des endroits différents du monde, à des endroits différents de soi, mais on les a, oui.
On les a et puis on les a eus. Goûtez la différence.
Si vous les voyez, j’aimerais que vous me les rameniez.
ou les rapportiez
tout dépend de l’état dans lequel vous les trouverez.
Parfois, je vois des gens, ils se disent mes enfants, ils passent devant moi comme en un défilé, mais ce ne sont pas eux. A quoi les reconnaitrais-je ?
J’en ai vu passer
la mère dit à la fille
je suis réaliste
la fille (à huit ans, elle n’avait peur de rien) dit à la mère
tu es monstrueuse
la mère répond à la fille
non, je suis réaliste
Vous imaginez bien sûr la synthèse, que n’a pas dite la mère, ce qui prouve qu’elle n’est pas cette monstrueuse que disait qu’elle était sa fille (que sa fille disait qu’elle était), qui malgré tout ne lui voulait pas de mal.
Les deux souriaient.
Quelles intelligences.
À laquelle des deux ai-je souri déjà ?
Mais je ne voulais pas être monstrueuse, c’est ce que j’ai été dans l’obligation de leur expliquer, bien longtemps après. C’est ça que j’ai dit à Amélie, et peut-être aussi à Louise, je ne sais plus, et elle est partie. Les deux ensemble ? Elles sont parties.
Des jumelles, c’est normal, l’une ne va pas sans l’autre.
Moi dit le poète, c’est Bertrand, ce qui m’intéresse après tous mes voyages, il a beaucoup voyagé, finalement c’est l’écriture, c’est d’écrire un livre sur la langue. Quel poète ! il vient de découvrir le monde.
c’est pas sur la langue, c’est pas au bout de la langue, ton mot il est pas là.
c’est sous la langue, hey connard qu’il faut aller chercher, c’est là où il y a cet espèce de tendon, un peu dégoûtant, là où on met à fondre les médicaments homéopathiques qui s’ils ne font pas de bien ne font pas de mal, quel drôle de concept ;
ton mot, l’est là, et les autres aussi, fondants. Et le tendon, faut le couper si tu veux les attraper, les sauvegarder, si tu veux oublier d’être poète. S’ils te font pas de bien, ils te feront pas de mal, hey poète, nous la joue pas au torturé.
C’est ça que j’ai dit à Bertrand. Ça ne lui a pas plus. Il est parti en Mercedes, c’était sa voiture, tu parles d’un poète !
Comment plaire à ses enfants ? Depuis, je me pose la question.
C’est pas la langue qui est intéressante, c’est le dessous de la langue.
Quand je leur dis ça, même sans les insulter, ils ne me comprennent pas. Pourquoi ?
Il me restait encore Catherine, la seconde de mes enfants. A cinquante ans, elles est venue me voir, et m’a simplement dit « Maman, c’est fini, je m’en vais. » Que pouvais-je répondre ? Bon vent, ma fille, qu’il te soit propice doux et généreux ? Il ne faut pas se moquer, cela peut être dangereux. J’ai souri et je n’ai rien dit. Même pas « adieu ».
Et voilà comment je me suis retrouvée sans enfants.
Et maintenant ?
J’en ai quelques souvenirs, oui, inscrits dans mon cerveau, comme des taches de couleurs. Je pense même que chacun y a sa place. Les endroits non colorés, sont les emplacements des enfants que je n’ai pas eus. C’est ridicule. Cette conception, ce concept ne tient pas debout. Avez-vous déjà vu votre cerveau ?
Il faut le remplir, ne pas laisser ces parcelles incolores.
Car l’incolore est douloureux. Vous le savez peut-être.
Le vide aussi.
Je crois en fait que j’ai eu cinq enfants, je n’en suis pas sûre. Vous pensez que c’est ridicule d’avoir ce doute, comment ne peut-on pas savoir combien d’enfants on a élevé. Les ai-je tous élevés ? Déjà les jumelles c’est un problème, un enfant à quatre bras, quatre jambes, deux bouches. Est-ce qu’on les compte pour deux ou pour un. Voyez comme ça gigote, dans tous les sens. Par quel bout les attraper ? Qu’est-ce qui compte, le nombre de fois où on est enceinte (monopare, quadrupare,) où le nombre d’enfants qui sort de la caverne ? Comment remplir le vide de son cerveau ?
À cette cinquième, encore une fille, admettons que je l’ai eue, j’ai fini par lui dire que c’était la réalité qui était monstrueuse. Mais qu’il fallait s’y faire. C’était comme ça. À elle, je le lui ai dit. J’avais perdu ma gentillesse. Et plus personne pouvait faire semblant, par simple politesse, de ne pas voir que la réalité elle l’était monstrueuse. Depuis le temps !
Elle est partie, elle aussi, en me disant « non, ce n’est pas la réalité, c’est toi. »
Elle n’avait rien compris. Elle est partie se marier avec un boucher, quelle drôle d’idée. Elle maniait très bien la hachette. Elle avait un joli petit présentoir avec cinq hachettes, sur un fond lumineux. C’était son enseigne. Quand j’allais faire les courses et que je lui parlais derrière son comptoir, car je continuais à aller la voir, tant pis pour le boucher, je les voyais qui clignotaient et me faisaient de l’œil. Que voulait-elle me dire par ses hachettes ? Elle en avait mis cinq. Je lui ai demandé pourquoi ces hachettes, ma fille.
Elle s’est contentée de me répondre
ce ne sont pas des hachettes, ma mère. Ces couperets dans le langage de la boucherie s’appellent des feuilles, ma mère : avec elles, on tranche avec le tranchant et on aplanit avec la large surface plane qui ressemble tant à une feuille qu’un boucher fin observateur a trouvé convenable de leur donner ce nom. Ce sont donc cinq feuilles blanches que j’ai mises sur ce fond blanc légèrement luminescent comme une enseigne. Des feuilles blanches, tu entends ma mère ? aussi coupantes que le tranchant d’un couteau, aussi étourdissantes qu’une claque donnée avec le plat de la main.
Elle a toujours aimé parler celle-là, en faire tout un plat, faire des manières, en rajouter. Je ne l’ai jamais bien comprise. C’est insupportable.
Ça vous étonne ? Pourquoi ? Vous pensez qu’on devrait comprendre ses enfants ? Est-ce que je me comprends moi-même, non, vous voyez bien, alors comment pourrais-je comprendre les autres. Ils sont si peu de mon sang. J’ai déjà assez de travail avec moi. Laissez-moi tranquille, s’il vous plaît.
Elle parlait pour cacher la réalité ! Oui, elle oubliait de dire que le nom exact était « feuille de boucher ».
C’est une autre affaire, non ? J’ai demandé son avis au poète. Feuille ou feuille de boucher, est-ce pareil ? Il aurait dû savoir. Mais il refusa de me répondre. Depuis que je lui avait parlé de ses tendons sublinguaux, nos rapports n’étaient plus les mêmes. C’était tendu comme disait Rose. Il me disait de me débrouiller avec mes concepts vaseux, d’aller chercher cette sensibilité sublinguale où je voulais mais plus chez lui, plus jamais chez lui.
Quelle violence.
J’ai dû dire quelque chose que je n’aurais pas dû dire.
Sans doute
Ah, excusez-moi j’ai omis de vous préciser que la cinquième, elle s’appelait Rose. C’est moi qui ai voulu ce nom. Son père, non, alors il est parti. C’était un japonais, il s’appelait Kiyaüki, il ne voulait pas d’une fille qui s’appelle Rose Kiyaüki, on peut le comprendre, il est parti, adieu Kiyaüki.
Je vous entends très bien, vous passez dans le couloir, et à cette minute précise, cette minute là précisément, à ce moment de l’histoire que vous m’avez demandé de vous raconter et que je ne vous raconte que pour vous faire plaisir, vous vous dites « ça y est, cette fois, elle est complètement folle. » Vous dites, je peux répéter mot pour mot vos paroles, ce qui prouve bien que je ne suis pas folle. Vous dites, en baissant la voix et la tête : « elle est folle, de plus en plus folle tous les jours, complètement folle ».
C’est peut-être vrai.
Je crois que j’ai perdu autant de maris que d’enfants. C’est bizarre, quand on y pense. Et combien de maris pour les jumelles ? N’y pense pas alors m’a dit le sixième, c’est le plus gentil, un garçon, j’en ai eu tellement des filles, des pestes, toutes. Lui le petit garçon il était mignon, toujours à me tenir la main, à faire attention à ce que je ne marche pas dans les crottes de chien, à tenter de savoir ce que je pensais. Il est rentré dans mon cerveau et puis il est parti, lui aussi. Je commence à me demander pourquoi on se casse la tête, ou autre chose, à faire des enfants pour qu’ils s’en aillent comme ça. Je l’avais appelé Rocky, pour que ce soit du solide, pas du vaporeux qui s’échappe. Je croyais bêtement que pour les autres j’avais mal choisi leur nom, et que celui-là avec un nom pareil, de pierre posée lourdement sur le sol, jamais il ne pourrait s’évader. Je me suis trompée. J’aurais dû m’en douter, ils aimaient les cerfs-volants, et quand ils marchaient avec moi, tous reliés par la main à ma main, c’était comme une traîne qui volait au vent. Ils marchaient en volant, mes enfants. Des aériens. Faits pour l’éther, et pas pour la lourdeur des bois canadiens, ni des polders allemands ou hollandais, ni des rochers (mêmes américanisés) de la forêt de Fontainebleau.
Vous savez où il habite, maintenant ? Rue de la pierre levée. Est-ce que ce n’est pas drôle ?
Non, j’ai sept enfants, je m’en souviens maintenant, mais à quoi bon s’en souvenir puisqu’ils sont partis.
Ça ravive la douleur.
Des plaques commémoratives dans le cerveau. Elles sont scellées, boulonnées. Il y a écrit : Bertrand, Catherine, Amélie, Louise, Rose, Rocky. Et que faire du vide ? Qu’y mettre ? C’est bizarre, il n’y a rien pour le septième. Aurai-je renoncé à lui attribuer un nom ?
Perrine Poirier
Les enfants que j'ai eus
court récit écrit pour Le Lampadaire ©, 2014
Les enfants que j'ai eus
court récit écrit pour Le Lampadaire ©, 2014
La biographie lambertienne de Perrine Poirier est ici
Le Pen à jouir
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Je revois le mur sur lequel ces mots peints à la hâte, d’une taille démesurée : «Je suis homme avant d’être Français » et la fierté que je concevais d’en comprendre le sens, chaque fois renouvelée, lorsque notre voiture le longeait, tout près des quais de Seine. Par contre, celui qui portait l’inscription « Le Pen à jouir », à la sortie de Fontainebleau, ce graffiti-là m’échappait complètement. Et, même si je percevais qu’il contenait un univers de sous-entendus adultes qu’il me tardait de pénétrer, je n’osais en demander la pleine signification. Non pas que j’ignorais qui était Jean-Marie Le Pen. Mais « à jouir » ? Et puis cette construction sémantique, vraiment. Incompréhensible.
Le jour où je finis enfin par percer le mystère, cela me fit beaucoup rire. Nous roulions vers la maison, ma mère et moi. Elle me demanda ce qui m’amusait tant, je me gardais bien de lui répondre. La veille, dans un de ces gigantesques hypermarchés, j’avais eu le mauvais goût de lui dire, à propos de je ne sais plus quoi, que je n’en avais « rien à foutre ». Je poussais le caddie, traînant les pieds à sa suite, tandis qu’elle devait comparer les prix de quelque boîte de thon en conserve. Nous n’étions pas seules dans les rayons. Un père et ses deux enfants, assez jeunes. « Tu sais ce que c’est que le foutre?» Son air glacé, dominant ma piètre personne et le reste du monde. Son port altier réclamant le pardon de ma bouche pour avoir osé proférer de telles paroles. « C’est du sperme, ma fille. » Nos compagnons de courses accidentels, je le perçus instantanément, se hâtèrent de quitter le lieu.
Impensable, donc, d’évoquer cette inscription sur le mur. J’aurais préféré être avec mon père à ce moment-là, nous aurions bien ri. On ne plaisante pas avec ma mère, surtout pas à propos d’un sujet comme celui-là. La sexualité, c’est sacré. C’est l’amour triomphant, c’est l’intimité, c’est le lien le plus personnel du couple. On ne dégrade pas. Le sujet n’est pas tabou. On le dit, sans honte surtout sans honte, et avec quel empressement de bien montrer, de bien faire voir aux autres que le thème est assumé. On se promène nu à la maison, même si les enfants n’ont pas envie de voir parce que c’est naturel et qu’on est en famille et qu’il n’y a pas de honte à avoir. C’est assumé de manière médicale. Sperme et non foutre. Vulve, verge, et non zézette, zizi ou autre sobriquet amusant. On fait l’amour, on ne baise pas. Du sérieux, pas de blague, jamais.
Qu’en est-il du plaisir ? On ne le mentionne pas, il suffit juste de savoir qu’on ne se donne pas à n’importe qui. On ne plaisante pas.
La vérité c’est qu’on ne se donne pas tout court. Du moins, pas elle. Je le sais par mon père. Il n’est plus question de plaisir entre eux depuis longtemps, s’il en fût question un jour.
Ce soir-là, elle écoute Carmen. La journée de travail terminée, les tâches domestiques qu’elle s’était attribuées selon un plan hebdomadaire bien conçu réalisées avec soins, les enfants nourris, elle s’installe dans son fauteuil, dans le salon, pose sur son crâne son casque sans fil et, ainsi coupée du monde, de nous, écoute sa musique. Les yeux clos, ses jambes sursautent en rythme, qu’elle marque également par les tapotements de ses ongles longs sur le bras du fauteuil. Son père était musicien, elle a le son dans la peau, le mouvement en elle. Elle ne perçoit pas, comme nous qui la surprenons souvent, gênés, que tout son être exprime une rigidité parfaite quand elle croit l’agiter de manière sensuelle, que sa voix sonne faux quand elle fredonne, que le battement de ses jambes, loin d’exprimer une perception accrue des subtilités musicales, lui confère un caractère robotique. Il y a un manque de pudeur amer dans cette exhibition de ma mère vivant son plaisir, se délectant de ses moments rien qu’à elle, en plein centre de l’espace familial. C’est insupportable de la voir se trémousser comme si je n’étais pas là. Comme si elle ignorait notre présence à tous, nous infligeant malgré nous le spectacle de sa jouissance.
Pendant ce temps mon père a rejoint secrètement son garage. Dans les sous-sols, il a levé la porte de fer, l’a refermée derrière lui, s’est glissé dans le noir le long de l’Escort. Calé entre le coffre et les étagères murales, il cherche de la main ses bouteilles. Le torrent de brûlure se déverse le long de sa trachée, inonde l’abdomen flasque, le transperce de milliers de lames étroites. Dépossédé de son corps il en ressent cruellement chaque parcelle jusqu’au dernier atome. C’est ce qu’il avait attendu tout la journée. Il s’agrippe du mieux qu’il peut aux étagères, tente de ne pas plier. Ses idées ne sont plus, pas plus que les choses ni même les formes. Quelques couleurs, peut-être, un camaïeu de gris dans l’obscurité du garage.
Chaque soir, c’est la même chose. Chaque soir, le besoin de quitter cette vie qui lui fait horreur. Cette femme qu’il aime malgré le désamour qu’elle lui porte, qu’elle lui témoigne dans chacun de ses gestes, chacune de ses paroles. Qu’il la déçoit, qu’il la rebute, qu’il n’est pas l’homme qu’elle aurait voulu avoir. Qu’elle ne le quittera pas malgré tout parce qu’il est le père de ses enfants et que, pour eux, elle doit rester mariée, porter sa croix jusqu’au bout. Il vit avec cette certitude de n’avoir de valeur en aucun lieu, aucune circonstance. De n’être pas aimable. Absolument indésirable. Le rhum a raison de ces sentiments, le pousse dans les tréfonds d’un univers qui n’existe pas, où ni lui ni elle ni rien n’existe. Juste cette intense brûlure qui en redemande, qui se nourrit encore et encore de ce déchirement rédempteur. Agrippé au métal du coffre, plié en deux, il parvient à se redresser, récupère la bouteille posée devant lui. C’est comme s’il était sorti de lui-même, il pourrait se voir d’en haut.
La lumière s’allume dans le couloir, pénètre par fins faisceaux le carré de la porte. Des sons de moteur, les grincements des grilles, des pas dans le dédale des couloirs. Depuis combien de temps se tient-il affaissé contre le coffre, il l’ignore. Il voudrait boire encore. La bouteille est vide. Quelque chose remonte le long de la gorge, dégouline sur le menton, la veste. C’est chaud, ça a un goût de cuivre. Il porte la main à son cou, la regarde, il ne voit rien. Il fait trop noir. Ça continue de sortir par la bouche, ça ne peut pas s’arrêter. Il comprend. Les médecins l’avaient mis en garde. Ils lui avaient dit d’arrêter, de tout arrêter avant qu’il ne soit trop tard, avant que les varices n’envahissent l’œsophage. Une fois là, rien à faire pour les retirer, elles éclateraient. C’est donc à ça que ça ressemble. Il ne souffre pas. Ça coule encore. Il ne l’avait pas imaginé ainsi. Inconscient, il s’effondre. Il ne ressent pas l’impact de toute sa masse sur le sol. Étalé entre les roues arrière du véhicules et les vieux cartons de jouets de ses enfants, il ne sent plus sa mâchoire qui ne parvient pas à faire barrage contre l’afflux, le sang qui coule, qui coule encore, dessinant les contours de son corps sur le béton. Le sang qui coule, qui coule jusqu’à la dernière goute.
C’est la scène finale. Carmen quitte don José. Elle arrache sa bague, chante qu’elle n’en veut plus. Elle la lui rend. Fou de rage, de douleur, d’amour, il enfonce une lame dans son ventre. Elle tombe, morte. Carmen, la femme, la féminité à l’état brut, celle en laquelle elle a toujours voulu s’identifier. La sauvage, celle qui suscite le désir, bestiale, tombe, et la musique triomphe. Aux sons des Toreador, ma mère sent l’explosion monter en elle. Elle entend le concert des voix qui chantent la fin de l’amour, l’ultime désespoir de José, sa victoire sur l’infidélité de Carmen. Elle ne fredonne plus, ses cuisses ont arrêté de battre le rythme, pourtant la musique éclate, les sons bien connus la transportent si loin. Elle se fige, tous ses muscles sont tendus, ses doigts crispés, ses ongles plantés dans le velours du fauteuil. Ça continue, Toreador, et Carmen, Carmen. Elle peut la voir, Carmen, étendue de tout son long. La mélodie redescend, le rythme ralentit, plus que quelques instants avant la fin du disque. Elle reprend son souffle, reprend conscience de son corps dans le moelleux de l’assise. Elle sent cette légère chaleur sur ses joues. Ça y est. Elle rouvre les yeux, sourit. Enlève son casque. Écoute le silence du salon. Elle va bien. Mieux que bien.
Arielle Lacazzi
Le Pen à jouir 2014
première publication
dans le n°27 de la revue Dissonances, « Orgasmes »
Le Pen à jouir 2014
première publication
dans le n°27 de la revue Dissonances, « Orgasmes »
Deux mères
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Les gens voudraient changer de mère. Les gens ont de la rancœur, une vive rancœur qui les tient jusqu'à très vieux, pour leur mère. Ils rêvent d'une mère qu'on leur a dictée, une mère à la voix qui berce, maman douce et compréhensive, qui chante et susurre des mots tendres. Sur le soir de leur vie encore, ils rêvent d'être pris dans le creux tiède de ses bras, d'une voix qui murmure à leur oreille allongée et poilue. Ils sont des vieux pleurant leur enfance perdue, leur enfance volée car il n'y a pas d'enfance sans mère, ils le croient fermement, il n'y a pas d'enfance sans une certaine sorte de mère, image parfaite de mère imposée du dehors, ils ne se rendent pas compte, ils ne voient pas que ce rêve ne leur appartient pas. La mère qu'ils ont eu, ceux-là, elle était défaillante et défectueuse et dure. Ou simplement absente, ou indifférente, ce qui revient au même. Elle les a faits souffrir du manque de caresse, câlineries et cajoleries, et les anciens enfants privés de tout ça s'inventent pour dormir le plus gentil des clichés.
Elle, au contraire, la femme dont je veux parler, sa mère était parfaite. Plutôt, elle s'était faite sans défaut pour sa fille. En beauté et en patience compréhensive. Sa mère n'était pas comme les autres gens. Elle ne s'était pas inventé une mère de rêve et de remplacement pour se guérir de son enfance, elle s'était rêvée elle-même, fabriquée pour correspondre exactement et dans les moindres détails à l'attente collective, pour que jamais, oh non jamais, sa fille puisse lui reprocher quoi que ce soit, qu'elle ne puisse pas lui être infidèle en se forgeant une mère plus belle. Alors quand le rêve est venu de changer et de trouver mieux, quand la femme que j'évoque s'est autorisée cette traitrise, ce qu'elle a trouvé, paradoxalement, c'est le plaisir suave d'une mère plus laide, plus folle, et méchante. Pour exister par elle-même et sortir enfin de l'ombre qui l'avait longtemps effacée, pour se donner pleinement et en toute indépendance à sa propre maternité, elle s'est modelé la douce figure d'une vilaine marâtre.
C'est arrivé alors qu'elle attendait son premier enfant. C'est arrivé quand elle a reçu l'effrayante nouvelle, qu'elle attendait une fille, que les choses se continuaient, se répétaient, de fille en fille, et que rien, aucune petite aspérité dans le souvenir de sa mère, ne lui permettrait de croire qu'elle pourrait la surpasser en douceur, ou en don. Face à cette terrible découverte et à l'impuissance à laquelle elle s'est trouvée réduite, il y eu cette solution-là, secrète, de se forger une mauvaise mère. En attendant la petite qui germait dans son ventre, pour apaiser la terreur qui la prenait et lui serrait la gorge, elle se faisait chaque jour une petite séance de cauchemar réconfortant, une fausse enfance de misère et de solitude, et s'inventait, morceau par morceau, affreux lambeau par affreux lambeau, comme Frankenstein créant son monstre, la génitrice la plus atroce, une qui épouvante et qui, à elle, caressait l'imagination. Elle a eu honte bien sûr. Elle s'est dit que cette envie qu'elle avait, c'était celle de quelqu'un qui n'avait jamais souffert, qui ne connaissait pas la douleur de l'abandon et qui était assez confortable pour désirer la douleur. Alors elle s'était cachée de ça, elle avait menti, elle avait gardé précieusement son secret inavouable.
Elle la voit. Elle s'allonge tranquillement sur son canapé, un oreiller douillet sous la tête, la nuque légèrement relevée et le corps bien étendu, le dos calé pour ne pas trop sentir le ventre alourdi de la petite qui pèse, et la voit. Sa mère idéale et désirée est alcoolique. Elle porte sous ses yeux les valises brunes du vin, la peau fripée du sommeil enfui, les cercles de terre asséchée, craquelée comme la boue du désert, cercles qui jaunissent le regard, le font partir loin derrière et le vident. La plupart du temps, elle serait effondrée sur un fauteuil, réduite à une carcasse, muscles avachis et bourrelés denses qui débordent et la main tachée qui pend. Le corps, la main, la clope qui pend. Et la cendre sur le tapis. Elle serait immobile. Perpétuellement. Fixée dans sa moiteur poisseuse, monstrueuse, et partie ailleurs, en dehors du langage, déchirante de rien. Son souffle stupéfiant. Et moi j'étais dans son ventre. Je rêve l'horreur d'avoir été dans ce ventre, cuvée comme tout ce qu'elle boirait, et rejetée ensuite. Comme je la cacherais cette mère, je la cacherais aux yeux de tous, elle serait inmontrable. Et ce serait facile : elle-même refuserait de se donner au jour et aux regards, à la vie. Je pourrais juste la dire, me dire en la disant, voir l'intérêt pour moi de celui qui m'écoute, la douce pitié à la place de l'admiration qu'inspire ma vraie mère, moi inexistante et c'est tout. Je la dirais, elle et ses fringues de loques, n'omettant aucun détail sordide, exagérant le sordide, couleurs passées et pisseuses du costume, bouffe séchée dégoulinant au cou. Mère dont on se défait facilement, qu'on abhorre et crache et expulse. Les mères expulsent les enfants mais les enfants doivent expulser les mères. Elle m'a expulsée, je l'expulse à mon tour avec dégoût. Mais facilement. Elle, le vide ; elle, le rien. Les yeux mi-clos, lourdes paupières vertes, qui me voient et ne me voient pas. Est-ce qu'elle est morte ? La crainte de l'enfance, de désir mêlée, quand elle aurait trop bu. L'enfant coupable qui veut la mort de sa mère. Quand elle ronflerait sur le fauteuil, puis quand elle tanguerait comme une barque. Cognant les murs et recognant, sifflant son souffle rauque. Au bord du précipice, je vais me coucher, phrase sans les consonnes, quasi inaudible, devinée par habitude. Voix pâteuse, langue énorme, collée au palais, bouillie, invraisemblable bouillie gutturale et morne, consonnes avalées, traînantes et mâchées. Rumination et ruine des mots. Ce serait ça les souvenirs, souvenirs de sept ans, de la mère qui se lève et se couche, qui tangue et qui vacille et perd son équilibre. Débrouille-toi, tu es grande, je suis fatiguée et je me couche. Pas de sentiment d'abandon, non. Un soulagement car elle se couche. Qu'elle se couche. Et disparaisse enfin dans le fond du puits que l'alcool a creusé pour elle. Un ensevelissement. L'enfant qui ramasse les vêtements tombés dans le couloir, toutes les traces de sa sale présence. Ramasser, ranger, haïr. Se construire contre, ensevelir la mère sous la honte, pelletée par pelletée. Comme ce serait simple et beau.
Souvenir de sept ans, souvenirs. Le délice des sentiments faciles enveloppe d'une écharpe douce, d'un mohair chaud. La facilité de la haine, de la colère, comme une laine tricotée main efface pour un temps l'image adulée pendant l'enfance, la vraie mère sans défaut, la statue. Construite par ses soins avant, par ses petites mains d'enfant qui aime et admire, maintenant encombrante. Statue qui prend tout l'espace dedans, il n'y a pas la place, pas de place avec fontaine et bacs à fleurs pour rendre hommage à la statue. Elle était la plus belle des femmes, absolue et sublime aux lèvres rouges, envoûtante de parfum mélangé à la cigarette, ses bras profonds, fossette au sourire aimant, sa féminité qui enivre. Souvenir lyrique, bâti à sept ans, chéri et dévastateur. Elle, ses yeux agrandis de khôl, ses cils battants, ses yeux d'indulgence et d'amour posés sur elle. Être elle. Petite, elle lui volait ses foulards et ses chaussures. Pieds minuscules de fillette, jambes qui se tordent sur les talons trop hauts. L'espace, le vide, entre le talon et l'arrière de la chaussure, marquait l'inaccessible. Elle claudiquait pour lui ressembler, vacillante et ridicule, clownesque. Et le maquillage que sa mère prêtait, la douceur vaporeuse du gros pinceau, la sensualité du rouge à lèvres, de ses lèvres sur les lèvres de la petite, le trouble. Bâton qui glisse sur la bouche, épaisseur salée, pâte mangée pour mieux en sentir le goût d'interdit. Un peu de la femme sur la fille, princesse délirante et folle, fausse cigarette tenue avec une grâce maladroite, chercher la femme dans le moi d'enfant. Elle qui la couchait tendrement, c'est le rêve des vieux qui n'ont jamais eu de mère, s'allongeait au bord du lit, on pense aux vieux et on pense à Proust, l'entourait et la gardait, longtemps, contre son corps. Longtemps, si longtemps, jusqu'au sommeil, pour protéger des mauvais rêves, elle restait, généreuse d'elle-même. Comme sûre qu'elle seule pouvait effacer les dangers de la nuit. S'engourdir dans ses bras, tout doucement sombrer en caressant le creux fragile du poignet et se promettre, avec la fermeté de l'enfance, quand je serai grande, je serai toi.
Quand je serai grande, je serai toi. Ou je ne serai pas.
Agnès Jauffrès
Deux mères ©, 2014
court récit écrit pour le Lampadaire
Deux mères ©, 2014
court récit écrit pour le Lampadaire
Le jour de la photo
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Je me demande si je vais pouvoir passer la nuit ici, seule. J’ai peur du noir. Je n’aime pas dormir seule dans une maison. J’ai peur.
Ma mère, elle, n’avait pas peur du noir : quelle que soit la maison, et même à l’hôtel, elle allait et venait sans allumer l’électricité. On lui disait, mais maman, tu as des yeux de chat, et c’était vrai, elle se dirigeait dans la maison, dans les couloirs, entre les meubles, sans jamais se heurter, sans un bruit, d’un pas souple et silencieux de chat. Ou de fantôme. Mon père, lui, se cognait contre la table, le fauteuil, la chaise, jurait pestait, cherchait à tâtons l’interrupteur (qui, dans la nuit, prenait un malin plaisir à se déplacer de quelques centimètres, oh pas grand-chose, juste suffisamment pour que la grosse main de Kolia palpât le mur en hésitant, ses doigts effectuant une danse prudente mais déterminée, il lui fallait allumer avant de descendre les escaliers, Kolia avait si peur de se retrouver nez à nez avec un spectre ou avec un petit garçon blond pétrifié qui chantait à tue-tête dans le grand escalier de pierre pour se donner du courage et faire fuir les vampires, un petit garçon qui adorait les histoires de sorcières des neiges que lui racontait sa mère, qui s’endormait en murmurant, bonne nuit Babayaga, à demain, sois gentille, protège moi, ne m’envoie pas de cauchemars, tu sais, moi je t’aime bien, pour essayer de s’assurer les bonnes grâces de la fée mal aimée, un petit garçon blond très conscient de son pouvoir de séduction mais au fond, tout petit et très inquiet, Kolia mon père avait une peur panique de se retrouver nez à nez dans le noir avec l’enfant qu’il avait été et ne cessait pas d’être).
J’ai peur du noir.
Je suis assise sur les marches du perron, le soleil décline doucement, j’ai encore le temps de rentrer ce soir à Paris si je n’ai pas le courage de dormir seule dans la grande maison… Ou alors, je peux décider d’aller à l’hôtel. L’île est déserte, il n’y a pas de touristes, pas de vacanciers.
Pour l’heure, je regarde le jardin. Le cerisier est en train de mourir, ses branches sont malingres, le vent le fait couiner doucement, on dirait qu’il appelle, on dirait qu’il se plaint. Peut être qu’il cherche ma grand-mère. Grany installait sa chaise longue contre lui, tous les étés, pour somnoler, pour écosser les petits pois, pour nous lire un livre, pour bavarder avec le jardinier, pour nous prendre en photo, chaque année.
La photo, c’était le signal de la rentrée prochaine. Un matin, elle décrétait qu’il était temps de faire la photo de famille, sa photo de fin d’été. Nous étions à son goût, suffisamment bronzés et bien portants après presque un mois de vacances auprès d’elle et de Grand-Père Jakob pour figurer dans son album. Ce rituel lui procurait un plaisir infini.
Un matin, il fallait faire la photo, un matin sans doute où la lumière lui semblait assez belle mais plus aussi violente qu’en juillet, un matin peut-être où le cauchemar familier était revenu, un cauchemar que je l’avais entendu raconter à Hannah, l’oreille collée contre la porte de sa chambre. La vieille Hannah venait rendre visite à ma grand-mère tous les jeudis après-midis, elles s’enfermaient dans la chambre de Grany, et je me demandais vraiment ce que pouvaient se raconter ces deux vieilles dames, et aussi, ce qu’elles avaient à cacher, quels secrets elles échangeaient pour avoir à s’isoler de nous tous. A tout petits pas, en retenant ma respiration jusqu’à devenir tout à fait écarlate, je me postais derrière la porte peinte en gris et bleu, je regardais passer l’araignée minuscule qui logeait dans un trou microscopique juste au-dessus des gonds, et j’écoutais. C’est un cauchemar Hannah qui revient si souvent… C’est épuisant… Je les revois, je les revois clairement, je les revois tous, alignés les uns derrière les autres sous la neige, je vois le regard affolée de Maman, les larmes baignent son visage, je revois mon père qui refuse de lâcher la main de Samuel, j’entends les cris et les coups de bottes qui écrasent son visage, il y a cette tache de sang dans la neige qui dessine une licorne, et puis cette femme en uniforme qui me tape dans le dos, me pousse en me disant : « toi, viens par ici, suis les autres », je me retourne, j’entends Maman qui crie « va ma chérie, va vite, sauve toi ! », elle serre Samuel contre sa poitrine, les grands yeux noirs de Samuel… La nuit, Hannah, la nuit, est peuplée par les grands yeux noirs de Samuel, je les revois, je les revois comme je te vois, Hannah, ses yeux comme du velours… J’entends sa voix, il crie « Malka ! tu vas où ? », et là, je me réveille ou bien Jakob me réveille, sa main me caresse la joue, il a son sourire triste, tu sais Hannah, et il me dit « ils sont revenus cette nuit ?... », et alors, le lendemain, je dois faire la photo. Tu comprends ? Je veux ma photo de fin d’été. Je les veux tous autour de moi, sous le cerisier. J’en fais faire un rouleau, une pellicule de douze, une par personne tu comprends, comme ça, ils choisissent chacun celle qu’ils préfèrent. C’est Joli Cœur qui descend à bicyclette au village pour déposer le film chez le photographe, c’est « sa mission » comme il dit, il prend un petit air si sérieux et concerné, c’est magnifique. Il sait que c’est très important pour moi, il se sent responsable tu comprends Hannah ? Et puis, le lendemain matin, il va les chercher sur son vélo rouge, je lui donne mon porte-monnaie, il rapporte un petit sac avec douze croissants chauds et le paquet avec mes photos. Je suis la première à choisir, je prends la meilleure des douze photos, je colle la photo dans mon album, et après, ils se débrouillent entre eux. Moi, j’ai conjuré le mauvais sort.
Je range l’album sur ma table de nuit, et quand je sens que la nuit menace d’être douloureuse, avant de m’endormir, je regarde la photo du cerisier, avec tous mes enfants et mes petits dessous, autour de moi et de Jakob, leurs visages souriants, rigolards ou renfrognés (souvent Simon ne sourit pas sur la photo mais il est tout de même très beau), je les regarde, je ferme les yeux, si l’image est claire et précise, alors, je sais que je peux éteindre calmement la lumière, sans crainte, tu comprends…
Moi je ne dormirai pas dans la maison. J’ai peur du noir.
Françoise Sliwka
Dimanche matin peut-être
extrait ©
Dimanche matin peut-être
extrait ©
L'errance intérieure
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Allez, Trico, lève-toi, un peu de courage ! Il en faut, du courage, pour affronter la vie. Et pour supporter mes congénères qui la peuplent. Quel mot curieux : congénère. On entend surtout la première syllabe.
Du courage ou de l'insouciance, cette huile qui fait coulisser les rouages les plus résistants, cette disposition qui transforme en poussière la pointe de la flèche.
En considérant plus attentivement l'équation, il suffirait de répondre tout uniment aux questions que me posent mes chers congénères, de consentir à leurs désirs, en un mot, de ne pas les contrarier. C'est simple finalement. En théorie.
Quand on y réfléchit un peu plus, les inconnues se démultiplient : comment dire, par exemple, à un collègue, que ses considérations personnelles me rasent profondément ? Si j'ose le lui avouer, il se vexera inévitablement, s'offusquera, se carapatera dans une bouderie belliqueuse. A moins qu'il ne soit naïf ou irrémédiablement allègre, il le prendra pour lui et une dégradation marquée de nos relations en résultera immanquablement. Il pourrait même avoir l'indélicate faiblesse de ne plus m'adresser la parole.
Par chance, je n'ai pas de collègues.
Il est 10 heures, le soleil est levé, enfin il poursuit son ascension, chaque jour la même, strictement ou presque ; quel idiot, ce soleil ! Il manque vraiment d'imagination pour proposer chaque jour un spectacle identique.
Ne travaillant pas aujourd'hui, ni demain d'ailleurs… attention, je ne dis pas que je ne travaillerai jamais, on ne sait jamais comme on dit… Donc, ne travaillant pas aujourd'hui, j'ai la journée de libre, je n'ai de compte à rendre à personne. Rien ne m'oblige à sortir, ce qui ne signifie pas nécessairement que je ne sortirai pas. N'ayant aucune formalité particulière à effectuer, la logique voudrait que je ne sorte pas. La logique est une tenaille dont les mâchoires broient et recrachent les insectes les plus azimutés.
Si je sors, ce sera pour m'aérer les idées, pour faire circuler le sang. Ceci étant, celui-ci continuera vraisemblablement à circuler même si je ne sors pas. Le fait qu'il ne circule plus scellerait mon décès, n'est-il pas ?
Personne ne répond. Vous devez encore être endormis… ou sortis ? Aurais-je proféré une énormité ou une abjection, sans même m'en apercevoir ? C'est étonnant, je suis très scrupuleux en matière de déclarations.
Je sortirai… si ça peut vous faire plaisir. Mais pourquoi vous ferais-je plaisir, je n'y suis pas particulièrement enclin. Toujours plaire, ne pas agacer, ne pas choquer, ne pas mécontenter. C'est pesant à la fin. On a autre chose à faire, non ?
Non, pas grand-chose, à vrai dire.
Je risque même de m'ennuyer aujourd'hui. Comme les autres jours, au demeurant. Je commence déjà à m'ennuyer, je le sens. Et lorsque je m'ennuie, lorsque la fourbe inertie s'empare de mon corps, j'ai la fâcheuse tendance à perdre ma contenance. La question alors est : que faire pour la restaurer ? Je suis comme démuni, comme impuissant. C'est sûr, jamais je ne pourrai combler une femme avec si peu de charisme. Du reste, je ne risque pas de rencontrer une femme si je ne sors pas de mon appartement. Je n'y tiens pas particulièrement non plus… à rencontrer une femme… ni à sortir.
A moins de tomber directement sur la femme idéale, ce qui est rarissime, je ne souhaite nullement m'encombrer d'une seconde volonté, synonyme d'ambivalence, de disharmonie, d'antagonisme et de schizophrénie.
Au vu de mon éloquent panache, vous vous dites fatalement : « cet homme est un expert du couple». Détrompez-vous. Détrompez-vous avant de vous lamenter des conséquences d'un raisonnement trop hardi et fumeux. Détrompez-vous avant de générer en moi une puissante culpabilité induite par une telle mystification.
Je n'ai vécu en tout et pour tout qu'une aventure dans ma vie : j'avais 16 ans. Ma cousine, 18.
Je sortirai plus tard. Surtout ne pas se forcer. Il est trop tôt pour sortir, de toute façon. Commençons par prendre un café, ça me donnera peut-être de l'énergie pour sortir ou, qui sait, la lucidité suffisante pour imaginer des raisons légitimes de ne pas sortir.
J'aurais au moins marché un peu aujourd'hui, de la chambre à la cuisine, de la cuisine au salon… Ce n'est pas rien. C'est toujours ça de pris, toujours quelques mètres de moins à effectuer à l'extérieur… dans l'hypothèse où je sortirais.
Si je travaillais, j'aurais vraisemblablement moins de temps libre pour m'ennuyer. Pourquoi ne travaillé-je pas ?! Qui en a décidé ainsi ? Je pourrais très bien être avocat, banquier ou cadre. Non, j'en doute, je n'en ai pas les compétences. Les recruteurs, ces monstres retors, exigeraient des diplômes que je ne possède pas. J'aurais pu les obtenir, en travaillant un minimum à l'école. Oui, si j'avais travaillé un peu et si j'avais fréquenté l'école, je les aurais sûrement obtenus. Comme tout le monde, ou presque. Et aujourd'hui, je serais banquier dans une grande banque. Ou même petite. Ou caissier dans une grande surface… ou sous-caissier dans une petite surface. Il est indécent de prétendre à d'excessives ambitions. Souvent les ambitieux finissent par gâcher leur vie, et celle des autres. Ou par mourir.
Je mangerai plus tard, je n'ai pas faim. Pourquoi devrais-je manger tous les jours à la même heure ?! C'est insensé ! Je suis libre d'attendre 15 heures pour manger, personne ne me le reprochera. Sauf si je sors et que je croise quelqu'un. Il ne faudrait surtout pas, dans ce cas, évoquer ce sujet. Il faudrait deviser d'autre chose. Mais de quoi ? Je n'ai rien en tête à ce moment précis. Probablement me viendra-t-il un sujet intéressant avant que je décide de sortir.
C'est décidé, je ne sortirais que si une question consistante me vient à l'esprit. Ça viendra inéluctablement, d'ici-là. Savoir se fixer des objectifs précis est l'apanage des caractères forts et entreprenants.
Au bout du compte, il semble inconcevable que je ne sorte pas aujourd'hui. Malgré la tenaille de la logique.
Coupons le téléphone pour ne pas être dérangé. Le calme absolu est nécessaire en vue de faire advenir à la conscience une question profonde, digne d'être partagée, voire creusée dans le cas où cette question galvaniserait les deux interlocuteurs.
Ainsi, nul ne pourra me reprocher d'avoir mangé à 15 heures.
Ça me lessive de penser sans cesse. Je vais m'asseoir un moment dans le salon. Ceci dit, la fatigue n'est pas d'ordre physique, plutôt d'ordre nerveux. Alors pourquoi m'asseoir ?! Ça ne fera qu'empirer. Il faut que je bouge plutôt pour atténuer la tension nerveuse.
Idéalement, il faudrait que je sorte, que je me délasse au grand air. Pourquoi grand, au fond ? Il n'est pas plus grand que celui qui est à l'intérieur. Rien n'est scientifiquement établi sur ce point.
Hélas, je dois convenir qu'aucune question captivante n'a daigné traverser mon esprit jusqu'ici. Réfléchissons… Serait-il envisageable que je sorte sans croiser quiconque et ainsi ne pas entamer de conversation épineuse ? Si, par malheur, je croisais quelqu'un, me resterait l'option de baisser la tête et faire semblant de ne pas le voir. Qui plus est, ce serait vraiment une effroyable infortune si je croisais quelqu'un sur le sentier si peu fréquenté derrière chez moi.
Pour autant, ce n'est pas totalement exclu. Surtout à cette heure-ci où les gens ont coutume de se promener afin de faciliter le transit. Dans l'hypothèse où ils se seraient sustentés à un horaire traditionnel…
J'ai bien fait de ne pas manger, cela supprime une raison de sortir et écarte par là même la menace saignante d'un reproche.
Je n'aurais pas dû manger si tard cet après-midi, je ne ressens pas la faim ce soir. Mais c'était manger ou sortir, il me fallait choisir, je ne pouvais pas rester sans agir, je ne supporte pas de dériver comme un vulgaire débris dans un intervalle vague et indéterminé.
Désormais, il fait nuit, je ne peux plus sortir. J'aurais dû sortir plus tôt, ça m'aurait évité de réfléchir tout l'après-midi au moment propice pour sortir.
Pourvu que personne ne m'appelle pour sortir ce soir.
Qui donc pourrait m'appeler ? À part une erreur, je ne vois pas, je n'ai ni famille ni amis. Et puis, j'ai coupé le téléphone, donc si un ami ou un parent dont j'ignore l'existence souhaite m'appeler, je ne commettrai pas la maladresse de décrocher vu qu'aucune sonnerie ne m'aura signalé l'appel. Par voie de conséquence, cette personne, étrangère à toute réalité vraisemblable, n'aura pas le loisir de m'inviter à boire un verre ou de m'infliger une quelconque récrimination eu égard à mes horaires de fonctionnement. Ce fait n'ouvrant aucune contestation, je n'ai guère besoin d'approfondir tous les tenants de cette question.
Comme je ne sortirai probablement pas aujourd'hui - la logique sort une nouvelle fois victorieuse de son combat avec le chaos - je vais me promener dans l'appartement, de façon à libérer les forces vives qui sommeillent en moi. Je me sens particulièrement dynamique ce soir. J'aurais pu faire un footing ou du vélo si j'affectionnais ces activités. Mais j'abhorre le sport, vous comprenez… et je n'ai jamais acheté une bicyclette de toute ma vie. Même si j'en avais possédé une, l'obscurité étant inopinément tombée, je n'aurais probablement pas perpétré l'imprudence de l'enfourcher avec si peu de visibilité.
A moins d'être sous l'emprise d'un délire carabiné. Ce que personne, ici présent, n'est parvenu à confirmer ni même à insinuer.
La vie est vraiment mal conçue. C'est un euphémisme d'affirmer que, quel que soit son créateur, il fait preuve d'un manque évident d'application.
Demain, je ne ferai pas la même erreur : je n'attendrai pas que la nuit tombe pour être dynamique. Pourvu que je vive jusqu'à demain pour pouvoir rectifier ma funeste erreur.
Heureusement que je pense à tout, que j'excelle en termes d'organisation. A ce niveau, chaque détail compte et prend une importance considérable.
On manque étonnamment d'air dans cet appartement. J'ouvrirai la fenêtre de la cuisine dès que j'aurai l'occasion de m'y rendre.
Qui donc a eu l'idée saugrenue de refaire l'isolation ?! Le propriétaire probablement. Etant donné qu'il ne vit pas dans ses appartements, il ne peut pas prendre conscience de la difficulté à y respirer.
Tiens, me voilà déjà dans la cuisine. J'ouvrirai la fenêtre plus tard, la rue est encore trop bruyante. Si je l'ouvre maintenant, le brouhaha urbain affectera ma concentration et certains détails cruciaux risquent de m'échapper.
Ah, j'envie ceux qui habitent en campagne, ils peuvent se promener à l'envi et laisser les fenêtres ouvertes.
À quoi bon se promener si l'on est en mesure de laisser les fenêtres ouvertes ? Je ne comprendrai décidément jamais les campagnards !
Quelle forme je tiens ce soir ! Je vais me préparer un dernier café pour assouvir mon besoin de mouvement. Je l'aurais bien bu au bistrot en bas de chez moi, mais je risque de croiser des gens - pas des amis ou des collègues bien sûr, je ne suis pas fou - puis de discuter à bâtons rompus jusqu'à plus d'heure et donc de revenir tard à l'appartement, trop tard pour commencer à dîner. Non, restons ici et attendons patiemment que la faim afflue.
On ne s'en rend pas nécessairement compte, mais caler et enchaîner les diverses activités de la journée relève d'un art minutieux. Avec l'expérience, on apprend à ne rien laisser au hasard, on acquiert indubitablement de l'expérience. Le seul inconvénient de l'apprentissage empirique de la sagesse est la raréfaction de la survenue de surprises. Si j'étais sûr que n'adviennent que de bonnes surprises, j'organiserais moins ma vie. Mais comment en être sûr ?
C'est inouï, je suis tout bouillonnant. J'ai l'impression d'être une aspirine plongée dans un verre d'eau. Mon cœur bat à cent à l'heure. C'est passablement curieux pour quelqu'un qui est allongé dans son lit et ne produit aucun effort. Pourquoi ne parviens-je donc pas à dormir ?!
Et cet air qui est saturé, brumeux, partout ! Sans cet air omniprésent, je dormirais déjà, à n'en pas douter.
Peut-être ai-je bu trop de café. Mais qu'aurais-je fait si je n'avais pas bu autant de café ? Je me serais ennuyé à coup sûr. J'aurais perdu ma contenance, lézardé mon charisme et n'aurais pas osé sortir pour le coup.
Certes, je ne suis pas sorti. Quelles en sont les raisons légitimes, à votre avis ?
Inutile d'attendre une réponse, tout le monde doit dormir à cette heure-là. Ou alors, on se complait à m'éviter. Gougnafiers, va !
Il est heureux que je fume également, sinon la journée serait triste et longue. Quoiqu'une journée de 24 heures ne peut pas être plus longue qu'une autre journée de 24 heures.
Enfin, je ne suis pas un spécialiste de la journée. Certains illuminés oseraient probablement soutenir le contraire.
Il est inconcevable que je tourne ainsi dans mon lit toute la nuit. Je finirai bien par m'endormir, par me soumettre au cycle ordinaire.
Pas sûr : hier, je n'ai pas pu fermer l’œil de la nuit. Certes, j'avais bu beaucoup de café, me semble-t-il.
Je pourrais me lever et sortir, prendre un peu l'air. L'air insaturé, il va de soi. Je ne croiserais aucun congénère à cette heure-là.
Non, c'est trop dangereux de sortir la nuit, je pourrais tomber nez à nez avec des voyous. Quoique les voyous soient aussi des personnes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas écrit, bande de sournois !
Je vais plutôt fumer une cigarette sur le balcon et savourer ainsi la douceur nocturne estivale.
Il fait trop frais, rentrons. Retournons au lit terminer cette délectable cigarette.
Ah, quel réconfort d'être allongé ! On n'est pas assez allongé dans la vie.
D'un autre côté, si je ne parviens pas à m'endormir, cette position va vite m'exaspérer. Peut-être devrais-je me lever. Mais pour quoi faire ? Je n'ai pas encore fini ma cigarette, je ne vois pas l'intérêt d'en allumer une seconde pour m'occuper. J'ai l'amère impression d'avoir le cul entre deux chaises.
Tout en étant allongé.
On ne distingue plus rien dans cette chambre. L'air est obscur, enfumé et omniprésent. Rallumons la lumière pour cesser d' être assailli par cette noirceur lancinante.
Pourvu que l'aube pointe rapidement, à cette heure, le sommeil viendra naturellement.
Ça m'agace de penser sans cesse. Et l'aube qui ne vient pas, c'est bizarre. Si je me fie à mon ressenti, il devrait déjà être 10 heures du matin. Il doit y avoir un dysfonctionnement quelconque au niveau de la mise à l'heure des horloges. J’appellerai la mairie après avoir dormi. Merde, je serai contraint de rebrancher le téléphone… au risque ensuite d'être dérangé par des importuns et de perdre le fil limpide de mes pensées.
Écrivons un peu pour passer le temps. Ça m'évitera peut-être de penser. Que pourrais-je bien écrire ? Nulle idée originale ne s'impose à moi. Et même si, par chance, il m'en venait une, je n'ai pas le talent littéraire pour la mettre en mots, le style nécessaire pour la ciseler, la polir, la dévoyer. Je n'écrirais qu'à mon endroit, en quelque sorte. C'est assez déprimant comme perspective. Lire un texte que j'ai moi-même écrit ne présente aucune valeur. Quel égotisme, de surcroît.
Tiens, c'est déjà le matin.
Enfin.
Je ne suis pas particulièrement fatigué. Juste un peu las. Que vais-je donc bien pouvoir faire aujourd'hui ? En premier lieu, rebrancher le téléphone. Quoique le décalage horaire semble s'être résorbé. Quelqu'un d'autre que moi a dû appeler la mairie. Hé hé, je vous ai encore pigeonnés en beauté, résidus de fiente !
Ainsi, je n'ai pas besoin de rebrancher le téléphone. Cette nouvelle serait délicieusement électrisante si je n'étais si soudainement imbibé d'aboulie.
Allez, Trico, lève-toi, un peu de courage !
Cyrille Godefroy, L'Errance intérieure, 2015
Holistic Strata
(deux images et une vidéo)
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Courtesy of Yamaguchi Center for Arts and Media [YCAM]
Photo: Ryuichi Maruo (YCAM)


Pour savoir qui est Hiroaki Umeda ("Hiroaki Umeda is a choreographer and a multidisciplinary artist now recognized as one of the leading figures of the Japanese avant-garde art scene...) vous pouvez vous rendre sur son site (voir nos liens), lire la suite de sa biographie, vous tenir au courant de son travail, vous étonner, admirer.
Nous le remercions d'avoir bien voulu nous prêter quelques images de Holistic Strata, images en mouvement (ci-dessous) et images arrêtées (ci-dessus).

danseur et chorégraphe
En grand
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
Le lundi matin.
Le lundi matin je me lèverais à 06h45. Par habitude. Par habitude de quand nous nous levions ensemble. Je me lèverais. Irais pisser. Me regarderais dans le miroir. Ne me regarderais plus dans le miroir. J'irais dans la cuisine. Mettrais de l'eau à bouillir. Une cuillère de café soluble, une pomme, une cigarette. J'entendrais le souffle de la ventilation dans la cuisine. Je boirais ce café. Je boirais un autre café et fumerais une autre cigarette. J'entendrais le souffle de la ventilation dans la cuisine. J'irais aux toilettes. Je me laverais. Mettrais un jean un tee shirt.
Je ne sortirais pas. Le lundi j'aurais ma journée à tuer. Je me mettrais sur le canapé, armée d'une pince à épiler. Je scruterais chaque poil sous la peau et gratterais. Mon entre-jambe et mes tibias n'auraient jamais été autant marqués de points rouges. Je fumerais une autre cigarette, je serais calme et voilée. Le temps s'écoulerait au rythme des nappes de fumée que je cracherais. Il n'y aurait aucun bruit. À part le râle de la ville mais au loin seulement. Il serait midi je ferais un autre café- cigarette.
Je regarderais par la fenêtre. Je regarderais longtemps par la fenêtre. Et la ventilation toujours là. Je n'aurais rien à penser. Ensuite je traînerais vers le canapé. Je regarderais mes ongles. Je regarderais longtemps mes ongles. J'en rongerais quelques uns surement. Je m'arracherais aussi la peau autour. Je reprendrais la pince à épiler et continuerais la traque aux bosses. Ensuite je voudrais surement regarder un film. Je n'aurais pas d'idée précise. J'en mettrais un. Je ne le suivrais pas. Je ne comprendrais rien aux mots articulés. Ça ferait un fond sonore.
Avec un peu de chance ce serait la fin de l'après midi. J'attendrais alors le soir. Je regarderais mon téléphone. Il serait vide. Il ne sonnerait pas. Il n'aurait pas sonné. Je continuerais à attendre. Debout dans le couloir. Dans le jour baissant. Le cendrier déborderait et l'air serait saturée. J'aurais faim mais ne le remarquerais pas. La nuit serait très avancée.
Je me mettrais dans le lit et fumerais une cigarette par habitude. Par habitude de quand nous nous couchions ensemble. Je fermerais les yeux. Je répéterais dans ma tête une succession de s'il vous plaît. Je mettrais du temps à trouver le sommeil. Je m'endormirais.
Et la gorge serrée de cafard me ferait mal déglutir. Des fourmis dans tout le corps. Je me dirais que mon corps est un nid à microbes et qu'il serait bon de le passer au désinfectant. Parfois peut-être j’espérerais trouver une chemise à lui oubliée sous le matelas. Et je me verrais danser avec dans le salon teinté de lumière absente de la nuit qui tombe. Et je parlerais à son voile de restes. Et j'irais virevoltant dans la salle de bains pour regarder son souvenir qui se rase dans le miroir. Je lui donnerais sa serviette je continuerais ma danse autour de mon imagination de lui, assis sur le tapis et mes brûlures au ventre s'engourdiraient de tendresse et passeraient parce que tout irait faussement mieux, ne t'en fais pas. Ou si peu . Les yeux dans les yeux. À lui dire comment c'est longs les jours, comment c'est creux les jours sans lui, comment c'est difficile et lourd un corps à porter, des larmes tout le temps à ravaler, des envies de hurler à taire, des envies de casser à contrôler. Et.
Le mardi matin.
Le mardi matin je me lèverais à 06h45. Par habitude. Par habitude de quand nous nous levions ensemble. Je me lèverais. Irais pisser. Me regarderais dans le miroir. Ne me regarderais plus dans le miroir. J'irais dans la cuisine. Mettrais de l'eau à bouillir. Une cuillère de café soluble, une pomme, une cigarette. J'entendrais le souffle de la ventilation dans la cuisine. Je boirais ce café. Je boirais un autre café et fumerais une autre cigarette. J'entendrais le souffle de la ventilation dans la cuisine. J'irais aux toilettes. Je me laverais. Mettrais un jean un tee shirt.
Je laisserais un post-it pour le cas où il passerait. Je mettrais mon tabac dans mon sac. Mes chaussures au pied, prendrais les clés, le badge de l'entrée. J'enlèverais le post-it et le jetterais à la poubelle. J'ouvrirais la porte, fermerais la porte, descendrais les escaliers. Mes pas résonneraient dans l'escalier. Je sortirais dans la rue. Le soleil commencerait déjà et encore à me bruler les yeux. Les voitures seraient bruyantes et trop nombreuses. Je marcherais dix minutes. Mes jambes seraient lourdes à soulever. Je sentirais les muscles de mes cuisses se tendre et se détendre au rythme de mes enjambées. Je serais arrivée à mon travail. Il serait entre 08h40 et 08h50.
Je prendrais un café à la machine. Je ne discuterais pas avec les gens. Ou alors de loin. Je commencerais à voir la danse lente de l'arrivée du personnel. Je me mettrais dans la salle de travail et recouvrirais des livres, des bouchons dans les oreilles. Mes gestes seraient mécaniques et un poil trop lents.
La journée
s'écoulerait fade et lointaine. Distante et sale. Parfois j'attendrais longtemps l'ascenseur. Mon regard se bloquerait sur les lignes verticales et mécaniques de la structure en métal vitré du bâtiment. La sonnerie de l'ascenseur me rappellerait à l'ordre. J'appuierais sur -1. Les étages défileraient. Mes pas seraient mesurés et mécaniques. Mes mots rares et faibles. Mes sourires tirés. Le midi je ne prendrais pas de pause. Je regarderais de temps en temps mon téléphone. Vide téléphone.
Pendant ma pause je recouvrirais encore et toujours toutes sortes de documents. D'un papier lisse et transparent. Il serait souple, toujours. Et aucune bulle d'air ne viendrait écorcher la surface. Objet épilé au toucher. Douce joue en plastique que je caresse les yeux fermés. Et la journée continuerait, animal sauvage et tapi dans un coin. Animal fragile, apeuré dans une tanière en feu de bois. 17h sortie du travail. Je traverserais le pont. Mon corps lourd sur mes jambes lourdes. Je ne regarderais pas les voitures et traverserais. Comme ça. J'arriverais en bas de mon immeuble. Sortirais le badge et prendrais l'ascenseur. L'ascenseur arriverait au huitième étage. J'ouvrirais la porte de l'appartement. L'appartement serait silencieux et immobile. Il ne me chuchoterait aucun secret, aucune visite passé pendant mon absence. Je fumerais une cigarette, boirais un café, irais me laver les mains, irais aux toilettes. Je sortirais de la salle de bains et me mettrais droite sur le canapé. Je regarderais le vide laissé par ses affaires. Longtemps, je regarderais le vide. Les instruments partis auraient laissés des traces au sol. Ses livres enlevés auraient laissés des traces aux étagères. Ses chemises retirées auraient laissées des traces aux cintres. Son corps absent du lit aurait laissé un creux à mon corps endormi.
Le jour déclinerait vite. Je prendrais un livre pour me donner de la contenance mais mon cerveau aurait du mal à articuler les lettres dans ma tête. Je fermerais le livre et observerais les ombres sur le mur. La petite lampe du salon recouvrirait les parois murales d'ombres bienveillantes/malveillantes. Les plis du rideau recouvriraient le reste du rideau d'ombres malveillantes/bienveillantes. L'appartement serait sombre mais immobile. Je respirerais doucement. La nuit continuerait d'avancer.
Je me mettrais dans le lit et fumerais une cigarette par habitude. Par habitude de quand nous nous couchions ensemble. Je fermerais les yeux. Je répéterais dans ma tête une succession de s'il vous plaît. Je mettrais du temps à trouver le sommeil. Je m'endormirais.
Prise d'un élan boulimique et frénétique de restes de lui, je courrais sur la pointe des pieds, petits pas de rongeur nocturne jusqu'à la salle de bains pour fouiner et scruter des poils de lui sur le sol peut-être encore. Détective des heures sans sommeil, je récolterais en bouquet des épluchures de peaux, d'os et de cheveux pour en faire un petit autel sur le rebord de la baignoire. À reconstituer un bout de doigt, à reconstituer une mèche de cheveux, à reconstituer un morceau de peau. C'est alors que la structure de son corps à découper prendrait forme dans la structure de mon esprit lavé de lui. Je le regarderais et me souviendrais des plis de sa peau au coin de ses lèvres. Je reniflerais ses aisselles et lui soufflerais des promesses tenues. Je lui dirais ma journée et combien c'est difficile un silence de mur le soir en rentrant. Comment dans ces cas là je voudrais travailler toute la journée et le nuit durant. Pour ne pas ressentir son vide. Et lui dire que parfois je m'improvise marabout pour lire dans le marc du café sa présence quelque part dans l'ailleurs que je ne sais pas.
Le mercredi matin.
Le mercredi matin je me lèverais à 06h45. Par habitude. Par habitude de quand nous nous levions ensemble. Je me lèverais. Irais pisser. Me regarderais dans le miroir. Ne me regarderais plus dans le miroir. J'irais dans la cuisine. Mettrais de l'eau à bouillir. Une cuillère de café soluble, une pomme, une cigarette. J'entendrais le souffle de la ventilation dans la cuisine. Je boirais ce café. Je boirais un autre café et fumerais une autre cigarette. J'entendrais le souffle de la ventilation dans la cuisine. J'irais aux toilettes. Je me laverais. Mettrais un jean un tee shirt.
Mercredi, jour d'enfants en bas âge à qui raconter des histoires pour croire à des jolies fins. Alors avant de partir je mettrais mon masque de menteuse. Je me colorerais les paupières de gris anthracite et un peu de vert canard. Du mascara pour des cils à toucher les plafonds hauts. Et la poudre partout, de la poudre beaucoup, pour rendre ma peau uniforme, inexpressive et hermétique. Pour prendre les visages que je souhaite. Je sortirais de la salle de bains, éteindrais la lumière, mettrais mes chaussures à talons, prendrais mes clés. Et claquerais la porte. Je descendrais les escaliers et mes pas résonneraient dans tout l'immeuble. J'arriverais au deuxième étage, me rendrais compte que je n'ai pas fermé à clé. Me dirais qu'il n'y a rien d'important dedans. Continuerais la descente. Et arriverais dans la rue. Je me concentrerais pour étendre mes jambes et avoir une démarche naturelle. Le pont serait ma piste d'entrainement. Je plierais, tendrais, lancerais, poserais la jambe. Je plierais, tendrais, lancerais, poserais l'autre jambe. J'attendrais au feu, je traverserais la route. Deux fois.
J'arriverais à mon travail. Badge. Ascenseur. Quatrième étage. Salle de travail.
Collègue café. 10h moins 10. Je descendrais dans la partie jeunesse. Prendrais un chariot. Mettrais des livres dessus. Rangerais le chariot. Le temps s'écoulerait. Je clignerais des yeux et ferais des appels de fards à paupières. L'heure du conte approcherait. L'heure du conte commencerait. Les gamins seraient là. Brouhaha de cris aigus et de remarques inintéressantes qui couvrirait mon brouhaha interne et inapproprié. Je leur expliquerais que nous sommes mercredi. Que je n'aime pas le mercredi. Mais que parce que nous sommes mercredi, ils auraient droit à une histoire. Je prendrais un livre, je l'ouvrirais et lancerais ma voix contre les murs. Ma voix éraillée et creuse tenterait de couvrir et d'envelopper toutes les petites têtes blondes. Je me jetterais dans les histoires et pleurerais quand il faudrait pleurer, rirais quand il faudrait rire et crierais quand il faudrait crier. Je ferais ça, passable. Ça fonctionnerait. L'heure du conte serait finie, les enfants partiraient. Je me frotterais les yeux et effacerais mon maquillage. Je descendrais de mes chaussures. Toute la journée je resterais sans chaussure. Loin de mon piédestal factice. Personne ne me dirait rien. Je passerais ma journée non-aimée à plat, à chercher, à creuser avec le talon, sous chacun de mes pas, à tour de rôle, le sol armé du grand bâtiment hostile. Les deux dernières heures de la journée seraient longues. Mais ce ne serait pas grave. Je passerais mon temps à m'occuper l'esprit par l'ordre alphabétique des romans mal classés. Les lumières s'éteindraient, je voudrais rester, je n'aurais pas fini. Mais il faudrait rentrer mademoiselle dans votre appartement minable et vide. Alors d'un pas encore une fois lourd et absent, je mettrais un autre pas devant un autre pas, mes chaussures à la main. À l'extérieur, les gens se moqueraient je crois. À l'extérieur, je serais un pantin désarticulé qui aurait fini sa danse matinale et trop brève. J'aurais mis une 30 minutes à rentrer pour un trajet qui n'en compte que dix. Je serais contente, j'aurais bien tué le temps. Il serait presque 20 heures. Je finirais ma cigarette et boirais du coca. J'irais me laver les mains et irais aux toilettes. Je sortirais de la salle de bains et me mettrais droite sur le canapé. Là, je me dirais que c'est un soir à oublier, que c'est un soir à être saoule. J'ouvrirais une bière pour moi, j'ouvrirais une bière pour lui. Je trinquerais et boirais la première gorgée. Finalement, j'irais me mettre dans la cuisine. Sur la chaise blanche. À la table blanche. Ici, ça me paraîtrait moins grand. Ici, parfois je regarderais mon reflet que je ne connaîtrais plus dans la vitre du micro onde, dont je ne me servirais plus. Avec la première bière j'aurais tué trente minutes. Je prendrais la sienne qu'il n'aurait pas touché. Je la trouverais meilleure. Parce que ce serait la sienne. Parce que pourtant moins fraîche et moins de bulle. Je ne saurais pas pourquoi mais je penserais au trajet pour aller à la gare de chez mes parents. Avec le terrain de tennis désaffecté et la route bordée de peupliers.
Ensuite, je regarderais la ville qui se coucherait. Par la fenêtre, je verrais des écrans de télévision qui s'animeraient dans des appartements loin en face. Je regarderais le calme de la ville, le loin de la ville, l'absence de la ville. J'entendrais peut-être des chiens au loin. J'aurais fini la deuxième bière. J'en ouvrirais une troisième. Mais ça ne me ferait rien. L'alcool depuis, ne me ferait rien. Parce que mon cerveau se serait endormi, parce que mes sens se seraient endormis, parce que mon euphorie se serait endormi. Je me chercherais dans le reflet de la table blanche. Je ne verrais rien. Peut-être serait-elle trop sale. Je prendrais une éponge, du produit et frotterais. Frotterais encore. Frotterais encore. Jusqu'à en avoir chaud. Jusqu'à en avoir des gouttes de sueur sur le front et sous les bras. Et ce ne serait plus la table que je décaperais mais ma peau. Que je voudrais retrouver vierge. Que je voudrais connaître lisse. Ce serait toute cette période et cette personne que je voudrais gommer pour ne plus avoir à faire face. Parce que je n'y arriverais pas, parce que ce serait douloureux. Mais la table ne pourrait pas être plus blanche que blanche. Et la peinture resterait. Et cette histoire resterait et les pellicules de ma peau resteraient toujours là. En palimpseste. Et je serais vraiment fatiguée. Depuis longtemps. Et je me mettrais sur la chaise blanche. Et je me roulerais une cigarette. Et je m'endormirais le front dans mon coude, la cigarette qui se consumerait, qui ne se consumerait pas sur le bord du cendrier. En vrac. Comme saoule malgré tout. Comme presque saoule malgré tout. Sans rite. Sans rien. Je tomberais de fatigue le front dans mon coude, la cigarette qui se consumerait, qui ne se consumerait pas sur le bord du cendrier.
Le jeudi matin.
Le jeudi matin je me lèverais à 06h45. Par habitude. Par habitude de quand nous nous levions ensemble. Je me lèverais. Irais pisser. Me regarderais dans le miroir. Ne me regarderais plus dans le miroir. J'irais dans la cuisine. Mettrais de l'eau à bouillir. Une cuillère de café soluble, une pomme, une cigarette. J'entendrais le souffle de la ventilation dans la cuisine. Je boirais ce café. Je boirais un autre café et fumerais une autre cigarette. J'entendrais le souffle de la ventilation dans la cuisine. J'irais aux toilettes. Je me laverais. Mettrais un jean un tee shirt.
Jeudi, journée qui démarrerait tard. Alors, surement je prendrais le temps de me changer et d'essayer d'autres vêtements. Sans jamais en être convaincue. Je ferais traîner les minutes au fil des tee-shirts qui s'entasseraient sur le dessus de la machine à laver. Je me rendrais compte que le temps est déjà au retard. Je me changerais une dernière fois pour remettre ma panoplie de premier choix. Je ne serais pas convaincue. Je me trouverais bouffie. La journée commencerait mal. Je descendrais vite les escaliers en courant. Marcherais vite et traverserais les routes n'importe comment. J'arriverais à mon travail essoufflée pour me rendre compte que les gens ont pris encore plus le temps, eux, ce matin. J'irais sur la terrasse fumer une cigarette. Les gens commenceraient à arriver. Vite, je m'éclipserais dans la salle de travail. Je ferais un choix de livres simples à couvrir. Des albums, des documentaires, des romans et des contes. J'en feuilletterais certains. Mais pas tous. Ça m'ennuierait. Et puis la matinée coulerait au fil des illustrations pour enfants. Il serait 11h30. J'irais au rez de chaussée pour récupérer d'autres livres à trier. Je reprendrais l'ascenseur et retournerais dans la salle. Mes collègues proposeraient un repas toutes ensemble. Je prétexterais une occupation prévue depuis longtemps. Je retournerais chez moi pour une heure et demi. Je la passerais à fumer, à boire du café, à souffler, à boire du coca, à aller aux toilettes, à m'épiler les sourcils, à fumer. Je retournerais au travail et malgré moi ferais le compte à rebours dans ma tête jusqu'à 19h. Cette journée me pèserait. Mais comme le fait de rentrer, d'ailleurs. Je ne saurais pas ce que j'attendrais alors j'aurais le ventre noué. Je voudrais être quelqu'un d'autre. Je voudrais être ailleurs. Je voudrais être quelqu'un d'autre ailleurs. Je voudrais croire que cette brûlure blanche passerait un jour ou l'autre. Je voudrais croire que je pourrais repartir à zéro. Je voudrais croire en la spontanéité, la nouveauté, la surprise. Au lieu de ça, je serais un poisson cru dans un bocal creux rempli d'eau plate.
La journée de travail serait finie. 19h. Je sortirais du bâtiment. Des collègues dehors discuteraient ensemble et lanceraient un appel pour aller boire un verre quelque part. Je ferais comme si je n'entendais rien. Je rentrerais, la tête dans les épaules, le regard posé sur rien, je rentrerais les mains bourrées dans mes poches, les pieds traînants et les lacets mal fait. Je n'arriverais pas à me souvenir de quelle culotte je porterais. Je serais en bas de l'immeuble. Deux hommes se disputeraient et feraient mine d'avoir envie de se battre. J'ouvrirais la porte d'entrée. Et monterais les escaliers, vite, à pieds pour ne pas attendre l'ascenseur, pour ne pas être tentée d'aller moi aussi participer à la bagarre, pour ne pas avoir envie d'aller voir ce que ça fait un couteau dans la chair, pour ne pas être traversée par des pulsions de leur exploser le crâne sur le bitume.
Les huit étages m'essouffleraient et me brûleraient les cuisses. J'arriverais chez moi. Ouvrirais la porte. Et m'assoirais par terre dans le couloir d'entrée. Le dos appuyé au mur.
Début de la soirée chez moi. Je serais donc assise par terre dans le couloir d'entrée. Le dos appuyé au mur. J'aurais des vagues d'énervement venues de je ne sais où. Je me concentrerais sur ma respiration. À expirer fort. Toutes les toxines de mes nerfs. Les mettre hors de moi. Je ne sais pas pourquoi j'aurais les poings très serrés et mes ongles rentreraient dans ma chair. Je me projetterais des images mentales de choses lisses et plates. Des plaines. Enneigées les plaines. Je m'imaginerais un vent léger dessus. Et les traces du vent sur la neige. Comme une mer figée. Je décrisperais une main. Je décrisperais l'autre main. Soudain j'entendrais le bruit de la télévision de la voisine. J'irais dans la salle de bains, j'entendrais mieux. Je collerais mon oreille aux carreaux froids. J'entendrais le magma de paroles rapides et inarticulées. Et des buzz de jeux à réponses rapides. Je retournerais dans la cuisine prendre une bière et mon tabac. Je me remettrais à mon poste de voyeur des oreilles. Je passerais la soirée comme ça. Petit à petit je me décollerais du carrelage et resterais appuyée contre le mur froid. Recroquevillée dans la baignoire. Je ne comprendrais rien à ces murmures réconfortants. Paroles uniques et rares qui me chanteraient une berceuse en secret. Juste pour moi. Les basses de l'émission qui passeraient me caresseraient l'échine. Je me dirais peut-être qu'il y a un message codé là dessous. Peut-être. Il tenterait peut-être de me parler à travers le mur. Il me verrait peut-être à travers le mur. Je m'imaginerais mon amour coincé entre les parois des deux murs des appartements voisins. Je me l'imaginerais, sa joue collée, à ma joue collée. Le mur nous séparant. Il me dirait quelque chose. De ne pas m'en faire. Et d'être patiente. Que ce n'est qu'un temps. Un moment à attendre. Il me dirait peut-être aussi qu'il m'aime encore. Il me dirait peut-être aussi qu'il ne m'aime plus. Ou peut-être rien. Peut-être que ce ne serait qu'une télévision réglée trop forte par une voisine trop sourde. Et peut-être que je serais trop fatiguée pour être claire et distincte dans mes pensées. Alors surement, dans ce cas-là j'irais me mettre au lit.
Je me mettrais dans le lit et fumerais une cigarette par habitude. Par habitude de quand nous nous couchions ensemble. Je fermerais les yeux. Je répéterais dans ma tête une succession de s'il vous plaît. Je mettrais du temps à trouver le sommeil. Je m'endormirais.
Dans le creux de la nuit sa voix caverneuse viendrait crépiter et cramoisir dans le cartilages de mes oreilles. En cadence et inaccessible, je ne le comprendrais pas encore. D'abord, je ne le comprendrais pas. Je décalerais ma tête du coussin pour singer que je dors encore. Et encore.
J'ouvrirais les yeux mi clos, pour le découvrir assis et penché au dessus de moi. Ses chuchotements inarticulés me conteraient de jouer le jeu. Jusqu'au bout. Sans rien transparaître. Sans rien exprimer. Et de tenir le compte. Des jours, des mots, des mois, des monstres. Les cadavres seraient suspendus dans cet espace temps hors des horloges. Et moi, frémissante, je ne respirerais pas. Juste je sentirais son souffle dans le creux de mon oreille. Et me concentrerais sur les règles à suivre, sur les conduites à adopter. Souveraine des codes à respecter, mes yeux, contenairs d'une vision à faire le deuil, je me concentrerais, je me concentrerais il dirait. Et sa voix caverneuse se ferait plus lointaine. Et sa présence animale se ferait plus légère. Jusqu'à ce que tout disparaisse. Les yeux ouverts, je ne verrais plus rien. Je me rendormirais.
Le vendredi matin.
Le vendredi matin je me lèverais à 06h45. Par habitude. Par habitude de quand nous nous levions ensemble. Je me lèverais. Irais pisser. Me regarderais dans le miroir. Ne me regarderais plus dans le miroir. J'irais dans la cuisine. Mettrais de l'eau à bouillir. Une cuillère de café soluble, une pomme, une cigarette. J'entendrais le souffle de la ventilation dans la cuisine. Je boirais ce café. Je boirais un autre café et fumerais une autre cigarette. J'entendrais le souffle de la ventilation dans la cuisine. J'irais aux toilettes. Je me laverais. Mettrais un jean un tee shirt.
Dernier jour d'une semaine de travail de plus à ajouter au compteur. Presque la fête dans ma tête. Sans trop savoir pourquoi. Stupidité des impressions collectives. Pour l'occasion je mettrais du rouge à lèvres. Et un foulard coloré. Je sortirais de chez moi avec un semblant de sourire. Sans trop savoir pourquoi. Stupidité des impressions collectives. L'ascenseur descendrait les huit étages. Arrivée dans le hall d'entrée, je me regarderais dans la glace. Rangerais mon pseudo sourire, effacerais ma peinture buccale et joviale et mettrais mon foulard dans la boîte aux lettres. En sachant très bien pourquoi. Parce que rien ne dure. Parce que rien ne tient. Parce que rien ne résiste au trajet de l'ascenseur. Parce que rien ne résiste à la chute de l'ascenseur qui m'aspire et me garde toujours les tentatives de sentiments bienpensants.
Du coup, je sortirais de l'immeuble comme chaque jour, depuis un long moment déjà. Comme chaque jour, je ferais le même trajet avec mon même air. Comme chaque jour j'aurais mon badge d'entrée dans la poche gauche. Je rentrerais dans le bâtiment de mon travail. Attendrais un autre ascenseur. Et comme chaque jour rejoindrais le quatrième étage. Je regarderais mon planning et aussi celui des autres jours insipides à venir, de la semaine à venir. À ajouter au compteur.
Mes vendredis actuels me sembleraient toujours plus courts que ceux d'avant. Lorsque je terminais à 19h et passais mon temps à compter les heures, une par une, qui me séparaient de mon amour. Me dire que mon week-end avec lui serait entravé de cette partie de soirée trop avancée. Et maintenant, toujours ce sentiment d'attente de la fin de la journée mais avec la raison en moins. Stupidité des impressions collectives.
J'errerais et découlerais dans ce vendredi en faisant mes gestes toujours mécaniques et en ne sachant pas pourquoi j'aurais cette hâte de fin. Stupidité des impressions collectives.
Il serait déjà midi. Je resterais boire un café et plusieurs à mon travail. Pour profiter de l'odeur des lieux, pour le garder en mémoire tout ce long week-end d'hibernation à le passer avec moi et ma gueule. La pause du midi serait passée.
Nous serions déjà le début d'après-midi et j'aurais l'angoisse dans le ventre. Je rendrais mes gestes encore plus lents et suspendus. Histoire de rendre le temps plus étiré. Et mes mots se désarticuleraient et se rendraient pâteux. On me comprendrait mal. On me demanderait si ça irait, j'aurais l'air fatiguée.
Les larmes aux yeux, la gorge serrée, je dirais que j'aimerais être ici et voir des étagères en abondance de livres à découvrir. Sans l'envie de les lire. Il ne resterait plus qu'une heure. Je resterais à ranger des livres et à mettre tout en ordre. Comme un devoir de quitter des lieux propres et serrés pour lorsque j'y reviendrais. Comme si le lieu était à moi. Et comme si j'en étais l'unique salarié. En oubliant que des gens finissent plus tard, que des gens y travaillent le week-end. 17h, je serais libre. Bon week-end on me dirait. Et face au soulagement qu'auront les gens d'enfin retrouver leur proches, ce serait un bouleversement dans mon intérieur d'enfin ne retrouver personne. D'abord je resterais plusieurs minutes debout, les bras le long du corps, comme ça sur le pont. À juste être abasourdie par ce grand vide de trois jours qui s'offrirait à moi. Tout ce temps à tuer. À s'y jeter dedans, lui rentrer dedans la tête la première. Et puis le soleil dans la gueule m'éblouirais. J'aurais chaud. Il faudrait que je change d'espace. Je marcherais. Tout droit. Dépasserais mon appartement et marcherais encore. Tout droit. Les gens me sembleraient euphoriques et hâtés d'aller quelque part. Je marcherais et entendrais mes pas résonner dans le squelette de mon crâne. Et je serais dans un désert urbain parsemé d'éléments mobiles qui me dépasseraient et passeraient à côté de moi. Je continuerais toujours à marcher tout droit. Devant des boutiques, devant des grands magasins, sur des routes en travaux, sur des rues piétonnes, sur des rues bondées, sur des trottoirs étroits. Je traverserais le fleuve.
Le jour commencerait à décliner. Il ferait plus frais. Ce serait bien. Je commencerais à avoir mal aux pieds, enfin les pieds chaufferaient plutôt. Je trouverais un banc.
M'assoirais, fumerais une cigarette. Je regarderais la fraise de la cigarette rougir. Les cendres s'envoleraient. Certaines tomberaient sur mon jean. Je fermerais les yeux et me concentrerais sur l'air qui effleurerait mes joues. De l'eau tiède pourrait baigner sur ma tête. Je serais ensevelie dans des nappes aquatiques et chaleureuses. Mon corps serait lourd. Mes mouvements suspendus et si j'avais les cheveux longs, ils flotteraient autour de moi. Au lieu de ça, je serais plate et attirée par le sol, les cheveux courts collés au crâne et ma cigarette finie. Je me lèverais du banc en dépliant mes genoux. Je tournerais sur ma gauche. Ferais le tour du banc. Et reprendrais le chemin inverse. Trajet de retour que je connaîtrais par cœur. Chemin inverse qui me ramènerait jusqu'à chez moi. Chemin inverse qui me renseignerait sur le temps écoulé par la fermeture des commerces. Les gens ne me dépasseraient plus. Ils seraient assis à la terrasse de cafés et par grappe. Ils ne me verraient plus ne me verraient pas, ne me connaîtraient plus ne me connaîtraient pas. Et moi je ne les envierais plus ne les envierais pas, ne me mettrais plus à leur place ne me mettrais pas à leur place, ne me demanderais plus comment ils font ne me demanderais pas comment ils font pour être comme ça. Je me serais fait comme à l'idée. Je ne me sentirais pas concernée. Et ce passé de moi me serait devenu étranger. Je serais dans une période, dans un pan de mon âge qui serait creux et vierge. Devant des boutiques, devant des grands magasins, sur des routes en travaux, sur des rues piétonnes, sur des rues bondées, sur des trottoirs étroits, je rentrerais chez moi. Mon regard au fil de mes pas lisserait les joues de chacun. Je rentrerais chez moi. Mon regard au fil de mes pas, effleurerait les allures de chacun. Je rentrerais chez moi. Mon regard au fil de mes pas, entendrait des bribes de mots de chacun. Je serais arrivée chez moi. J'ouvrirais la porte de l'immeuble avec mon badge. Taperais le code de l'étage dans l'ascenseur. Arriverais au huitième étage et entrerais dans mon appartement. La nuit serait enfin arrivée. Je mettrais deux lumières dans le salon, une dans le couloir, une dans la cuisine et une autre dans la chambre. Comme si d'autres personnes occupaient les lieux. Pour tromper la solitude. La soirée du vendredi soir pourrait commencer. Je me demanderais quoi faire.
Je n'aurais rien à faire, rien envie de faire. Aucun projet à terminer. Aucun projet à commencer. Aucune idée d'envie de quoi que ce soit. Du blanc dans ma tête. Alors je m'installerais, les jambes en tailleur sur le canapé. Non, les jambes devant moi posées par terre. Je regarderais le mur blanc en face. Je me roulerais deux cigarettes. Me servirais un verre de coca. Retournerais me mettre sur le canapé. Droite donc. Face au mur, une cigarette allumée. Je regarderais les ondulations qui se détacheraient de la partie incandescente de la cigarette allumée. Je regarderais les plis du papier à tabac et le tabac à travers cette transparence de la cigarette allumée. Je me demanderais si j'aurais à nouveau le courage de me brûler la peau du bras avec la partie incandescente de la cigarette allumée. Je me demanderais ce que ça ferait si je tirais pour la première fois une bouffée de la partie incandescente de la cigarette allumée. Est ce que je tousserais à cause de la fumée de la partie incandescente de la cigarette allumée. Est ce que ma gorge se serrerait à cause du goût de la fumée de la partie incandescente de la cigarette allumée. Je me demanderais si un jour je ne fumerais plus. Si un jour je serais gênée, écœurée par l'odeur de la fumée de la partie incandescente de la cigarette allumée. Ma cigarette serait finie, je l'écraserais dans le cendrier.
Il me resterait la deuxième cigarette en attente. Posée sur la table. À voir pour plus tard. J'irais aux toilettes. Tirerais la chasse. Allumerais la petite lumière au dessus du miroir du lavabo. Je m'observerais. Je compterais mes rides au coin des yeux. Me rappellerais l'apparition de chacune d'entre elles. Je mettrais autour de chaque index une feuille de papier toilette et partirais à la traque aux points noirs. Je me ferais des petites marques rouges sur le visage. Mais qui partiraient vite. J’aérerais ma peau de toute sa mauvaise humeur accumulée ces derniers temps. Ensuite je prendrais la pince à épiler et redessinerais mes sourcils.
À ce moment, il me manquerait. Énormément et à fond. J'aurais vraiment du mal ce soir là je crois. Je ne saurais pas vraiment pourquoi.
Alors je me replongerais dans les particules de sébum superficielles à éliminer des pores de ma peau. J'aurais réussi à tirer une bonne heure comme ça. Je ne voudrais pas savoir l'heure qu'il est, pour me détacher du compte immense qu'il y a d'ici à la reprise du travail. J'attendrais juste que la fatigue arrive pour m'endormir vite.
Je regarderais de très près mes yeux et leur intérieur opaque. Je les fermerais. Et tenterais de me rappeler les siens. Ils seraient toujours présents dans mes souvenirs. Par contre l'emplacement exacts de certains grains de beauté seraient flous. Le motif précis de certaines chemises aussi.
J'éteindrais la petit lumière, puis la grande lumière de la salle de bains. Irais m'allonger en culotte et débardeur sur le lit. Les bras le long du corps. Je fermerais les yeux et respirerais par le ventre. Pour me détendre. Pour faire venir le sommeil plus tôt. Ça viendrait, oui je sentirais que ça viendrait. Alors effort dernier.
Je me mettrais dans le lit et fumerais une cigarette par habitude. Par habitude de quand nous nous couchions ensemble. Je fermerais les yeux. Je répéterais dans ma tête une succession de s'il vous plaît. Je mettrais du temps à trouver le sommeil. Je m'endormirais.
Un réveil nocturne me ferait déplier mes genoux et m'extraire du lit. Je ne serais plus là s'il vous plait, c'est long écourtez le temps. Rendez moi absente et endormie. Je me gratterais la joue et sentirais qu'aucune partie de mon corps n'a été touchée depuis longtemps. Et j'ouvrirais la fenêtre et regarderais les voitures passer pour attendre la sienne. Ce soir il rentrera. Et au loin, enfin, après des heures à scruter dans la nuit, les voitures allumées, je verrais la sienne.
Petite, qui se faufile entre les rues et cherche une place. Je lui ferais signe qu'il y en a une juste en bas de l'immeuble. Que je la lui garde du regard depuis longtemps déjà. Il ferait un créneau facile et délié. Alors je courrais devant la porte d'entrée et compterais jusqu'à 23. L'ascenseur ne ferait aucun bruit. Je retournerais voir par la fenêtre, s'il est toujours dans sa voiture. La voiture serait vide et éteinte. Il aura dû rentrer dans l'immeuble pendant ce temps. J'écouterais à travers la porte. Je n'entendrais rien. Je recompterais jusqu'à 23. Rien. Il devrait regarder le courrier. À 10, j'entendrais l'ascenseur. 10 il ne se passerait rien. Je lui chuchoterais de prendre l'escalier, l'ascenseur devrait être en panne.
Par communication mentale, il me dirait d'accord. Il y aurait huit étages. Pour chaque étage, je compterais jusqu'à 15.
Huit fois. Lentement. En mettant des Mississippi entre. À la fin du compte. Je me dirais que j'aurais dû compter jusqu'à 20 plutôt. Alors je rajouterais 5, huit fois. Calmement. Même si mon cœur palpiterait, même si j'aurais envie de courir pieds nus et de lui sauter dans les bras dans la cage d'escalier. Il devrait être là. Je n'entendrais rien. Ou si, peut être son souffle léger à travers la porte. Il ne devrait pas oser rentrer. Je regarderais par le judas. Personne. Il devrait être accroupi et l'oreille collée à la porte pour écouter le bruit que je ne ferais pas. Alors moi aussi je m'assoirais par terre contre la porte et lui poserais une liste de questions et lui dirais que chez moi c'est chez lui. Que je me ferais petite, que nous pourrions dormir séparément s'il préfère, que je ne ferais pas de bruit. Que je ne demanderais plus jamais rien. Juste le voir et savoir qu'il est ici. Qu'il est de retour. Et mes murmures se feraient de plus en plus légers, et mes mots de plus en plus confus et mes pensées de plus en plus floues. Personne en retour. Et je ne saurais plus où je voudrais en venir. Personne en retour. Et mes yeux se fermeraient et ma tête deviendrait lourde et s'affaisserait entre mes épaules. Personne en retour. Je dormirais en attendant son choix.
Le samedi matin.
Je n'aurais pas d'habitude de levé le samedi matin alors je me lèverais comme ça. Ce serait tôt j'imagine. Je serais assise contre la porte d'entrée. J'ouvrirais les yeux sur la fenêtre en face. Le jour ne serait pas vraiment levé. J'aurais froid en culotte sur le sol. J'aurais des courbatures dans mon cou. Je contemplerais longtemps le ciel matinal. Mes jambes seraient froides. À côté de moi, il y aurait toujours le tabac de la veille et le cendrier au sol.
Alors je fumerais une cigarette. Je me demanderais comment ce passera cet énième week-end à ne rien faire. J'aurais peut-être un peu peur mais sans plus. J'aurais peut-être fait un mauvais rêve je crois. Une désagréable impression me resterait en tête. Pour sortir du brouillard, je ferais bouillir de l'eau froide dans la bouilloire blanche. J'attendrais debout en regardant la bouilloire blanche et en entendant le bruit de l'eau frémissante. J'arrêterais la bouilloire blanche. Je mettrais une cuillère de café soluble dans la tasse blanche, remuerais avec la cuillère. Je m'assoirais sur la chaise blanche. Face à la table blanche. Je boirais par petites gorgées mon café trop chaud. La première tasse serait finie. Je fumerais ma cigarette restée sur le cendrier. Je regarderais le cendrier. Longtemps je le regarderais. Et je me demanderais. Il sort d'où ton cendrier.
Aujourd'hui je ne sortirais pas.
Le samedi j'aurais ma journée à tuer.
Je me mettrais sur le canapé, armée d'une pince à épiler. Je scruterais chaque poil sous la peau et gratterais. Mon entre-jambe et mes tibias n'auraient jamais été autant marqués de points rouges. Je fumerais une autre cigarette, je serais calme et voilée. Le temps s'écoulerait au rythme des nappes de fumée que je cracherais. Il n'y aurait aucun bruit. À part le râle de la ville mais au loin seulement. Il serait midi je ferais un autre café-cigarette. Je regarderais par la fenêtre. Je regarderais longtemps par la fenêtre. Et la ventilation toujours là. Je n'aurais rien à penser.
Ensuite je traînerais vers le canapé. Je regarderais mes ongles. Je regarderais longtemps mes ongles. J'en rongerais quelques uns surement. Je m'arracherais aussi la peau autour. Je reprendrais la pince à épiler et continuerais la traque aux bosses. Ensuite je voudrais surement regarder un film. Je n'aurais pas d'idée précise. J'en mettrais un. Je ne le suivrais pas. Je ne comprendrais rien aux mots articulés. Ça ferait un fond sonore.
Avec un peu de chance ce serait la fin de l'après midi. J'attendrais alors le soir. Je regarderais mon téléphone. Il serait vide. Il ne sonnerait pas. Il n'aurait pas sonné. Je continuerais à attendre. Debout dans le couloir. Dans le jour baissant. Le cendrier déborderait et l'air serait saturée. J'aurais faim mais ne le remarquerais pas. La nuit serait très avancée.
Je me mettrais dans le lit et fumerais une cigarette par habitude. Par habitude de quand nous nous couchions ensemble. Je fermerais les yeux. Je répéterais dans ma tête une succession de s'il vous plaît. Je mettrais du temps à trouver le sommeil. Je m'endormirais.
Nuit blanche. Nuit vide. Nuit absente. Pas là. Pas présente. Nuit sans intérêt. Rien à rapporter. Rien à signaler.
Le dimanche matin.
Le dimanche matin je me lèverais à 06h45. Par habitude. Par habitude de quand nous nous levions ensemble. De quand je mettais le réveil à sonner pour le travail la semaine. Je me lèverais. Irais pisser. Me regarderais dans le miroir. Ne me regarderais plus dans le miroir. J'irais dans la cuisine. Mettrais de l'eau à bouillir. Une cuillère de café soluble, une pomme, une cigarette. J'entendrais le souffle de la ventilation dans la cuisine. Je boirais ce café. Je boirais un autre café et fumerais une autre cigarette. J'entendrais le souffle de la ventilation dans la cuisine. J'irais aux toilettes. Je me laverais. Mettrais un jean un tee shirt.
Je ne sortirais pas. Le dimanche j'aurais ma journée à tuer. Je me mettrais sur le canapé, armée d'une pince à épiler. Je scruterais chaque poil sous la peau et gratterais. Mon entre-jambe et mes tibias n'auraient jamais été autant marqués de points rouges. Je fumerais une autre cigarette, je serais calme et voilée. Le temps s'écoulerait au rythme des nappes de fumée que je cracherais. Il n'y aurait aucun bruit. À part le râle de la ville mais au loin seulement. Il serait midi je ferais un autre cafécigarette.
Je regarderais par la fenêtre. Je regarderais longtemps par la fenêtre. Et la ventilation toujours là. Je n'aurais rien à penser. Ensuite je traînerais vers le canapé. Je regarderais mes ongles.
Je regarderais longtemps mes ongles. J'en rongerais quelques uns surement. Je m'arracherais aussi la peau autour. Je reprendrais la pince à épiler et continuerais la traque aux bosses. Ensuite je voudrais surement regarder un film. Je n'aurais pas d'idée précise. J'en mettrais un. Je ne le suivrais pas. Je ne comprendrais rien aux mots articulés. Ça ferait un fond sonore.
Avec un peu de chance ce serait la fin de l'après midi. J'attendrais alors le soir. Je regarderais mon téléphone. Il serait vide. Il ne sonnerait pas. Il n'aurait pas sonné. Je continuerais à attendre. Debout dans le couloir. Dans le jour baissant. Le cendrier déborderait et l'air serait saturée. J'aurais faim mais ne le remarquerais pas. La nuit serait très avancée.
Je me mettrais dans le lit et fumerais une cigarette par habitude. Par habitude de quand nous nous couchions ensemble. Je fermerais les yeux. Je répéterais dans ma tête une succession de s'il vous plaît. Je mettrais du temps à trouver le sommeil. Je m'endormirais.
Saut à suivre de toute une semaine en panne à venir très cher. Ce serait déjà ça. La pluie laverait la ville de toute cette merde. Ce serait déjà ça. La pluie laverait la ville de toute ma pollution cutanée. Je sentirais les jours à venir difficiles. Je sentirais les jours arsenaux. Ce serait déjà ça. Au moins ce serait déjà ça. Dans son lit de ronces mortes, il devrait douter et se demander surement. Regardez dehors. Dans mon lit de fil dentaire, j'enchaînerais les rages de dents. Regardez dehors. Ça sentirait le souffre. Regardez dehors, ça sentirait les interdictions parentales. Ce serait déjà ça. Autour d'un café, l'urgence diabolique et somatique des mots non dits pourraient tourner au vinaigre. Vous le saurez. Vous le verrez. Mais vous ne direz rien. Alors tout le monde courraient à grand pas. Dehors ça se poursuivrait mais à peine. Ce serait déjà ça. Dehors ça se poursuivrait à grand pas. Et encore la pluie laverait la ville de toutes les inquiétudes vaines. Et toujours la pluie lave et laverait de toutes les perturbations dominicales.
Le lundi matin.
Le lundi matin je me lèverais à 06h45. Par habitude. Par habitude de quand nous nous levions ensemble. Je me lèverais. Irais pisser. Me regarderais dans le miroir. Ne me regarderais plus dans le miroir. J'irais dans la cuisine. Mettrais de l'eau à bouillir. Une cuillère de café soluble, une pomme, une cigarette. J'entendrais le souffle de la ventilation dans la cuisine. Je boirais ce café. Je boirais un autre café et fumerais une autre cigarette. J'entendrais le souffle de la ventilation dans la cuisine. J'irais aux toilettes. Je me laverais. Mettrais un jean un tee shirt.
C. Von Corda,
En grand 2014
inédit pour Le Lampadaire ©
En grand 2014
inédit pour Le Lampadaire ©
Compter les heures
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
(14)
Départ
Je suis bien ici, comme je suis bien ; je suis seule, Germaine n’est plus là. Le totem l’a emportée, et je la vois encagée là-haut, suspendue dans les airs. Elle fait des grands gestes. Elle crie tout bas. Des sons inarticulés lui restent coincés dans le gosier. Je fais semblant de ne pas m’en apercevoir. N’gono tõgolo ne veut pas la laisser parler. Ni da, ni ka fyele. Tous ses organes de la parole se sont ligués contre elle, révoltés. Ceux du haut du corps, ceux du bas du corps, plus rien dans la vessie pour assouplir son discours, ni les poumons n’aèrent ses mots, ni les intestins ne veulent provoquer de leur mouvement incessant le vent de l’âme. L’air ne circule plus chez elle. Asséchée. J’ai mon lexique des mots du corps, je sais comment ça marche. Je sais le parcours de la parole. J’ai appris – que croit-on que je fais ici. Je commence à l’enseigner à l’oiseau-esprit-de-la-grue, le pur esprit de la grue : il sait dire sono bara la vessie, dogo yoro organes cachés les sexuels, nuguw intestins, komo kiliw reins, fugovugo poumons, tye foie, ka fyele trachée, n’gono tõgolo gosier, da bouche. L’oiseau les connait par cœur, parce qu’il doit se fabriquer ses propres organes de la parole s’il veut parler, alors il se répète les mots magiques, jusqu’à ce que la chose arrive. Jusqu’à ce qu’il se crée un intérieur. C’est à lui de faire, moi je lui ai fait son extérieur, sa beauté féroce.
Germaine fait le guet là-haut. Le guet de la gourde qui incarne l’attente. C’est son tour. Qu’elle regarde et qu’elle me prévienne quand quelque chose arrivera ! Qu’elle fasse enfin son travail cette fausse cousine qui n’est pas ma sœur. Je suis à moi seule Marie et Anne. Peut-être lui mettront-ils un grand voile pour la protéger du soleil. Et de la pluie. Elle va cuire là-haut. Ou se noyer. L’air, l’eau, le feu explosent dans sa douleur. Sans mots. Tant pis pour elle, qu’ils se débrouillent avec elle. Seules digɛ déesse de la nuit et aga de l’aurore lui seront bénéfiques, elle les attendra toute la journée et regrettera leur départ. Qu’elle cherche les signes annonciateurs, le nuage de poussière formé par le galop des chevaux de ses frères sauveurs, de son oncle, de ses cousins, la boule bleue ou rouge du nuage porteur de la peste et du choléra, porteur de toutes les maladies du monde ; la boule rouge ou bleue du nuage porteur de la masse compacte de tout ce qui est, dans le monde entier, inaudible. Qu’elle regarde le monde rougeoyer à travers ses yeux brûlés par le soleil, inondés par la pluie. Qu’elle écoute, qu’elle cherche à entendre. Qu’elle attende et qu’elle souffre.
Elle est punie. Je l’ai vue parler à l’homme aux chiffons. Il l’a emmenée, il l’a gardée pour lui, et maintenant je suis seule.
Enfin.
Que vont faire les oiseaux ? Je leur ai promis d’aller les voir, mais je ne veux plus y aller maintenant qu’il y a Germaine et l’homme. Il faut qu’ils se débarrassent de l’homme, au moins de l’homme, alors j’irai.
Barnabé ne viendra pas. Il m’a abandonnée. Qu’elle regarde s’il arrive. Je l’attends. Il n’arrivera pas à se débarrasser de moi comme il l’a fait de ses autres femmes. Je suis partie, je l’ai laissé sur la lagune ; il s’est enfui et m’a enfouie dans le sable. Qu’il vienne me chercher ici.
Je n’ai rien à attendre.
Ici j’ai retrouvé ma dignité. Je suis moi.
Emme = Emme
emme ça veut dire moi, ça veut dire mon, ça désigne tout ce qui est de moi, je peux dire emme quand je veux dire je. Tout peut rentrer dans ce mot qui m’entoure comme un cercle magique tracé autour de moi, autour de emme.
Que emme trace autour de emme.
Emme est mon nom, mon nom dogon, en dedans et en dehors
de emme enfermement
Signé Emme
L’amour est une dure réalité où tous les moyens sont bons pour l’obtenir
mais pas emme, pas pour emme, elle s’en fiche.
L’homme va-t-il tomber de sa grue. Que font les oiseaux ? ils tardent trop. Je dois partir.
Loin de la Loire ; où la retrouver ?
Amoenus, Almus, Fecundus, Piscosus, Declivis, Praeceps, Citus, Concilus, Prosperans, Rapidus, Tumidus, Effusus, Exudans, Vagus, Arenosus.
E.
L’homme caché dans ses chiffons, est-ce Barnabé ? Je n’ai reconnu ni ses yeux, ni sa voix. Il s’est déguisé. Pourquoi a-t-il pris Germaine alors ?
Il agit sans connaissance de cause. C’est moi qu’il devait venir chercher. Les oiseaux doivent me venger. Que font les oiseaux ? Ils ne me parlent plus ?
E.
aga,
lo̜llogo̜ro lawalo̜gū bo̜y
oiseau, ô, salut
l’oiseau aux écailles de bois est prêt
n’guma à parler seule lui apprendrait
n’guma la parole secrète à moi apprendre
ye no̜n emme̜ g’imbere̜ sagyã bo̜y
ta voix j’entends
malgré mes dépends
mon costume est prêt
awa vidyu dyu marie-emme awa vidyu túnuyo bo̜y
malgré mes dépends
no̜n bire̜ na yonugu na
parole bonne est-ce ? mauvaise est-ce ?
na
mon matériel est prêt,
digɛnaï,
j’ai fini toutes mes inscriptions sur les murs des maisons,
une boîte dans mon stylet et ma réserve de sable mural j’ai mis
mon papier de recouverte me suis
n’écrirai plus jamais sur l’ordinateur, fini cyberespace, proscrits, indésirables,
au nez je leur ris, il y a d’où se tordre de rire, tordons
digɛ,
du papié j’ai assez
et le faire je sais
j’ai assé
lɛdonsdudéserjéasséavɛc
m’en allé je peux
je m’en vɛ
n tagara
digɛ
aga
digɛ
Sophie Saulnier,
«Compter les heures»©
extrait d'un récit long, 2015
«Compter les heures»©
extrait d'un récit long, 2015
La brodeuse et les perruches
COLLECTION DES CURIOSITÉS
Si les hommes n'avaient pas cette manie de s'attacher depuis toujours, elle ne serait pas là à attendre. Elle n'aurait pas besoin de perruches pour lui tenir compagnie, ni de fils colorés. Si les hommes n'avaient pas cette manie de s'attacher tout en refusant l'attachement.
Cette idée des perruches pour être moins seule, elle l'avait eue en lisant, comme elle avait eu l'idée de broder pour l'attendre. Il y a tant de bonnes idées à prendre dans les livres quand on en manque, quand on ne sait plus comment remplir le temps. Elle avait relu l'histoire de Félicité, la servante à la vie mécanique, la paysanne dévouée, ignare, mystique, celle qui perd tous ceux qu'elle ose aimer, celle dont la vie est peuplée de taureaux, de colombes, et qui meurt auprès de son cher perroquet empaillé. Félicité parfois malheureuse, parfois indifférente, verso de Pénélope. Elle avait relu et elle s'était dit que oui, les perroquets, les perruches, ça irait bien avec le point de croix.
Elle avait beaucoup réfléchi à tout ça. Au problème d'attendre un homme qui bouge et qui ne bouge pas, qui revient et qui n'arrive jamais, à la solitude des brodeuses. Elle s'était dit qu'il lui fallait un animal de compagnie. Mais lequel ? Pas un qu'il faut caresser, ni un chien, ni un chat. Un poisson ou un oiseau. Mais quand même les poissons sont idiots, muets, béats, et un aquarium, les parois de verre d'un aquarium, ces limites répétitivement marquées par le parcours stupide et identique, et, pire parfois, circulaire, de ses habitants, limites malgré la transparence qui ne trompe pas l'oeil, le contraire de l'horizon, de l'infini, du dieu puissant au trident, l'aquarium, non, décidément, elle ne pouvait s'y résoudre. Il lui fallait un oiseau. Oiseau en cage et oiseau sédentaire. Prisonnier. Douloureux. Image d'elle figée par l'homme qui ne vient jamais. Image de lui qui veut le retour, ne veut pas le retour, approche, s'éloigne, avance et repart.
Elle était allée à l'animalerie. Elle avait laissé ses fils de couleur, ses cotons, et, un après-midi, elle était sortie chercher son oiseau. Le soleil, par les persiennes, striait joliment le parquet et l'appartement était rayé d'ombres et de lumières, en algorithme. Ça faisait bien sentir le silence, l'épaisseur du silence, la chaleur. Elle avait quitté son ancienne solitude, claqué la porte, tourné les clés. Sa tête était pleine de perruches, de futures amies avec qui échanger, de lectures accumulées, articles, conseils pour comprendre leur communication complexe, battements d'ailes et modulations sophistiquées de leurs cris, langage croisé du corps et de la voix, parfois simultanément. Elle traversa la rue, sourire aux lèvres, pensées pour lui au bout du monde, lui qu'elle attendrait le temps qu'il faudrait, elle n'avait plus peur maintenant, elle ne serait plus tout à fait abandonnée. Elle aurait sa perruche qu'elle cajolerait. Sa perruche, pour la remercier d'être là, compagne patiente de broderie, elle lui offrirait des os de seiche immaculés, purs, brillants de blancheur. Ça ferait un peu penser à la mer, à lui sur son bateau. C'était exaltant cette question de l'os de seiche, de son blanchiment. Ça occupait l'esprit : le bouillir ? ne pas le bouillir ? simplement le brosser sous l'eau du robinet puis le laisser se déprendre de son humidité sur le rebord de la fenêtre ? Elle avait lu des conseils contradictoires sur le sujet, elle était devenue experte, et toutes ces recherches, ça l'avait apaisée. Détachée de la littérature, éloignée de lui. La saison des seiches, les régions où l'on en trouve, plages où elles viennent s'échouer, mortes, et laisser leur squelette. Elle avait rêvé de beaux rêves d'os, d'hiver, de Morbihan
Un couple de perruches nymphomanes, voilà ce qu'elle avait maintenant. Elle devenait sourde à force de boucan, du tapage rythmé des battements d'ailes pendant l'accouplement, des sifflements frénétiques d'orgasme. Elle avait la douloureuse sensation d'être un peu l'os de seiche rongé. Derrière son comptoir encombré de lapins et souris et cochons d'inde, il l'avait tout de suite prévenue, le vendeur. Péremptoire. Les perruches ne supportent pas d'être seules, seules elles se laissent mourir, il faut au moins prendre un couple. Il y a de ces hasards, la vie est tellement ironique parfois, on a l'impression de voir le type là-haut, le créateur barbu, se tordre de rire. Vlan. Prends-toi ça dans la figure, Pénéfélicité, Félicilope, tu voulais te faire un joli reflet animal, perruche aux plumes vertes et brillantes, ondulées on les appelle, seule comme toi, avec qui converser, parler de lui infiniment, de l'homme attendu, et il avait fallu accepter de prendre un couple qui baise toute la sainte journée. Parce qu'elle n'avait pas osé dire non au vendeur, évidemment. Elle avait été faible. Une femme qui se perd à attendre un homme, qui se projette dans cette attente pour dix ans au moins, une incapable de dire non au moindre vendeur qui a un tout petit peu de science sur les mœurs des « psittacidae » (nom latin copié du grec, même pas du grec pur), c'est pas une digne représentante du sexe faible ? Hein ?
Et maintenant elle se disait :
« Ma vie est perdue.
J'habite avec un couple de perruches, avec deux oiseaux obsédés et popote, si je leur ouvrais la cage, ils ne partiraient même pas. Je brode des nappes et des napperons, les motifs sont de plus en plus compliqués, puis je les repasse et les range, bien pliés, dans l'armoire de la chambre. Je cherche le silence en moi. La concentration qu'il me faut pour la broderie me fait trouver le silence. J'oublie ainsi les cris et les bruits d'ailes, mon mâle sur ma femelle, vert plumage et front ondulé de noir, cire bleue intense du bec hurlant. Quand c'est trop de bruit, que la recherche du point parfaitement exécuté ne suffit plus à entrer en moi-même, à descendre assez loin pour m'exclure du vacarme, je cherche à atteindre, de mon aiguille levée, le plus vite possible, du mouvement le plus sûr, la lueur qui perce la persienne rabattue. C'est un jeu exigeant, qui demande une attention absolue, lever l'avant-bras d'un geste vif et rapide, attraper le soleil du premier coup. Lorsque je trouve le degré d'application qui me permet, plusieurs fois de suite, de réussir ce défi, ça crée une toute petite étincelle en l'air, éclat sur la pointe de l'aiguille, et la paix se fait enfin en moi.
Tout disparaît.
Lui et les perruches. Les perruches et lui. Les perruches qui me rappellent à lui. À son absence, à mon corps intact et intouché, son corps intact et intouché car il est allongé par terre quelque part, prisonnier de ses liens. Ça dure un instant, brève détente, le temps d'un soupir de soulagement et puis tout repart, les livres qui tournent dans ma tête, les histoires qui circulent, si nous étions des perruches, des reines et rois séparés mais promis aux retrouvailles, si j'avais des prétendants pour me distraire, me rassurer. Mais non, c'est Félicité la gagnante, la servante seule et bête, qui ne comprend rien à rien et passe à côté de tout, attend quoi, on ne sait pas, dans un monde rempli de perroquets qui font l'amour. »
Agnès Jauffrès, La brodeuse et les perruches, 2015
court récit écrit pour le Lampadaire
court récit écrit pour le Lampadaire
Clandestins
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Fuir l’horreur, à travers d’autres horreurs.
Fuir la mort, à travers de multiples petites morts.
Destins tragiques de ceux/celles qui n’ont d’autre espoir qu’une mort en sursis face à une mort certaine.
Sans nom, tout au plus un visage et un corps qui luttent contre tout et tous- identité à jamais niée-, par l’argent payé pour rejoindre un mirage de survie.
Hommes/femmes/enfants à l’existence rayée du possible,
hommes/femmes/enfants à la peau noire ou bronze, au regard vide et pareillement absents.Où réside l’espoir quand tout se désagrège?
Il y a la nuit- partout, au-dessus dans le ciel dont on ne regarde plus ni étoiles ni soleil, en dessous dans la violence des flots qui secouent les viscères et l’âme, autour quand l’horizon se ferme sur une image de soi-même multipliée à l’infini par la douleur et la désespérance.
Il y a ce qu’on ne pensait jamais devoir vivre.
Ahmed, Leïla, Khaled, Youssef, qui d’autre encore dans la longue marche ?
Unis dans le déchirement – il faut s’arracher à un cocon affectif – village, famille- en oublier l’essence, en renier la langue et la culture. Il faut. Il faut un jour décider d’extirper de soi ce qui pouvait être amour, espoir et qui ne s’est révélé que haine, violence et malédiction.
Unis dans le harcèlement – Chercher/trouver l’argent, chercher/trouver la filière, chercher/trouver des bourreaux temporaires, on espère qu’ils le soient, Chercher/trouver la force au-delà des limites du possible.
Unis dans la peur – la peur, seul sentiment qu’on est encore en mesure d’éprouver, le moteur ultime avant, pendant, pour l’après on l’espère plus douce, difficilement on imagine son absence, cela tiendrait du miracle. La peur dans la faim, la soif, les remous menaçants des vagues, les gifles du vent qui transporte les embruns. La peur dans la violence des mains, des bouches et des sexes.
La peur dans sa plus cruelle extension.
Départ
Ne pas regarder derrière soi, surtout ne pas s’attacher à une forme, une couleur familière, une voix, surtout ne pas emporter ne serait-ce qu’un grain de ce que l’on quitte, surtout pas de souvenirs ; c’est le prix à payer pour rendre le départ possible et anesthésier un moment la douleur ; une fois qu’on sera déjà très loin, elle pourra resurgir si elle en a encore la force.
La longue marche
Ne pas penser au soleil de plomb qui déchire les yeux, qui alourdit les membres et rend les pieds sanglants ; ne pas penser à des lèvres éclatées, à une peau étouffée par la sueur et le sable ; ne pas penser qu’il n’y ait pas, à l’horizon, une source et quelques dattes ; ne pas penser à ces regards lascifs, arrogants, en tout menaçants.
Ne pas penser dans cette longue marche forcée.
La mer
C’est par l’odeur d’abord qu’elle paraît, une odeur singulière, l’odeur avant de voir le rivage. Un parfum humide et âpre après la stérilité sèche des déserts de dunes ou rocailles. – La mer –, pour la plupart jamais vue avant. La mer, enfin, pour certains jamais atteinte ; des corps perdus en route – sacrifiés à une utopie de liberté, des corps que blanchit la canicule, qu’ensevelit le vent.
Et la barque, juste un « quelque chose de plat, long et décoloré», se balançant doucement mais en équilibre précaire comme sur le point de vouloir déjà terminer sa course au fond des flots. Une barque qui n’a rien d’un bon présage.
La traversée
Et la marche continue, marche flottante que n’assure plus la prise des pieds sur un terrain solide, marche flottante dont on ne peut avoir le contrôle. Sensation extrême d’instabilité existentielle : que deviendra-t-on en proie à l’horizon ? Et intensification de l’angoisse, paradoxalement plus sentie qu’avant, car ici pont de fuite : la liquidité et le péril permanent ôtent forces et courage – la terreur règne dans le silence des voix, dans l’immobilité statuaire des corps. Le silence des voix qui n’ont plus rien à dire, le silence juste parfois lacéré par un sanglot isolé ou un cri de détresse. La violence qui n’épargne pas ceux-là mêmes qui voulaient la fuir ; le désespoir attise les ses des bourreaux, aiguise leurs armes pour s’acharner sur des êtres qui semblent ne plus rien avoir à perdre, des êtres qui ont déjà tout perdu d’eux-mêmes, alors que peut-on encore leur soustraire ?
La barque de la mort en sursis.
Un huis -clos suspendu entre la vie et la mort, entre le ciel et les abîmes, un huis-clos obscur, malodorant – insupportable – et par force supporté.
Quand on réussit encore à relever la tête, dans un ultime élan de dignité retrouvé, dans la trêve accordée par la mer ou les hommes, on regarde devant soi, l’horizon où l’on voudrait , comme les naufragés d’un voyage infernal, voir se délimiter une fine ligne sombre – Terre –.
Monika Madrigali
Clandestins, 2015
Clandestins, 2015
Tous les chiens sont bleus
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
[...] Dans ma voix, un cri.
Mais Haldol me retient. Il retient mes cris, mes murmures. Moi qui ai déjà caché de nombreux comprimés sous ma langue, aujourd’hui je les prends tous sans problème. Je ne sais pas si ça agit. Je sais seulement que mes deux amis me manquent. Rimbaud apparaît et me dit qu’il a le sida. Il veut faire un pacte de sang avec moi. J’accepte ce qu’il demande et je me coupe le pouce. Baudelaire apparaît et dit qu’il veut faire partie du pacte. Le seul fait de mourir d’autre chose que de la puce (ou du grillon) me rend déjà heureux. Mourir avec Rimbaud et Baudelaire. Mieux, impossible. Acouguêlê Banzaï !
Je suis déjà allé en Chine. Quand je le dis comme ça, on dirait que j’ai beaucoup voyagé. C’était un endroit très joli, plein de gens, de vélos et de nombreux nuages. Les nuages, nuages. Là-bas, j’ai eu faim, j’ai eu soif, j’étais étranger et j’ai follement aimé les nuages lointains, très lointains, les merveilleux nuages ! Dessins dans le ciel. Lorsque la journée est ainsi, un jour de soleil, un jour tel qu’il est, je ne veux plus sortir d’ici. Je vais dormir dans le calme vert d’un Lexotan six milligrammes. M’agripper à mon chien bleu et faire des pactes avec le bonheur. Me souvenir de la Chine, de ses bicyclettes, de son drapeau rouge couleur-de-sang et, surtout, des incroyables nuages du ciel chinois.
Je crois qu’après le pacte de sang tranquillisant, je serai plus heureux. Je veux mourir de n’importe quoi, sauf d’une puce que j’ai avalée. J’avale des médicaments. Un jour, j’en ai avalé trois. Un autre, quatre. Je ne sais pas vraiment ce que je dois faire pour me sentir mieux. Simplement parce que je suis un ptérodactyle dans une cage. Un corbeau qui picore le ventre d’un éventail. Un homme sans peur de la terreur que c’est de vivre sans peur. Never more, ici personne n’a peur. Y compris le procureur général de la République. Il me rappelle un personnage de western et de films de gangsters. Même sénile, il se sert d’une cuillère au lieu d’un couteau. Ici, il n’y a que des cuillères. Le procureur fait cette plaisanterie dangereuse qui consiste à parcourir tout le chemin entre les doigts avec un couteau, dans ce cas, une cuillère. Le vieux fait ça avec habileté, comme s’il s’y entraînait depuis longtemps. Pour s’amuser. Laisser les vents d’adrénaline souffler.
Rimbaud apparaît à l’heure où soufflent les vents. Ce sont des vents qui l’amènent et me font vivre enroulé dans son écharpe. Il fume des joints. Se désagrègent près de moi les volutes de fumée que Baudelaire tire de sa pipe. Il me dit qu’il est un père-de-saint. Il me dit qu’il a des pouvoirs. Il rénove mon langage. Je crois pieusement en lui. Rimbaud, c’est la tempête. Baudelaire, c’est le vent. L’un prend de l’éther. L’autre, de la cocaïne. Triste, je suis seulement celui qui découvre que les pilules colorées le font grossir et, chaque fois plus, m’éloignent de ces amis de longue date. Qu’est-ce que la vie sans amis ? Je suis comme Emmanuel Bove qui aimait secrètement les amis qu’il n’avait pas. Je suis l’ami de mes yeux. Ils voient seulement ce que je veux. Je regarde à travers mes lunettes colorées et je vois tout en noir et blanc. Tout ressemble à un film de Bergman. D’ailleurs, je ressemble un peu à Charles Laughton.
Pour peu de temps, j’espère. Pourquoi être gros et boire du café avec du sucre? Tout avec beaucoup de sucre. Je vois des montres et des tasses de café. Je crache des bulles de savon. Je deviens un train qui avance sans savoir où s’arrêter. Je me transforme en une machine qui écrit et elle écrit ce qu’elle veut que j’écrive. J’attaque voracement une fourmi et j’arrache peu à peu les poils de mes aisselles. Je fais une épilation. Je tire de moi des empreintes de pas. Frissons. Certitudes. Des choses que je devrais faire. Je tire de moi de féroces anguilles et je couvre mon abdomen de barbe à papa.
On est en juin.
On fête la Saint-Jean à l’asile.
La farandole des fous est bien alignée. Ceux qui ont pris du Gardenal ne parlent pas. D’autres prennent de l’Haldol. D’autres sont des drogués. D’autres sont fous d’eau-de-vie et jouent au billard. Personne ne veut entrer dans la file pour danser. Aucun psychotique ne veut danser. Aucun oligophrénique ne veut arrêter de donner des coups de tête dans le mur. Mais Rimbaud est content et danse sans tristesse. Il est, passez-moi l’expression, comme le couteau entre les dents. C’est un esprit tzigane, un esprit d’Indien. Esprit de porc. Épine. Lèpre. Sida. Silence de chaux et myrte, mauves dans herbes fines. Rimbaud brode des giroflées sur une toile jaune paille. Volent sur la lampe grise sept oiseaux du prisme. À travers les yeux de Rimbaud galopent deux chevaliers : Baudelaire et moi. Toutes les choses qui tuent passent par moi. Qu’est-ce que c’est ? Cocaïne ou éther ? Quel est ce nouveau son ? Des tambours. Je ne sais pas danser, je ne sais pas danser. C’est mon ami, un ami, enfin. Acouguêlê banzaï ! Je crache en l’air et j’ouvre un parapluie. Baudelaire parle en crachant. Je prends le parapluie pour me protéger. Postillons.
On m’a obligé à venir ici. Je ne voulais pas venir. Je ne veux pas rester, putain! Avertissez-les que je suis Charles Laughton, putain ! Ont-ils jamais vu un film? Ceux qui sont abandonnés auraient une meilleure vie hors de l’asile, même moi. Disons que je passe une saison en enfer, une saison dans la tête avec mes amis poètes et acteurs. Demain, je les aurai oubliés, mais ils reviennent après-demain. Je sais qu’ils ne vont jamais m’abandonner, les amis sont là pour ça, non ? L’éboueur de Comlurb m’invite à manger une boîte de biscuits Segredo. La vie est un secret pour moi. Je ne sais pas exactement ce qu’elle signifie. Dans le monde du dehors, je cherche tous les jours mon nom dans les avis de décès. C’est décidé : je ne veux pas aller à mon enterrement. Comment sera le ciel des objets ? Le ciel des montres, des télés, de l’ordinateur, du lance-pierre, de la fourchette, du couteau, des cuillères ? Ici, il n’y a que des cuillères : personne ne mange avec une four-chette et un couteau. Ils mangent la bouche ouverte, sauf Rappelle-Mamie. Rappelle-Mamie mange un peu comme ma mamie, elle est mince, douce, gentille. Et il y a aussi un détail très important : elle m’embrasse à chaque fois qu’elle passe devant moi. Je n’aime pas beaucoup les baisers. Rimbaud m’a déjà forcé à l’embrasser sur la bouche. Je lui ai déjà dit, ça ne sert à rien, je ne peux pas être ce que je ne suis pas.
Qui sait, Rimbaud, peut-être que Verlaine va se pointer et arranger ça.
Rodrigo de Souza Leão
extrait de Tous les chiens sont bleus.
Traduction du portugais (Brésil) Émilie Audigier, 2023, révision Le Lampadaire, Wagner Schwartz, Antoine Chareyre
extrait de Tous les chiens sont bleus.
Traduction du portugais (Brésil) Émilie Audigier, 2023, révision Le Lampadaire, Wagner Schwartz, Antoine Chareyre
Les croisements du docteur Rosa
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Au moment le plus inattendu de ma vie, alors que j’étais sur le point de succomber à une implacable solitude, je fus surpris par l’appel du médecin : « Viens ». La voix, au début un balbutiement hésitant, gagna peu à peu corps et envergure, se transformant en un courant d’ondes qui inonda mon sommeil. « Viens, viens ». Je me réveillai. Avais-je rêvé ? Je ne le croyais pas. Cela faisait très longtemps que je ne recevais pas d’appel, que je n’entendais pas de voix, que je ne servais plus à rien. Un monde peuplé de créatures rationnelles m’avait expulsé de l’essence des choses et avec le temps, je m’étais désenchanté : je m’étais replié dans le silence. Mais voici que la voix d’un médecin, d’un simple médecin, surgissait de la nuit, sûre d’elle-même, me réveillant, impérieuse, dense, me donnant presque un ordre. « Viens ». Je ne pouvais pas y croire. Mon nom, cette voix prononçait mon nom.
Je me levai, la lumière se fit, et c’est alors que je le vis. Il se tenait à un croisement, une mallette de cuir à la main. Son costume en lin blanc qui habillait son buste à la perfection, la cravate glissée entre les plis de son gilet, le chapeau en feutre incliné vers la gauche avec une fausse négligence et ses boutons de manchette luisant sur ses poignets, tout cela semblait converger vers l’armature aux branches épaisses qui soutenaient deux verres de vue. L’homme était arrivé à pied jusqu’à l’ancien point de rencontre, parcourant l’intérieur des Sentiers Morts. Un ciel piqueté d’étoiles recouvrait sa tête. S’il avait pu regarder au-delà, dans la direction de chacun des quatre points du quadrant, il aurait pu voir au nord un troupeau de chèvres, au sud deux chevaux noirs tachetés et, à l’est, un ruisseau cheminant entre des pierres imbibées de silence. À l’ouest, il aurait remarqué des pas allant dans sa direction. Mais le médecin n’avait pas encore vu, ni entendu mes pas. Il continuait à regarder le néant, à crier « Viens » dans l’obscurité, « Viens ». Quel beau tableau : la campagne, l’odeur nocturne de la rosée, cette voix qui déclame. Je fus saisi d’une sensation de bonheur indescriptible lorsqu’enfin je pus lui adresser la parole.
« Cela fait très longtemps que je n’ai pas eu le plaisir de parler à un homme, docteur Rosa. »
La voix se tait. Son regard oblique vers la gauche. L’armature et les verres fouillent les buritis au bord du ruisseau, cherchant l’origine de la salutation. Des chèvres ocre, couleur d’argile, noires prune, des chèvres aux cornes tordues s’approchent au trot silencieusement, rejoignant le médecin sans que celui-ci s’en rende compte. J’allume la lanterne et je la pose sur un morceau de bois découpé dans un arbre. Attirés par la lumière, les yeux du médecin rompent les limites des lunettes, s’aventurent dans le bosquet au bord de l’eau jusqu’à être éblouis par une sphère rouge qui brille et aveugle, mais dont la clarté diminue peu à peu. Je règle la lanterne. Je diminue la flamme, je la soulève au-dessus de la tête de l’homme, éclairant son corps de haut en bas, et tendant l’autre main vers lui.
Je sens sa paume lisse me serrer en tremblant, pendant que sa main gauche recule et comprime contre sa cuisse la mallette marron à cornières argentées. Mes yeux sont attirés par trois boucles qui réfléchissent sur le cuir de la malle la lueur de la lanterne derrière nous et dont la surface métallique, polie et couverte d’arabesques finement gravées, fait que je me perds toujours davantage dans les courbes sinueuses de ses lettres pointues. Explorant ces signes, m’arrêtant dans leurs courbes, je ne me rends pas compte que la silhouette blanche du médecin et sa main droite semblent reculer, refuser la rencontre, s’éloignant et se dissolvant dans l’espace. L’indignation palpite, court dans mes veines. Je tire l’homme comme une monture subjuguée par les rênes, le mors, et en le sentant à nouveau proche je sens son haleine embuer les verres de ses lunettes. Mais alors que je m’apprête à ébaucher mon sourire de triomphe et à me souvenir à haute voix du commandement donné aux anciens – «tu ne te parjuras point » -, un hennissement déchire les prés de part en part et un frémissement parcourt le bas de ma colonne vertébrale. Je lâche sa main; et nous regardons la route tous les deux.
Comment ai-je pu les oublier, les chevaux, les montures à la robe noire tachetée qui au petit trot viennent vers moi dans la poussière des pistes, harnachés et solennels ? Le pas égal, le dos et le poil luisant, ils s’approchent, quittent la route, descendent vers nous et s’arrêtent, un de chaque côté, enveloppés dans la vapeur qui sort de leurs naseaux. Leurs sabots martèlent la terre. La lune brille. J’échange un regard avec le médecin et presque en même temps, nous mettons les pieds à l’étrier et montons.
Lorsque la moisson est récoltée, dans les dernières semaines de juin, l’odeur de bois fraîchement coupé remplit la campagne. Éparpillées en cônes autour de nous, les termitières dorment. Les chariots à bœufs vides sont alignés sur le bord de la route. Et les empreintes de ceux qui nous précédèrent et posèrent les pieds ici des jours durant marquent la surface du sol comme des semailles d’hommes, d’enfants et de femmes.
C’était dimanche. Les chevaux marchaient au trot, évitant les flaques d’eau. Les palmes des buritis s’agitaient et semblaient prendre des formes humaines, pendant que le médecin, le corps balançant sur la selle où il était mal installé, me fixait du coin des yeux. Des points lumineux commençaient à s’éteindre dans le ciel qui acquérait progressivement des nuances colorées. Des points lumineux commençaient à apparaître au pied de la cordillère, de sorte que ma monture accéléra le pas en apercevant les premiers poteaux et rues du hameau.
Nous y faisons notre entrée. Les oreilles de mon cheval se dressent et se cambrent. Le rythme de ses fers trottant sur les pavés s’accélère et laisse place au galop, jusqu’au sommet de la colline, et lorsque je remarque les premiers contours du beffroi s’ébauchant sur la surface du matin, mon premier réflexe est de brider, retenir, tirer l’animal avec toute mon amertume et mon embarras. Mais mon cheval insiste, ignore mes forces. Il projette son cou en avant et n’interrompt sa fuite que devant une porte en pin sculpté, où viennent d’entrer deux têtes et corps grisonnants égrenant un chapelet.
La fumée de l’encensoir flotte vers le toit de l’église, comme si elle cherchait, entre les trous et les fissures de la voûte, une ouverture pour s’échapper. Bouches et bras s’alignent devant une silhouette pâle, et un à un les disques de blé glissent du calice dans la main, de la main dans les autres mains, puis de là, dans la salive et la mémoire, où ils se dissolvent. Caché sur un banc du fond, j’entends grincer la porte d’entrée. Je regarde derrière moi et je vois le médecin franchir le seuil, enlever son chapeau, s’agenouiller, tracer un carrefour sur sa poitrine et s’avancer vers moi.
Il s’installe et s’assied à ma droite, protégé par la mallette en cuir qu’il pose entre nos corps. Son visage s’absorbe dans la contemplation des figures furtives qui quittent leurs sièges pour former une file dans le couloir. Je sais qu’il ne tardera pas à se joindre à elles et si par négligence il abandonne la mallette marron, la plaçant sous ma garde, je saurai alors en mon for intérieur, que je pourrai l’ouvrir, examiner dans un rideau de secret les papiers qui s’y trouvent et vérifier les termes dans lesquels ils furent rédigés, établis et signés.
Le docteur se lève. La valise reste inclinée contre le bois, ses trois boucles me regardent fixement, me disséquant.
Et c’est alors que devant moi, parmi les bigotes qui se coudoyaient sur l’autel, une vieille aux sabots et à la mantille grise accueillit dans le réceptacle de ses mains le pain qui est également corps, mais avant de le mordre (car nous savions par devers nous, elle et moi, qu’elle le mordait à nouveau), elle fut parcourue de haut en bas par un tremblement qui la jeta contre le sol. Étendue par terre, la salive luisant à la commissure des lèvres, la femme trouva malgré tout des forces pour tordre son cou, pointer du doigt le fond de la galerie et planter ses deux yeux durs dans le banc qui me cachait. Innombrables furent alors les yeux qui suivirent les siens et se tournèrent dans ma direction à cet instant où je touchais presque la serviette : solide mur de regards denses, accusateurs, toujours plus proches, m’opprimant.
Sur la place en face de l’église, le matin se propage rapidement. Je cherche les montures, un bras m’attrape fermement par le coude, le médecin m’aide à marcher jusqu’aux animaux pendant qu’il protège la mallette dans l’autre main. Nous montons. Donnons un coup d’éperon. Nous poursuivons notre route.
À cette époque, des croyants ayant fui dans le désert campaient au bord du ruisseau, où un homme en costume les baptisait. Après avoir plongé leur corps à jeun dans l’eau, ils se séchaient les uns les autres et se serraient autour du feu, mâchant l’aumône qu’ils avaient recueillie. Les dos, les mains, les jambes et les têtes et les côtes isolés comme des pelotons dans une tranchée, les guenilles en guise de serviettes parfois et les bras recroquevillés : tout et tous apparaissaient plus nettement à mesure que nous descendions la colline, lui devant, moi à sa suite, moi et lui avançant au milieu des rafales d’air mortes et froides. Nous arrivons au ruisseau. Nous mettons pied à terre. Le docteur marche vers la rive, dessinant dans l’air un long salut avec son chapeau aux larges rabats.
Non, ils ne me permirent pas d’entrer dans l’eau. Ils ne me permirent pas d’avoir les pieds nus comme le médecin et comme lui de parcourir – déchirant et meurtrissant leur plante - le sentier de pierres escarpé qui donnerait sur la terre mouillée, et là de me reposer quelques secondes avant de toucher le liquide. Et ils ne voulurent pas non plus que mes orteils, après que j’eus pris ma respiration pour plonger, parcourent le lit en pente, creusant des sillons dans la matière froide, éveillant les poissons qui s’enfuiraient. Non. À moi, ils ne le permirent pas. L’homme au manteau de cuir attend en silence. Debout, à un point équidistant entre les rives, son tronc – comme un arbre enterré à la verticale aux branches nues tournées vers le haut – attend le moment où il recevra l’autre qui avance dans le courant. Les bras du baptiste s’ouvrent sur la lame d’eau, rappelant les anses d’une ancre. Le corps du médecin lutte contre les flots, coule, réapparaît entouré d’un banc de poissons, et la rivière le lave et l’accueille comme une antichambre où l’on abandonne impuretés et infirmités.
Et maintenant que la croupe du cheval du docteur oscille à nouveau devant moi et que nous continuons notre route, j’essaie d’imaginer le goût de sel déposé sur sa langue. J’essaie de me souvenir du visage de ceux qui se jetèrent, plongèrent, qui le soutinrent, ainsi que l’huile ointe sur leur front et le retour de celui-ci – limpide et triomphal – dans le monde et à la surface. Le jour est déjà haut. Nous commençons la montée de la colline, des montagnes en fleur. Le pas des animaux se fait plus lent et saccadé. Leurs sabots sonnent contre les pierres, et le bruit régulier de leur poitrine – comme de la mienne, la sienne ou même ta respiration que je sens maintenant – est tout ce qui me reste et marque le rythme de l’escalade. La piste est toujours plus escarpée. Je m’accroche aux rênes et au dos qui tremble et prend son impulsion entre mes jambes. Lorsque nous atteignons le sommet, nous nous arrêtons devant les parois de pierre qui plongent franches, indiscutables et infinies. À leurs pieds, cités et royaumes germent. Nous croyons les voir. Et peut-être les voyons-nous presque inaccessibles, invisibles. Nous regardons, et nos regards les recréent.
Je montre la vallée. Ma main droite, qui s’étend au-delà de moi et de nous, se pose sur le visage de ces rivières et plateaux, parcourt l’écheveau de rues et de toits, caresse des châteaux et des murailles épaisses qui protègent contre les peurs. Elle explore la silhouette de forteresses inexpugnables, ponctuées de regards qui veillent à l’intérieur des heaumes. Les hommes, les mondes ; leurs villes, tours et coupoles dorées : mon index les désigne. Le docteur les voit. Ou, comme moi, il les rêve seulement. Sa monture retourne le sol avec ses pattes arrière, cousant la trame d’une broderie sur la terre. Les sabots dessinent frénétiquement une, deux, des dizaines de croisements. Mes yeux suivent la valise. Au fond de la vallée, dans la ville la plus lointaine et protégée, une sentinelle contemple le sommet de la montagne, attentif à ce qui se passe ici sur ces pierres. Les trois boucles de la mallette en cuir brûlent sous le soleil. Le vent prend la montagne d’assaut. Le regard du médecin retombe sur moi, puis s’esquive, plonge sur la plaine gorgée de richesses et revient vers moi. Je cherche la mallette avec la main gauche. Il recule et la protège contre sa poitrine. Nos regards se croisent, s’évitent, se cherchent et s’entrecroisent. Je descends de cheval. Il m’imite. Le vent souffle l’ordre intimé aux anciens : « Tu ne te parjureras point. » Et c’est dans le sens contraire du vent – et de son plein gré – que le médecin marche à ma rencontre. Au moment le plus inattendu de ma vie, la valise m'est enfin offerte. Je brise les verrous. Je tends la liasse de papiers vers le soleil. Ils portent tous sa signature. Ils sont tous là, signés.
Nous descendons la montagne par des sentiers opposés. Les contours de la terre deviennent de plus en plus diffus, les crêtes des collines palissent, le plateau est garni d’épis de maïs, qui s’étendent jusqu’aux limites de l’horizon. Une cabane et une étable commencent à poindre. J’attache le cheval. Je jette mon manteau sur les tabourets de la cuisine et je commence à descendre l’escalier en colimaçon long et obscur. À mesure que les marches s’enfoncent plus avant, je feuillette l’ensemble de pages dactylographiées, prenant soin que la chaleur rouge de la lanterne ne se répande pas sur les documents. L’escalier fait des contorsions et se rétrécit avant d’arriver à ma chambre. Je ferme la porte, le kérosène s’assèche, et avec lui la flamme dans mes mains. Mais mes yeux ne tardent pas eux aussi à s’éteindre peu à peu et à reconnaître et à s’habituer à la nuit cloîtrée entre les murs.
Sans comprendre l’impulsion étrange qui me guide, je prends la première des feuilles de la liasse et la fixe soigneusement sur la pierre. Je fais deux pas en arrière, m’efforçant de la regarder dans la pénombre : on aurait dit un tableau ou un rectangle blanc sans cadre. Je réserve le même sort aux pages suivantes : alignées par rangées sur la surface du plafond et du sol, superposées par ordre numérique sur mes meubles, cimentées comme de fragiles carreaux en papier sur mes tableaux, statuettes, tapisseries. Les contours de la chambre disparaissent, recouverts par cette profusion de feuilles, certaines d’entre elles corrigées çà et là avec la vigueur d’un stylo à plume. Et c’est un peu avant de m’allonger définitivement sur mon lit que je me rends compte que je n'habite plus dans cette pièce, mais à l’intérieur, entre les lignes de ce texte que lui, le médecin, m'a confié au sommet de la montagne. Je m’aperçois que recouvert, blotti, enveloppé dans la couverture de ces pages, j’habite désormais leur être, leur noyau, les mots. Je m’allonge sur le lit. Je me tourne vers le coin et le mur. Je lis la première phrase :
Que nenni. Les coups de feu que vous avez entendus, ce n’était pas une querelle d’hommes, Dieu soit loué.
Avant de me couvrir définitivement la tête, je vois que les rayons de soleil filtrent à travers les feuilles que j’ai collées, et que, de papier qu’elles étaient, elles se sont transmuées en verre, en vitraux. Je dors en respirant cet air chargé de lumière.
Krishna Monteiro, "Les croisements du docteur Rosa",
Ce qui n'existe plus, 2015, Tordesilhas, São Paulo.
Traduction du portugais (Brésil) pour Le Lampadaire, Stephen Chao, 2015.
Ce qui n'existe plus, 2015, Tordesilhas, São Paulo.
Traduction du portugais (Brésil) pour Le Lampadaire, Stephen Chao, 2015.
Le diable
le transporta encore
sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire,
et lui dit:
« Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. »
Matthieu 4-8
le transporta encore
sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire,
et lui dit:
« Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. »
Matthieu 4-8
De l’identitarisme
ou
Les Palmes Académiques du Mutisme
littéraire en Amérique Latine
NOUVEAUTÉS
**Elle est devenue en 1952, après une dissolution de 30 ans, l’Académie des Arts et Lettres du Venezuela.
**D’après le poète Anton Mejilla (1856-1923) qui fut de ceux-là et donne dans ses Mémoires publiés en 1932, une liste des principaux participants dans laquelle on note la présence de Ramon Terruel, l’auteur du fameux roman Tierra y Pàn (1894), ainsi que celle du chroniqueur mondain Ismaël Nadal dont on sait que ses rapports avec les identitaristes hâtèrent la fin.
**Les deux hommes se sont rencontrés à deux reprises à Lisbonne en 1923 à l’occasion des manifestations organisées par les partisans du dramaturge Antonio Ferro contre la censure de sa pièce Haute Mer.
**Voir en particulier The Meaning of Silence (White Worm Press, 1986) et Understanding Identitarism, History and Sociology of a Litterature Quest (Delaware University Press, 1990).
**1857-1940.
**1901-1953.
**Martyr du IIIe siècle, né homme-tronc et muet.
Le 31 octobre 2006, au lendemain de sa réélection à la présidence du Brésil, Luiz lnacio Lula da Silva s’est rendu à Belém sur la sépulture de Fernandao Seis pour prononcer devant la pierre tombale restée, selon les vœux du poète, vierge de toute inscription, un hommage appuyé à «l’un des plus importants acteurs de l’émancipation intellectuelle du Brésil et de l’Amérique latine ». Cet acte inattendu marque la volonté du président Lula d’affirmer solennellement la place du Brésil dans le concert des nations, non seulement comme puissance économique, mais tout particulièrement en tant que force morale à part entière. Au-delà des intérêts particuliers de son pays, il s’est fait le porte-parole unanimement salué de tout le continent sud-américain, reprenant à son compte l’héritage du mouvement littéraire des identitaristes dont il vient symboliquement d’écrire un chapitre décisif, sinon final.
L’identitarisme, dont Fernandao Seis a été l’un des principaux promoteurs au Brésil, est un curieux phénomène artistique. Très peu étudié faute de documents, il était promis à un anonymat irrémédiable si le président Lula ne l’avait exhumé des oubliettes de l’Histoire. De fait, il n’y a guère à ma connaissance que dans le supplément à l’indigeste et précieux essai dirigé par A. R. Dumont, intitulé Œuvres, Auteurs & Définitions Littéraires des Trois Derniers Siècles* qu’il en est fait mention en des termes lapidaires, sous la plume du professeur Ernest A. Laewiroth*, dont il nous a été permis de citer l’article.
« IDENTITARISME ou Identitarisme Littéraire. Mouvement littéraire sud-américain né entre la fin du XIX° siècle et le début du XX° siècle. Les principaux animateurs de ce mouvement, caractérisé par le souci de se défaire de l’influence tutélaire des pays colonisateurs et de l’Europe en particulier, cessèrent ou refusèrent d’écrire le moindre mot ».
La recherche d’éléments supplémentaires montre dès lors que le tome IV de la Sociologie du Monde des Arts de Don Eusebio Cameo* reste, bien que très parcellaire, l’unique source documentaire sur la question. Ainsi est-il établi qu’à la même période, sans se consulter, au Venezuela d’abord, au Brésil, en Argentine et, de manière plus diffuse, dans l’ensemble du continent sud-américain, des hommes de lettres, soucieux de retrouver leur indépendance intellectuelle et créative jusque-là confisquée à leurs yeux par les canons esthétiques venus d’Europe, ont cessé purement et simplement d’écrire.
Ces poètes, romanciers et essayistes, plus tard suivis par d’autres personnalités issues des différentes couches de la société, mus par la conviction que la nature profonde des habitants du continent latino-américain a été dévoyée par la colonisation européenne, ont brusquement refusé de se sentir exilés dans leur propre culture. Aux révoltes sanglantes des paysans sans terres, aux coups d’État, aux guérillas qui secouaient le continent entier, les identitaristes ont répondu par une révolution muette dont le silence, il faut en convenir, ne fut assourdissant que pour eux-mêmes. De cette génération sacrifiée d’intellectuels sans œuvre subsiste à peine la mémoire de quelques académies dont la fonction militante et dérisoire a principalement consisté à décerner des prix honorifiques aux plus méritants d’entre eux. Les Palmes Académiques du Mutisme Littéraire ont été, le temps de cette étonnante aventure, la distinction à laquelle aspirait chacun de ces révolutionnaires romantiques à l’exaltation pressée. Bien que presque oubliés aujourd’hui, les lauréats de ces palmes sont le symbole d’un mouvement dont l’action, toute limitée fût-elle, a permis de faire germer dans l’inconscient des générations futures d’écrivains sud-américains, l’idée de leur différence et cette singularité grisante qui depuis un siècle caractérise leur œuvre.
C’est en juin 1896, à Caracas, que s’organise, sur l’initiative des romanciers et essayistes Julio Guzman et Oscar de la Boya*, la première contestation organisée qu’il est convenu de considérer comme le point de départ de l’histoire du mouvement identitariste. Paradoxe éclatant, ils impriment à un millier d’exemplaires le fameux Manifesto Mudo Identitarista* dans lequel ils dénoncent toute activité littéraire imprimée pour les cinquante années à venir et appellent tous les écrivains et tous les journalistes à cesser de publier et de composer jusqu’à ce que « la littérature vénézuélienne ait repris sa conscience propre ». Le manifeste annonce également la constitution d’une Académie des Lettres du Continent Sud-Américain** pour laquelle ils lancent une large campagne d’adhésion.
La première réunion de l’Académie des Lettres du Continent Sud-Américain se tient au premier étage du restaurant du frère de Guzman. L’assistance ne doit probablement pas excéder dix personnes**. La séance commence par une dispute sur la question des minutes : faut-il ou non, en vertu des motivations qui rassemblent les membres de l’Académie, rédiger des comptes-rendus de séances? Les extrémistes soutiennent qu’il ne faut plus rien écrire, d’autres menés par Ismaël Nadal considèrent que les minutes d’une réunion, fût-elle une académie de gens de lettres, ne constituent nullement un texte à caractère littéraire et donc qu’il est parfaitement concevable de consigner par écrit le déroulement des débats. Oscar de la Boya, qui s’est fait le chef de file des partisans du « Nada Escrito», finit par remporter l’adhésion du plus grand nombre lorsqu’on retrouve le couteau qu’il a perdu plus tôt dans la soirée planté dans le ventre de Nadal. Celui-ci meurt sur place, au milieu des cris et des invectives. Dans le souci d’apaiser les esprits, Julio Guzman réussit à convaincre l’assemblée de décerner à Ismaël Nadal le premier grand prix de l’Académie des Lettres du Continent Sud- Américain « pour l’ensemble de son œuvre posthume».
À la suite de la cérémonie officielle de remise du prix à la veuve de Nadal, les membres de l’Académie se réunirent pour une veillée funèbre qui tourne rapidement, comme de coutume, au débat passionné. La question est de savoir s’il faut également récompenser, en vertu du précédent couronnement posthume de Nadal pour une œuvre qu’il n’a matériellement pas eu le temps de produire, tous les grands écrivains vénézuéliens décédés avant la proclamation du Manifesto Mudo Identitarista. Jugée sans fondement, cette éventualité a été repoussée : puisque les identitaristes ont décidé de cesser d’écrire pour s’affranchir des canons esthétiques de l’Europe, il était inconcevable de récompenser les œuvres des écrivains des générations précédentes. Plusieurs ont objecté que parmi ces écrivains historiques – le romancier Raùl de la Peňa et le poète-docker Esteban Gomez y Puech* en particulier –, certains auraient pu faire d’excellents identitaristes s’ils avaient été encore de cette terre. Le débat s’est donc porté sur la question de savoir s’il est possible de considérer comme identitariste une œuvre non écrite pour cause de décès. Le journaliste sportif Isidoro Morro dont le cousin était le propriétaire du Café des Sports sur la Plaza Mayor a invité l’assemblée à réfléchir sur le problème autour d’un verre.
Toujours dans ses Mémoires, Anton Mejilla indique que la bière et les boissons fortes ont déjà commencé leur travail de sape lorsque Oscar de la Boya soulève la question de la Mort en tant qu’écrivain à part entière. Partant du principe selon lequel un écrivain mort reste par essence un écrivain à cette différence qu’il n’est plus dans la possibilité matérielle et physique d’écrire, il demande si la Mort, en rendant muets les écrivains, n’est pas la première des identitaristes. Il ajoute que dans cette éventualité, il est du devoir de tout identitariste de se suicider de manière à être certain de résister à la tentation tenace de composer dans le secret de son cabinet de travail, ou dans l’inconscience des rêves, un paragraphe ou quelques vers. Cette assertion insurge les nombreux catholiques du groupe qui crient au blasphème et menacent de démissionner sur le champ. Guzman, encore lui, essaie de tempérer l’extrémisme de la Boya. Il propose au groupe de jurer de ne jamais écrire un mot qui serait publié. De la Boya refuse de prêter serment et tient tête à l’assemblée. Il soutient qu’un identitariste sincère ne peut avoir d’autre issue que de se supprimer d’une balle entre les deux yeux. C’est à ce moment qu’intervient Barnabeo Morro, le cousin, qui n’en pouvant plus des postures de la Boya, lui tend le pistolet à un coup qu’il garde derrière le comptoir pour se prémunir des voleurs en lui proposant de montrer l’exemple. Ici la version de Mejilla diverge de celle donnée par Guzman quelques années plus tard. Toujours est-il que la Boya, malgré ses discours enflammés, se dérobe. Le cours des événements reste confus : Mejilla écrit que la Boya a tenté de se sortir de cette situation par une pirouette rhétorique ou un bon mot.
Le cafetier, aidé de quelques joueurs de cartes restés là comme au spectacle malgré l’heure tardive lui a alors proprement cassé la figure avant de le jeter « comme un journal froissé» (sic) sur le trottoir. Guzman pour sa part affirme s’être interposé au moment où la Boya, qui a posé le canon de l’arme sur son front, va presser la détente et qu’il l’a «pour son propre bien»* assommé d’un coup de poing.
Malgré les efforts de Guzman pour arranger les choses, les relations entre la Boya et les identitaristes du Groupe de Caracas vont dès lors se dégrader inexorablement jusqu’à la rupture définitive. Pendant quelques semaines la Boya se rend aux réunions mais il apparaît évident qu’il ne vient plus que pour provoquer le scandale. On en vient régulièrement aux mains jusqu’au jour où l’avocat Arnoldo Ferrer est grièvement blessé d’un coup de couteau par la Boya. Recherché par la police, celui-ci n’a d’autre solution que de fuir Caracas.
Ici commence l’une des plus folles épopées nées de la littérature. Oscar de la Boya rejoint les rangs d’une bande de desperados dont il ne tarde pas à prendre la tête. On ne sait exactement quel discours il leur tient, toujours est-il que son charisme violent lui permet de rapidement transformer ce groupe de voleurs de poules analphabètes en un redoutable commando de choc spécialisé dans l’attaque des bibliothèques, des librairies et des imprimeries. Leur premier coup de main date de fin 1897. Une vingtaine de cavaliers aux visages cachés par des loups en forme de lettres de l’alphabet prend d’assaut et détruit partiellement l’imprimerie Caballero y Serafin dans la banlieue sud de Caracas. Un mois plus tard c’est au tour du principal dépôt de journaux de Caracas de subir la furie de ceux qui se surnomment les Desperados Identitaristas.
Pour Guzman il ne fait aucun doute que le chef des cavaliers qui porte le masque de la lettre A est la Boya. Il essaie en conséquence, mais en vain, de prévenir les autorités qui ne semblent pas faire cas de l’affaire. Plusieurs autres établissements ayant un rapport avec la chose imprimée, particulièrement les dépôts de papier, subissent dans les deux années qui suivent les attaques des identitaristes masqués. Au matin du 28 avril 1900, les employés de la Bibliothèque Municipale de Caracas signalent que leur directeur a disparu. Laissée en évidence sur le bureau du bibliothécaire, on a trouvé une note exigeant la cessation de toute publication à caractère littéraire au Venezuela. L’émotion suscitée par l’enlèvement de Don Gustavo Baldazar provoque une violente campagne de presse contre les identitaristes. Accusés de haute trahison, Guzman et le Groupe de Caracas n’ont d’autre solution que de déroger à leur règle : ils publient dans les principaux journaux du pays une lettre ouverte en forme de profession de foi dans laquelle ils réaffirment leur pacifisme et expliquent que leur démarche est résolument patriotique et en aucun cas dirigée contre les intérêts supérieurs du Venezuela.
Deux autres enlèvements suivent celui de Gustavo Baldazar. En juin l’ancien éditeur de la Boya est sans ménagement arraché des bras de sa maîtresse. En juillet c’est au tour de Domingo Sanguino, directeur du Magazine des Lettres, de disparaître alors qu’il se rend au siège de la rédaction. Ce n’est que sous la menace d’une mise à la retraite anticipée que le gouverneur de Caracas ordonne à la troupe de rechercher activement les Desperados. On organise en vain quelques brèves battues dans les villages autour de la capitale. Ce manque de conviction manifeste n’a provoqué pour toute réponse que la libération du bibliothécaire. Un garde retrouve le pauvre homme devant le palais du gouverneur, à l’aube, tenant ses oreilles enveloppées dans un linge. Ses ravisseurs l’ont en outre chargé de délivrer un message appris par cœur : «Puisque je suis maintenant incapable de porter des lunettes pour lire, les Desperados Identitaristas me libèrent mais ils ne s’arrêteront pas là »*. Après cette atteinte à l’intégrité physique d’un haut fonctionnaire s’engage une chasse à l’homme sans précédent. L’armée patrouille dans tout le pays avec l’ordre de mettre fin aux agissements des Desperados Identitaristas par n’importe quel moyen. Le hasard fait qu’un détachement d’auxiliaires des milices urbaines surprend la Boya et ses partisans dans la bibliothèque municipale de Maracaïbo qu’ils s’apprêtent à incendier. Le siège dure deux jours dans une fusillade nourrie. De part et d’autre on tire pour tuer et l’on dénombrera à la fin de l’opération plusieurs morts et blessés dont Guzman, sollicité par l’armée pour tenter de convaincre une dernière fois la Boya de se rendre, frappé par une balle dans le bras droit. Il s’agit d’une mauvaise blessure qui nécessite une amputation d’urgence. Le médecin affirme qu’entendant la mauvaise nouvelle, Guzman aurait répondu : « Ce n’est pas grave, c’est la main avec laquelle j’écrivais et je n’en ai plus besoin aujourd’hui». Juste avant l’assaut final, certainement pour tenter de couvrir leur retraite ou dans un geste suicidaire désespéré, les Desperados Identitaristas ont mis le feu à la salle de lecture de la bibliothèque. Les soldats n’ont manifestement pas reçu de consigne pour faire des prisonniers. Du reste, ils en firent peu. La Boya a quant à lui réussi à s’échapper avant la curée. Guzman est catégorique : il n’a pas reconnu son cadavre parmi les victimes. Toujours est-il qu’on n’a plus entendu parler de lui. Lorsque la rumeur a couru des années plus tard qu’un justicier masqué d’un loup sévissait en Californie espagnole, certains ont cru reconnaître la Boya en Zorro. Il va de soi que cela ne saurait être pris au sérieux.
L’épisode sanglant des Desperados Identitaristas a porté un coup sévère aux identitaristes du Groupe de Caracas qui n’ont jamais été en mesure de se défaire de leur mauvaise réputation. Le mouvement a peu à peu périclité. La plupart de ses membres se sont détournés complètement des affaires littéraires. Les poètes Igor et Cecilio Perez se sont consacrés à l’élevage. Le journaliste essayiste Trajàn Orca a quitté Caracas pour tenter sa chance dans l’exploitation d’une mine aurifère. Le jeune et prometteur Tomàs Santo Tomàs a repris son emploi de magasinier dans une boutique de prêt-à-porter. Les plus convaincus ont rejoint d’autres groupes identitaristes d’Amérique du Sud. Guzman s’est installé aux États-Unis dans l’espoir de créer un groupe identitariste américain représentatif des minorités littéraires à l’échelle du continent. Ses contacts prolifiques avec les autres académies identitaristes
sud-américaines et son engagement sans retenue pour la cause l’ont amené à devenir le seul écrivain à se voir décerner les Palmes du Mutisme Littéraire de chacune des grandes académies identitaristes*, dont les prestigieuses académies brésiliennes de Recife et Belém.
À l’automne 1896, le quotidien de Belém O Clarim rapporte dans un bref article à la fois amusé et scandalisé que deux écrivains du Venezuela viennent de se lancer dans une grève littéraire patriotique. L’information, on s’en doute, ne suscite aucun intérêt particulier. Il faut attendre le mois de janvier 1897 pour que le poète Fernandao Seis découvre que les fruits qu’il vient d’acheter au marché sont enveloppés dans un journal vénézuélien qui reprend et commente les intentions des auteurs du Manifesta Mudo Identitarista. L’idée de Guzman et la Boya touche Seis si profondément qu’il décide le jour même de créer la Revue Blanche Sud-Américaine ou Revista Blanca Sul-Americana qui tire son nom du fait que seuls le nom et l’ours, à l’exception de tout le reste, sont imprimés, les pages étant laissées en blanc, et dont la première livraison paraît le 17 mai 1897. Cinq participants figurent au sommaire de la revue à côté de Fernandao Seis : Ricardo Caeiro, Alberto Reis, Fernando Campos, Alvaro de Soares et Bernardo Search ; la lecture de la correspondance croisée entre Fernandao Seis et Fernando Pessoa** nous confirme que ces personnages n’étaient autres que des pseudonymes de Seis. Les cinq premières livraisons portent au bas des pages blanches la signature de l’auteur du texte supposé occuper l’espace libre. C’est Isabel Ugalde do Murga, poétesse mais surtout mécène de la revue, qui a mis fin à cette pratique. Elle a également émis l’idée de supprimer l’ours de la revue, chose que Seis s’est refusé à faire parce qu’il lui semblait important que l’on connaisse nommément les membres du mouvement identitariste de Belém. La Revista Blanca Sul-Americana paraît jusqu’en 1919 à raison d’un numéro par mois. L’activité de ses membres et sa régularité l’ont durablement imposée comme l’un des fleurons de l’aventure identitariste et sa notoriété a largement dépassé le cadre du continent. Si l’on s’exprime en termes de lecteurs, le nombre des abonnés ne cesse de croître – on en compte à son apogée, 2013 en 1917– dont quelques-uns sont des membres éminents de l’avant-garde européenne*. Outre les Brésiliens, la revue publie les œuvres des identitaristes issus d’autres groupes sud-américains. Elle s’ouvre également dès 1910 aux arts plastiques en ne reproduisant pas les œuvres graphiques de toute une génération de peintres, de sculpteurs et de photographes très tôt sensibilisés aux questions soulevées par le mouvement et totalement engagés dans la voie de l’indépendance intellectuelle et morale à l’échelle du continent. Ainsi la Revista Blanca Sul-Americana devient-elle le support d’expression incontournable d’une autre conception de la modernité en Amérique du Sud.
Militant convaincu, Seis tient néanmoins à veiller à la qualité des œuvres publiées dans sa revue. Il crée pour se faire un comité de rédaction composé de lui-même et de ses deux plus proches amis, Carlos do Nascimento et Fulmencio Roa Boca. Ceci montre l’idée particulière que Seis se fait de l’identitarisme. Il n’a en effet jamais été question au sein du Groupe de Belém de cesser complètement d’écrire, encore moins de cesser toute activité artistique. Au contraire de la plupart des identitaristes sud-américains, Seis estime que la recherche artistique et littéraire, même si elle ne doit pas être divulguée, reste la condition fondamentale. Il assure que le mutisme identitariste ne doit pas être considéré comme une fin mais comme un moyen. L’identitarisme est selon lui une étape obligée mais temporaire sur la route de l’émancipation de l’art sud-américain. Il encourage les membres du Groupe à produire et loue au siège de la banque Pinto e Sotomayor un coffre au nom de la Revista Blanca dans lequel sont conservés, rangés par numéro, les textes et œuvres reproduits dans la revue. Il destine ces archives à la publication au moins cinquante ans après la mort du dernier représentant du groupe identitariste international, en espérant que le mouvement aura d’ici là atteint son but. L’ouverture du coffre a eu lieu discrètement le 23 novembre 1993, date anniversaire du cinquantenaire de la mort de Joao Ferreira*, en présence de Mme Eveleen Nicecock, docteur en littérature à l’université du Delaware, chargée par le ministère brésilien de la Culture, en vertu de ses précédentes études sur le Mouvement identitariste**, de conduire les travaux sur les Archives Seis.
Outre les très vivaces groupes du Venezuela et du Brésil, le mouvement identitariste n’a guère fait florès sur le continent, excepté quelques cas isolés dont on peut en conscience se demander s’ils sont à mettre à l’actif d’une action réfléchie et préméditée ou d’un acte spontané, récupéré après coup par les différents membres actifs, dont Julio Guzman qui contribua grandement à établir la légende d’un mouvement identitariste, non seulement littéraire et artistique mais également politique et social. Aussi me contenterai-je de citer pour finir quelques cas isolés ou curieux qui selon les principaux protagonistes du mouvement font de plein droit partie de la geste identitariste.
Le Mexique est à ce titre un riche foyer de cas légendaires liés à l’identitarisme. Il convient de citer au premier chef le cas du capitaine Juan Beltramo, unique exégète de l’identitarisme militaire. Commandant d’une garnison à la frontière du Texas, Beltramo a convaincu ses hommes de se lancer à la reconquête du Texas, perdu lors de la guerre de 1830. Son premier coup de main a lieu le 18 avril 1899. Il porte sur le relais de San Ignacio, défendu par une petite unité de la cavalerie des États-Unis. L’assaut s’est déroulé de nuit, dans un silence complet, Beltramo ayant en effet ordonné à ses hommes de ne proférer aucune parole durant l’action. La petite armée s’est ensuite tournée vers Punta Blanca, ville moyenne abritant un fort et une garnison importante. Fidèle à sa stratégie du plus grand silence, aidé par l’effet de surprise, Beltramo s’empare du fort dont il fait sa base opérationnelle. De là il procède à de nombreux coups de mains, harcelant les caravanes, les relais de postes et les points d’eaux. Le but de Beltramo est de devenir suffisamment nuisible pour que le gouverneur du Texas ne puisse faire autrement que d’envoyer une forte armée à sa rencontre. Il veut remporter sur l’armée américaine une victoire majeure qui lui ouvrirait grand les portes du Texas. La bataille a lieu à Chapatoola-junction le 24 septembre 1901. Sur ses drapeaux, Beltramo a fait broder la devise « Muere primero, habla despuès». Son armée s’est étoffée de nombreux volontaires. Elle s’avance au son de fanfares silencieuses comme à une fête. Les témoignages des journalistes présents rapportent combien cette armée en marche dans un silence quasi complet fit impression sur les troupes fédérales. Au terme d’un combat furieux de cinq heures, les Mexicains battent en retraite. La mort de Beltramo sur le champ de bataille a mis fin à sa folle aventure.
S’il n’y a eu personne pour ranimer la flamme de la reconquête du Texas, le souvenir de l’épopée de Beltramo est resté vivace au Mexique avec la persistance des bandas calladas ; sortes d’orchestres dont les instruments à cordes en sont dépourvus et les souffleurs se contentent de porter leur instrument à la bouche tandis que le chanteur remue les lèvres en silence. C’est dans l’une de ces formations que le célèbre chanteur Lauro «El Chispito» Capilla a commencé sa carrière avant de devenir l’un des principaux interprètes du style mariachi de Jalisco.
En Uruguay la cause identitariste a été défendue, à son corps défendant, par Pascual de Vacas**. Éditorialiste pour le quotidien La Nacion, poète et romancier auréolé d’un certain succès, Vacas s’est trouvé frappé d’une frénésie d’écriture diagnostiquée par les médecins comme une Folia Scriptorica très avancée. Pour le soigner on lui a prescrit un mélange de psychotropes inhibiteurs à forte dose dont il est resté dépendant jusqu’à la fin de ses jours. L’effet des médicaments s’est révélé on ne peut plus efficace : Vacas cesse complètement d’écrire dès la première prise, ce qui attire sur lui les regards admiratifs de plusieurs membres actifs du mouvement identitariste. Il reçoit d’ailleurs, à titre d’encouragement, les Palmes du Mutisme de l’Académie de Recife puis le Grand Prix des Lettres de Vera Cruz. En 1920, une terrible rechute le conduit à l’hôpital. Durant les onze mois qui suivent, Vacas remplit des dizaines de cahiers avec seulement la lettre A. Lorsqu’il commence à tracer des « B », les médecins l’estiment en voie de guérison et le laissent sortir. Il est définitivement interné après l’agression d’un homme qui écrivait son courrier à la terrasse d’un café. De l’hôpital, pendant ses brèves périodes de rémission, il parvient à donner trois lectures radiophoniques de la cinquième édition de l’Annuaire des Administrations uruguayennes*. Pascual de Vacas meurt le 8 octobre 1940. Il avait perdu l’usage de la parole deux ans auparavant.
Pour finir évoquons le père franciscain Anastasio Sardia**, l’un des rares ecclésiastiques à adhérer activement au mouvement identitariste. S’inspirant de la vie de saint Crépinien**, il a été l’initiateur d’une nouvelle façon de servir la messe en espagnol sans prononcer la moindre parole. Ses prêches et ses muettes homélies ont étonné ses ouailles avant de courroucer ses supérieurs qui l’ont envoyé dans un cloître faire pénitence. Se conformant au vœu de silence de sa communauté, Sardia, bientôt accusé de provocation et de manœuvres politiques se voit menacé d’excommunication. Soutenu par les plus pauvres de son ancienne paroisse, la sanction est ajournée mais Sardia est obligé de quitter l’Église. Il poursuit dès lors une vaine carrière d’évangélisme muet à travers le Mexique, l’Argentine et le Pérou. L’épiscopat a laissé entendre que Sardia était analphabète.
..............................................................................................................................................
Notices biographiques de quelques auteurs cités ci-dessus.
Julio GuzmanNé en 1868 à Porto Muerto (Venezuela). Il a écrit et publié plusieurs romans très influencés par la littérature fantastique espagnole dont l’analyse systématique l’a doté d’une très particulière faculté d’anticipation sur le devenir de la littérature. Son engagement d’ans l’aventure identitariste ne lui a pas permis de mener à terme ses Nouvelles Exemplaires. Ce projet, comme l’attestent les archives conservées par Mme Henri Bachelier, était néanmoins parfaitement connu de Pierre Ménard qui s’en est largement imprégné avant de commencer la rédaction de son Chapitre IX du Quichotte. Bien qu’on lui ait reproché de n’avoir jamais accepté de détruire ses œuvres pré-identitaristes ou d’interdire leur réédition, il fut le seul du Groupe de Caracas à n’avoir plus jamais rien écrit après juin 1896. Il meurt d’une crise d’apoplexie en 1936 lors d’une conférence donnée à l’Université du Vermont.
Oscar de la Boya Caracas, 1839 - Los Angeles, Mexique, 1920 (?). Le co-auteur du Manifesto Mudo Identitarista est l’un des plus prolifiques auteurs pré-identitaristes du groupe. Ses essais sur la littérature et sa poésie romantique militante sont autant de manifestes annonciateurs de l’identitarisme. Il est le premier à avoir détruit l’intégralité de ses manuscrits. Son manque de moyens financiers ne lui a pas permis de racheter à son éditeur les stocks de ses livres afin de les détruire, de sorte que quelques volumes ont heureusement survécu. Ses héritiers, fidèles à sa mémoire, refusent toujours la réédition de ses écrits. Ainsi à ce jour ne subsiste-t-il qu’une édition clandestine et certainement incomplète de son œuvre : Obras Echas, Cerca las Diez editores, Caracas, 1947 pour l’édition princeps puis 1953 et 1987, partiellement revues et augmentées.
Ismaël Nadal. Caracas,1865-1896. Chroniqueur mondain et poète des salons à la mode de Caracas. Il est certainement le seul parmi les premiers identitaristes à vivre de sa plume. Ses détracteurs dans le monde des lettres disaient volontiers de lui qu’il vivait plus de sa queue que de sa plume (Roberto Elziego). Il est vrai que Nadal ne faisait rien pour atténuer la rumeur persistante de ses exploits amoureux auprès des dames de la bonne société. Sa brève aventure identitariste qui coïncide avec sa disparition prématurée a retardé la publication de ses œuvres. Elles sont régulièrement réimprimées depuis 1931 grâce à la Fondation Nadal, fondée par la nostalgique veuve du banquier Upmann.
Fernandao Seis. Macapa, 1853 - Belém, 1942. Connu pour ses poèmes historiques d’un classicisme « à l’antique» qu’il tient à déclamer lui-même lors de grandes soirées oratoires, on le tient pour plus grand lecteur que poète ou écrivain. Ses silences, particulièrement lors de ses lectures des œuvres symbolistes françaises lui ont valu un prestige inégalé. Bien que co-fondateur du mouvement brésilien, il n’est pas un identitariste intransigeant. Il continue d’écrire pour lui-même et publie jusqu’en 1940 plusieurs recueils de contes pour enfants dont il soutenait qu’il «faut éduquer le goût facétieux des lettres ».
Carlos do Nascimento. 1884-1923. Do Nascimento est une figure de l’art brésilien. Totalement oublié et méconnu des spécialistes de l’art moderne, il est l’inventeur des installations propres à l’art contemporain de la fin du XX° et du début du XXI° siècles. Ses «Sculptures Mortes », conçues à partir de cadavres d’animaux, lui valent une notoriété sulfureuse immédiate et une reconnaissance sans équivoque dans les milieux de l’avant-garde. En 1929 Salvador Dali et Luis Buñuel lui rendent un hommage appuyé en intégrant dans leur film Un Chien andalou l’image d’un âne en putréfaction. Surnommé du haut de son mètre quarante-quatre le Nain Géant, il a toujours soutenu avoir servi dans la Légion étrangère. Sa veste de cuir brun très usée avec sur le dos un étrange motif floral à moitié effacé ajoute à son côté fantasque. Il a affirmé à de nombreuses reprises que c’est un souvenir de l’un de ses compagnons d’arme mort au combat dont il a conservé la peau pour se faire confectionner ce vêtement, le dessin dans son dos n’étant rien moins que le tatouage de son ami. Le «scandale de la veste tatouée» a atteint son paroxysme lors du procès retentissant intenté contre lui par les deux sœurs Moraes qui prétendaient reconnaître le tatouage de leur père décédé. Une enquête a établi qu’à l’époque de la mort de Moraes père, Carlos do Nascimento était assistant à la morgue de Belém. Do Nascimento a évidemment maintenu sa version du légionnaire. Malgré les doutes et les fortes présomptions rien n’a pu être prouvé et l’affaire en est restée là.

De gauche à droite: Alvaro lňaki, Cecilio Perez,
Milton Ferreira, Fernandao Seis, Julio Guzman,
Carlos da Nascimento, Emeregildo Royo et
Vicente Hozla. Photo coll. de l’auteur.
Vincent Puente
« De l’identitarisme ou Les Palmes Académiques du Mutisme
littéraire en Amérique Latine», Anatomie du faux, 2000
Éditions La Bibliothèque.
« De l’identitarisme ou Les Palmes Académiques du Mutisme
littéraire en Amérique Latine», Anatomie du faux, 2000
Éditions La Bibliothèque.
*Van Meerch éditeur, Amsterdam, 1948.
*À qui l'on doit le tardif mais excellent Traité sur les Formes (Sutton & Nobles éd., New York, 1932).
*Rosa y Rosa éditorial, Cadiz, 1958. Partiellement repris pour le compte des Presses Universitaires de France par Françoise
Martinez dans sa thèse Ordre et révolution : les Avant-gardes sud-américaines au début du XX° siècle, PUF, Paris, 1989.
*Notices biographiques des auteurs en fin de texte.
*Littéralement, «Manifeste Muet Identitariste ». Cette feuille mal imprimée reste le seul document jamais publié par des identitaristes. Après une longue recherche, il s’avère que trois exemplaires sont encore conservés : l’un se trouve dans les collections des Imprimés Précieux de la Bibliothèque Municipale de Caracas, l’autre dans le département des Livres Précieux de la Bibliothèque Nationale de France à Paris, le troisième exemplaire a été acheté par un collectionneur privé lors de la première dispersion de la Collection Astor organisée par Sotheby’s à Monte-Carlo en 1997. Notons en outre que ce document est celui où pour la première et, certainement, la dernière fois le terme «identitariste» fut imprimé dans son contexte historique contemporain.
*Célèbres respectivement pour un cycle romanesque épique dont le héros est un Indien pueblo muet intitulé Le Sang des Guerriers (1842) et pour un unique sonnet inachevé composé entre 1860 et 1861, dont les deux premières strophes et le dernier vers évoquent le silence contemplatif du Poète face aux Andes.
*Propos rapportés par le journaliste Arthur Benway lors d’une entrevue avec Guzman le 26 octobre 1934 pour le compte du Los Angeles Tribune.
*Terriblement myope, la pauvre victime n’a pu en effet reprendre son poste. Il apparaît que Gustavo Baldazar a achevé sa carrière au sein de l’administration vénézuélienne comme inspecteur général des Impôts délégué aux Réclamations.
*Gran Palma Muda de l’Académie des Lettres du Continent Sud-Américain (1903, décernée à titre exceptionnel par les anciens membres du Groupe de Caracas deux ans après que celui-ci fut dissout) ; Palmas del Mutismo Litterario (1904, décernées par l’Académie Identitariste de Buenos Aires); Palmas Identitaristas do Recife (1906, décernées par le poète sourd Fernando de Meiros au nom des Identitaristes Fédérés du Brésil) ; Palmas dei Silencio Mexicano (1909, décernées par l’Académie de Mexico) ; Gran Premio Identitarista (1910 puis 1912, décerné par un collège international des Identitaristes pour la meilleure œuvre non écrite de l’année).
*La vente Breton d’avril 2003 a révélé que le fondateur du surréalisme en possédait une collection complète. Celle-ci a été préemptée par la Bibliothèque Nationale. Voir le Catalogue : Livres, volume II, pages 40-41.
*1871-1943. Dramaturge et cinéaste tardif, son œuvre est essentiellement centrée sur l’analyse, l’adaptation et l’interprétation pornographiques des auteurs latins antiques. Sa version des Catilinaires de Cicéron (1937) reste sa meilleure réalisation.
*«Meurt d’abord, parle après. »
*Julio Guzman, dans sa conférence intitulée L’identitarisme des confins, donnée à l’université de Houston, Texas, loin de condamner Vacas pour sa crise d’écriture, compare le contenu des deux cahiers à «une forme d’antimatière en tous points conforme à la pensée identitariste», Il en va de même pour ses lectures de l’annuaire dont il soutient «qu’elles relèvent de la même volonté de se défaire de la matière littéraire. »
La secrétaire de Borges
NOUVEAUTÉS
Je ne sais pas quand elle a découvert que je n’y voyais plus. Je ne m’en étais pas vraiment aperçu moi-même, je regardais les pages des livres et je pensais encore pouvoir les voir, les lire, les comprendre, et elle, sachant la vérité, préparait son plan.
Mon processus d’éloignement vis-à-vis des livres a duré de nombreuses années. Je me sentais cependant toujours plus proche d’eux. Je lisais de moins en moins, mais comme je travaillais dans une bibliothèque, je pouvais les sentir, les humer, les manipuler quotidiennement. Mes subordonnés étaient surpris par mes longues heures de service, mais il ne m’importait guère que les heures soient du matin ou du soir, dès lors que la pénombre me recouvrait. Je restais en compagnie de mes amis et je me délectais des reliures de cuir, luxueuses, ou je me laissais émouvoir par la simplicité des couvertures en carton qui enveloppaient les trésors les plus sublimes. Je les connaissais depuis toujours, croyais-je. Après avoir appris à lire, je les ai reconnus. Les présentations avaient déjà été faites, peut-être dans une vie antérieure, peut-être dans les Limbes originelles. Il me semblait que je communiais avec les histoires, et celles qui étaient déjà écrites étaient les sœurs de celles qui étaient encore à l’état d’idée. Les mots écrits réclamaient leurs frères, leur demandaient de s’organiser en une armée invincible et de sortir de mon cerveau étroit pour partir à la bataille, sous forme écrite, à travers le monde. L’aphorisme « publier ou périr » prenait un autre sens et une nouvelle urgence.
Je connaissais chaque livre par son odeur, ses rainures, son poids. Je n’avais pas besoin de lire le titre du volume pour reconnaître le tourbillon de la comédie de Dante, connue sous le nom de divine, mais émouvante surtout par son humanité. Je la tenais en main, plein de révérence, et mes nerfs sentaient les impulsions qui les avaient créées : les déceptions, les croyances, les humiliations et les petites vengeances, qui ouvraient son auteur à la beauté, à la perfection. Je réalisais combien la superstition l’imprégnait, et j’imaginais la figure grave de Dante pareille à celle d’un maniaque obsessionnel qui sort se promener et tourne toujours à droite afin d’éviter l’effrayante senestre et la possibilité du mal.
Lorsque j’effleurais les volumes poussiéreux de Proust, l’air me manquait, et je me sentais ébloui par la lumineuse sonorité de ses mots réverbérant contre les colonnes d’une cathédrale. Et si je passais à côté de Don Quichotte, je me sentais attiré par la chaleur de sa fantaisie et je m’approchais pour sentir l’odeur du bon vin des tavernes vendu à bas prix, et écouter un peu la musique jouée à la guitare et les éclats de rire qui secouaient le peuple.
Je connaissais également les volumes de philosophie qui exhalaient un arôme mêlant logique et folie. Nietzsche paraissait toujours accompagné par des tambours et des cymbales, dans un rituel païen qui se perpétuait. Spinoza, Sartre, Platon possédaient des caractéristiques propres qui me permettaient de les reconnaître de loin, de l’autre côté des étagères où ils étaient bien installées, mais où ils ne dormaient jamais. Il n’y a pas de livres plus insomniaques que ceux de philosophie... Des plus obscurs aux plus célèbres, des plus populaires aux plus sophistiqués et érudits, je pouvais tous les reconnaître sans me tromper.
Je pouvais me passer de mes yeux même pour les lire. Je suivais les textes que je connaissais par cœur, sans réaliser que je les lisais seulement avec les yeux de la mémoire. Et c’est pour cela que j’ai eu tant de mal à me rendre compte de ma cécité, qui s’est manifestée par l’écriture, et non par la lecture, contrairement à ce à quoi on pouvait s’attendre. Si j’étais comme les singes dont on se sert pour les expériences, et si j’étais habitué à écrire à la machine, j’aurais composé des chefs-d’œuvre de la littérature mondiale et réécrit non seulement Don Quichotte, mais également Madame Bovary et Gilgamesh, tout cela à l’intérieur des Mille et Une Nuits. Cependant, je ne parvenais à écrire qu’avec un porte-plume et du papier, et c’est pourquoi rien de tout cela n’a été écrit, et j’ai dû roder autour de ces œuvres alignant thèmes et idées, éliminant les distances et ajustant les perspectives que je tirais de mes chers livres.
C’est parce que je n’arrive pas à écrire que j’ai eu besoin de ses services. Mais elle travaillait déjà avec moi depuis un certain temps. Discrète et indistincte sont les deux adjectifs que j’aimerais utiliser pour la décrire, mais cela faisait longtemps que j’avais renoncé à décrire quoi que ce soit. Je peux seulement raconter ce qui s’est passé, bien que d’une manière étrange, susurrant dans ce micro branché à des bandes magnétiques qui préserveront pendant un temps déterminé, tant qu’une intense tempête solaire ne se sera pas décidée à les détruire, ma voix, mes angoisses et mes incertitudes.
Lorsqu’elle a pris en charge les tâches de secrétariat, elle faisait les choses que nous ne souhaitions pas faire : organiser les notes et les archives, répondre au téléphone, remplir les porte-plume d’encre et diviser la journée en tranches en fonction des activités nécessaires. À vrai dire, elle travaillait pour ma mère qui, malade, peinait pour répondre aux lettres des éditeurs, pour s’occuper des questions bancaires et des obligations domestiques. Une femme extraordinaire, ma mère : elle m’a même trouvé une épouse qui pourrait la remplacer, mais la secrétaire était restée et après la disparition de ma mère, j’en ai hérité, comme on hérite d’un meuble de famille. Elle a toujours été une personne silencieuse et sa présence se signalait non par l’agitation de l’air ou par ses bruits, mais par la viscosité du silence qui l’entourait constamment et par la matérialité du calme qu’elle imposait.
Je crois qu’elle avait déjà constaté ma cécité avant même qu’elle se soit manifestée. Alors, artisane mathématiquement précise, géomètre de la vie, elle s’est préparée pour le jour où, vaincu, je l’appellerais pour la première dictée. Une lettre banale. Ensuite, une affaire urgente et plus complexe. Elle est devenue petit à petit une partie de mon système. Que les mots fussent prononcés rapidement, ou qu’ils aient été distillés goutte à goutte, son texte n’était jamais fautif, et elle se dépêchait de le relire de sa voix spectralement sereine. Cela me tranquillisait.
Elle m’a bien entraîné. Je ne la considérais bientôt plus comme une présence étrangère, elle faisait seulement partie du système, comme l’encre du porte-plume. Essentielle, mais privée d’importance intrinsèque. Elle remplissait ses fonctions et je lui faisais confiance. Le premier glissement s’est certainement produit sans que je m’en aperçoive. Un mot anodin remplacé par un synonyme. On rature « mot » et on écrit « vocable ». Quelle différence cela fait ? Au début, même moi, je ne remarquais rien. D’autant plus qu’elle a toujours fait preuve de sagesse et d’un bon goût inégalable. Et elle n’aurait jamais fait un changement qui porte préjudice à la musique de mon écriture. Le rythme a toujours été respecté, les modifications qu’elle opérait sans que je m’en rende compte était de simples nuances.
Un jour, j’ai vu qu’un mot avait été remplacé par un autre. Et je m’en suis seulement rendu compte parce que la veille j’avais été mécontent de ma phrase. Avant de la proférer, comme j’en avais l’habitude, je l’avais laissée résonner dans mon esprit une, deux, plusieurs fois, mais mon cerveau avait trébuché sur le même point, sur le même mot à la tonalité légèrement pédante et désuète, qui ne me plaisait pas. De guerre lasse, je capitulai et résigné, j’acceptai le mot insistant. Le lendemain, selon son habitude, elle relut le dernier paragraphe pour que je puisse retrouver le rythme et reprendre le processus créatif. Mais à la place de la phrase estropiée, il y avait une sentence fluide et sinueuse, une perfection sereine. J’eus le souffle coupé l’espace d’un instant. Elle remarqua ma surprise, mais resta calme et attendit une réaction de ma part. Je me tus, lâchement. En fin de compte, elle avait amélioré mon œuvre, poli une arête, l’avait perfectionnée. Je me tus et me tairais les fois d’après. Les corrections se multipliaient. Et à partir d’un certain moment, ces corrections n’apparaissaient pas seulement dans les extraits qui ne me satisfaisaient pas. Je terminais une journée de travail, satisfait du résultat, et le jour suivant, je m’apercevais que ce qui m’avait satisfait n’existait plus, ayant été remplacé par un texte invariablement meilleur que le mien, plus neuf, plus resplendissant, de la qualité d’un joyau poli aux facettes bien taillées, dont l’architecture reproduisait la lumière de pensées exprimées avec plus de tranchant et d’intensité.
C’est alors qu’a commencé le véritable jeu. Avec toujours plus d’audace, elle a changé une idée centrale. Une fois, deux fois, à chaque fois. Comme un dieu joueur, elle a commencé à révoquer les diktats de ma nature et à parer les coups dont j’avais l’intention de frapper mes personnages. Ou elles les exposaient à des coups que je n’avais pas programmés. Si je les condamnais à mort, elle les sauvait, même si c’était pour leur permettre de composer une épopée entière dans un temps congelé, au terme duquel une balle que j’avais tirée atteindrait fatalement le cœur du condamné. Si je leur laissais la vie sauve, elle les rendait stériles et arides, muets.
Le travail de composition a cessé d’être le fruit de ma volonté pour devenir le travail de deux intelligences antagonistes, avides de se dépasser l’une l’autre. Le texte est devenu un échiquier, où chacun de nous essayait d’anticiper les mouvements possibles de l’autre. Je fermais la porte, elle ouvrait un couloir. Si je prenais un chemin, elle bifurquait, et je m’aperçus que toute ma création consistait désormais à échapper aux labyrinthes qu’elle créait et que mes textes n’avaient jamais été simples avec autant de complexité. Jaloux, je m’apercevais que la qualité de mes textes ne dépendait désormais plus de moi, mais du jeu dont j’étais prisonnier. Irrité, j’arrêtai de dicter. Je ne supportais pas le défi qu’elle me proposait, je voulais la réduire au silence, l’anéantir. Seulement, en la réduisant au silence, je m’anéantissais moi aussi.
Je tentai un subterfuge : je fis appel à un autre écrivain, un disciple qui m’admirait et qui se proposait de me lire des textes récemment publiés et de relire des livres depuis longtemps chers à mon cœur. Les dictées se déroulaient sans nouveauté, mais elles étaient extrêmement fatigantes. Si je mentionnais une des œuvres de ma bibliothèque imaginaire, je devais lui expliquer que les pages citées n’existaient que dans les volumes de mon propre univers. Lorsque je proférais le nom d’un détective maudit, ou celui d’un chef de clan persécuté par le sort, je devais épeler leur nom, expliquer la géographie de leur lieu de naissance, décrire la généalogie exigée par l’avidité inquisitrice de l’écrivaillon. Et rien ne changeait, il n’y avait aucune surprise inespérée : si mes mots se présentaient de manière opaque et sans vie, personne n’osait les polir et les regrouper, si mes idées s’affadissaient et paraissaient usées, personne ne venait les dépoussiérer ou les aérer. Je devais admettre qu’elle me manquait, son labeur silencieux, la toile où elle m’égarait et qui, l’étonnement initial passé, m’avait stimulé.
Je lui demandai de revenir et elle s’exécuta docilement. Je dictai ma page, et elle la relut, sereine. Je l’écoutai, nerveux, attendant les pièges que j’avais appris à valoriser, mais il n’y avait pas de changements notables. À vrai dire, aucune altération n’avait été faite. J’essayai de composer des phrases désarticulées, dures et sans rythme, pour l’obliger à réagir, mais il ne s’ensuivit aucun changement, aucune correction. Je tremblais, j’étais dérouté, je ne savais que faire. Notre jeu avait toujours été silencieux, tacite, à aucun moment nous n’avions admis que nous jouions. Je décidai d’attendre aussi patiemment qu’elle, dans l’espoir que dans les prochains jours, elle recommence à collaborer à mes compositions. Cependant, elle paraissait impassible. Tous les jours, j’attendais, en haleine, la lecture qu’elle ferait de mon travail de la veille, ses judicieuses interventions. Ce que j’entendais cependant c’était toujours le texte que j’avais proféré et qui me paraissait toujours plus anémique, toujours plus confus et pourquoi ne pas le dire, sénile. Je me hasardai à faire des corrections, rien ne me satisfaisait et mes histoires se ressentaient de ces nombreux rapiéçages et corrections. Toutefois, je n’ai pas eu le courage de l’interpeller. Je suis resté silencieux, je me sentais accablé, dictant toujours moins chaque jour. Je savais qu’à ce train, je ne parviendrais pas à terminer mon nouveau livre, et même la peur de rencontrer mon éditeur ne me motivait pas à composer de nouvelles histoires. Je réalisais qu’elle était devenue indispensable, que je dépendais de ses modifications et que la seule chose que je désirais, c’était d’écrire des textes pour les voir dérangés, réordonnés, construisant à travers le dialogue des labyrinthes toujours plus complexes.
Cette situation durait depuis quelques mois, lorsque je reçus la visite de l’écrivaillon que j’avais mis de côté. Admirateur exalté, il faisait l’éloge de mon nouveau livre, me tissait des louanges et faisait des commentaires quasiment inintelligibles. Mais je n’étais pas au courant de ce nouveau livre, et j’avais pleinement conscience que mes histoires étaient décousues, dépourvues de trame et de structure. Je savais qu’aucun éditeur ne publierait pareils textes, même s’ils portaient ma signature. Je pensai que, las de ne pas recevoir de nouvelles histoires, mon éditeur avait lancé une réédition d’œuvres anciennes épuisées, mais l’écrivaillon me démentit. Il m’assura en outre que ces histoires étaient ce que j’avais publié de meilleur. Il exagérait en disant que Dédale n’avait pas composé des labyrinthes aussi sophistiqués que les miens. Je lui demandai alors de me donner un exemple de ce qui lui plaisait tant et il lit lut un extrait d’une nouvelle. Je me sentis transfiguré. Un mélange de plaisir et de terreur m’envahit. Cette nouvelle était de moi, mais je ne l’avais jamais écrite. Je reconnaissais mon idée, le grain d’une idée que j’avais lancé à ma secrétaire, mais ce grain s’était transformé en une semence qui avait germé, verdoyante, et avait crû jusqu’à devenir un arbre luxuriant que je ne connaissais pas, bien qu’il fît partie de moi. À ma demande, l’écrivaillon a continué sa lecture et a fini par lire tout le livre, mon livre, dont je savais pourtant qu’il n’avait pas fructifié à travers moi. Ces histoires étaient les miennes, même si je ne les avais jamais énoncées. Le style était si proche du mien que moi-même j’avais du mal à montrer les différences. Seulement, chaque mot semblait dégager une luminosité, un brillant que – je le savais – mes textes n’avaient jamais possédés.
Elle m’avait entièrement usurpé. Elle s’était passée de moi, et avait même refusé le jeu d’échec initial de la composition. Je ne peux pas, je ne veux pas la démasquer, car cela me détruirait. En outre, je reconnais que ces textes sont les miens, et ces nouvelles s’accordent avec mes œuvres du passé, les amplifient et leur donnent une nouvelle dimension, de nouvelles significations. Sans ma production actuelle, mes nouvelles antérieures seraient tronquées, inexpliquées et inexplicables.
Je devins l’écrivain le plus célébré de mon pays. Je rencontrai le succès de mon vivant et je serai un classique après ma mort. Cependant, elle n’est qu’un fantôme. Elle dépend de moi pour publier ses textes et personne ne la croirait si un jour elle révélait être la véritable auteure de mes livres. Je suis Borges, le grand Borges, aimé et reconnu, admiré. Elle est une secrétaire sans nom et sans présence, environnée d’un silence toujours plus visqueux, qui mourra à l’instant même où mes yeux se fermeront définitivement. Aveugle et silencieux, c’est moi qui resplendit souverainement et je l’observe se consumer à l’intérieur de la gloire. Après ma mort, elle ne pourra plus usurper ma voix sous peine de se révéler une imitatrice sans valeur. Pour préserver l’œuvre qu’elle a créée elle devra garder le silence. Et pour qu’elle disparaisse pour toujours, je me tais également, et je dois la laisser emmurée pour toujours dans le meilleur labyrinthe qu’elle ait jamais construit : le silence indifférent de l’Autre.
Lúcia Bettencourt
« La secrétaire de Borges», A secretária de Borges
2006, editora Record, Rio de Janeiro.
Lauréat du prix SESC.
Nouvelle traduite du portugais (Brésil)
par Émilie Audigier et Stephen Chao.
« La secrétaire de Borges», A secretária de Borges
2006, editora Record, Rio de Janeiro.
Lauréat du prix SESC.
Nouvelle traduite du portugais (Brésil)
par Émilie Audigier et Stephen Chao.
Biographie de quelques auteurs du Lampadaire.
1. Maria Rantin
NOUVEAUTÉS
Maria Rantin est lusophone par sa mère portugaise, et anglophobe pour des raisons que nous ne développerons pas ici mais qui concerne ses relations avec son père américain. Malgré cette difficulté relationnelle, elle revendique sa double appartenance et se dit américano-portugaise. Elle est l’auteur de plusieurs récits en langue française publiés par Le Lampadaire.
Maria Rantin a fait des études d’entomologie à l’université de Lisbonne. Dans sa thèse elle s’est demandé quelle était la résistance des pucerons à la chaleur. Elle étudiait plus particulièrement les pucerons des rosiers qui longent les tiges et sont élevés par les fourmis, et ceux des cerisiers qui se lovent dans les feuilles et sont entretenus par un autre insecte jusqu’alors inconnu d’elle et dont elle cherchait à découvrir le mode de vie.
Tout allait bien, elle menait ses expériences selon le protocole convenu avec son maître de thèse. Ses travaux avaient de l’avenir, et des laboratoires spécialisés dans la lutte contre les pucerons suivaient de près l’avancée de ses recherches. Une fois tout le matériel assemblé, les expériences réalisées, vint le temps de rédiger. C’est à ce moment que sa thèse prit un tour étrange.
Un certain nombre de troubles du comportement auraient dû alerter ses proches et ses professeurs, des indices, des failles, des hésitations, des tremblés. Tout cela fut mis sur le compte du surmenage causé par l’attention suraiguë qu’elle devait porter à des phénomènes aussi minuscules que la production de gouttes d’un liquide sucré par un puceron vert adulte.
Son regard aiguisé, sur-sollicité, se posa sur une goutte d’eau qui s’était déposée sur son bras alors qu’elle buvait un verre de rosé qui certes avait été rafraîchi avec des glaçons mais qui n’avait aucune raison de baver sur elle. Elle fit le lien avec « l’exquise rosée » dont parlait son maître en pensée, le grand entomologiste français Fabre, lorsqu’il décrivait le système de production de miellat par le puceron et son exploitation par la gourmande fourmi :
Ils sont les vaches des fourmis, qui viennent les traire, c’est-à-dire provoquer par des chatouillements l’émission de la liqueur sucrée. Aussitôt parue au bout des tubes, la goutellette est bue par la laitière. Il est des fourmis à moeurs pastorales qui parquent un troupeau de pucerons dans un chalet construit en parcelles de terre autour d’une touffe d’herbages. Sans sortir de chez elles, elles peuvent traire et se remplir le bidon.
Les non versées dans l’art pastoral exploitent les stabulations naturelles. En procession sans fin, je les vois, très affairées, escalader les genêts ; en d’autres processions je les vois redescendre, repues et se pourléchant. Leur ventre distendu est devenu perle translucide.
Toutes nombreuses et zélées qu’elles sont ces laitières ne peuvent suffire aux produits d’un tel troupeau. Alors les pis corniculaires expulsent d’eux-mêmes le trop-plein et le laissent négligemment tomber. Au-dessous, branches et rameux reçoivent l’exquise rosée et se vernissent d’un enduit visqueux. C’est le miellat.
Maria Rantin s’acharna à prouver que la production, par le verre de rosé frais, d’une perle d’eau relevait du même principe que celle de la liqueur sucrée par le puceron qu’il soit vert ou noir. Ceci lui valu le blâme de son jury de thèse qui lui indiqua qu’avant de se lancer dans la lecture du grand Fabre et d’en tirer des conclusions scientifiques, elle aurait mieux fait de parfaire son français. C’est pourquoi elle se retrouva sur le marché du travail sans travail et sans diplôme.
Comme elle avait le goût des digressions, ce qu’elle venait de prouver, elle décida de devenir écrivain et érigea en principe cette phrase qui devint son drapeau national « Faisons de toute faille un succès » soit « Tornamos toda falha em sucesso » dans sa langue maternelle.
Elle suivit le conseil des membres de son jury de thèse et parfit son français. Je dis bien « parfit », car elle prétendit (c’est ce qu’elle me confia) non seulement parfaire sa connaissance et sa pratique du français, mais parfaire aussi cette langue même, non qu’elle la jugeât vraiment imparfaite. Elle la trouvait simplement incomplète.
Les verbes défectifs lui posaient problème : elle m’expliqua que suivant les dictionnaires parfaire était un verbe défectif ne connaissant aucun des temps simples, ou bien un verbe inusité au passé simple mais acceptant le présent et le futur. Dans l’usage courant, elle ne le rencontrait qu’à l’infinitif (voir le rapport du jury de thèse). Or un verbe qui ne s’emploie qu’à l’infinitif la désolait.
Elle devint donc écrivain, parfaisant son et le français jour après jour, ligne après ligne. Pour ce faire, comme elle aimait dire, bien que cette expression soit peu heureuse elle le savait, elle s’expatria en France sous le prétexte de retrouver une vague famille qui s’était installée dans la région parisienne.
Elle travailla à mi-temps dans un zoo, mais bien qu’elle ait étudié l’éthologie des pucerons on ne lui confia que des tâches ménagères, passant avec son balai de la fosse aux ours aux cages des phasmes. Vous l’avez compris, elle était victime de cet a priori qui veut que les portugaises sans diplômes soient femmes de ménage.
Elle avait pourtant lu Fabre. Elle ne se plaignit pas de la situation qui lui laissait du temps libre pour écrire, et la mettait en contact avec une grande diversité d’animaux dont elle essayait de comprendre, parfois même de transcrire, les différents langages ou modes d’expression.
Elle rencontra Joseph Pasdeloup dont le nom ne pouvait que la séduire.
Hubert Lambert
Travail en cours, pour Le Lampadaire
Travail en cours, pour Le Lampadaire
NOUS (ne) SOMMES (pas)
NOUS (ne) SOMMES (pas)
ces fashions victimes
en costumes de cerveaux
dérives sertis de bouches
en débriefs incessants
sur des continents de
plastique
nous sommes animaux
de Faraday poussières
des horizons couchants
sur les toits aux antennes
vêtus nus ni rayés tachetés
ou mouchetés venus
des étoiles poudroyantes
à tout levant
Béatrice Brérot et Aaron Clarke
2015, série des petits livres pauvres
Confession d'un ange
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Nous, nous n’avons pas de langue, notre alphabet n’a que des lettres de lumière, notre syntaxe est le silence. La langue que j’utilise en ce moment n’est pas la nôtre, c’est votre langue humaine, l’une des nombreuses langues humaines en quoi s’est transformé, dans sa décadence, le silence des origines. Recourir à cette langue est pour moi comme sauter d’un nuage blanc dans un fleuve fangeux, comme me déplacer d’un entendement plein et transparent vers l’opacité d’une pensée qui, pour s’exprimer, a besoin de mots, de mots pauvres et marcescibles. Je renoncerai donc à la musique qui, dans notre monde, correspond à votre langue, et je m’en remettrai à des séquences de sons sans harmonie et toutefois nécessaires. Je n’ai pas le choix, si je veux que ma confession atteigne certains d’entre vous. Si je veux parler de la limite à laquelle je suis parvenu, après avoir fait durant des millénaires l’expérience de l’intelligence angélique et avoir participé à la glorification en chœur de Lui, principe et fin de l’univers (j’ai dit durant des millénaires, et je sais combien est impropre cette unité de temps pour une condition où l’existence n’a pas de mesure, et où le sans-limite est la qualité qui définit le temps comme l’espace).
Rien ne m’est arrivé au cours des événements qui séparèrent violemment du Ciel une partie de notre lumineuse communauté, événements que vous les hommes définissez du nom de chute et expliquez comme la conséquence d’une rébellion. En réalité, ce ne fut pas une véritable rébellion, mais la conscience du fait que l’Un était la célébration artificielle de l’infiniment égal, de l’absolu, de l’identique, et que le double, à savoir le haut et le bas, l’éternel et le transitoire, la lumière et les ténèbres, étaient des figures plus congruentes à la forme de l’univers, à son rythme, à son apparence. Et ce ne fut pas non plus une vraie chute, mais seulement le déplacement d’un point de vue, la germination d’une autre possibilité. En tout cas moi (en prononçant le plus utilisé de vos pronoms je sens combien il est faible pour définir une singularité dont la racine est dans l’appartenance et dans le chœur), moi, disais-je, je fus parmi ceux qui, tout en comprenant l’importance de l’ouverture et de la séparation, ne voulurent pas appauvrir le chœur, ne voulurent pas atténuer la musique de la prière ni soustraire aux silences qui habitaient cette musique la contemplation, et avec elle la plénitude de la béatitude. Je suis resté, en somme, avec les êtres célestes, et dans cet état j’ai vécu tout le temps que vous appelez évolution de l’univers, et également le temps que vous appelez histoire de la Terre, et de la civilisation. Mais maintenant j’ai atteint une ligne de frontière et je dois choisir une nouvelle condition. Je suis parvenu à cette conjoncture parce que dans la prière j’ai privilégié la musique plutôt que la louange, dans le silence le vide plutôt que l’attention. Et dans la contemplation j’ai fixé mon regard intérieur sur la beauté plutôt que sur la vérité. En somme, moi aussi au cours de mon existence je me suis déplacé hors du centre, aventuré à la marge, et à la surface, de l’essence. Disons que je suis resté ébloui, et conquis, par l’apparence. Dans mes pérégrinations j’ai contemplé la gloire sans fin des mers aux heures du couchant, les ciels de pierre au-dessus des déserts, la formation et la dissolution des nuages sur les chaînes de montagnes et sur les forêts. J’ai vu passer d’innombrables saisons, chacune dans ses différences de lumière, de son, de pluie, avec sa façon particulière d’attendre la saison suivante. De chaque saison j’ai senti le souffle, caressé l’âme : du vent et des ombres je distinguais tous les degrés. Mais j’ai vu aussi la douleur de votre monde animal, la propagation de la cruauté et l’abondante stupidité dans votre espèce humaine. Maintenant, sur la ligne de cette frontière où l’amour pour l’apparence m’a conduit, je dois choisir l’une des formes dans lesquelles vous les humains avez résumé et représenté notre nature : si j’ai aimé l’apparence, c’est en elle que doit s’effectuer mon choix, ma métamorphose. Les deux formes conjointes dans lesquelles vous nous avez représentés sont l’animale et l’humaine : le vol et le visage, les plumes et le regard, les ailes et le chant. En réalité il y a aussi un troisième élément dans votre représentation des anges : l’élément spirituel, la relation avec le céleste, l’appartenance au divin. Mais dans cette direction qui, isolée, ne serait que privation de forme, il m’est interdit de me diriger. À ce stade, des deux autres mondes qui s’offrent à ma métamorphose, c’est le monde animal que je perçois comme le plus proche de ce que je ressens. Parce que la bête garde encore en même temps une part d’énigme, d’innocence et d’étonnement. Et elle est capable d’une pensée à laquelle les hommes ne peuvent parvenir, une pensée qui, sans langue, se nourrit d’un dialogue assidu avec toutes les formes de la nature, sans rhétorique connaît la proximité avec l’âme des choses, sans le Moi perçoit ce lien entre singularité et appartenance que vous autres hommes ne reconnaissez pas et que vous vous efforcez d’annuler. Je n’ai pas encore choisi la forme animale ni l’espèce en quoi transférer ma nature. Je pourrais être un oiseau aux grandes ailes blanches ou irisées, mais ceci rappellerait de trop près vos représentations angéliques, ou je pourrais devenir une panthère, un chevreuil, un tigre, un dauphin ou l’une des innombrables créatures animales qui peuplent la terre et la mer. J’accepterai la douleur et la blessure qui sont inhérentes à ce passage, je glisserai par nécessité et presque avec désir dans la condition mortelle, qui vous est commune aussi, mais j’aurai la consolation de rester quand même au-delà de cette surface du sentir et de cet égoïsme de l’agir qui est la condition la plus répandue parmi vous, les humains.
Cette confession, exposée dans votre langue, n’a qu’un but : faire savoir que parmi les espèces animales l’humaine est désormais privée de tout attrait. C’est vrai, dans notre monde angélique il nous est parfois arrivé de subir la fascination humaine : quelqu’un de mon chœur, dans le passé, est descendu parmi vous et resté parmi vous, attiré par le parfum d’un corps féminin. Mais aujourd’hui, nous vous regardons avec indifférence, nous cherchons même à nous protéger de l’ennui de votre monde. Et pourtant, que ce soit moi ou ceux qui sont parvenus à la même frontière que moi, au même choix, nous ne désespérons pas de pouvoir un jour vous rencontrer. Ce sera lorsque, une fois abandonnée la prétendue supériorité de votre genre humain, et apprise des animaux la forme profonde de la pensée, vous serez prêts vous aussi à une métamorphose.
Antonio Prete, « Confession d'un ange »,
L'ordre animal des choses,
traduit de l'italien par Danièle Robert,
Les éditions chemin de ronde, collection Stilnovo, 2013.
L'ordre animal des choses,
traduit de l'italien par Danièle Robert,
Les éditions chemin de ronde, collection Stilnovo, 2013.
publié avec l'aimable autorisation de l'éditeur
Le souffle du manque
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
La place était très vaste, une place ovale, entourée de palais hauts et blancs, une fête de persiennes vertes tout autour, sur le pavé des îlots d’orangeraies, au-delà des corniches un ciel perdu dans son bleu cobalt, un ciel mourant dans les grandes mains du soir : le lointain, qui apparaissait dans une trouée entre les constructions, au bout d’une rue escarpée, était bleu, comme tout lointain, et lui aussi était mourant dans l’étreinte du soir. Toutes les tables du café étaient peu à peu tombées dans l’ombre, la mienne était la dernière à retenir encore un peu sur le verre de prosecco la lumière de la fin juin, la partageant avec le chien qui était resté tout le temps tranquille et couché à mes pieds, à suivre d’un œil très mobile le mouvement des voisins. Maintenant son dos brun-noir et brillant allait lui aussi se confondre avec les ombres qui envahissaient la place.
Ce fut à ce moment, exactement quand le vol noir d’une hirondelle déchira l’air en fondant au cœur de la place pour remonter d’un coup, ce fut alors que je ressentis, soudain impétueux, un vide qui battait dans mon estomac en demeurant vide, un vide implacable, de là se répandant dans mes veines et mes pensées, s’infiltrant dans mes souvenirs et ma respiration, un vide qui était manque et désir en même temps, perception du fait que ce qui est perdu est perdu pour toujours, perception accompagnée d’une affection immense pour l’objet perdu qui, lui aussi, semblait vide, c’est-à-dire privé de nom et même d’essence, pur manque dispersé dans l’air du soir.
Cela arriva de nouveau, à quelque temps de là, dans une autre ville, la route était fermée à la circulation car c’était jour de marché, le long des bancs de fruits et légumes les voix se pressaient, dans les kiosques de bois, derrière les piles de fromages, les marchands offraient aux clients des morceaux à déguster. Je venais d’entrevoir une ruelle latérale où me replier, et une fillette m’effleura, haletante, elle demandait si quelqu’un avait vu son chat roux qui était descendu dans la rue et s’était perdu au milieu des gens, ce fut alors, tandis que je tournais sur le trottoir de l’autre rue et que je voyais que la fillette avait tourné elle aussi et avait aperçu à ce moment son chat et l’appelait et allait le rejoindre, maintenant que le chat s’était arrêté sur le seuil d’une porte pour se laisser rejoindre, ce fut alors que, plus violent encore qu’auparavant, revint le vide, effrayant comme un abîme. Mais cette fois, sans presque s’attarder dans l’estomac, il évoluait vite vers une abstraction vague et diffuse, s’insinuant dans mon regard et mes pensées, de sorte que la rue devenait une rue de n’importe quelle ville du monde, avec la lumière de midi qui gommait les différences entre les palais et recueillait toute chose dans un lointain sans contours, sans limites, et moi j’étais là au milieu de ce lointain, avec mon vide qui était même alors une grande bulle d’inexistence, au centre de laquelle tournoyait le sentiment, ou peut-être l’idée, d’un manque immense, d’une privation que rien ne pouvait combler, et tout ceci était douloureux, était asphyxiant.
La chose se répéta un soir au théâtre, au beau milieu d’une célèbre romance qu’un ténor caressait avec volupté et lançait vers le public, elle se répéta un après-midi alors que j’emmenais mon chien dans les jardins, et encore un matin d’hiver pendant que je réchauffais le moteur de ma voiture, et que l’essuie-glace balayait la neige fondue, elle se répéta bien d’autres fois, et chaque fois le vide était plus vide, une étendue infinie de sables irréels s’ouvrait toute grande, sans mirages à l’horizon.
Aujourd’hui, il y a quelques années que ce délire d’absence s’est comme dissipé, semble s’être évaporé en lui-même, vide d’un vide. C’était surprenant : au fur et à mesure que les assauts s’espaçaient, la perception du vide, de sa violente irruption dans le corps, abandonnait l’instant, perdait le lien avec le paysage et avec ce qu’il y avait autour, et alors il arrivait que les choses retrouvassent très lentement comme une présence, comme une maison à elles dans la présence, et cette présence avait une sorte d’irradiation : c’était, pour ainsi dire, une lueur de consistance. A partir de ce moment les fenêtres des immeubles, le vol des hirondelles, la foule du marché, la lutte et l’étreinte de la lumière et de l’ombre, tout paraissait participer, de sa place, à une nécessité, l’éclair de l’apparaître mettait sur toute chose une brillance vibrante, même si provisoire.
Le manque qui, comme le vent sur un arbre, s’était abattu à plusieurs reprises sur mon corps et dans mon esprit, n’était plus la perception d’un moment. Le frisson qui auparavant déflagrait en un instant était devenu maintenant persuasion que l’existence même, l’existence des individus et l’existence universelle, coïncidaient avec ce manque : la respiration même du monde n’était autre que le souffle de ce manque. Qu’était en effet l’apparaître sinon l’impossible somme de vides infinis?
Ainsi, sur fond d’un Manque absolu, sans commencement ni fin, les corps et les choses m’apparurent enfin comme le surgissement d’une apparence temporaire et pour cela précieuse, comme le vent d’une présence fugitive et toutefois touchée par la chaleur de la proximité.
Maintenant je pouvais apercevoir le sourire de la fillette à l’instant où elle retrouvait son chat.
Antonio Prete « Le souffle du manque »,
L'ordre animal des choses,
traduit de l'italien par Danièle Robert,
Les éditions chemin de ronde, collection Stilnovo,2013.
L'ordre animal des choses,
traduit de l'italien par Danièle Robert,
Les éditions chemin de ronde, collection Stilnovo,2013.
publié avec l'aimable autorisation de l'éditeur
Quand tu dormiras, je chanterai
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Il entra dans l’arène et remarqua inquiet que l’autre avait des éperons courbes comme des épées mauresques. Tout en fer, brillante, pointue, la cuirasse de son adversaire couvrait entièrement la surface de la tête et des membres inférieurs. Il pensa à lui-même, à ses armes. Il pensa également à la raison pour laquelle les mains dans les tribunes étaient si nerveuses : elles soulevaient des nuages de poussière, se débattaient et empoignaient l’air, ne rappelant aucunement celles qui en d’autres temps, éclairées par des flammes, faisaient naître des oiseaux noirs sur un mur blanc en guise d’écran. Ces mains l’avaient toujours intrigué. Il pense : « En plus de voler comme des oiseaux aux plumes d’ombre, ces mains crient comme des corbeaux. Elles doivent être tes sœurs ». Les cris venus des tribunes résonnent aux alentours, l’autre le provoque, agitant vers la droite et vers la gauche la cape, la queue multicolore. Mais il ne se laisserait pas prendre à cette ruse. Il se contente de suivre son double avec des mouvements pendulaires du cou, protégeant son flanc, croisant le fer, levant l’aile droite comme un bouclier ou une barrière placés très au-dessus de la ligne de la tête. « Attention à ta tête », disait Conceição. « Si l’aiguille la pique, nos efforts n’auront servi à rien». Il se souvient avec quel soin Conceição et l’enfant donnaient des coups d’aiguille afin de contourner son crâne, éviter d’abîmer les vertèbres de la colonne tout en cassant et rompant la résistance de la coque et de la membrane à l’intérieur de laquelle il flottait. Il voyait, immergé, que tout ce qu’il connaissait était sur le point de se fragmenter, se briser. La membrane vola en éclat. Le fluide s’écoula. Le premier souffle pénétra dans la racine des poumons. Pour la première fois, il se tint fermement sur ses deux pieds flageolants, il se sentit accueilli par deux paumes. Et celles-ci le soulevèrent jusqu’à la femme aux cheveux-plumes-gris-argentés, et le conduisirent – et tout était brillant – jusqu’au visage de Conceição qui reflétait la douceur. Il pense : « Comme elles étaient lisses les mains du garçon en ces temps-là ». Dans l’arène, la foule des mains resserre son étau sur lui et son adversaire, couvrant le sol d’une pluie de papiers verts qui rappelaient les feuilles des arbres. L’autre le regarde de haut, picore la terre qu’il raye furieusement, joue de la pointe de son bec en quête d’une brèche pour le planter dès le premier coup. Toutefois, sous les prothèses et protections métalliques qui recouvrent sa tête, il arbore une expression étrangement perdue. Le babil des mains s’amplifie, il poursuit et mime son double avec une totale symétrie de mouvements. Et avant même se songer à reculer, il sent la pression des paumes sous son bas-ventre et se voit subitement soulever dans l’espace, volant à contrecœur en direction des lames et des dagues. Une. Deux. Trois. Il s’éloigne, haletant après la quatrième estocade. Il se frotte les yeux, il sent un filet rouge et épais lui couler dans le cou. Il regarde devant lui : à son image et sa ressemblance, les plumes de l’autre arborent également un collier de sang. « Il se peut qu’elle l’accueille, il se peut qu’elle le tue », disait Conceição. « C’est le fils d’une autre mère, personne ne sait comment seront ses plumes». Conceição et le petit garçon le pose parterre, le territoire où il marche maintenant semble s’allonger, embrassant des étendues sans limite. Derrière un réseau de fils d’argent, montant en tresses jusqu’à des hauteurs où la vue se perd, une paire d’ailes se hérisse en pressentant son arrivée. S’il connaissait le mot exact pour définir leur ton et couleur, il dirait : « Nacre ». Mais il ne l’apprendrait que plus tard. Attentives, méfiantes, téméraires, les ailes de nacre se positionnent pour le combat, dans une posture défensive. Sans même comprendre la dangereuse ligne frontalière où il s’aventure, il traverse et saute; les ailes se tendent pendant une fraction de seconde, puis se décontractent, s’ouvrent, l’enveloppant à l’intérieur d’une texture fort semblable à celle des pétales. Une obscurité dense et accueillante l’embrasse et il se demande s’il ne pourrait pas retourner à l’intérieur de la membrane dont la femme et le garçon l’ont expulsé. Mais là tout était liquide, et ici, il y a seulement un air imprégné de reconnaissance. Là, en outre, ces étranges êtres sphériques qui maintenant l’entourent, recouverts d’un plumage jaune-or, n’existaient pas. Dans l’obscurité, il se vit encerclé par des yeux curieux, scintillants, minuscules : des yeux totalement différents de ces deux orbites flamboyants, qui – il le sait – veulent aujourd’hui, cet après-midi, et à tout prix, le détruire. L’autre essuie avec le bout des ailes le rouge qui sourd de sa poitrine, retient son souffle, aiguise ses éperons sur le sol. Et en examinant, pensif, son double et sa triste figure parcourue par des tremblements, il se rend compte qu’il ne lui reste qu’une seule alternative. En effet, derrière lui, dans son dos, les mains grandissent et se rapprochent. Derrière lui se dresse l’infranchissable barrière des mains : lugubres, calleuses, insensibles. « Tôt ou tard elles me pousseront en avant », pensa-t-il. Alors, il anticipe.
Il se pose sur l’autre comme un harpon, enfonçant le plus profondément possible les pointes des éperons (elles étaient courbes comme des épées mauresques). Il entend un craquement sec et sent quelque chose qui se brise. Il agit comme on le lui a appris, comme il est écrit : l’aile droite est le bouclier qui pare les coups ; la gauche est l’épée qui cingle ; et du ciel et du sol et de tous les côtés, le corps se déchaînera, rappelant les tempêtes vengeresses de grêle : ainsi était-il écrit. Il s’aperçoit que l’autre s’éloigne, le visage effaré et livide. Avec le pied droit, il le plaque contre lui, et maniant savamment son éperon gauche, il ouvre dans son ventre une série d’incisions précises. Une. Deux. Trois. Il entendait, il pouvait entendre quelque chose qui se brisait. Conceição comptait et rompait les épis de maïs, et ces grains tombaient sur lui et les autres, et la couleur du maïs se confondait avec celle de leurs corps, et les bouches recueillaient la nourriture qui s’éparpillait parterre et dans les herbes. Et les ailes de nacres circulaient aux alentours, protectrices, tranchant et picorant. Et lorsque le soleil avait définitivement décliné, lorsque les frères se rassemblaient derrière l’écran aux fils d’argent et la respiration rythmée de leurs corps était tout ce qui subsistait dans la nuit, il les voyait alors se matérialiser, prendre leur envol : oiseaux aux plumes d’ombre, planant au-dessus des murs blancs de la cuisine. Devant les flammes du poêle à bois, les mains de Conceição s’envolaient. Elles rasaient le public de la maison et du voisinage, qui s’était entassé sur les bancs et les tables, assistant presque sans cligner des yeux aux évolutions de ce théâtre de volatiles noirs.
Sur le sol, ses pieds froids. Devant lui, l’ennemi épuisé, éreinté. Opaques sont les couleurs qui colorent le monde, sa vue se trouble, et pendant un moment, il croit se battre contre deux ou trois. Mais il comprend que maintenant le double, au lieu de l’attaquer, lui tombe dessus et s’appuie sur lui comme une canne, et il s’aperçoit qu’il s’effondre également sur le corps de l’autre, tous deux tournant autour d’un axe imaginaire, se dissolvant et piétinant une flaque faite de leur propre essence. « Ne regarde pas ça », dit-il à son reflet dans le liquide. « Ne regarde pas ça », disait Conceição. Le corps gisait de tout son long à l’intérieur du chaudron, son dos coupé par une entaille à travers laquelle son dernier souffle s’échappait. Frictionnant sa peau à une cadence impitoyable, les doigts de Conceição arrachaient les plumes, les jetant en l’air. La lumière les traverse avant qu’elles se posent; il reconnaît sa couleur, sa texture, cherche le mot exact pour la nommer et soudain dit en lui-même : « Nacre ». Car il l’avait appris et maintenant il le connaissait. « Ne regarde pas ça », disait Conceição au petit garçon : « Cette cuisine est infestée ». Les prochains après-midi, les prochains jours lui apporteront l’humeur cyclique des vents : glaciaux, lents, enflammés. La roue des vents tournait, autour d’elle les saisons se succédaient, et s’enfuyant et tournant le dos à la femme et à ses mains, il se sentait capable de faire des pas toujours plus grands. Les frontières du monde rétrécissaient. L’écran en fils d’argent se rapproche. Un jour, pour sa surprise, il se vit soulever dans les airs : c’était son propre battement d’ailes. Et en se posant sur une poutre en bois, il contempla orgueilleusement ces deux membres, revêtus de plumes multicolores et pointues.
Son double le regarde. Comme Conceição le regardait. Le double tourne autour de lui. Comme elle, de loin, tournait autour de lui. Lorsqu’elle apportait la pluie de maïs. Lorsque, sournoise, elle s’approchait. Recroquevillé sur ses blessures, le double l’examine d’un coup d’œil. Porte-il avec lui le poids des souvenirs ? Le corps dans le chaudron, les plumes piétinées : en se les rappelant, il prenait du recul, il s’envolait loin de Conceição. Mais elle persiste, fait intrusion sur son territoire, ouvre le portail, s’assied dans un coin sur la paille et là se perd dans ses pensées, l’assiégeant avec le poids de son regard. Le double boite, il a la jambe droite réduite en miette. Les mains crient et se pressent contre l’arène. Alors, c’est la charge, le saut dans ces deux mains chaudes comme des flammes, et lui surpris et prisonniers parmi les nœuds de cette maille de doigts : il aperçoit sur les paumes de Conceição un bout de chair vivante, il lui assène une série de coups de bec rapides, essaie inutilement de se libérer (le double pâlit et se contracte).
Ils entrent dans la cuisine, lui est soulevé à un mètre et demi du sol. De cette hauteur, emprisonné dans les doigts et les paumes qui le soutiennent, il voit défiler à toute allure des choses qu’il ne sait pas nommer : tissus, ustensiles, objets suspendus. Sa poitrine frappe, bat la chamade et peut-être parce qu’on sent et redoute cette cadence, les deux mains commencent à l’abaisser. On le descend, on lui présente une écuelle remplie de grains dorés et en goûtant le premier, il s’aperçoit qu’il est fait dans la même matière que ceux qui tombent sur son dos et celui de ses frères, les après-midi et les matins. Il mange et dévore le maïs, en même temps qu’il sent la caresse des doigts de Conceição, qui lui frottent les plumes du dos dans un mouvement de va-et-vient. «Ne regarde pas ça », dit-elle au petit garçon qui épiait déjà. « Nous voulons rester seuls. » Alors qu’il nettoie la gamelle, il est à nouveau ramassé par les mains. Et comme Conceição montrait, disait et enseignait les noms, révélait et cataloguait le monde, tout était brillant : l’image de São Benedito, gardien de la cuisine, derrière laquelle se cachaient les allumettes, la carafe d’eau avec à côté d’elle la canette cabossée en aluminium, les chamoisines brodées, les azulejos verts provenant de l’autre bout de l’océan, le poêle à bois, forge qui respire et éclaire, et lui – à partir de cet instant – empruntait des chemins ouverts par la femme aux cheveux-plumes-gris-argentées, suivant ses pas depuis le lever du soleil à la tombée de la nuit, tous les jours.
Il se dit à lui-même que si le double continue à flâner de cette manière ingénue devant lui, toute garde baissée, les ailes arquées, la démarche sans fermeté et indécise, l’affaire sera entendue en peu de temps. Il décide d’attendre. Le sang de l’autre coule et imprègne le sable. « Ainsi, il s’écroulera bientôt comme un sac vide » pense-t-il. Il vaut mieux attendre. Il sait qu’il est blessé lui aussi, mais les années passées dans l’arène lui ont appris que jusqu’à un certain seuil – qui était ténu, et dont la juste appréciation différenciait les grands combattants -, n’importe quelle blessure était réversible et pouvait être guérie. Il regarde la trace laissée par le sang de l’autre. Il calcule. Derrière la tête du double, des nuages traversent le ciel, encadrent son profil dans un grand panorama bleu. C’était comme si la forme des nuages, leurs dessins et leurs reliefs se regroupaient et entouraient cette tête qui rappelait une auréole ou l’annonce d’un sacrifice. Mais l’un des cumulo-nimbus s’obscurcit, prend une forme pointue; et avant qu’il puisse respirer, il sent quelque chose comme une broche embrasée se planter dans son ventre. Après avoir été soulevé et jeté au sol, après s’être redressé et avoir vu que l’autre riait d’un rire suicidaire, après avoir constaté qu’en vérité les nuages sont de mauvais augures et que le sable était maintenant trempé par son sang, il déduit que lui aussi a dépassé le point de non-retour.
Le petit garçon criait dans la nuit. Lorsqu’il avait été apporté, enfant, dans un panier et que Conceição l’avait accueilli dans les draps où elle dormait, les pleurs étaient noyés dans des gouttes d’eau sucrées s’écoulant une à une entre ses dents, qui se serraient, qui grinçaient. Cependant, avec le temps, avec la ronde de la roue des vents, les hurlements de celui qui avait grandi et dormait désormais sur le lit d’à côté s’intensifiaient, résonnant dans toute leur terreur à quatre heures du matin, comme l’appel d’un être prisonnier de quelque chose qu’il ne comprenait pas. La statue à son chevet ne servait à rien – « C’est une protection », disait Conceição en la posant; les prières, les bénédictions, les infusions de sauge étaient vaines; car les cris résonnaient, persistaient, réveillaient toute la maisonnée. Jusqu’à ce qu’une nuit, passant la main droite dans ses cheveux lavés par les sueurs froides, Conceição tira de je ne sais où une chanson oubliée, dont le dernier vers disait : « Quand tu dormiras, je chanterai ». Seule avec l’enfant entre des murs chargés de souvenirs (seulement eux deux étaient restés, les deux autres étaient partis), elle remarqua que ses bras se décroisaient et finissaient par pendre, flottants, et que tout son corps se tournait vers le coin, s’endormait. Elle tira les rideaux. Épia par la fenêtre. Vit que le matin s’ébauchait.
Au-dehors, suspendu sur un morceau de bois, il écoutait lui aussi la musique. Il sentait qu’une lumière en gestation dans les entrailles de la nuit, s’intensifiant derrière les crêtes de la montagne, éclairait non seulement et toujours plus la cour, le mortier, la machine à moudre la canne, mais également l’intérieur de lui-même; elle extrayait de lui quelque chose qui avait toujours existé : une volonté, une force ancestrale, une trépidation endormie. Quelque chose qui pour des raisons mystérieuses le démangeait maintenant de manière insupportable, de plus en plus intensément, quelque chose qui se précipitait avec anxiété dans ses veines en direction de sa gorge avant de quasiment exploser comme un spasme, un emportement, une volonté inexorable et incomprise. Il accommoda ses pieds sur le perchoir. Il se remplit les poumons, il sentit quelque chose fleurir en lui. Il vit par la fenêtre la silhouette de Conceição qui câlinait le petit garçon. Et lorsque le cri explosa enfin et jaillit de sa gorge, résonnant sur le faîte des toits, il réalisa que pareille à la femme qui veillait, tout son être semblait affirmer : « Quand tu dormiras, je chanterai ». Il répétait ce vers à plein poumon. Il chantait. Le soleil naissait.
Le coup atteint son double en pleine tête. Il arrache la couverture métallique qui couvre son visage, de sorte que la protection couleur de bronze voltige au loin comme un heaume jeté dans les airs. Mais la réaction ne tarde pas : le contrecoup est fulgurant, il revient désespéré, et tous les deux ont maintenant la tête découverte, le bec dénudé, les deux yeux nus et éblouis. Comme ils perdent leur sang, ils sont de plus en plus faibles au milieu de ces mains hystériques qui transforment leur vie en enfer, ils se flagellent l’un l’autre à l’aveuglette. Une à une, les pièces de son armature se brisent, tombent au sol, et il pense : « On dirait que c’était hier ». Dans un hier aujourd’hui lointain et perdu dans le temps, il suivait les pas de Conceição sur le plancher de la cuisine. Pliée sous le poids d’une brassée de bois, elle se traîne en direction du poêle – l’allume, souffle dessus, l’alimente, sourit en entendant le crépitement des étincelles qui dansent. Elle s’assied contemplative au coin du feu, mord dans un pain au maïs, le rompt avec sa bouche et les ailes sont blotties entre ses genoux. Elle ne voit pas la silhouette, ténèbres contre l’écran formé par les murs ; elle ne remarque pas, lugubres et calleuses, les deux mains qui s’étirent. Lorsqu’elle pressent l’approche du petit garçon, elle pense lui dire : « Ne regarde pas ça », mais cette présence s’évanouit déjà. Et mordillant le pain de maïs, Conceição conclut que les cris qu’elle avait cru entendre n’étaient que les sifflements du vent secouant le toit et ses poutres.
Dans le jardin, le petit garçon se serre la gorge, étouffant le dernier appel au secours. L’autre main descend à terre, manipule une série d’ustensiles brillants qu’il n’avait encore jamais vus. La main brandit une pièce (longue, recourbée, à la pointe aiguisée) et l’emboite dans l’éperon gauche : sa jambe lui pesait désormais. Et cette sensation presque intolérable de lourdeur se diffusait dans ses deux pieds et sa tête, opprimant son cou comme un fardeau, entraînant la chute de son corps sans attache sur la place, le faisant osciller d’un côté à l’autre, tant celui-ci supportait à peine le capuchon, les bottines et les poignets en acier. Il tombe. Par les trous de la cotte de maille, il entend des rires étouffés. Il regarde en direction de la cuisine. Il veut appeler Conceição, manger le maïs, se reposer à nouveau aux pieds de la femme et de São Benedito. Mais elle n’écoute pas. Il y a longtemps qu’elle n’écoute plus. Conceição, ligotée, stérilisée, prisonnière de sa chaise, les épaules inertes et la tête blême plongée dans la brume.
Sa jambe gauche donne un coup dans la tête du double, qui tombe à genoux. Mais il ne s’aperçoit même pas de la chute de l’ennemi. Il fixe un hier lointain, un jardin, les mains du petit garçon : cet après-midi, elles portent des coupures et des cicatrices, qui n’ont pas toujours existé. Il voit une terre entrecoupée de grillages, où des mains le soulèvent à nouveau, mais d’une autre manière : avec la technique d’un soldat et la rigueur d’un maître d’armurerie. Il sent le garçon – ou celui qu’il est devenu – laver et polir l’habit en métal. Il voit une gousse d’ail entre ses deux paumes. Il accepte, picore et avale l’offrande, un feu brûle son ventre : il remarque alors que monte en lui un goût, une assurance, une colère sourde et un désir de se battre. L’armure en cuir et en bronze est belle. Les entraînements se succèdent. Au cours d’une longue succession de fins d’après-midi, leur sont présentés les stratagèmes, les coups, les techniques. Les manières de saigner et résister. L’armure semble se nourrir de sa chair, parfaitement intégrée au cou et aux membres inférieurs. Légère désormais, flexible comme une seconde peau, ajustée presque avec la minutie et le soin d’un orfèvre. Le petit garçon le met sur ses genoux. Il désigne un cercle dessiné dans le jardin. Ils marchent ensemble dans cette direction. Les mains le posent. En regardant sur les côtés, il se sent entouré de centaines d’autres mains. Il met les pieds dans l’arène pour la première fois et pendant un temps, il croit être devant le reflet de sa propre image. Mais il reste statique, pendant que l’être devant lui bouge : il s’agite comme un étendard de guerre, une queue de toutes les couleurs. Il entre dans l’arène. Il remarque inquiet que l’autre a des éperons courbes comme des épées mauresques.
Le double ne respire plus. Et lui, piétinant ce corps inerte, essaie d’avancer en direction du dernier reflet de la maison et de la cuisine. Il voit Conceição blottie contre le poêle à bois. La vieille tremble, retourne une bûche, les flammes crépitent, brillent, le soleil décline. Solitaire, privée du public des jours passés, Conceição lève les deux mains en l’air. Et elle pense : “Ne regarde pas ça”. Mais elle aperçoit le premier d’entre eux, ses ailes, ses plumes d’ombre déployées, son dos qui prend son envol en traçant des courbes sur les murs. Conceição contemple ses propres mains. D’autres oiseaux prennent leur essor : planant sur le toit, le sol, de tous les côtés, ils rappellent un vol d’oiseaux migrateurs en quête de chaleur. Noirs comme des corbeaux, ils crient, dansent autour du feu. Leurs formes, qui s’agrandissent, recouvrent peu à peu le toit, les casseroles en cuivre et les briques blanchies. Elles s’étendent sur les tissus, les ustensiles, sur le vert océanique des azulejos, et unis dans un seul corps, fondus soudain en un tout, ils descendent et s’obscurcissent, se posant même sur le saint protecteur. La nuit brise les vitres. Recouvre les herbes. Le maïs. Le pilon, la machine à moudre la canne. Elle baigne la terre, ses tons de nacre. Et une membrane, fort ressemblante à celle dont sa mère et son fils l’expulsèrent, dresse à nouveau ses murs. Dense et sombre, le fluide le soulève par les jambes, par le dos, par le cou. Les contours du jardin disparaissent. Une silhouette se dessine dans l’obscurité. La membrane se referme, le dernier souffle s’échappe de la racine de ses poumons. Il essaie de tenir fermement sur ses deux pieds flageolants, mais il vacille; et partant à la dérive, suspendu dans ce liquide, il parvient encore à entendre un son : le tournoiement de la roue des vents, son engrenage, son souffle glacial, avançant sur la terre comme le galop de légions en marche.
Krishna Monteiro, « Quand tu dormiras, je chanterai»,
Ce qui n'existe plus, 2015, Tordesilhas, São Paulo.
Traduction du portugais (Brésil) pour Le Lampadaire, Stephen Chao, 2015.
Ce qui n'existe plus, 2015, Tordesilhas, São Paulo.
Traduction du portugais (Brésil) pour Le Lampadaire, Stephen Chao, 2015.
« En effet, les coqs de combat, les faucons de chasse et tous les oiseaux qui, par la main de l’homme, ont été forcés aux joutes guerrières seront également susceptibles d’être armés comme des cavaliers. » Traité médiéval de fauconnerie et autres arts, 1386
Mutation d'un bipède sans plumes
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Mercredi 20 août, 15h30
T. Ezna, interne psychiatre
T. Ezna, interne psychiatre
10h50 : arrivée du patient aux urgences psychiatriques, attaché par l’équipe du Samu.
Homme, 1m75 environ, corpulence moyenne, la quarantaine. Nu sous un large pull en laine, état d’incurie extrême. Identité inconnue.
Le rapport de police fait état d’une agression du patient sur une femme dans la rue Saint-Barthélemy. Circonstances floues. Il aurait été surpris pourchassant ladite femme à quatre pattes, après l’avoir mordue au mollet gauche.
À son arrivée dans le service, l’équipe médicale constate que le patient urine et défèque à même le matelas, tente de manger ses excréments, émet des sons rauques lorsqu’on l’approche. Présente un état d’agitation important. Ne semble pas avoir accès au langage.
À ma demande : analyse d’urines et bilan sanguin classique, ainsi qu’un électrocardiogramme initial. Lors des prélèvements et examens, l’homme tente de mordre les infirmiers à plusieurs reprises. Injection de 2 ampoules de Loxapac. Passé 30 min. le patient s’endort. Profitons de l’état de sommeil pour pratiquer un scanner cérébral.
Résultats d’analyses : bilans sanguins normaux, absence de toxiques dans le sang et les urines. ECG initial et scanner normaux.
15h : patient transféré en service psychiatrique pour une durée indéterminée, protocole de contention.
Hypothèses médicales, compte-tenu du bilan somatique normal :
- déficit cognitif, syndrome autistique sévère ?
- schizophrénie non traitée avec phénomène d’hallucination intrapsychique ?
Tu es traité comme un moins que rien, de la viande, de la merde. Ils se jettent sur toi, t’attachent, te piquent, te perfusent. Ton corps ne t’appartient pas. Leurs bras sont puissants, sentent la javel, comme les murs, comme le sol. Ça empeste la propreté artificielle. Ils te font mal, s’en foutent.
Ne veulent rien entendre, tu cries ils se rapprochent, affirment leur force. Tu veux qu’ils s’éloignent. Rien à faire.
Ils pensent tout savoir, comme si leurs connaissances médicales leur donnaient le pouvoir de décider de la vie qu’il faut mener. Je les emmerde.
Tu te réveilles attaché à un putain de lit dégueulasse, plein des tâches des odeurs des autres, de tous ceux qui sont passés avant toi. Leurs cris résonnent encore. L’air est moite, visqueux, ça colle à la peau, aux poils.
J’ai tout de suite compris. Impossible de mener la vie qu’on désire.
Tu as faim. Tu ne peux pas bouger. Tu te calmes et tu attends. Leur drogue est puissante, ça aide.
Jeudi 21 août, 7 heures
T. Ezna, interne psychiatre
T. Ezna, interne psychiatre
Examen clinique complet du médecin généraliste : normal.
Mutique, calme, faciès détendu. Encore somnolent.
Me suit bien du regard, mais ne manifeste aucune réponse langagière ou comportementale à mes questions. Dissocié ? Halluciné ?
Mange par terre, n’utilise aucun couvert. A uriné et déféqué sur le sol de la chambre d’isolement. N’appelle pas les infirmiers pour ses besoins.
Poursuite de l’isolement pour observation. Levée de la contention.
Introduction du Risperdal ce jour, à 1 mg le soir.
Arrêt du Loxapac en systématique, à administrer uniquement en cas d’agitation après avoir appelé l’interne de garde.
Prévoir IRM cérébrale et électroencéphalogramme.
Ce rêve où je reviens à la maison. Elle est toujours là, elles y vivent encore. Sophie et les filles. Elles m’accueillent comme si je n’étais jamais parti.
Je vois son sourire en demi-lune, me souviens des raisons qui m’ont poussé à la fuir. Je suis bien de retour, définitivement, je ne peux rien contre ça. C’est terrible. Son air hypocrite, sa façon de laisser entendre en creux qu’elle est une bonne mère, la meilleure épouse. Je veux lui dire quelque chose, les sons refusent de sortir de ma bouche pourtant ouverte. De toute façon, tout acte de parole serait assimilé à une tentative de désobéissance. Sournoise, hypocrite. Hypocrite. Elle transforme mes filles en des monstres d’apparence. À son image. Me laisse comprendre que je ne trouverai jamais mieux, que je ne la mérite pas plus que tout le reste. Je veux lui arracher les tripes à mains nues. Mais les filles sont là, me regardent, m’appellent « papa», me demandent de venir leur lire une histoire. Leurs visages si purs. Et je sais, je sais qu’elles n’y échapperont pas, qu’elles deviendront comme leur mère. Je ne peux rien y faire, pas même les prévenir, elles ne me croiraient pas, ne comprendraient pas. Elles sont trop jeunes.
J’ai peur d’elles. Je ne veux pas leur lire cette histoire, mais elles me dévisagent. De leur air tendre. Je dis « d’accord ».
Je ne suis plus attaché au lit. La chambre est froide, faussement blanche. Le cuir des sangles pendant aux barreaux, éclaté. Je suis trempé. J’ai soif.
Jeudi 21 août, 16h30
T. Ezna, interne psychiatre
T. Ezna, interne psychiatre
Nette amélioration comportementale. Bon contact. Calme. Bonne présentation. Demandes aux infirmiers adaptées autour de l’hygiène, des repas.
1er entretien contributif avec le patient. Compétences langagières de bonne qualité. Pas de désorganisation psychique. Discours cohérent.
État clinique somatique stable.
A déjeuné ce midi assis avec des couverts. Ne présente plus aucun comportement régressif.
Pas de phénomène hallucinatoire, aucun signe de dissociation psychotique.
Durant notre entretien, il répète à quatre reprises qu’il doit sortir pour retrouver quelqu’un. Quand je l’interroge sur son identité, son adresse, il ne répond pas. Pas davantage quand je lui demande où trouver, comment contacter cette personne. Je lui rappelle les raisons de son hospitalisation : l’agression dans la rue, son état de santé à son arrivée aux urgences, il n’émet aucun commentaire. Reste mutique en me regardant droit dans les yeux. J’énonce le souhait qu’il m’en dise plus le lendemain.
Alliance thérapeutique encore très fragile. Poursuite de l’isolement avec possibilité de sorties pour activités thérapeutiques en fonction de l’état clinique.
Augmentation du Risperdal demain à 1 mg 2 fois/jour.
Hypothèses médicales : bouffée délirante aigüe avec mécanismes psychotiques transitoires ou dissociation d’origine post-traumatique, hystérique. Syndrome autistique écarté.
Je dois retrouver les miens. J’ai bien fait de partir, de quitter cette vie qui était faite pour un autre. Pour celui qui aurait pu rendre Sophie heureuse ou se contenter de faire semblant d’y parvenir ou de faire semblant d’être heureux sans y parvenir. Ce n’était pas moi. Chaque soir à me demander comment sortir de là. Elle n’était pas si mauvaise, elle ne doit toujours pas comprendre pourquoi je l’ai quittée. Un éternel mensonge dont elle se convainc elle-même. C’est ce qu’ils font tous, autant qu’ils sont. Tu essayes à tout prix de paraître heureux, tu suis des principes qui t’échappent. Obéir aveuglément à un patron, s’humilier devant des objectifs qui ne te regardent même pas. Ingérer de la norme, en bouffer plus que tu n’en peux, la reproduire, la transmettre.
J’ai d’abord quitté ma femme avant de rencontrer Lila. Je n’ai pas été infidèle.
Je n’étais ni bouleversé ni abattu, comme on m’avait fait croire que je le serai. Un immense relâchement. Lila est arrivée après. Nous nous sommes tout de suite aimés. Elle n’aspire qu’à vivre, seulement ça. Se fout des apparences, ne me demande rien. Ne m’impose pas de jouer un rôle. Elle a deux fils, je les considère comme miens. Nous sommes heureux, n’avons de comptes à rendre à personne.
J’ai abandonné mon travail, sans lettre de démission, juste cessé d’y aller, de me déguiser, de mentir. Je n’ai pas besoin d’argent pour vivre. Plus envie de m’aliéner à cette société malade ni de dépendre de ses faveurs. Je n’ai besoin de rien. Les autres possèdent assez pour nous. Ils ont trop. Ce qu’ils n’utilisent pas, on peut vivre de ça. Tant pis si ça ne leur plaît pas, comme cette grosse qui voulait me virer de ses poubelles. Ils disent que je l’ai attaquée, qu’elle va porter plainte.
Vendredi 22 août, 8h45
T. Ezna, interne psychiatre
T. Ezna, interne psychiatre
État clinique stable. Légèrement sthénique, faciès crispé. Bon sommeil, bon appétit.
Capacités cognitives et langagières normales.
A entretenu une conversation ce matin, m’a immédiatement demandé de contacter sa femme pour le faire sortir. M’a expliqué l’avoir récemment quittée pour une nouvelle histoire d’amour. Refuse catégoriquement de parler de cette nouvelle rencontre. Présente une agitation anxieuse en parlant de cette dernière, répète qu’on doit la laisser tranquille.
Après l’avoir rassuré sur ce point, a consenti à me donner son identité ainsi que celle de sa femme : M. Sébastien et Mme Sophie Marin.
Augmentation du Risperdal à 3 mg par jour.
Les seuls êtres que j’aime sont dehors, ne savent pas où je suis, doivent être morts d’inquiétude. Tout le monde s’en fout ici. Personne ne pense à ce qui est bon pour moi, pour mes proches, pour Lila, pour nos fils. Je l’ai bien vu à l’air condescendant du médecin. Ils peuvent m’enfermer tant qu’ils veulent. Je m’en contrefous, je retournerai près des miens.
Ces espèces de maîtres à penser ne désirent qu’une chose : prouver que le bonheur, c’est leur modèle de vie lamentable. Ont-ils besoin que je m’incline, queue entre les jambes, pour leur montrer qu’ils ont raison ? Ont-ils besoin de me voir à terre, asservi, suppliant leur clémence ? Soit ; je leur ferai croire ce qu’ils veulent. Je m’engagerai à trouver un toit, puisqu’ils imaginent qu’on est plus heureux enfermé qu’à l’air libre. Ou mieux, je leur dirai que je compte m’installer de nouveau avec ma femme. Je jouerai les repentis, je sais faire. Ils n’auront pas d’autre choix que de me relâcher. Et je retournerai auprès de Lila.
Seuls les moments passés avec elle valent la peine d’être vécus. Seuls l’amour et la liberté. Pas les biens, pas la propriété, pas le mariage, pas leurs institutions, pas le travail. Pas la somme de ces aliénations consenties.
Ils vont appeler Sophie, elle signera les papiers pour me faire sortir.
Vendredi 22 août, 14h15
T. Ezna, interne psychiatre
T. Ezna, interne psychiatre
Après l’entretien avec M. Marin, ai contacté sa femme, Mme Sophie Marin. Cette dernière a immédiatement souhaité me rencontrer.
Elle arrive à l’hôpital moins d’une heure après mon appel, dans un état de grande nervosité. Elle m’apprend qu’elle et M. Marin sont actuellement en instance de divorce, qu’elle demande pour le motif d’abandon du domicile conjugal. M. Marin les a quittées, elle et leurs deux filles, six mois plus tôt. Elle ne lui a plus parlé depuis.
Quand je lui demande les raisons du départ de son mari, elle évoque le décès de sa mère deux années auparavant (dont il était très proche, deuil qui l’a accablé de chagrin, ce qui a grandement affecté leur vie de couple), puis le décès de leur chienne Toupie à la suite duquel il aurait, selon les termes de Mme Marin, « pété les plombs ». M. Marin serait alors devenu mutique, aurait cessé de s’alimenter, de se laver, de se vêtir. Un matin, il est parti, sans affaires, sans papiers ni argent.
À l’évocation de la nouvelle compagne de son mari, Mme Marin fond en larmes. Elle m’explique que, après de longues recherches, elle a fini par retrouver son mari sous un pont de la ville voisine. Selon elle, c’est là qu’il vit désormais depuis au moins huit semaines. Elle a effectivement constaté qu’il n’était pas seul.
Apparemment désorientée, elle me demande de préciser ce que j’entends par le terme de « compagne », si ce sont bien les mots qu’a utilisés son mari. Je lui réponds par l’affirmative. Elle se tait un long moment, paraît en état de choc.
Mme Marin me montre alors une photo de lui qu’elle a prise à la demande de son avocat : on le voit lové, sur un amas de cartons, à demi nu, contre un chien. Il y a deux autres chiens derrière eux.
Il me faut un bon quart d’heure pour calmer Mme Marin.
Je l’informe que, selon toute vraisemblance, M. Marin souffre d’une dissociation d’origine traumatique avec un dédoublement de personnalité dont il n’a sans doute pas conscience. Son état nécessite de poursuivre l’hospitalisation pour observation et affirmation d’un diagnostic.
Mme Marin se dit prête à remplir un dossier pour hospitalisation à la demande d’un tiers.
Je la sens, elle est là, je reconnais son odeur. J’ai entendu ses pas dans le couloir, elle a dû aller dans le bureau du toubib.
Il faut que je me prépare, ils vont venir me voir. Que je joue le jeu, que je montre le visage de l’époux docile qu’elle a toujours connu. Elle va demander où j’étais. Je ne parlerai ni de Lila ni des garçons. Je dirai que je m’étais égaré, sans préciser davantage. Que je suis prêt à revenir.
Il faut que je me concentre sur ce dernier point. Elle a besoin de ça, de cette vie normée avec son mari, son jouet domestique. Elle va signer les papiers, ils vont me faire sortir.
Alice Azzarelli,
Mutation d'un bipède sans plumes,
Le Lampadaire, 2015.
Mutation d'un bipède sans plumes,
Le Lampadaire, 2015.
Biographie de quelques auteurs du Lampadaire.
2. Joseph Pasdeloup
NOUVEAUTÉS
Joseph Pasdeloup avait été un enfant maussade. Son père, être exécrable, imbu de lui-même, alternait crises d’autorité et démonstrations de tendresse. Pour échapper aux ordres absurdes et à la mélasse sentimentale, le jeune Joseph Pasdeloup (que son père appelait, lors de ses accès d’affection, Josephette ou Josy) se réfugia dans la lecture et particulièrement celles des livres de mythologie. Échapper ? Il le crut longtemps.
Enfant, il connaissait tous les noms des dieux et déesses de la mythologie gréco-latine, leurs destins, leurs légendes. Adolescent, il insista pour étudier le latin et le grec, ces deux langues qu’on lui disait mortes. Attrait pour la mort, goût de l’inutile, apprentissage d’une langue qui lui garantissait l’impossibilité de communiquer ? Quelle fut sa motivation profonde, il se refusa toujours à le dire, mais le fait est qu’il excella dans l’étude de ces langues qu’il disait imparlables.
Fort de ses connaissances livresques, il s’attaqua, avec un enthousiasme inhabituel, à la représentation picturale de ses héros. Il commença par peindre Jupiter. Mais ce portrait (en pied) déclencha un tel fou rire chez les membres de la famille Pasdeloup, que son élan fut arrêté net. Précisons qu’un ami de la famille possédait un chien, un colosse de la race des Mastiff, nommé Jupiter. Lorsque, fièrement, sa peinture à la main, Joseph avança vers ses parents et annonça « J’ai peint Jupiter », tous pensèrent voir l’extraordinaire animal ; ils virent le grand Zeus-Jupiter lanceur de foudre, un éclair à la main. Ils rirent.
De quoi, se demanda Joseph, de l’écart abyssal qu’il y a entre un chien même mastoc et le roi des dieux, de la maladresse de sa production, de sa bizarrerie mythologique, de la bêtise qu’il y a à donner un nom de dieu à un chien? Non, Joseph le comprit aux quelques phrases qu’il prononcèrent, ils rirent à l’idée que, sans le savoir, lui, le récalcitrant Joseph, venait d’honorer la suprême autorité, celle du père.
Joseph, catastrophé par cette interprétation qui ruinait tous ses efforts, retourna à la maussaderie. Il réalisa que tout acte est porteur d’une charge symbolique, que créer, parler c’était donner le champ libre aux interprétations malveillantes, ironiques, faciles. La peinture c’est fini, dit-il. Restons improductif. Mieux vaut être le chercheur que le cherché.
Cet épisode eut une autre conséquence, tout aussi décisive, sur son rapport au monde : lui qui connaissait toutes les métamorphoses des dieux, il n’avait encore jamais pensé que les animaux qu’il croisait pouvaient être une de leurs incarnations. Depuis cette révélation, Joseph Pasdeloup se mit à hanter les zoos pour chercher chez les animaux ce qu’il ne trouvait pas chez les hommes : la divinité.
Jeune homme, en quête d’indépendance il arpenta nuitamment la ville à la recherche des animaux de papier que des peintres, va savoir pourquoi, marouflaient sur les murs arlésiens. Il voulait commencer une collection, s’emparer de ces figures qu’il ne s’accordait pas le droit de peindre lui-même. Il n’y parvint pas : les décoller c’était les déchirer. Ils appartenaient aux murs, les en ôter c’était les priver de leur sens. Au lieu de les thésauriser, il leur rendit alors hommage in situ, cherchant à entrer dans leur histoire. Il déposa des offrandes devant l’image d’un chien, un chien loup sans doute, noir sur fond blanc, qui semblait garder l’entrée d’un hôtel particulier, il lui reconnaissait une âme car il s’appelait Sam (son nom était noté en haut à droite). Il chercha à ouvrir la porte verte à vulgaire serrure dorée sur laquelle était apposé un cheval-poney rayé vert, blanc et bleu, la gueule tournée vers le passant comme l’invitant à entrer : la porte ne s’ouvrit pas. Il resta pétrifié, terrorisé devant un reste d’orang outang, bras accroché aux barreaux de la cage que semblait dessiner le reflet d’une fenêtre dans une autre fenêtre, un évadé peut-être atteint en pleine course, en plein cœur, le corps déchiqueté, cadavre accroché tragiquement à la prison qu’il tentait de fuir. Il s’appelle Gogo, l’inscription funéraire se lit sur le rebord du muret.
Quelles sont ces traces, vestiges, qui les dessine ? Pourquoi ces images ?
C’est pour répondre à ces questions, qu’il se décida à écrire.
Adulte, il publie au Lampadaire des textes dans lesquels on retrouve son obsession pour la mythologie et pour les images. Il continue ses visites au zoo, à la recherche de la déesse, de l’ondine, de la muse prise au piège animal. Il rencontre Maria Rantin en grande conversation avec un insecte.
« Un dieu peut-il vraiment se métamorphoser en insecte ? »
C’est la question que Joseph pose à Maria.
Hubert Lambert
Travail en cours, pour Le Lampadaire
Travail en cours, pour Le Lampadaire
Biographie de quelques auteurs du Lampadaire.
3. Perrine Poirier
NOUVEAUTÉS
Perrine Poirier est aveugle. Elle n’écrit pas, elle s’enregistre. Sa voix est rocailleuse avec un léger accent bourguignon, ce qui amplifie les /r/ de son nom. Elle s’écoute parler et en éprouve un grand plaisir.
Elle fait de sa naissance biologique un mystère, elle prétend être née sur un bateau, lors d’une croisière que ses parents auraient faite sur le Nil. Parfois, elle affirme que sa mère l’a mise au monde lors d’une traversée de l’Atlantique sur un paquebot transportant des émigrés. Parfois, elle se dit née en Argentine.
Toute sa famille a péri dans un naufrage. Elle avait dix-huit ans. Ses parents avaient décidé de lui fêter son anniversaire en mer. Un mauvais coup de vent fit chavirer le voilier. Ils périrent tous, sauf elle. Pour les honorer et porter leur deuil, elle changea son prénom et choisit de s’appeler Perrine. Sa cécité, survenue quelques temps après le drame, consacra sa naissance en jeune muse aveugle. Elle se dit ondoyée et présente comme un destin cette double naissance aquatique : la biologique et la poétique. Mais quand on lui demande si son nom, Poirier, est aussi un pseudonyme, elle répond par cette phrase dénuée de sens: « Car elle n’a pas péri Poirier. »
Dans son écriture, ou plutôt dans sa parlerie, elle est prolixe, prolifique, une sorte de grand tumulte, des vagues de remugle de varechs, des tempêtes accessoires, des annexes débordantes, un flot de sons sans sens, ce qui l’emporta, la noya, lui évita la noyade, cette eau qui coule sur la jeune fille, cette eau qui lui fait fête, c’est son anniversaire, les yeux obstinément fermés, les mains attachés, elle perd pied et ne sait ni d’où vient cette eau, ni quand elle l’inondera, ni quand on s’arrêtera de tenter de la noyer. Elle est aveugle et parle de peur, de plaisir, de torture et de dictature.
Perrine Poirier est une voyageuse. Sa maison, pleine de souvenirs plus ou moins exotiques en est la preuve. C’est une collectionneuse de séries, elle refuse l’unique. Elle fait de cette manie une conséquence de sa cécité. Voici comment elle l’explique : il faut deux yeux pour voir le relief, la distance, la position d’un objet dans l’espace. Elle ne les a plus. Mais elle a toujours deux mains. Ses mains sont ses yeux, cette affirmation serait d’une banalité d’aveugle, si elle ne l’avait théorisée à sa manière, par un long et compliqué raisonnement analogique qu’elle tente d’approfondir jour après jour.
Théorie de la bimanocularité simplifiée :
1. Les yeux et les mains ont en commun la particularité de former des paires et d’être des organes de la perception.
2. Puisque la vision binoculaire est ce mouvement des yeux qui rassemble en une seule image l’image produite, en léger décalé, par l’œil gauche et celle produite par l’œil droit, alors la perception bimanoculaire est ce mouvement des mains qui rassemble en une seule perception la perception de l’objet tenu dans la main gauche et celle de l’objet tenu dans la main droite.
3. Vérification de la théorie par une expérimentation en trois temps.
Premier temps : la tête bien droite, campé sur ses deux pieds légèrement écartés, le sujet (Perrine Poirier), tenant dans la main droite un objet identique à celui qu’il tient dans sa main gauche, tend les bras en position horizontale à hauteur et dans le prolongement des épaules, puis les rapproche lentement jusqu’à ce que les mains et les objets qu’elles contiennent se touchent. L’expérience est estimée satisfaisante quand les deux objets se confondent s’emboîtant l’un dans l’autre pour ne plus faire qu’un.
Second temps : dans une position plus tranquille, assise par exemple, le sujet (Perrine Poirier) tient dans ses mains les deux objets et effectue exactement les mêmes mouvements (main gauche, main droite) de palpation (reconnaissance des contours, de la forme, du poids, de la matière).
Troisième temps : extension de l’expérience. Une fois l’image de l’objet arrêtée dans le cerveau, reprise des temps 1 et 2 avec des répliques de l’objet, légèrement différentes.
Binoculaire. Bimane. Entrechoc. Gymnastique d’aveugle. Tâtonnement angoissé ?
Non, mesure du monde et de ce dont il est fait.
Somme des expériences = somme du monde.
C’est sur ce modèle qu’elle crée ses fictions, elle double et redouble ses personnages, les croisent et les superposent, pour tenter de fixer L’UNIQUE.
Le nommer.
Mais le souvenir de l’eau trouble sa perception, ses mains tremblent, les vagues, les frémissements, les ondes viennent flouter les contours, et L’UNIQUE se perd et s’éloigne.
Dysfonctionnements. Maux de tête, intermittence, fatigabilité, noyade.
Et Perrine recommence.
Gymnastique bimanoculaire, orthopsy, orthèse.
Dysfonctionnements. Maux de tête, intermittence, fatigabilité, noyade.
Et Perrine recommence
Elle ne raconte que ce qui lui plaît, et exige que ses paroles soient retranscrites sans retours en arrière ni corrections. Le lampadaire a suivi ses consignes et a publié son étrange récit : « Les enfants que j’ai eus ».
Perrine Poirier a toujours été un peu mythomane.
Elle ne pouvait qu’intéresser l’âme investigatrice de Fred Lucas qui la rencontra sur la coursive du bateau la ramenant, pour la xième fois, chez elle, enveloppée dans un plaid qui la protégeait de ce froid que l’on doit ressentir lorsque l’on s’adresse à la mer et qu’on en attend une réponse.
Hubert Lambert
Travail en cours, pour Le Lampadaire
Travail en cours, pour Le Lampadaire
Même Nancy c'est mieux
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
adoptée à 5
émancipée à 15
elle n'a jamais connu son père
elle n'est jamais partie à sa recherche
elle a décidé une bonne fois pour toutes
que son père était Lemmy Kilmister
elle ne fait jamais la bise
jamais
et ne croit pas à l'astrologie
même si les trois mecs qui ont le plus compté dans sa vie
étaient tous trois du signe des gémeaux
elle est veuve
elle a trois enfants
trois garçons
et y a trois ans jour pour jour
elle a fait un infarctus
en portant un morceau d'avion
pendant une mission intérimaire
les seuls êtres vivants qu'elle n'a jamais envie d'engueuler
sont les chiens et les plantes
ainsi qu'une corneille à qui elle file tous les matins un bout de croissant
c'est tristouille ce soir
c'est vraiment tristouille
taxi jusqu'à la gare sous une pluie très très fine
elle enchaîne clope-café-clope
adossée
à l'abri
la main droite sous son aisselle gauche
à s'abstraire dans les films que font les reflets
elle quitte Albi
elle a sa dose de crevards
son meilleur ami est devenu un gros enculé
non tu ne peux pas m’appeler maman
et non on ne peut pas baiser quand même
elle ne reviendra jamais dans cette région de merde
jamais
même Nancy c'est mieux
Heptanes Fraxion
Le Lampadaire, 2016
Le Lampadaire, 2016
Le chemin de la gare
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Cric, crac.
Voici ce qu’il y a ici.
De chez moi, longe le bâtiment blanc, gros et long pavillon de banlieue à quatre étages, au toit à deux pans de tuiles rouges de l’allée des coquelicots,
tourne à droite dans la rue Alfred Dequéant (le peloton nazi tire, les balles font des trous rouges un peu partout, il a 25 ans, je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand, sois heureuse, aies des enfants, quand même un boche c’est un boche dit maman et son père… des mains errantes écrivent sur les murs, des mains errantes lancent des tracts à vélo, dans les rues, des tapis d’écrits noirs, des cris rouges…),
traverse le terrain vague où les pas des voyageurs tracent un sentier de terre (les jours de pluie les pieds sont un peu boueux comme dans le bidonville tout autour, comme sur toutes les pelouses de la cité d’ailleurs où l’usage redessine les plans de l’architecte. Ça rue, ça rée, ça râle du talon et la tête fait non avec les pieds. On bat la semelle qui tire à hue et à dia. C’est un combat, je ne mets pas mes pas où l’on me dicte. Celui qui ne sait pas marcher dans la contre-allée ne mène pas son chemin à l’être de l’autre. Il est errant. Il aménage un pauvre appartement où il est seul au rendez-vous et ne ment pas quand il le faut. Albert dit : « Nous sommes en droit de dire que toute révolte qui détruit cette solidarité perd le nom de révolte et coïncide avec un consentement meurtrier. »),
à gauche prendre la rue du 11 Novembre (on passe d’une guerre à l’autre, le pied encore boueux du no mans land on remonte la tranchée, dans le trou il se tient les entrailles, il s’entortille les mains et les avant-bras autour des boyaux, un dernier râle tend les bras et tire sur le tout, dit le grand père, adieu la vie, adieu l’amour, adieu toutes les femmes, l’obus boueux souffle toutes les flammes),
marche entre d’un coté la voie ferrée et de l’autre côté les pavillons avec leurs potagers (où au printemps le facteur vend ses salades et ses radis. A la commande, il chausse ses sabots de jardinage, déterre le légume et l’enveloppe dans une feuille de France-soir. Je suis en chemisette et en short entouré d’un vol de hannetons le long de la voie ferrée. On court au soleil sur la terre),
monte la butte en terre du pont de la rue Noël Pons,
passe dessus à droite,
suis cette longue rue bordée d’un côté d’un mur en béton et de l’autre en briques ce sont les entrepôts de la SNCF,
marche longtemps dans cette rue déserte avec les paroles chiches des murs (il y a des murs taiseux),
passe sous le pont, prend à gauche la rue de Rouen,
remonte un peu le long de la caserne,
puis à droite vois la halte de La Folie. Une baraque en bois avec un poêle à mazout. Cric-crac c’est une halte au milieu de nulle part, He, gringo que fais-tu seul au milieu des cactus ! Eh, gringo, sais-tu que je dégaine plus vite que tu lances ton couteau ? Même pas vrai, regarde !
Il y a un peu moins d’un kilomètre de marche.
Pour la sortie d’ici, pour Paris, il n’y a que cette halte de La Folie.
Je t’indique le chemin car on se perd facilement dans ces lieux. C’est l’antre de l’entre, la mare du terrain vague. C’est entre histoires et images. Ce n’est ni jour, ni nuit, entre chien et loup, c’est entre deux portes, le centre et la périphérie, c’est entre vérité extérieure et mensonge intérieur, c’est là que le meilleur d’entre nous se voit dans le miroir la queue entre les jambes. C’est le royaume du dessous qui flotte à la surface comme les lentilles dans une mare. Cric-crac, dans l’arc de la mare il y a l’invisible cyclops à la moustache en avant pleine de taches, le collembole, fourmi kangourou qui n’arrête pas de sauter et les daphnies, qui redoutent de trouver leurs Chloés, se déplacent sans se faire remarquer. Cela essaie de passer entre les gouttes, suivre l’ondulation qui trouble l’eau, la vaguelette du sort, l’accident de travail de la vie. Le diptyque militant bienveillant pleure en regardant Quand passe les cigognes et danse au bal de la reprise des cartes de la cellule. Le scorpion d’eau serre la pince à tous ses voisins inlassablement amical et sournois : je patiente, je patiente, je suis avec demain… Le têtard batifole comme un enfant qu’il est, il fait des rondes en chantant : un, deux, je vais chez eux, trois, quatre, de Chartres à Montmartre, quatre, cinq, six, je prends au passage quelques millepertuis sorties de la nuit, sept, huit, leur dire une bluette, faire le pique assiette pour manger un peu beaucoup de la galette avec une énorme fourchette. Immobile, imperturbable devant la ronde, la larve de la salamandre regarde ses taches de plastique, ses pattes et dit : je traverse l’eau, je traverse le feu, et j’men fous ça repousse. Autour de la mare, un peuple de batraciens surveille son monde. Il ne gobe pas tout ce qu’on lui raconte. Il est attentif à la nouveauté qu’il peut recycler. Il croque son monde : il faut bien construire la fiction! Entre, pas de fuite, pas de retrait, seule une révolte, un combat du daphnie contre le têtard.
A la Folie je passe une frontière après c’est les vallées, la bruyère, le pont cardinal… C’est blessant ce passage. C’est l’abandon de ses traces, de ses empreintes, de ses semelles qui nous constituent. On laisse sa langue au chat sans avoir de réponse. On n’est plus qu’une moitié entrant de l’autre côté. Peut être une moitié d’homme dans ce monde nouveau.
La nuit.
La terre au repos…
Nul trottoir ou chemin ne tinte du pas d’un promeneur. Nulle herbe ne frissonne du vent d’un passant. Nulle chaussée ne renvoie le bruit d’un moteur. La zone industrielle ressemble à un géant qui dort. De rares fenêtres allumées. Seuls ceux de la voie de chemin de fer, ceux qui partent au 3 x 8 chantent Les Crapauds :
Se gonfle et se creuse
D’une bave affreuse
Nos flancs sont lavés
Et l’enfant qui passe
Loin de nous s’efface
Et pâle, nous chasse…
Et la musette du casse-croute en travers du dos, d’entonner plus fort comme pour se réveiller :
Dans l’eau qu’elle souille
Sa chaîne se rouille…
Avant de passer sous le pont, à gauche, il y a l’impasse du chemin de fer et un pont.
Sur le pont je déchire le manuscrit. Pas de pluie, pas de vent, un temps gris à pendre un canal, les morceaux tombent à pic, en tas sur la voie de chemin de fer. Ils ne s’éparpillent pas. Ils tombent drus comme une boîte de conserve à la poubelle.
Je suis sur le pont, au-dessus d’une voie ferrée. Des fils, des caténaires, des rails, des traverses, un monde géométrique où tout se rejoint, se fige en un point. Un point noir.
Puits, pierre, feuille, ciseaux, « la rencontre fortuite d’un parapluie et d’une machine à coudre sur une table de vivisection », hasard de la rencontre, jeu de propriété, jeu des rencontres, du hasard objectif.
Puits, pierre, feuille, ciseaux, la main cachée derrière le dos, un deux, trois, puits de mine et puits d’amour qui chaque jour absorbe les rocs fuligineux pour les recracher quelques heure plus tard, pierre du terrain vague qui jamais ne se refusa à une fronde contre le chagrin, feuille de papier de soie pour le bouquet et feuille de paye presque entièrement absorbée par le crédit à l’épicerie, ciseaux des Parques qui tranchent entre accident de parcours et accident de travail.
Puits, puis pierre, feuille ciseaux comme un langage des signes, main cachée derrière le dos, undeuxtrois, les mains entrent en scène :
-- La feuille couvre le puits, je t’ai eu, 5 à 7 pour moi
-- Tu vas voir !
Main cachée derrière le dos, un-deux-trois, pouce et index en rond, examen microscopique du sol, main tendue, paume vers le bas, comme pour dire doucement, doucement, poing qui ne demande qu’à se dresser pour guetter l’avenir.
-- Je recouvre ta pierre et ton puits !
Feuille énervée qui présente son squelette comme une toile d’araignée. Théâtre de doigts, théâtre nu comme celui de Jean Vilar où cour et jardin sont un courant d’air et pourtant se succèdent les affrontements, les rebondissements du score avec des comédiens qui ont un sacré doigté.
J’ai dix ans.
1) Je reviens au quartier
De velours et de porcelaine
Pourtant bâtit de loques
C’est mon premier domicile
Le désespoir dans ses grandes lignes
Premièrement
Il y a une foule de distractions en société
Ça tient de diverses choses
Je demande pour mes quatorze ans
Une vie comme une dent
Sans garde-fou sans ceinture
En forme d’arête
Au-dessus des joies comme des affres
Chérie viens près de moi
Petite fille de ma rue
Les sirènes miaulent et se taisent
Pères
Vous n’êtes pas venus pour rire ni pleurer
Rien jamais n’acquiert l’homme
Faites moi rire bouffons
Leurs yeux ont tous un ciel de larmes
Et le roman s’achève de lui-même
Le pont est sur le chemin de la gare, en retrait dans une ruelle à gauche, avant un autre pont, avant la gare.
Sur un pont, on se demande toujours :
Qu’est-ce que c’est ce moi? Ai-je des ailes ? Comment se comporte le bateau dans la tempête ? L’abat-jour s’allume-t-il ? L’ampoule est-elle encore bonne malgré la longue durée promise ?
Qui suis-je ? Sans doute un étrange pays divisé en multiples contrées. Une particule qui vagabonde dans un pays de cendres ? Un point noir que j’aperçois là-bas cerné de toutes part d’envies muettes.
Questions sans sens. C’est par là ou c’est par là ?
Seul le solitaire isolé en lui-même répond du fond, il ne veut plus de ces hier de souffrance, de cette souffrance qui vient frapper au cœur même de la joie. Plus de jour de l’an, plus d’an, plus de cabestan qui soulève l’ancre des ans d’avant, seulement un lest douloureux vers les fonds marins.
Quel est ce temps, moment de demain?
Moi, seul sur le pont, invoquant les étoiles. Le vent impétueux qui souffle dans le drap, le vent impétueux qui souffle à ras s’engouffre dans le maillot. Je crie, je tombe, je suis au sein des flots.
Tout vient comme un éternel présent, sauf la ride creusée comme un caniveau dans lequel s’écoule la larme. Les images d’hier se couchent sur la photo d’aujourd’hui. Par transparence on voit le cliché de demain. Temps plié, le présent n’exprime-t-il pas le passé : Il y a à peu près une heure je sors de chez moi, le futur : demain j’arrête… ou un mot de plus et je pars ? Il est une vérité générale qui se répète, un travail du jour. Hier, demain, ici et maintenant obstinément face à ton nez. Temps plié de rires. Temps replié sur lui-même.
Je m’assieds dans le terrain vague, à l’écart du passage, dans les hautes herbes, au milieu des boutons d’or. Nous faisons une ronde, un de nous tourne autour de nous, c’est le jeu du béret. Il tient, selon les fois, une croix, un foulard roulé en croissant ou une étoile. Je regarde devant moi. Il tourne, parfois retourne, plaisir sadique de l’attente, de la tension qui virevolte dans les cœurs. Mes oreilles guettent le vent, le temps et le froissement. Je surveille mes arrières. Mon dos est en alerte, mon dos est gros comme un hérisson. Des centaines d’aiguilles prêtes, des centaines d’aiguilles contre les arriérés. Ça y est, c’est moi. Je me lève, j’attrape l’objet et je cours et je tourne. Plus vite que j’attrape ce lâche, ce traître qui me laisse ce culte derrière moi. Je cours, tourne et retourne les pages du ciel. Trop tard, il s’assoit. J’abandonne discrètement l’objet dans un coin et retrouve une place. Du fond du salon devenu salle de repassage vient une chanson : il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour, il pleut sur les framboises…C’est l’heure nunuche, je quitte le terrain vague, je me cache sous la table, le chat me griffe un peu, ce tigre est indomptable et joue avec le feu…
Le coiffeur me coupe les cheveux. Il plaque l’épi qui se redresse. Il le coupe, c’est sa seule solution et me vante le journal « La Lumière » de Jehova. S’cusez, chez moi c’est plutôt l’Eveil communiste!
Sur le chemin de l’école Adeline Zoursdru, amie de la lumière de « La lumière» me vend la bible cinq francs et me prédit pour la troisième fois la fin du monde.
Ahmed Zarbi me raconte l’histoire du foulard. Le prophète dit : c’est le voile ou le viol, tu choisis.
J’envie le stylo quatre couleurs des premiers communiants.
Les enfants acceptent tout, pêle-mêle : la vie, la mort, les squares et les trains électriques. Les larmes dans les gares, Guignol et les coups de trique.
Gaulois, je me méfie du ciel, ce qui est en l’air finit toujours par terre avec une belle couronne mortuaire.
J’ai quarante ans.
2) Pères
Aux jolis yeux cérulés
Ils connaissent bien la mer
(elle a des yeux comme des balais)
Les amants et un désir
De la chaleur et du sang
Jusqu’à cette heure
Un frisson et tout redevient lisse
Combien hauts, combien purs sont tes bords
Fol espoir
Je ne te suis pas
Jamais s’il est mort
…
Deuxièmement
La langue étrangère et le jeu
Arbres dans les vallées à l’automne
En forme de savate molle
Agréments naturels éléments de musique
Ne plus aimer que la douceur et l’immobilité
Sous le coup de l’inspiration
Vivre ainsi
Qui se mire grandit
Et ceux-là sans savoir nous regardent
Pères
Au conseil des visages
Votre second ministre un idiot, votre troisième ministre un crétin
Je trouve cela beaucoup plus juste
La vie c’est plein d’intérêt
Et puis ça se gâte soudain
Le ciel s’étoile d’avions, d’obus, de croix, de fusées
Semelle inusable pour qui n’avance pas
Je préfère je tente
Le charme du matin
Saute au ciel et y fait un trou laiteux comme un biberon
Voilà ce que j’écris comme commencement.
C’est le pont de mon enfance. Celui sur lequel je grimpe et que je traverse à l’extérieur, dans le vide. C’est le jeu du jeudi.
C’est un pont sur le chemin de la gare dans une zone industrielle semée de quelques pavillons. De part et d’autre de la rue, un long mur de béton, ce sont les entrepôts de la SNCF et la voie du Paris-Rouen, un train qui ne va pas jusqu’à la mer. Et puis brusquement dans le désert de béton, une pelouse, un bouleau au pied d’une maison.
Je suis seul sur le pont. Toujours seul. Jamais un passant. Sert-il à quelque chose ce pont auquel on accède par quatre marches ? Je ne vais jamais au-delà des quatre marches qui servent à le descendre à l’autre bout. Peut être rencontre-t-il des ouvriers très tôt le matin quand sonne la diane dans la cour de la casernes proche ou très tard le soir au retour du travail ?
Sur une bordure cimentée d’une dizaine de centimètres, les mains accrochées à la rambarde métallique, je traverse, je défie. Je défie quoi ? Suis-je Zarathoustra au-dessus de la fée électrique et de l’écrasant chemin de fer ? C’est la solitaire et tranquille épreuve du jeudi comme s’il n’y a pas autre chose à faire.
Le manuscrit ce sont les poèmes de mon enfance, écrits avec mon dictionnaire de rimes en imitant Baudelaire. Puis plus tard, en vrac, Aragon, Breton, Michaux, Prévert, Vian,…
Des bouts d’elle, des azurs déchirés, des tas de sable, des étraves de navire, des mers assoiffées, des compagnons, des bouffons s’en vont.
Elle,
est bleue, marine ou ciel, d’un mouvement des cheveux aux doigts, assise, la première jambe repliée sur elle, la seconde à l’équerre sur le sol. L’angle du genou plein du pied de la première jambe. Le buste légèrement en arrière, un bras pend tandis que l’autre monte contourner sa tête.
Elle de face,
a peut-être les yeux noirs et son corps se meut de la courbe à la droite. Changement de styles dont l’histoire m’est étrangère. Dans l’angle formé par le bras levé et la poitrine se montre l’aisselle, jusqu’alors voilée par ce même bras baissé. Poils noirs broussailleux, odorant de la chaleur. Au sommet commence la courbe du sein bleu aréolé de carmin, cercles concentriques au territoire veiné de blanc, demi-sphère au front du repos.
Elle et son corps,
simple avec ses cheveux noirs jais, aux reflets variant des racines aux pointes, qui s’éparpillent dans la mouvance, s’étalent, battent comme des ailes à l’envol. Ils se nouent, se tressent et forment un écheveau qui oscille devant ses lèvres. Les mains viennent parfois s’y poser. Doigts fins, presque osseux, aux articulations saillantes, doigts disjoints qui laissent des ouvertures. Rien n’est totalement caché et laisse place à l’imagination, au rêve ou au fantasme. La bouche porte alors les doigts, gonflée de sang, annonce le dit, le délit et son cortège de faire.
Elles
Béatrice, Béa, qui apporte le bonheur, je le vois sur ton visage que j’ai en mémoire. Le prénom, le nom et le visage. Seulement le prénom, le nom et le visage. Pour le reste, rien. Où, quand, comment, pourquoi ? Pas un mot, pas une voix. Où sont tes pas ? Dans la rue, l’avenue, une cave ou le terrain vague? Faille de la mémoire : une connue parfaitement inconnue. J’entre dans un monde où tout est flou, incertain. Une personne vide de vie, est-ce possible ? Comme si on ne sait plus pourquoi Mélusine devient serpent en dessous du nombril chaque samedi. Béa, tu te plies et te replies et encore te replies dans ta chambre chaque jour, chaque minute où je vois ton prénom. De toi je n’ai que la mue.
Lucie à la jolie géographie, dessine-moi un fleuve, ses affluents et ses tourments, condamnée à être proie pour sa beauté venue du Mékong. Attachée nue à sa beauté, se débat dans ses liens, hurle sa douleur sur le quai de Seine désert, extérieur-intérieur, prête à être déchirée par les bêtes sauvages comme Méridienne claquant la porte à Vénus, hurle que tout cela n’est qu’apparence, illusion, livrée aux beaux discours prétendants dans un violent marivaudage, murmure à bout de force : « la conclusion t’avertit que tout est fiction de poésie », hurle, crie, oscille au bout de ses liens, attend et attend en hurlant son Persée.
Maria venue de Bratislava, la future chanteuse d’opéra pour vivre dans un autre monde, un monde de mythes, de légendes et de contes enchantés, vit dans le terrain vague entre ses cours de chant, c’est la fille de la mare, elle plie les herbes folles , les tresse en couronnes, bracelets et pendentifs, parle aux pâquerettes, aux coquelicots et aux boutons d’or, on va voir si tu fais pipi au lit, les mange et enterre les insectes morts déclarant que seul ce qui est mort est intéressant, que seul le passé est vivant, que demain est une dégradation d’hier, que la magie c’est avant aujourd’hui.
Maryse venue de champagne, qui sait qu’elle va devenir aveugle néanmoins garde sa foi, son rire contre la ride, mais tend déjà le bras devant elle, tâtonne l’air, tend déjà l’oreille aux sons de la ville pour y trouver son chemin musical, la messe pour un temps présent.
Mike de là-bas, loin dans les terres de Gé, qui ne peut résister au désir de l’autre, regards, mots bas, sidération, qui a vingt ans a deux enfants qu’elle élève seule afin qu’ils soient plus siens et qui chaque nuit attend le troisième pour repeupler.
Patricia venue de Paris, la première, celle qui apparaît toute vêtue de sa blouse à la sonnerie de la récréation de maternelle et nous jetons nos manteaux par terre pour délimiter un Eden de quelques minutes et les bêtes sauvages de se taire et les arbres formés par les bras des élèves de bruisser de baisers vermeils.
Sylvie venue d’ailleurs, sablier des ans, aux racines qui s’éventaillent dans le sol, qui s’accrochent à sa terre, enserrent les pierres hic et nunc et aux feuilles qui bruissent d’histoires, de cancans, forcément à rester planté là, mais qui au soir se rassemble en forêt pour une veillée qui chuchote toute la nuit les contes et les légendes et rugit, frondeuse, aussi.
J’écris, je ralentis ma vie. Elle passe à une image seconde. Je feuillette l’album de famille loin de l’image subliminale. C’est l’immeuble que l’on désosse et qui garde les marques sur du papier peint d’un temps habité.
Sur le pont, ou plutôt à côté, avant les marches, souvent je récite en fumant une Kool menthol.
Mon pied ne glisse pas, ma main ne ripe pas malgré la grosseur de la rambarde. C’est impossible. D’habitude j’ai le vertige, mais là aucunement. Je traverse sans peur, routinièrement, presque tristement.
J’ai soixante ans.
3) Par-dessus cette paix
Qui dégage mes origines
Le chemin de l’éternel regret
Qui ne voit jamais ce que moi je vois
A cause de ce peu qui manque, que jamais tu n’apportes
Mais c’est notre amour à tous deux
Qui répond à tous les noms du monde
Tous les bateaux tous les oiseaux
Seuls les plateaux de la balance
Reviennent de moi-même
Une corvée de jours en moins
J’ai de la veine
Mouillé par le sang
Et la gomme des nuits
Je ne suis jamais content
Troisièmement
Des gens à qui les coups ne font rien
Une rose et un cœur poignardé
Qui se roulent
Défendus par leurs jardiniers
C’est vous mes hommes c’est vous
Comme vous m’êtes familiers
Sire vous êtes le roi des cons
Sur lequel nous revenons
Et regarde-moi en face
Quand je t’écartèle
Il le faut arrache la vie
Tigresse comme une étoile filante
Une fois de plus ton nom tout de travers
Merde je ne veux pas de vies
Ah comme j’ai mal je vieillis
Je regrette mes dix sous
Les coquelicots fanent le long de la voie ferrée. Il n’en reste presque plus. D’année en année le pavot fuit le ballast.
Sur le chemin de la gare il y a des NON, FLN, FNL, Libérez Régis, en lettres blanches, Défense d’afficher loi 29 juillet 1881…en lettres noires et blanches. La nuit des mains errantes écrivent non est mon nom.
Non, il faut le crier pour que le silence ne vous tue pas.
Non, il faut le hurler au nez des boutonnières rouges.
Non, il faut le répéter devant le désordre de l’ordre, le chaos du chantier.
En bleu marine les CRS patrouillent, la mitraillette noire en bandoulière pointée sur le passant. Ils patrouillent près de l’épicerie La Maison Bleue où les petits vieux de la maison départementale, en bleu marine eux aussi, flottent, tanguent, se houent comme ils peuvent, achètent le journal, le Préfontaine ou le Vin des Rochers.
Le journal c’est le dehors qui rentre un peu dedans, un parfum de vie civile qui, dedans, passe de main en main, se vend plus cher à chaque passage. Le vin rouge c’est pour le dehors. Il donne un peu de couleur à la meulière anthracite qui écorche le visage quand on est noir. Ça arrondit les angles du jour si gris. Une mer de rouge pour que houlent les bâtiments, qu’ils chaloupent un instant en une rieuse valse musette dans les fumées de la papeterie de la Seine.
Encore les CRS près du marchand de couleurs. J’ai le nez à ras du canon. Un puits de gégène et de corvées de bois. Il n’y a pas de soleil et j’ai la sueur au front. Le puits du canon, les yeux dans les yeux, au fond du trou noir trois lettres blanches : FNL : je n’ai pas encore les voyelles mais j’ai les couleurs.
Et encore les CRS chez le pâtissier du bidonville où j’achète mes zlabia dégoulinant de miel. Y a rabi, zelabia, zelabia, zelabia. Il choit, Ils choient dans la Seine un dix sept septembre. Sous le pont Mirabeau coule la scène, des centaines de corps, des morts d’amour.
Tout s’efface, surtout les lettres blanches. Ils n’entendent plus les murs sous leurs casques. Ils ne voient pas le Défense d’afficher le nez braqué sur le smartphone.
Maintes fois je viens sur ce pont. Cette fois je sens que ma vie le traverse encore une fois, mais que je suis en train de descendre les marches. J’arrive sur l’autre rive. Elle m’emporte, elle m’abandonne loin d’ici, elle m’enterre.
Et encore les bergers allemands qui déchirent les matelas, les armoires, le soir quand le bidonville est fermé. Il y a la paix du 11 novembre, il y a la paix du 8 mai, il y a la paix du 18 mars et c’est toujours la guerre. Chaque mois apporte sa guerre, chaque semaine amène ses morts, chaque heure sa destruction d’humanité, efface les traces de la mémoire : pas de paix sur ce pont.
Je déchire mes rêves et ils font flop. J’espère une pluie de confettis qui couvre le ballast, que mes mots s’éparpillent, que ces rêves voyagent sur le rail, aillent au moins jusqu’à Rouen à défaut de rencontrer la mer, que ce soit un lâcher de ballons emportés par le vent au bout du monde, mais juste un tas. Je vous dis une boîte de conserve que l’on jette à la poubelle.
La bouteille jetée à la mer ne suit pas le courant, elle coule bêtement au fond sur la tête d’une vive et noie le SOS.
C’est fou tout ce que l’on fait et qui ne sert qu’à la minute qui suit. Ce que l’on fait au jour le jour et qui ne sert à rien, qui s’accumule dans les tiroirs et finit un jour ou l’autre à la poubelle. Mais je perds le fil de l’histoire.
Il faut fermer les années mortes au nez des portes.
S’en va le jour
Doucement, doucement,
A pas de velours.
Et la reinette dit
Sa chanson de nuit…
Cric, crac, tu danses sur la balance, tu t’envoles du pot de colle, direction Paris St Lazare.
Michel Lansade
Le Lampadaire 2016
Le Lampadaire 2016
La boîte
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Un des membres éloigné de notre famille était marin. Il ne passait que rarement nous rendre visite avenue d’Alembert, mais chaque fois il arrivait les bras chargé des cadeaux les plus inattendus, récoltés au cours de ses pérégrinations au long cours. Aussi, mon frère et moi, attendions-nous toujours sa venue avec impatience lorsque l’une de ses lettres nous laissait envisager un passage imminent du loup de mer ; c’est nous en général qu’il gâtait le plus. Un beau jour il se présenta chez nous à l’improviste, mais quelle ne fut pas notre déconvenue quand il extirpa de sa vieille valise une simple boîte de thé. Il tendit l’objet à ma mère en expliquant : « Ça vient de Chine ! ». Après quelques jours notre visiteur repartit comme il était venu, perdant à nos yeux une bonne partie de son prestige. Du thé !
Je commençais d’oublier le marin et sa perfidie lorsqu’un dimanche après-midi d’hiver, ma mère proposa de faire un thé. Elle extirpa du buffet le service de porcelaine – celui avec des grues au clair de lune peintes sur les soucoupes – puis après quelques minutes dans la cuisine, elle reparut, posant sur la table de la salle à manger un plateau avec du lait froid dans un petit pot, du sucre, quelques biscuits et la théière fumante. Avec précaution elle servit chacun de nous : « C’est du thé de Marcellin ! » précisa-t-elle avec une certaine solennité. Ma mère s’extasia sur la finesse du breuvage, mon père évoqua l’Indochine, comme chaque fois que l’atmosphère virait à «l’orientale», mon frère déclara qu’il n’aimait pas le thé, quant à moi je me brûlai cruellement la langue en maudissant une fois de plus le marin. J’ignorais encore qu’en cet après-midi brumeux s’esquissaient les contours de ce qui allait devenir pour moi une véritable cérémonie familiale.
À la maison nous ne prenions que rarement le thé, mais les prélèvements à-la-boîte-de-Chine demeuraient, eux, tout à fait exceptionnels. À la façon dont ma mère proposait un thé, je devinais d’emblée si nous allions avoir droit aux banales infusettes du commerce ou au somptueux breuvage ambré de La Boîte. Je parvins même à établir une hiérarchie secrète parmi les gens qui nous rendaient visite l’après-midi. Il y avait d’abord ceux à qui l’on n’offrait que du café ou du thé en infusettes ; venaient ensuite ceux pour lesquels ma mère consentait à ouvrir La Boîte, mais à qui (sans doute à cause de quelque manquement secret dont j’ignore la nature), elle ne renouvelait plus jamais l’offre ; les plus rares (ce n’étaient pas forcément les amis les plus proches) avaient régulièrement droit à l’infusion rituelle ; à ces derniers ma mère allait parfois jusqu’à confier un petit sachet contenant quelques pincées des précieuses feuilles aromatiques.
Il me serait impossible de caractériser aujourd’hui la teneur exacte de ces cérémonies, ni d’en décrire le déroulement précis ; les modalités de cette liturgie domestique ne furent jamais établies de manière explicite. À y réfléchir, peut-être ai-je été le seul à percevoir l’atmosphère sacrée de ses dégustations.
Je n’ai encore rien dit de La Boîte, car elle n’intervenait jamais directement dans la mise en scène : sitôt les quelques grammes indispensables placés au fond de la théière, le couvercle était remis en place : « Pour que ça ne s’évente pas ! », et La Boîte réintégrait l’étagère supérieure du placard de la cuisine. Objet décisif mais occulte du rite domestique on évitait de montrer La Boîte. Le goût intrinsèque de la liqueur ambrée et les appréciations formulées par les convives devaient suffire à l’enchantement. Mais si d’aventure, après la proposition maternelle, quelqu’un déclarait ne jamais boire de thé, on produisait sur le champ la pièce à conviction afin de confondre le béotien. C’était un gros cube de fer blanc aux angles arrondis, recouvert d’une peinture jaune mat qui s’écaillait facilement. Sur trois faces adjacentes se déployait un dragon schématisé par un unique trait rouge vif ; la quatrième face comportait des inscriptions en caractères indéchiffrables, du même rouge que le dragon. Sur le sommet de La Boîte, découpé par une étroite ouverture circulaire, s’ajustait un couvercle nervuré qu’il fallait rentrer en forçant et que l’on ôtait en faisant levier avec le manche d’une petite cuiller ou la lame d’un couteau. Laissé à l’état brut, le fer blanc du dessous accusa le premier le passage du temps en se piquant de rouille.
Implicitement présente mais rarement exhibée, La Boîte accompagna de son aura exotique une bonne partie de mon enfance et le début de mon adolescence. Puis un jour un sacrilège fut commis. Un prétendu connaisseur ès thés eut l’outrecuidance de faire remarquer – après avoir goûté avec affectation une gorgée du liquide adulé – que si le thé avait dû être excellent, cet « Imperial Yunan Flowery Pekoe » était à présent passablement éventé : il avait « perdu sa finesse » et « son corps puissant s’était irrémédiablement affaibli ». On protesta bien pour la forme, ma mère, en rougissant, argua qu’elle refermait toujours soigneusement le couvercle… Mais le spécialiste avait parlé. Le soir même ma mère se débarrassait du fond restant, qui devait bien dater d'une dizaine d'années. On tenta bien des subterfuges en versant dans La Boîte les meilleurs thés du commerce, mais le charme semblait définitivement rompu, même un thé rapporté d’Angleterre ne parvint pas à le rétablir. Rongée aux jointures, amincie par endroit et même percée par la rouille, La Boîte elle-même devenait innommable ; elle fut définitivement mise au rebut.
Si par hasard vous avez l’intention de visiter la Chine, rapportez-moi, s’il vous plaît, un peu de thé. Vous ne pouvez pas vous tromper le meilleur est toujours emballé dans une grosse boîte jaune, avec un dragon rouge dessiné sur le pourtour.
Christian Béthune
Le Lampadaire 2016
Le Lampadaire 2016
Piscine
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Étale, déployée, parallèle au carrelage, la surface est piquée de quatre coutures noires. Pas une fronce. La verrière haute au-dessus, répercute les échos qui définissent l’espace. Des plantes aux feuilles grasses dans la moiteur, incitent les plus audacieux à des rêveries sans fond.
Ça pue le chlore.
Faut y aller. Deux pendules rassurent selon une ligne Est-Ouest, aux deux bouts du bassin : ça ne durera pas l’éternité !
L’équilibre n’existe que par rapport à la chute, ici le pli du ventre est le signe du risque, faille fatale dans l’étirement qui va du menton aux orteils. Les fesses brusquement descendues à l’oblique sous la nappe, ramènent les cuisses au ventre et transforment le corps en paquet tortillé dans le lycra du maillot de bain, postillonnant et disgracieux, gorgé de tasses méprisables aux yeux des nageurs appliqués qui ont gardé leur rectitude. L’harmonie est trahie et il faut tout recommencer.
C’est en quête de cet équilibre, que je plonge une fois par semaine et me sens étrangement solide, prise dans la masse du rectangle d’eau. Je veux devenir un point d’onde. Je dois oublier chair et formes, bourrelets, complexes et regards d’autres pour n’être qu’une ligne abstraite entre deux points. Je sers de repère à l’espace, mets le plan en évidence en même temps que les autres baigneurs.
L’extension de nos corps posés sur la transparence du liquide, atteste de son existence. Une fois défini ainsi, l’espace devient irréfutable. Je l’élabore sans le vouloir en même temps que les autres, par les mouvements de mes bras, de mes jambes, le déplacement de mes dos et ventre – symétriques indissociables – étirés régulièrement au-dessus des carreaux du fond. Nous parachevons la perfection et redessinons sans relâche le rectangle 50 x 15 mètres. Si je détruis l’équilibre en trouant la nappe par une bascule de mon corps, cet espace se transforme en temps : celui de la reprise de la position première. Soupirer, cracher l’eau, rajuster le bonnet, remettre les lunettes. Cela sera du temps perdu. Les nageurs horizontaux devront garder le cap plus longtemps pour noyer ma faute en reprisant l’accroc de surface.
Il y a dans le bassin un nombre de nageurs constants. Mais il y a aussi les fauteurs de troubles, apprentis, mères avec enfants, copines sans motivations. Ce sont eux les agitateurs. Je me rallonge et tends de toute la force d’une croyance nouvelle, le bout de mes doigts devant moi et celui de mes orteils derrière. Je suis une planche imperméable. Nuque étirée et yeux ouverts derrière la vitre de mon masque, je me réjouis du spectacle des dentelures de soleil, feuilles de houx dorées qui dansent sur le carrelage. Les ciseaux noirs des aiguilles ont découpé sur les pendules la même tranche de vingt minutes et je me sens enfin là-dedans comme un poisson dans l’eau.
Brusquement l’eau éructe. Elle mousse, explose, se couvre anarchiquement de cratères bleu foncé. Un tiers de la surface est maintenant recouvert de coulures de lave claire projetées, acclamées par des salves de cris amplifiés sous la voûte. Le bassin de la piscine est alors partagé. D’un côté les allongés croisent à cadence régulière leurs corps bien disciplinés, de l’autre, côté chutes et cascades, d’anciens nageurs debout dans l’eau, crispent en terre de petit bain des pieds grossis par la loupe d’eau, et qui semblent si blancs qu’on les dirait malades. Leurs têtes et leurs regards se tournent en même temps vers un point apparu soudain sous la pendule de l’Ouest et qui se dirige vers eux. Il est juste 18 heures.
Il ressemble à un oiseau noir. Moulé dans le pelage brillant d’un justaucorps en caoutchouc, il porte sous ses ailes, des planches et des boudins de mousse multicolores. Entre ses dents il serre un sifflet qui stridule à chaque expiration.
Il balance alors les boudins et, de l’eau, une clameur s’élève : « les frites ! Par ici, les frites, ici, ici, moi je n’en ai pas ! »
Chacun des pioupious de l’eau nageote jusqu’à ce que chacun ait dans les pattes un de ces boudins de couleur qui dans les salles de sport se nomme « frites» et qu’on agrippe pour se muscler. Et puis, pendant qu’ils se placent tous, en six rangées debout, face longueur du bassin, l’oiseau siffleur jette à l’eau une longue ligne de flotteurs pareille à filet de pêcheur pour marquer le périmètre réservé aux pioupious.
Les remous de la baignoire se propagent du coup à toute l’étendue et les nageurs sont contraints de se tasser dans la quantité d’eau restante. Un peu partout des fesses plongent sous la ligne de flottaison, défaut d’équilibre, mouvements de colère mal placés. On entend même des « pardon » et des collisions silencieuses impriment des bleus sur cuisses ou ventres. Il n’y a plus d’espace ni de temps, plus la moindre idée de perfection. C’est le chaos.
C’est la faute à la mode de la gym aquatique.
Les cris de volatiles se muent en mots articulés, entremêlés, indéchiffrables, qui ne disent rien et ne veulent rien dire jusqu’à ce qu’un coup de sifflet très long, les fasse taire tous d’un seul coup. Le sifflet quitte la bouche et le professeur donne des ordres :
« Talons-fesses pour 10 fois, les mains à plat sur l’eau, sans les frites s’il vous plait ! Une deux ! Et tapez l’eau avec les mains, trois, quatre ! »
Le professeur a de la bouteille, il imprime sa discipline.
L’eau est battue et maltraitée, mais avec rythme. Personne ne moufte plus. L’espace s’est déplacé ; c’est à présent ici, autour du cours, qu’il se dessine, qu’il est parfait. Il est piqueté de 30 points, immobiles, chacun à sa place et chaque point est responsable d’un petit rond devant lui dans lequel il s’ébat.
Sur le bord, le prof braille, à la schlague mais c’est normal. Rien à dire, aucune faute dans ce carré-là de piscine. Tout est très bien organisé.
En revanche tout va de mal en pis de l’autre côté des flotteurs. Après les « pardons » et l’apparition de plus en plus fréquente de bosses sur la limite de l’eau, dos ronds, têtes bousculées dessous et haletantes à l’air libre, pieds orphelins saillants dehors dans un plongeon raté, des individus entiers sortent. Chassés du rectangle orthodoxe, ils fuient le désordre par les marches, vont chercher leurs serviettes et s’y mouchent longuement.
Rotent de dégoût à la pendule, partent à la douche, claquent des tongs sur le sol mouillé. La patience a des limites et la désertion se précipite pendant que d’une voix de baryton soutenue par l’ambiance vibrante, le maître continue sa leçon, « six et sept, serre ventre et fesses, six et sept, serre ventre et fesses!» et que les 30 petits points se crispent et s’ouvrent à l’unisson, faisant de très jolies broderies sur l’étendue calme de l’eau.
C’est la fin du cours. On retire la ligne de flotteurs, les pioupious volettent en piaillant et un gros tas de frites se forme sur le bord. C’est une débandade en milieu de bassin, lieu aléatoire de mariage entre nageurs et barboteurs.
Bien en a pris aux mécontents sortis de la flotte avant l’heure : Dans le mur du fond, à mi longueur, s’ouvrent soudain les deux battants d’une lourde porte.
Un bonhomme rond paraît, tout habillé de blanc. Il porte à sa bouche un mégaphone en aluminium, rejette la tête en arrière, balaye l’espace de son outil, d’une pendule à l’autre et de la voûte à l’eau et gueule :
- « On ferme, tout le monde dehors ! Ce soir, c’est la vidange ! »
Marianne Brunschwig
Le Lampadaire 2016
Le Lampadaire 2016
Monter sur la table
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
C’est l’histoire de Oulo. Oulo vit à Trieste et il est avocat. Il aime manger des framboises et trouve que les films d’action sont divertissants. Un jour, il a essayé de monter sur sa table et il n’y est pas arrivé. Il a pensé, « La vie a ses raisons ». Oulo a voyagé à l’extrême nord de la planète. Il a déambulé sur la glace et il a glissé. Lorsqu’il est tombé parterre, il a écrasé un petit de pingouin. Il a décidé de s’exiler sur une île au milieu de la mer, et il est allé à Rakahanga. Une fois arrivé, il a eu un creux et a mangé un sandwich. C’était un endroit très agréable. Ça lui a rappelé l’époque où il était livreur de pizzas. Oulo a pris l’avion et il est retourné chez lui. De retour, il a essayé de monter sur la table et il est tombé. En tombant, il a cassé le frigidaire et il s’est cogné la tête. Il a pensé « On fait ce qu’on peut ». Un homme a appelé et lui a dit qu’il avait besoin d’un tourne-vis. Oulo a dit que son tourne-vis était trop petit, parce qu’il s’en servait seulement pour démonter sa montre. L’homme a dit qu’il détestait les montres lorsqu’il était enfant. Oulo a dit qu’il lui casserait la figure si d’aventure il paraissait devant lui et il a raccroché. Oulo a marché dans le parc qui se trouve devant chez lui et a fredonné les chansons qu’il avait entendues ce jour-là. Il a entendu une chanson africaine très jolie. Oulo a été arrêté pendant qu’il chantait, les habitants de la région le détestait, car Oulo les humiliait lorsqu’ils se croisaient dans la rue. Oulo a dit aux policiers qu’il devait passer chez lui avant de se faire arrêter. Ils l’ont accompagné jusqu’à son appartement. Là, Oulo a essayé de monter sur sa table, mais dès qu’il y est arrivé il a glissé et s’est écrasé le menton contre l’évier de la cuisine. Sang et os giclèrent au visage des policiers. Oulo a essayé de parler et il n’y est pas arrivé. Avant de mourir, Oulo a pensé que la vie était curieuse, car bien des fois on n’arrive pas à monter sur la table et lorsqu’on y arrive, on meurt. L’un des policiers a essayé de monter sur la table et il est mort aussi, tombant de la fenêtre et tuant l’autre policier, qui dansait sur le trottoir.
Rafael Sperling,
Um homem burro morreu (Un homme bête est mort)
traduction Stéphane Chao
Le Lampadaire 2016
Um homem burro morreu (Un homme bête est mort)
traduction Stéphane Chao
Le Lampadaire 2016
Breaking news III
NOUVEAUTÉS
Nom : Kant, prénom : Emmanuel, sur un hippopotame, soudain éclaboussé. Surpris, il se cambre, tremble de mille pattes. L’avis du Rhododendron existentialiste : « Peu après 18h30 je me fis l’impression d’un funambule sur un rosaire. »
Encore lui, le nez de Gogol a la rate qui se dilate ; cliente satisfaite, une huître luit des dents. « Attention, un chat nommé Rodilardus vaut mieux que deux tu l’auras. » De Gaulle, 1954.
Jean-Louis Ermoux, journaliste interviewé par Arte pour une émission revenant sur ses quarante années de carrière, estime « qu’il est très facile aujourd’hui de critiquer les médias, mais que ferait-on sans eux ? Quel serait le monde ? C’est une question compliquée et fascinante, et je crois qu’on a vite fait d’être très sévère. Or le média existe s’il existe un auditeur. Et l’auditeur s’il n’a pas les lumières, certes imparfaites, des médias qui est-il ? Nous avons quand même la chance d’avoir accès à toutes ces informations. Bon, elles ne garantissent pas une vie heureuse, mais elles offrent la possibilité de comprendre un peu quelque chose. Ce quelque chose j’ai toujours considéré que c’était énorme. Et que les dégâts les dérives les abus et autres, valaient la peine en comparaison de ce que serait l’absence de toute information, de tout média. C’est-à-dire qu’on reviendrait à l’époque où le ragot faisait le gros des communications. Comme pour les morts, l’être humain a tendance à idéaliser le passé, il faut se méfier. Je n’ai jamais cru aux paradis perdus. »
Un matelot breton se met à fondre, avant de renaître : c’est un pin maritime. Un pasteur s’évapore en pleine messe, il renaît : c’est une vessie. Bien vu la machine, pas folle la térébenthine.
Ne mangez pas les cheveux de Schopenhauer, il sont si soigneusement hirsuteutons. Une girafe sortie du placard se marre « Lé monte gomme rebrésendazion et gomme folondé » « Che fais de dordre le gou ! », s’énerve Arthur, rouge comme une Tomate. Jetzt heisst er Tomate Mann.
« Quel serait le plus beau mot au monde ? » s’énerve Nietzsche, « assez de vous entendre. Ma moustache est plus intelligente que n’importe laquelle de vos villes, y a t-il un mot, une phrase, qui puisse rendre la vie à la vie ? Si vous ne le savez, laissez votre langue où elle se trouve, vous autres philistins. »
On voit sur cette vidéo Nietzsche mesurer plus de cent vingt-trois mètres. Sa moustache dépasse le mètre. Nietzsche souffle sur un palefrenier qui étouffe de rire tandis qu’il s’envole, ses dents tombant comme neige et boum, le pauvre homme atterrit contre la Chartreuse de Parme. On n’aimerait pas être à sa place !
L’industrie du scotch se montre confiante : « Sterling&Cooper ne manquent pas d’air, et nous notre scotch ça adhère. » Les ventes augmentent de 4,68% en marge démiurge, le seuil de rentabilité saillira l’entreprise au printemps.
Après l’attaque aux cornes scotchées sur le front en Espagne, tout homme portant une barbe de plus de trois jours sera suspecté d’être torero, dans le cadre de l’application du niveau 4 de la loi anti-torerisme. Plusieurs appels ont été reçus pour dénoncer des passants poilus, des voisins ou proches mal rasés. En réaction, plusieurs pays arabes ont multiplié les checkpoints afin de vérifier que les hommes ne s’épilaient pas.
Retour sur terre, femmes et hommes à l’allure réverbère, vos élucubrations m’indiffèrent. Avec ou sans haltères je me badigeonne la tête d’épinards, c’est foison de fer. Molière est au cimetière, le dictionnaire en poussières, longue vie à mes salaires. Au Niger je ferai construire sur chaque miette de terre un centre commercial digne de Gulliver, croix de bois croix de fer si je mens je vais en enfer.
Le businessman est interviewé par l’homme aux semelles en vent téméraire :
― Comment allez-vous, loup fuyant ?
― Loup fuyant ?
― Et la peur se fit fabriquer un costume de reine, l’enfila, et les yeux circonvenus louchèrent à perte de vue.
― C’est quoi la question ?
― La vie ?
Djib07 écrit sur le forum « spasmophilie&co » au cours d’une discussion dont le thème est «médias = vérité ? » :
« J’en peux plus, tous ces arguments, ces avis, ces contre-arguments, ces soi-disant faits. C’est comme si on pouvait me faire croire une chose une minute et exactement l’inverse la minute d’après. Et j’y croirai franchement à chaque fois. Maintenant c’est comme si j’arrivais plus à croire à rien, ou à vouloir croire.
Ouvrir le journal ça me rend fou. Mais si je le fais pas, alors je deviens fou aussi, même si autrement. Je sais pas quel est le pire. Me plonger dans des infos, des paroles dont je ne peux pas pas mesurer la véracité ou vivre comme un animal sauvage. »
En 2020 la somme des données produites par l’homme aura dépassé le nombre d’étoiles dans l’Univers. Comment tentera-t-on de s’imaginer l’infini?
Grèce ? Geai. Graisse ? J’ai. Le temps presse ? Les hommes pressent le temps. La presse leur tend les bras.
Jérémy et Maude dans l’émission Plus vrai que nature :
-Il est passé le facteur ou quoi ?
-Kstuveux ?
-Le facteur ! il est passé ?
-Ouais, t’énerve pas comme un chpakoi.
-Y a kchose pour moi ?
-Ouais tiens.
Le jeune roi anonyme ouvre l’enveloppe. Elle lui demande :
-Alors c’est quoi ?
-Parait que j’ai deux diabètes... je capte rien à cette merde.
-Attends fais voir... diabète sucré de type deux.
-Ah c’est bon ça j’aime bien quand c’est bien sucré sa mère.
Crise d’asthme, envie de terrier ou de meurtre ? Ils sont trop et partout ? Font trop de bruit ? Grâce au détecteur de blaireaux Blairiflair, ne vous laissez plus ennuyer. Capable de repérer un jeune surexcité, une pétasse ou une vieille chieuse à plus de deux cents mètres, il vous avertit et indique le chemin le plus tranquille pour votre bien-être. Visitez notre site blairiflair.fr pour découvrir toutes ses possibilités.
Madame Berges, intervient sur RMC :
« Moi je vote pour Gremchellin parce que comment il parle ça me parle. Et les autres c’est corrompus comme des rognons de boucher. Faut maintenant redonner la voix du peuple dans la rue. C’est comme ça qu’on finit la crise, coude dans le coude, j’ai pas bac plus quatre mais ça chacun peut le comprendre. » Un panneau publicitaire remporte l’élection présidentielle.
Le professeur René Selbiac transmet son analyse par particule de nanopigeon:
« Cette femelle homo sapiens, d’un poids de 78 kilos et d’une hauteur d’1m56 se meut en propulsant ses jambes jusqu’à son véhicule (moyenne : 13 cm, intervalle de confiance à 95%). L’évolution de son espèce lui permet de faire fonctionner cet engin sur des routes. Le dimanche 13 juin 2017, notre sujet d’étude a usé de ses possibilités mécaniques pour se rendre auprès de ce que l’on appelle la mairie. Grâce à son cerveau complexe, elle a pris la décision qui lui semblait la plus convenable quant au choix du mâle alpha de sa nation. Par ailleurs ses cordes vocales en résonant lui ont permis de communiquer son choix à ses congénères. »
Extrait d’un débat hebdomadaire ayant lieu de 23h15 à 00h55 sur France 3 : « Vous n’êtes pas raisonnable déclare Patrick Tufsal à un homme qui, à l’occasion, aime montrer qu’il est révulsé, on se sert des médias comme on vit. Négligez-vous, et vous négligerez la façon dont vous irez sur internet, regarderez la télé, ou lirez tel journal plutôt qu’un autre, ou aucun. Prenez-soin de vous et vous prendrez soin de la façon dont vous vous informerez, dont vous vous cultiverez, dont vous vous distrairez. Arrêtez de nous faire croire que les médias c’est le goulag des temps modernes, personne ne force personne à regarder des émissions de merde. Les gens ont encore un peu de responsabilité dans leur vie non ? »
Un charlatan mime la frimousse d’Einstein. Une fripouille taillade la cuisse de Satan. Un Suisse fripe la couille d’un Sultan. Saint-Sulpice prise la fouille d’un flétan. Une grenouille surprise flétrit l’étang. Une tante graisseuse souille ses frites de sang.
Orages époustouflants. Épouses soufflantes de rage. Essoufflement et bagout: surnage. Foulards et cagoules : courage. Du fioul dans les épinards : sarcophage.
Tentation de l’abîme, du piètre sacrifice. Sourires factices, farces et manèges. Auspice d’hiver, soupirs sous neige. Sources d’éclairs, fous rires stratèges. Désert sous stratosphère, lumière : siège ?
La mort, les mots, un air à sauvegarder.
Danses chancelantes, démences arrogantes. Nuisances sonores, luisantes aurores.
Julien Lezare
Chapitre 1 de la partie 3 du roman inédit
Vingt-Quatre Sept
2016
Chapitre 1 de la partie 3 du roman inédit
Vingt-Quatre Sept
2016
Biographie de quelques auteurs du Lampadaire.
4. Fred Lucas
NOUVEAUTÉS
Marcel Mauss
Les Techniques du corps 1934
Dès l’enfance, Fred Lucas eut l’âme d’un détective. Ses parents le comprirent très vite. Sa mère, la première. Dans son ventre, il bougeait, il bougeait sans cesse, tâtant les plis et les déplis de sa cache arrondie. Il observait, il réfléchissait, il tirait des conclusions.
De cette enquête utérine il ne lui resta rien. Le passage du monde liquide au monde gazeux lui causa un tel choc qu’il perdit tout souvenir de ses si précieux neuf premiers mois d’enquête.
Tout, sauf l’envie de savoir. Sa libido à lui. Un carnet aurait pu lui être utile. Il aurait noté ses impressions, il aurait su trouver les mots, il en est persuadé ; il les avait, il le sait.
C’est son père qui n’a pas voulu le lui donner.
Fred Lucas, est un imposteur. C’est sa posture, il la revendique. Sans complexe aucun.
« Je suis un imposteur. Même avec les mots. » C’est ainsi qu’il s’est présenté au Lampadaire. « Surtout avec les mots. C’est là mon talent » nous a-t-il dit en postillonnant.
Car ils ne veulent plus rien dire, même ceux du carnet.
Car les vrais sont partis.
Pour toujours.
Filatures, enquêtes, littéraires ou non, sur les impostures en tout genre.
C’est là sa spécialité.
Il décèle l’imposture mais il ne sait la résoudre, la réduire à néant, l’exploser. Juste capable de dire « là il y a quelque chose qui ne tourne pas rond », dire quoi il le sait aussi, mais dire pourquoi, remonter à la source, il ne le sait pas. C’est embêtant, c’est pour ça qu’il écrit.
Parce que sans ça il tourne en rond, comme un chat dans un bocal, non c’est un poisson pardon. Comme un chat qui tente d’attraper le poisson doré qui tourne en rond dans son bocal, longeant les parois transparentes, pourra-t-il échapper au chat s’il tourne en rond plus vite que son poursuivant. Pourquoi écrit-il ? c’est la question qu’il pose au poisson qui la pose au chat qui la pose au loup qui la pose au puceron. Au rose des roses au rouge du rouge qui la pose au quand dira-t-on la réponse, à la ronce la ronde ronce pas celle qui blesse, alors laquelle ?
Comment s’en sortir ?
Pour ses obsèques – il est prévoyant – il a chargé madame Baldieu de préparer la réception donnée en l’honneur de son arrivée dans l’autre monde, car s’il est conscient d’avoir un peu loupé sa naissance il ne voudrait pas louper sa mort. Mais se souviendra-t-il de sa mort et de la réception donnée en son honneur? Comment enquêter sur le futur ? Quels carnets prendre ?
Comment s’en sortir ?
Comment savoir ?
Qu’écrit-il ?
Entre la naissance et la mort comment vivre ? pour qui ? pour quoi ? Ce sont les questions qu’il pose à tous, sans se lasser. C’est là son enquête.
Et chacun lui dit : ne m’enlevez pas ma maison, laissez-moi mes enfants, ne me prenez pas mon moi. C’était toujours la crainte. Des phrases négatives. C’est ce qu’il a trouvé toujours et partout, dans les cris stridents et dans les silences, dans les pleurs et les chants, c’était toujours la crainte, la crainte de ne pas faire ce qu’il fallait faire, de ne pas avoir dit ce qu’il aurait fallu avoir dit. C’est la crainte universelle, c’est cette absence de mots.
Que peut-il y faire ? Comment arranger le monde ?
Il interroge Nerval, il interroge Van Gogh, il interroge Raymond Roussel et même Raymond Queneau. Toujours le même gouffre. La même absence. Il interroge les passants, les vivants et les morts. Il prend des notes, remplit carnets et carnets, carnets sur carnets. Inlassablement.
Il arpente le monde, se cache, espionne, tours de guet, pièges et lacets.
En vain.
Même l’aveugle rencontrée, frileuse, sur le pont d’un bateau, ne lui apporta pas de réponse.
Hubert Lambert
Travail en cours, pour Le Lampadaire
Travail en cours, pour Le Lampadaire
Danse. - Vous avez peut-être assisté aux leçons de M. von Hornbostel et de M. Curt Sachs. Je vous recommande la très belle histoire de la danse de ce dernier. J'admets leur division en danses au repos et danses en action. J'admets peut-être moins l'hypothèse qu'ils font sur la répartition de ces danses. Ils sont victimes de l'erreur fondamentale sur laquelle vit une partie de la sociologie. Il y aurait des sociétés à descendance exclusivement masculine et d'autres à descendance utérine. Les unes, féminisées, danseraient plutôt sur place ; les autres, à descendance par les mâles, mettraient leur plaisir dans le déplacement.
Descente. - Rien n'est plus vertigineux que de voir un Kabyle descendre avec des babouches. Comment peut-il tenir et ne pas perdre ses babouches ? J'ai essayé de voir, de faire, je ne comprends pas.
Je ne comprends pas non plus d'ailleurs comment les dames peuvent marcher avec leurs hauts talons. Ainsi il y a tout à observer, et non pas seulement à comparer.
Le marin
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
C’est un petit concert sur la place du village. Une joie enfantine anime les personnages de cette triste scène. Un groupe de quatre musiciens surannés agite la foule qui danse sans harmonie aucune. Depuis le début il y a ce vieux pêcheur, la soixantaine. Peut-être moins. De toute façon il a l’air vieux. Plus que de raison. Il a le visage rongé, sa peau a endossé les années de travail, de mer, de sel, de vent, d’alcool surtout. Autour de son cou, sous son épaisse tignasse blanche, se balance un cordon abîmé, au bout duquel un sifflet qui joue avec les lumières nocturnes. Ses yeux ont gardé les rides du plissement face au soleil et au vent trop violents de la haute mer. Il devait partir loin et longtemps aussi. Nul besoin de l’interroger pour savoir. On lit sa solitude et le désespoir de cette solitude à même son faciès. Homme aveuglant de la détresse qui jaillit de chacun de ses pores. Il semble s’être habitué à oublier qu’il est malheureusement seul, lui et sa mer. À oublier qu’il vit. Il boit parce qu’il ne sait plus quoi faire d’autre, impuissant à résister à l’aliénation de l’alcool et de la mer. Le marin n’appartient plus au temps, à rien, sinon à la mer. Accoutumé à la douleur, le corps est devenu irréel. Il essaie tant bien que mal de le faire se mouvoir en rythme. L’effort paraît vain et le résultat est pitoyable. Les pieds s’abattent lourdement sur le sol. Désarticulés, les membres s’élèvent avec disgrâce vers les cieux, il ne s’appartient plus. La musique fait ce qu’elle veut des corps. La mer aussi, mais pas ce soir, même si c’est elle qui l’a dévoré corps et âme. Il y a des enfants qui dansent autour de lui et dont il s’émerveille. Et dans cet étrange rapport avec le marin, à travers les pas de danse et les regards, les enfants savent très bien tout ça, sa peine, sa solitude, son envie de boire, qu’il veut mourir. Ils savent que le marin est dangereusement triste, qu’il est déjà la mort. Ils ont peur, ils s’en écartent. Ils voient la mort qui rit sur la musique parce que ce soir elle n’a plus de dégoût, ni de honte, ni de peur d’être elle-même. Elle danse, le marin danse, il vit. Il me fixe un moment, je suis la seule sur cette place à lui rendre son regard. Il s’approche de moi, l’émotion est trop lourde, je baisse les yeux, lâchement. La musique s’arrête. Il part en riant, pendu au bout de son fil. Sa silhouette s’efface tout doucement, là-bas.
Je quitte aussi le décor et je pleure, beaucoup, sans retenue. Je pleure à la santé du vieux marin, je pleure à la santé de la mort. Moi qui n’éprouve que haine et terreur vis-à-vis d’elle, moi qui viens de la voir heureuse, cette insolente riant parmi les gens qui ont horreur d’elle. Je marche et je pleure, songeant à mon marin souriant, porté par le rythme, le désordre de la foule, dans l’ivresse de mon émotion, souffrant pour cet homme qui n’en peut plus de vouloir mourir. Cette force vacillante qui me met hors de moi, en dehors complètement, hors d’atteinte de mon être, face à l’Autre, l’inconnu, le marin. Lui qui est si loin et si proche. Incarnation terrifiante de cet être tant aimé, recelant la vérité de mon monde, celle que je cherche à fuir, l’invisible.
Il n’y eut pas un instant où je ne fus scandalisée par l’impudeur de cet homme dans sa détresse. Ce en quoi il est remarquable. Sa vertu. Avouer, affirmer, légitimer son chaos intérieur équivalait au plus grand péché, et c’est en cela qu’il rayonnait. Il était l’homme le plus triste et l’affichait avec la certitude la plus immorale qui fût. C’est de cela dont il était libre et sur quoi il légiférait. Grâce à quoi il se détachait de la mer, de son emprise.
Assumée pleinement par lui, cette destruction de soi, le non-sens de la vie, trouvé dans le seul sens de la mort, prend une dimension écrasante, au-delà de tout beau. Et par-là je comprends qu’il ne suffit pas seulement d’accepter quelque tragédie. C’était comme si le marin se montrait à moi, me disant : «Vois ce qui est beau, davantage encore, vois ce qui te dépasse et aime-le, au travers moi, accepte le sublime de cet être aimé que tu es incapable de voir. » Il me semble être autorisée, comme par un commandement du hasard, à accéder à une vérité d’une puissance destructrice telle qu’elle provoque ce chavirement en moi, cette perte du centre de gravité, de tout repère, une sorte d’expérience mystique.
Alice Azzarelli
Le marin
2016
Le marin
2016
Dérive
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
flux
toute ivresse ankylose le moineau
revivre
voyage macrocosmique
pivot stochastique
expropriation abdication
autoperception ouest puis nord parfois est
trajectoire brancardée
9, 8, 15, 8
20, 26
verticale glissante crucifixion horizontale
ce n’est pas face à la trajectoire du monde que l’écriture est dérisoire, c’est face à soi et c’est bien pire
dérive
flux
chute
sortir du ruisseau de-revirare poussé par le vent traverser être emporté par les vents ou les courants dériveurs artillerie limer la rivure d’un clou pour le faire sortir de son trou pour chasser une roue de son pivot stochastique
toute ivresse ankylose le moineau
vivre
voyage macrocosmique
expropriation abdication dissociation
autoperception ouest puis nord parfois est
trajectoire brancardée
9, 8, 15, 8
20, 26
du 20 au 26
verticale glissante crucifixion horizontale
ce n’est pas face à la trajectoire du monde que l’écriture est dérisoire, c’est face à soi et c’est bien pire
flux
cri
déviation soustraction
glissement plagiat
gras ping lissage
rive
flux
sortir du ruisseau de-revirare poussé par le vent traverser être emporté par les vents ou les courants dérivants artillier limer la rivure du clou et sortir de son trou pour chasser une roue de son pivot stochastique
toute ivresse ankylose le moineau
dé-vivre
voyage cosmique
expropriation abdication, soumission
autoperception ouest puis nord parfois est
trajectoire brancardée
9, 8, 15, 8
20
la 26
verticale glissante crucifixion horizontale
fin
dérive
anonyme (moyen-âge)
Trame d’opéra
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Gestes Gestes mécaniques, mécanique des gestes, mouvements de bielles, belle machinerie, dans la salle des machines, mécanicien à l’œuvre, vieux chef d’orchestre, le concerto en sol de Ravel, virtuosité d’équilibriste, à la vie à la mort, on retient son souffle, il s’en faut de si peu, une microseconde, un dixième de millimètre, et l’illusion acoustique déraille, le public trébuche, l’acrobate se tue, il travaillait sans filet…
Le filet de la voix se tend, se tord, se dénoue, se relâche, lâche sa proie, se redéploie, s’élève au plus haut des cieux, retombe au plus bas, se brise dans un éclat, la voix est fêlée, la voie est sans issue…
Elle cherchait du secours, elle courait dans le tunnel, elle se heurtait à un mur de pierre, puis à un autre, puis à encore un autre, la vie était ainsi faite, il fallait courir, courir, toujours courir, ne jamais s’arrêter, faire semblant de chercher, d’avoir un but, chercher l’issue, chercher, désespérément chercher, ne jamais rien trouver, continuer de chercher, de faire semblant de chercher…
Qui cherche trouve… des chansons de trouvères… des gestes de troubadours… des exploits de funambules… des histoires d’opérettes… des opéras de quatre sous… des petits rats de l’opéra… des rats d’égouts, des ragoûts, des ragots, des fagots, des bigots, des chapeaux, des gens qui mangent leur chapeau…
Sur les chapeaux de roue… avancer, reculer, tournoyer, se noyer, surgir des flots… de voitures… sur les routes… qui déroutent… sens interdits, contresens, contraventions, rétention, gesticulation, gestes, gestes… précision du geste…
La précision d’une horloge… tic tac, tic tac, en avant, marche, une deux, une deux, deux par deux, en rangs, une seule tête, la tête au carré, carré d’as, as de pique, pique-nique, pas de panique, on s’arrête au signal, on signale, on signe, on saigne, on enseigne, on est le maître, on maîtrise, on abuse, on bute, on s’excuse, on remet les pendules à l’heure, on repart, on rattrape le retard, on met les bouchées doubles, on double, on dépasse, on se dépasse, on trépasse… on n’a pas vu le temps passer…
Réitération, duplication, duplicité, complicité, complexité, tissage, navettes, métissage, métis, mésaventures, vent qui tourne, girouettes, retourner sa veste, d’un même geste, mentir, tricher, rater, jeter, cent fois sur le métier, recommencer l’ouvrage, ouvrager, outrager, prendre de l’âge, agir, agir, agir…
Agent de police, agent double, vif-argent, poches trouées, puits sans fond, délire, tire-lire, ligne de bus, tirer un trait, se tirer, délirer, lire-lire, pleurer, se leurrer, se mentir, gommer, effacer, perdre la face, jouer une farce, rire, faire rire, rictus, rixe, boxe, box, boss, rentrer dans sa case, retourner à la case départ, jeu de l’oie, jeu de Monopoly, jeux de mains, jeux de vilains…
Monopoliser la parole, prendre de vitesse, griller la politesse, verbaliser, mettre en mots, émietter, éparpiller, papillonner, vibrionner, histrion, hystérique, neurasthénique, névralgique, stratégique, pas de quartier, à vos ordres mon général, remballez les bastringues, à bas le désordre, on ferme les bazars, on refuse le hasard, on règle, on codifie, on est réglo, la main ne tremble pas, le geste est assuré, le monde marche à la baguette, à la trique, à la matraque… tout est réglé… comme du papier à musique…
Un ange passe… grâce des mouvements dansés… le cygne meurt… les ailes d’un albatros emportent les pleurs… beauté de l’envol… tristesse du vol… la vie volée s’envole… un vent violent l’emporte… courant d’air, porte claquée, le camélia de la dame perd ses pétales, le compositeur perd les pédales, autant en emporte le vent, et caetera… et caetera…
Françoise Gérard
Trame d’opéra
2016
Trame d’opéra
2016
Urgences
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Quai des Invalides, dix minutes d’attente,
minutes longues…
Elle a craché sur l’écran en mâchouillant ses bonbons.
Mais les minutes ne font pas des croches.
Course aux urgences à l’arrêt.
Hôpital Moignon… son pied… malaise…
mal assis, mal compris.
À quoi sert un poète aux urgences ?
J’ai surtout autant besoin d’elle qu’elle de son pied.
Quai de l’Alma, elle a mal – loin…
enfant suivant ma mère sur Paris et ses musées…
plus tard, avec mon frère sûrement les quais et ses soirées –
là, pressant ce train cahotant mes pensées.
Vite, la voir, vis-à-vue au-deçà de sa douleur !
Toute urgence s’arrêta en salle d’attente…
De touche en touche communication téléphonique sans la toucher derrière cette cloison.
Trouble de perception… seul… Le Chesnay… hôpital… mon père… je sors prendre l’air pluvieux.
Trois heures de calme, d’air rechignant sa contrainte par la ventilation mécanique,
deux trois toux éparses, rires entre infirmiers, deux jambes qui ne semblent pas ici courent de sa mère à une autre femme, qui est-ce pour elles ? Réflexions bloquées contre cette porte vitrée.
En tout et pour tout six heures d’attente, sans en savoir plus, sortie sur un pied, la chaussure à la main, clopinant…
Nous voilà bien avancés… dans le temps.
Olivier Le Lohé
Urgences
2016
Urgences
2016
Une tasse de thé
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Je suis allé jusqu’à la gazinière et j’ai mis de l’eau à bouillir. Je n’ai pas fait attention et je suis revenu seulement deux millions d’années plus tard ; l’eau était encore là. J’ai versé l’eau dans une tasse de thé, et j’ai mis dedans 250 000 kilos de thé noir, parce que j’aime le thé très fort. J’ai posé sur un plateau mon thé, un récipient contenant le reste de l’eau chaude, les 100 kilos de thé en sachet qui était en trop et encore 350 tasses, au cas où quelqu’un en voudrait aussi. J’ai marché 10 000 mètres jusqu’à mon salon, où se trouvait mon épouse. “Tu veux du thé?”, criai-je dans ses oreilles de toutes mes forces, “Pardon?”, “Je t’ai demandé si tu voulais du thé”, ai-je dit en murmurant de l’autre bout du salon, “Oui, je veux bien”. J’ai mis le thé dans une tasse ; elle le but et me dit que c’était le plus mauvais thé du monde, et pour cette raison elle appela l’armée russe ordonnant qu’on me bombarde la tête, mais avant qu’elle ait terminé sa phrase, d’un coup de pied j’ai envoyé voler le câble principal de l’entreprise de télécommunication, laissant toute la ville sans téléphone. Quelqu’un s’en ait aperçu et a commencé à me tirer dessus avec un bazooka pour se venger. J’ai couru jusqu’à l’autre continent et je me suis caché dans un trou de 500 000 kilomètres de profondeur. “Ici personne ne va me trouver”, pensai-je juste après avoir verrouillé le portail en fer avec un mot de passe de 720 chiffres et lettres, mais dès que je tournai la tête, mon épouse était là, brandissant une épée d’acier en direction de ma tête. Heureusement, un héron volait par là au moment où elle assénait le coup, de sorte que l’épée s’abattit sur le crâne du héron. Comme son crâne était très dur, l’épée ricocha et commença à voyager en direction de la tête de mon épouse. Avant que l’épée ne l’atteigne, le commandant de l’armée russe (qui n’avait pas compris le message de mon épouse, mais s’était imaginé qu’elle était en danger) tira un boulet de canon dans l’épée et la tua. J’ai pleuré et j’ai pris mon épouse dans mes bras, lui disant que plus jamais je ne ferai le plus mauvais thé du monde. Nous avons pris un téléphérique et nous sommes revenus à la maison. Après avoir pris une douche, j’ai commencé à réciter à l’improviste pour ma femme un poème épique sur une grande bataille livrée au nom de mon amour pour elle, contre toutes les forces adverses de l’univers. Lorsque j’eus terminé, elle s’était déjà couchée, réveillée, douchée, avait écrit un poème épique sur un héros qui ne savait pas faire le thé (et pour cette raison avait coulé son empire), et était allée travailler.
Rafael Sperling
Une tasse de thé
publié dans le Journal Rascunho, mars 2012
Traduit du portugais (Brésil) par Émilie Audigier
Une tasse de thé
publié dans le Journal Rascunho, mars 2012
Traduit du portugais (Brésil) par Émilie Audigier
Vincent vomit
NOUVEAUTÉS
Il entre. Vincent entre. Il reconnaît tout. Dans le moindre détail. Les myosotis, les roses de Noël, les anémones et les renoncules, les giroflées et les marguerites, les parterres de fleurs découpés comme les parts d’un gâteau, un gâteau à quoi ? indigeste se rappelle Vincent. Bourré de médicaments, de neuroleptiques, de drogues à l’essai, épais comme un pain d’épices cuit à la glue d’opium, à l’odeur écœurante de clous de girofles. Cette texture, cette mélasse, son cerveau. Vomira-t-il là, sur le seuil, au moment de le franchir, alors qu’il a encore la main sur la poignée de cette porte cochère qui ouvre sur un jardin qu’il lui semble reconnaître. Alors qu’il ne sait plus s’il entre dans sa peinture ou dans un jardin. Il se heurte aux bordures. Aux bordures de son cerveau qui caquète, annone des qui et des que, qui hache et rompt, qui a perdu la douceur du geste, le fondu de la couleur. Non, plus jamais le fondu de la couleur. Mais la blessure du trait. L’odeur douceâtre de la douleur amoindrie par les drogues.
N’y avait-il pas, au centre du gâteau, comme un bassin avec des poissons rouges nageant bien visibles à la surface, dessinés par une main d’enfant. Les avait-il dessinés lui, le jeune Vincent dans des temps plus heureux lorsqu’il se promenait sous les arcades, sautant de l’ombre à la lumière et de la lumière à l’ombre.
D’ombre en ombre, et plus jamais de la lumière à la lumière.
Une stèle sur laquelle ils ont reproduit le dessin du jardin tel qu’il l’avait peint, le brut de la pierre mortuaire, les poissons rouges et le bassin.
Tous les asiles se ressemblent, se dit-il en poussant la porte du musée qui lui est consacré.
- Votre billet ? lui demande le gardien.
- Je suis ici chez moi, c’est mon nom que vous voyez là, sur la palissade. Les faussaires ont imité mon écriture.
- Vos papiers ? lui réclame le gardien.
Il montre l’ordonnance, la liste des médicaments à ne surtout pas égarer, la liste des peintures à acheter, sans oublier la térébenthine pour diluer les couleurs, les pinceaux qu’il lui faut réassortir, on en use tellement à vouloir peindre des paysages, ils sont abîmés il lui faut les renouveler, il montre l’arrêté d’enfermement, celui qui désigne l’asile dans lequel encore une fois il doit séjourner.
- Vous voyez on m’attend. C’est ici chez moi, répète Vincent.
Il montre l’esquisse du jardin qu’il a dessiné et selon laquelle ils ont disposé les plantations, arbres, arbustes et fleurs.
- Vos papiers d’identité, une facture de téléphone, de gaz ou d’électricité, je ne vous demande rien d’autre, s’énerve le gardien.
Pas besoin de paysagiste.
- Poussez-vous de là, vous êtes ici chez moi.
Pas besoin de gardien.
A-t-il avalé une part trop importante du gâteau, Vincent hurle en anglais, lui qui ne connaît que le français et le hollandais.
- It is my garden, The Garden of the Asylum at Saint-Remy.
- Mais tu n’y es pas, lui rétorque, soulagé le gardien qui croit avoir compris. Nous pas être Saint-Rémy . Nous être Arles et toi être bientôt prison quartier des fous, espèce de sale SDF. Ouste, hors d’ici.
Tout se confond dans la tête de Vincent, tous les asiles se confondent. Pourquoi les ont-ils tous construits d’après mon dessin, pourquoi cette obsession, cette absence d’imagination. pourquoi ces tourniquets, ces arbres tordus sous quelle douleur. La tête lui tourne, il vomit. Il vomit sur les myosotis, les roses de Noël, les anémones et les renoncules, les giroflées et les marguerites, il vomit sur les pieds du gardien, il vomit des flots de peinture aux odeurs douceâtres de térébenthine et de clou de girofle, aux couleurs entremêlées des berlingots, pyramides aux arrêtes acérées qu’il tournait et retournait entre ses doigts d’enfant pour savoir où commençait et finissait ce trait blanc qui démarquait le rouge, le jaune, le vert, le noir, le pourpre, et même le bleu, va savoir ce qui dans le goût confondu dans la bouche appartient au jaune, au vert, au rouge, au blanc, au vert de la menthe, au bleu du ciel, au brun de la térébenthine ou de la résine de pin, au vert de l’absinthe, au blanc de quoi, le blanc qui trace le trait, qui brise la couleur, ce qui dans le moulin à vent de papier vierge qu’il lui fallait colorer aux couleurs des berlingots, berlingots agrandis et éclatés, ce tourniquet qu’il tenait enfant, qui tournait tournait dans le vent hurlant sur la plage du nord, appartenait au blanc, au vert au bleu au jaune. Va savoir, répète Vincent la bouche pleine de peinture. Va savoir.
Et c’est en même temps si calme
- car je recherche le calme, dit Vincent au gardien qui a déjà appelé les pompiers, l’ambulance, la police, les éboueurs, la sécurité, que faire maintenant de toute cette mélasse peinturlurée qui envahit tout, il ne manquerait plus qu’elle s’infiltre sous la porte et défigure le musée. On se dirait dans une confiserie, dans une usine à peinture dont les machines ne sauraient plus s’arrêter de déverser leur production, mais pas dans un musée. Le système a pété sauté et plus personne ne sait l’arrêter. Il n’y a plus personne.
- Et mon musée que va-t-il devenir, pleurniche le gardien.
- Regardez, gardien, comme je suis calme et lumineux. Je ne tourne plus, c’est fini, la crise est finie. Terminée.
Le gardien voit une lumière et s’effraye, car ce n’est ni le gyrophare de la voiture de police, ni celui du camion de pompier, ni celui de l’ambulance qu’il voit. Pourquoi n’arrivent-ils pas plus vite ? La lumière semble venir du corps de l’homme qu’il a en face de lui, cet homme qui s’est transformé en gyrophare fixe arrêté explosé bloqué, à lui seul policier médecin et pyromane. C’est une étoile, il va rejoindre les étoiles, il s’enflamme dans un tournoiement hurlant, en sifflant, en éructant les syllabes d’une langue étrangère, totalement étrangère dans laquelle on entend les relents d’opium, une langue ulcérée à l’odeur opiacée aux sons stridents, inaudibles qui percent le cerveau s’ulcérant au passage. Un cerveau explosé, criblé de flèches, transpercé.
Et en plus il se dit calme, c’est un allumé essaye de se rassurer le gardien, un simple allumé.
Qu’est-ce qui l’allume ainsi ?
- Excusez-moi, dit Vincent, redevenu humble, puis-je m’asseoir un moment ici, je suis un peu fatigué, la tête me tourne voyez-vous. Vous permettez ?
- Non, répond l’homme apeuré. Non, rentre chez toi, va-t-en, je ne veux pas de toi ici, je n’aime pas les visions, je n’aime pas les fous, je n’aime pas les extraterrestres, les capsules galactiques extrasidérales, les soucoupes volantes, je n’aime que mon petit jardin, l’odeur du bœuf-carottes et regarder la télé-réalité. J’ai vu un film dans lequel deux péquenots pactisaient avec des extra-terrestres, ce n’est pas mon genre, tu t’es trompé d’endroit, retourne là d’où tu viens. Ouste, dehors. Ce n’est pas moi.
Hubert Lambert
Travail en cours, pour Le Lampadaire
Travail en cours, pour Le Lampadaire
Lait trompeur
NOUVEAUTÉS
1
Quand je rentre dans la maison, il y a d’abord l’odeur qui saisit, vive, telle une algue, quelque chose qui accroche, qui colle, dont on ne peut se défaire. Une odeur de peau, de saleté, de vomi, de diarrhée. C’est ton odeur, la nouvelle. Elle habite tout ce qui t’entoure. Elle est âcre, insupportable. Sous son empire, tout devient déplaisant à la vue, au toucher. Les meubles collent, poissent de cette même odeur, de cette même crasse. Cette crasse partout autour de toi. Elle s’installe là depuis que nous sommes partis. Elle ne te quitte plus. Je la déteste. Elle me soulève le cœur. Te voir me soulève le cœur.
Tes cheveux autrefois légers comme un duvet, bouclés d’ébène sont à présent plaqués, gras, luisants, lisses, au-dessus de ton visage défait, bouffi, déconfit. Tes yeux disent le vide de la mort, de la vie qui est partie. Tu es loin, loin, tellement loin derrière ton abattement, tes épaules écrasées. Enfoncé en toi-même.
Il y a la double porte accordéon en PVC du salon. Le chien la passe en en faisant vibrer les panneaux. Il n’y a que lui pour vivre ici.
Moi-même lorsque je franchis le sas d’entrée, quand l’odeur m’étreint la gorge, je perds un peu de moi, de ce que j’ai pu être avant. De ce que nous avons vécu. De mon père. Je ne te reconnais plus. Tu es méconnaissable pour quiconque. Tu n’es plus là, c’est tout comme.
Souvent tu me fais face. Toi, voûté dans le canapé hors d’âge. Moi dans ton Voltaire rouge qui signifie tant, dans lequel je te vois encore, heureux, en slip et chemise au retour du travail, souriant au chien qui lèche tes orteils. C’était drôle. C’était toi. Ça mettait maman hors d’elle et cela ajoutait au comique. On se comprenait. On riait. Tu étais mon clown, mon ami, mon soutien, ma sécurité. Je savais que tu étais là pour tout un tas de raisons dont je faisais partie et j’étais fière, si fière de ça. Tu étais le père dont tous les enfants rêvent. Tu étais au-dessus de tout, de nous tous. Ta joie, ta persévérance, ta hargne à combattre. Ta force, tu me semblais indétrônable. Il y a eu trop de combats.
Maintenant, assise face à toi, je vois le vide. Il n’y a que cela et c’est affreux. Le ghetto de Varsovie, les ruines, les êtres apeurés, terrifiés qui se cachent, aux abois, prêts à être anéantis. Tu te caches de toi-même dans cette épave qu’est devenu ton corps, dans le chantier de la dévastation, cet habitacle brinquebalant, mauvais, qui te fait capituler.
De l’alcool, il y en a tellement eu. Tu essaies de promettre, tu essaies d’y croire et moi avec. Nous voulons que ça s’arrête, que ça redevienne comme avant même si l’on sait que c’est impossible. Que cette guerre ne permettra à rien, jamais, de retrouver sa forme première. Qu’il y a eu trop de dégâts, trop de dommages.
J’ai envie de hurler. Que tout le monde sache. Qu’on nous vienne en aide. Nous sommes seuls. Tu es plus seul que quiconque, prisonnier du corps qui t’appartient, de la dépendance qui n’est qu’à toi, dont tu n’es pas coupable mais dont tu es pourtant l’agent. C’est incompréhensible.
Inimaginable, inconcevable. Toi alcoolique, mourant. Moi loin de toi, de cette maison qui était mon monde, que nous avons quittée en prenant bien soin d’achever la légende familiale pourtant chérie comme seule vérité possible.
J’ai vingt ans, environ.
2
Samedi matin, je suis en classe de 1re, je me réveille enthousiaste. Ce soir, nous fêterons les dix-huit ans d’un ami, j’ai hâte d’y être.
Quand je me lève, ou un peu après, je ne sais plus, je vois ces sacs en plastique, sur la table du salon. Je les ouvre. Ils contiennent des bouteilles. Je me mets à réfléchir, très vite. De toute évidence ces sacs me sont adressés. Et merde. Il y a quelques semaines toi et maman êtes partis pour le week-end, j’ai fait une soirée à la maison. J’avais dit pas d’alcool. Ils ont quand même dû en amener, ils ont oublié les bouteilles dans le jardin, vous venez de les trouver. Je m’apprête à me faire passer un savon. Maman entre dans le salon. Je vois dans son regard que ça va mal se passer. Je lui demande ce que c’est, ces bouteilles sur la table, parce que vraiment je ne suis pas certaine de ce que ça fout là. Je m’attends à me faire défoncer. Elle me dit demande à ton père, avec sa voix sèche méchante.
Je ne comprends plus rien. Qu’est-ce que tu as à voir là-dedans. Je ne sais plus quand ni comment tu te retrouves là avec nous. Je me souviens de ce demande à ton père, tendu de haine, de colère froide. De toi assis dans ton Voltaire, la tête tellement courbée de honte qu’elle pourrait bientôt toucher le sol. De ma mère, de la violence dans son regard, juge suprême condamnant, devant sa fille, son misérable mari. Il n’y a que haine, colère, violence, honte, mépris. Et moi entre vous je ne comprends pas ce qui m’arrive. Je sens que ça s’écroule mais je ne comprends pas.
Plus tard S. rentre, monte dans sa chambre. C’est peut-être cinq minutes ou deux heures après. Comme d’habitude il est monté sans un mot, j’ignore d’où il vient, il a dû passer la nuit chez sa copine. Je me tiens à la porte de sa chambre. Assis devant son bureau, il me tourne le dos. Je lui dis tu savais que papa est alcoolique. Non, lui non plus. Il se lève, on descend tous les deux. Tu es toujours assis, la tête pendante, tu n’as pas bougé. S. désamorce la colère de maman, il dit qu’on va s’en sortir tous ensemble, qu’on va se serrer les coudes, que tout va bien aller. J’y crois. Tout va bien aller. On est ensemble. On est une famille.
Cela fait au moins deux ans que ça dure, que tu bois. En cachette, dans ton garage. Plus tard, pas sur le moment mais plus tard, certaines choses prendront sens. Les repas où tu racontais n’importe quoi, t’endormais à table, les réactions disproportionnées de maman. Donc ce n’étaient pas les médicaments pour soulager ton dos. Tu n’avais pas pris simplement un cachet dans l’armoire à pharmacie de façon anodine. Tu étais sorti, avais pénétré les sous-sols des garages. Avais sans doute refermé derrière toi la porte de fer et t’étais calé là, entre les étagères du fond et le coffre de la Ford Escort. Tout seul dans le noir avec tes bouteilles. Sans lumière parce que la lumière est à l’extérieur des box, que c’est une minuterie, qu’il faut sortir pour l’allumer, et que tu ne devais pas vouloir prendre ce risque, qu’on te voie boire dans ton garage.
Du rhum bon marché, bien dégueulasse. Une bouteille, un litre chaque soir en rentrant du boulot. Puis du Schwepps pour changer le goût, l’haleine. Combien de temps as-tu passé ivre, là-dedans, à demi mort sur le sol, avant de trouver la force de sortir, de rentrer à la maison. Mon esprit ne cherche pas encore à se représenter cela. Les traits du visage de l’horreur se préciseront, prendront forme, s’affineront à mesure que nous glisserons dans la merde, dans toute l’étendue de la merde de ta dépendance, de la fureur de maman.
Pour l’heure nous sommes samedi matin, j’ai dix-sept ans et je crois S. qui te dit que nous allons t’aider, que tu vas t’en sortir, qu’on va s’en sortir. Je pressens un bouleversement dramatique sur lequel mes pensées glissent sans rien saisir. Mais je le crois.
3
Maman est pleine de haine pour toi et ça ne la quitte pas. Ça ne la quittera jamais. Elle vivra toute sa vie de femme déçue, d’épouse cocue. Elle gardera toujours sa colère. Peut-être amoindrie, mais toujours là, auprès d’elle. Parfois je me demande si ce n’est pas ce qui la tient debout. Elle ne peut pas s’en défaire. Son mari est alcoolique. Pas le mari d’une autre, pas celui d’une autre femme qu’elle peut juger, qu’elle ne plaindra pas parce que, ce qu’elle croit, c’est que tout se mérite. Pas le mari d’une autre. Le sien. La honte est pour elle et elle seule. Elle a honte de toi, cet homme qui se dégrade, qui se détruit, qui n’a plus l’estime de lui ou au moins d’elle pour l’épargner. Pour lui épargner l’infamie, l’opprobre de ta maladie qu’elle ne reconnaîtra jamais comme telle, quoi qu’elle en dise.
Elle dit que les alcooliques on les revoit toujours dans les hôpitaux, qu’ils n’ont pas de parole, qu’ils n’arrêtent jamais, jamais, qu’on ne peut pas les soigner, qu’on ne peut rien pour eux. Peine perdue. Elle ne le dit pas avec ces mots, mais au fond ça revient au même : pour elle ce sont de sombres moisissures vautrées dans leur déjection. Et toi, son mari, tu es comme ça. Un salaud qui la couvre de honte. Ce n’est pas la vie qu’elle avait imaginée. De même, elle me dira plus tard, à moi, sa fille, qu’on n’a jamais les enfants qu’on avait imaginés. Elle le dit en toute innocence, presque sur un ton de sagesse, comme si ça ne faisait pas mal d’entendre ça, qu’on n’est pas à la hauteur des souhaits de sa mère. Ou alors elle sait et elle s’en fout que ça fasse mal.
Ce n’est pas la vie qu’elle avait imaginée, ce n’est ni le mari ni les enfants qu’elle avait imaginés. Et pourtant c’est sa vie. Elle ne s’y résout pas.
Malgré tout elle reste avec toi, avec cet homme qu’elle n’aime pas, qu’elle n’aime plus depuis longtemps. Cet homme qui lui offre son pire cauchemar, cette vie qu’elle croyait réservée aux autres, aux femmes que l’on méprise ou que l’on plaint. Elle reste par devoir. Parce qu’elle ne supporterait pas de partir. D’être une femme divorcée. Elle a dû, par la force des choses, renoncer au bonheur en couple. Mais renoncer à l’idée même du couple, elle ne peut pas. Elle doit rester mariée. À tout prix.
Elle te dit que tu es gras, elle ne te touche pas, n’a jamais une parole aimable pour toi. Elle te dit que tu lui fais honte. Elle te dit que personne ne te force à boire, que tu n’as pas de volonté. Elle te dit que si tu veux arrêter, tu n’as qu’à le faire. Que tu continues parce que tu le veux bien. Que tu es faible. Lâche. Gras. Avec dégoût, elle te dit que tu es gras.
Quand tu l’as trompée, quand elle l’a appris, elle aurait pu partir. Simplement partir, te cracher à la gueule, s’avouer l’échec de votre couple. Elle aurait eu raison. Personne ne l’aurait condamnée. Ça aurait été toi le salaud, le mari fautif. Je n’étais pas encore née, il y avait S. qui devait avoir un ou deux ans. Elle t’aurait quitté, on n’en n’aurait plus parlé. Vous auriez refait votre vie et peut-être fini par être heureux, chacun de votre côté. Mais elle ne voulait pas que son fils soit un enfant de divorcés. Ce sont ses mots. Elle me l’a dit à moi. Elle l’a dit à S. Sous-entendant sans toi, mon fils, je l’aurais quitté, j’aurais préservé ma dignité, mais tu étais là, tu étais né et tu m’as empêchée de partir. Tu m’as condamnée au malheur en m’obligeant à rester avec ton père, cet homme dont je ne veux plus. Et tout ça je l’ai fait pour toi. Je me suis sacrifiée pour toi. C’est pour toi et à cause de toi que je souffre. Comme si elle n’avait pas pensé une seconde à elle, comme si elle avait été capable de la plus pure abnégation. Or une telle abnégation se tait, elle reste muette, silencieuse, elle ne demande pas à être reconnue. Ou ce n’est plus du sacrifice.
La vérité c’est que maman a surtout pensé à elle en refusant de te quitter, même s’il est tout à fait probable que c’eût échappé à sa conscience. Elle ne pouvait concevoir d’être, elle, une femme divorcée. Prononcer je suis divorcée. J’ai un fils et je suis divorcée. Qu’auraient dit, ou pire, pensé les autres. Elle aurait donné raison à tous ceux qui avaient d’entrée de jeu condamné le choix de ce mari, de cet homme fantaisiste et pas sérieux. Pire, elle aurait donné raison à son père. Elle n’aurait enduré ça pour rien au monde. Alors elle est restée comme plus tard elle restera quand tu deviendras alcoolique. Pour elle. Sans doute pensait-elle que tu arrêterais, qu’on pourrait étouffer l’affaire sans que personne ne soit au courant jamais. Qu’on reprendrait une façade normale et lisse. Il n’y avait rien à faire d’autre, de toute façon. Je crois que pour elle c’était juste comme ça. Elle devait rester. Porter sa croix jusqu’au bout. En silence. Rien de cette prétendue abnégation ne t’a jamais aidé.
Nous la suivons, S. et moi. Pendant des années, nous te fliquons, t’humilions, te passons les pires savons et disons les pires horreurs, chaque fois que tu bois, chaque fois que nous comprenons que tes promesses ne tiennent pas. Nous planquons ta carte de crédit, la mettons sous clé, vérifions qu’il n’y a pas un radis dans ton porte-monnaie, essayons de t’empêcher d’acheter à boire. Allons à ton garage à la recherche des bouteilles. Les ramenons à la maison, te les foutons sous le nez comme on colle le nez d’un chien contre sa pisse pour lui signifier qu’il a fait une connerie, qu’on sait, qu’on n’est pas contents. Qu’il va être puni.
On te prive d’amour, de tendres paroles. On ne te dit rien de gentil. Seulement que tu nous déçois, que tu nous gâches la vie. On te fait comprendre que tu ne vaux rien. Que tu es une merde. Une merde sans volonté, rien de plus. Pas même un homme. Le peu de dignité que tu étais peut-être parvenu à sauvegarder, on te l’enlève. On te la piétine sous le nez. Nous ne sommes plus que haine et colère. Et désespoir. C’est la seule chose qui nous unit désormais. Nous sommes misérables mais incapables de l’admettre. Nous décrétons que c’est toi l’homme de misère. Nous t’ôtons ta dignité et essayons de nous en parer à ta place. Nous nous drapons de ce qu’il te restait d’amour de soi. Dans notre orgueil grandissant toujours, nous nous figurons que nous valons mieux que toi, que nous n’avons rien à nous reprocher, que tu es seul responsable. Coupable.
4
C’est étrange comme le monde change avec l’alcool d’un autre. Les repères basculent. Vivre avec un alcoolique, c’est ne plus vivre tout à fait. La norme devient l’angoisse, l’exaspération, la colère, la rage. La rage se transforme en désespoir, encore plus vite en haine de soi. Je l’ignore ce samedi matin où j’apprends que tu bois. Je veux croire qu’il y aura une solution, qu’en avoir parlé c’est déjà l’avoir réglé. Je me figure que ce ne peut pas être si grave. Un alcoolique boit de l’alcool, il n’arrive pas à résister, il y va. Il est bourré, il nous emmerde le temps que ça dure et ça s’arrête là. Je sais que ce n’est pas une bonne chose, que cela signifie que tu vas mal, mais je n’imagine pas plus loin et je pense que ça va s’arranger. Je n’ai pas encore saisi à quel point cette maladie fusille tout ce qui bouge encore, à quel point le quotidien se transforme en un gouffre toujours plus profond, que ni toi ni nous ne pourrons plus que survivre désormais. Que toute force, toute détermination s’envoleront pour nous laisser chaque jour plus démunis que la veille. Démunis et isolés. Que l’alcool ne détruit pas seulement le malade, mais déploie avec vigueur ses tentacules, s’attaque à tout ce qui l’entoure. Je crois me souvenir qu’au début, la nouvelle réalité est là, troublante certes, mais bien surmontable. Mon père boit. Ça ne te ressemble pas mais c’est ainsi. Ce n’est qu’un mauvais moment à passer.
Je continue d’aller au lycée, de voir mes potes le week-end. Faire mes devoirs avec plus ou moins de sérieux. Tous les soirs je sors le chien, j’en profite pour fumer une clope avec A. J’ai parfois des crises de spasmophilie, des angoisses, des moments pendants lesquels l’idée d’appartenir à mon corps m’affole, mais je n’établis pas de lien avec ta maladie, l’effet qu’elle peut avoir sur moi, d’ailleurs je ne sais pas à ce moment-là que c’est une maladie. Je vis comme si ce fait n’existait pas. Les seules choses qui me préoccupent ont lien avec mes amis, la musique, les soirées à venir. J’attends les week-ends où l’on va chez les uns et les autres, à des concerts. Des histoires d’amour. Le reste n’a pas d’importance. L’existence continue sans grand changement. Je vis en totale ignorance de ce que tu traverses. L’annonce de ton alcoolisme ne signifie pas l’annonce de ta destruction, encore moins de ton envie de te détruire. Je ne mesure pas tout ça. La vie de famille est semblable à ce qu’elle est depuis des années. Nous sommes des étrangers les uns pour les autres.
Maman rentre du travail et ses premiers mots sont des cris de mécontentement. Les chaussures ne sont pas rangées, le goûter traîne sur la table basse, la vaisselle n’est pas faite, ou alors il fait trop chaud dans la maison. Qu’importe le motif, elle en trouve systématiquement un pour râler, crier, lâcher sa colère sur ce retour chez elle qu’elle ne veut apparemment pas. Pas de bonjour, pas de comment ça va as-tu passé une bonne journée ma chérie. Rien de tout ça. De l’acidité, de l’aigreur, tout ce qui peut sortir d’énervement. J’aurais aimé une mère heureuse de me retrouver en rentrant chez elle le soir.
Tu es absent. Quand tu es là c’est comme si tu étais ailleurs. Tu n’as pas de place chez toi. Tu rentres, caresses le chien, tu es heureux de retrouver ton chien, ton dernier puits d’affection. Tu es demeuré tendre, doux, le cœur davantage devenu cet immense vide assoiffé. Tu n’as jamais un mot méchant pour moi, n’exprime ni attente ni insatisfaction. Ce n’est pas pareil avec S., votre conflit est permanent. Quand S. est là je suis mal à la l’aise. Quand ma mère est là je suis mal à l’aise. Avec toi je me sens bien. Jusqu’à un certain point. Pour l’instant il reste encore de toi. Affaibli, mais il en reste.
S. me hait. Il déteste aussi ma mère, aussi toi. Il se sent détesté par vous, par moi. Toute notre famille. Je n’ai jamais eu d’échanges heureux avec lui, pas encore, ça arrivera après ta mort. Bien avant tu parvenais à faire régner une certaine harmonie entre nous, plus maintenant. Pour l’heure, je ne sais pas ce que c’est d’avoir un frère ni d’être une sœur pour quelqu’un. Nous n’avons rien en partage. Parfois, trop rarement, il m’ignore et c’est encore ce que je préfère. Des deux côtés nous ne nous supportons plus. Nous avons horreur de vivre ensemble et ne pouvons faire autrement qu’endurer le supplice quotidien de se voir, d’avoir nos chambres collées l’une à l’autre.
Finalement cette vie de famille ressemble à ce que j’ai toujours connu. Je ne sais pas exactement quand, à quel moment précis cela prend la difformité d’une brisure, noire. À quel moment exact tout se fissure, où notre famille n’est plus qu’une plaie béante. Cela se met en marche lentement, trop insidieusement pour être repérable.
Il y a ce jour où nous sortons le minitel, maman, S. et moi, où nous recherchons le numéro des Alcooliques Anonymes. Tu avais dû nous promettre que tu ne boirais plus jamais une goutte, c’était à la sortie de ta première cure, t’y étais peut-être tenu ou nous l’avais fait croire. Ce devait être la première rechute à laquelle j’assistais en connaissance de cause. Bref, je comprends que ce n’est pas tenable, que ça ne le sera jamais. Tu es au lit, tu cuves, nous appelons les AA. Nous demandons conseil, que faire pour t’aider. Le type au téléphone nous dit de partir, que c’est la seule solution. Lui-même est alcoolique, abstinent depuis x années, et n’a pu le devenir qu’après avoir perdu sa femme, ses gosses, son boulot. C’est ce qu’il nous explique. Que pour s’en sortir tu as besoin d’un déclic, qu’on ne peut l’avoir qu’en perdant tout, qu’il n’y a que ce moyen-là. Que tant que nous serons auprès de toi tu n’auras pas de raison d’arrêter. Qu’il ne faut jamais, jamais sous aucun prétexte croire un alcoolique, que la dépendance a une force telle qu’elle peut déployer des ressources inimaginables, duper n’importe qui, jusqu’au buveur lui-même. Que tu continueras de boire tant que nous resterons, quoi que tu nous dises.
Nous refusons de le croire. Sa parole constitue une attaque insupportable à notre entité familiale. Comme si nous n’étions pas capables de t’aider. Il nous dit protégez-vous. Il ne nous dit pas que c’est aussi pour toi que nous devons nous protéger nous-mêmes, que si nous ne le faisons pas notre haine pour toi, pour l’alcool ira croissante. Que nous ne serons bientôt plus capables de discerner l’homme du poison. Qu’arrivés à ce terme, à cette confusion de l’ennemi, nous ne serons bons qu’à te détruire davantage. Il ne nous le dit pas. J’aurais aimé qu’on me dise qu’en restant je te détruirai plus que je ne t’aiderai, que c’est ce que nous ferons tous les trois. Mais il ne le dit pas. Il dit partez, protégez-vous. C’est la seule solution, il n’y en a pas d’autres.
Nous ne l’écoutons pas. Nous allons y arriver, nous en sommes convaincus, nous en sommes capables, tu as besoin de nous. Nous croyons en l’idéal de la famille, de l’amour, nous refusons de voir que tout cela commence déjà à disparaître, que ces prétendues valeurs ne nous serons d’aucun secours. Que nous sommes déjà très loin de toute forme d’amour.
5
Toutes ces années n’ont pas de contour précis. Ça pourrait être une même journée comme mille ans, les durées deviennent floues, la valeur du temps disparaît derrière une interminable répétition de faits plus ou moins identiques, tournant tous autour de ton état, se rapportant uniquement à ce que nous essayons de faire, de devenir, en tant que famille habitée par l’alcool.
Il y a les soirs où il faut te porter jusqu’à ton lit, pour que tu ne restes pas étendu sur le dos, comme mort, au milieu du salon, après que tu es rentré on ne sait comment du garage.
Il y a les cris, les pleurs.
Les dîners où personne n’ose parler, car chacun sait que le premier mot servira de déclencheur à l’explosion générale. Où l’on se regarde entre deux bouchées pour sonder à ses traits, à son teint, la colère, l’épuisement de l’autre.
Tes paroles vides de sens.
L’exaspération.
Va te coucher.
Les soupirs.
La lassitude.
6
Une nuit, je suis réveillée par toi qui, te tenant dans l’entrebâillement trop éclairé de la porte, me dis que c’est l’heure, qu’il faut se lever. Tu m’appelles de ce nom que tu ne donnes qu’à moi. Ta voix est douce, tendre, paternelle. Tu souris.
Je regarde le réveil, il doit être dans les trois heures du matin. Je te dis que tu te trompes, que tu dois retourner dormir. Je me lève. La salle de bains est allumée, tu es habillé, prêt à partir, tout guilleret, d’une humeur que je ne t’ai pas vue depuis des siècles. Tu ne m’écoutes pas, je ne sais même pas si tu m’entends. J’appelle ma mère, comme on l’appelle, comme on la réclame en hurlant, enfant, en plein cauchemar. Les larmes, l’angoisse me prennent tout entière.
Un « idéaliste ». Plus tard, c’est sous ce terme-là que des psys situeront l’origine de ton mal. Tu n’étais pas quelqu’un qui pouvait se satisfaire du réel, simplement aimer les choses pour ce qu’elles sont. Tu les voulais plus belles, plus justes, pour toi mais aussi pour les autres. Tes rêves étaient pour l’humanité entière.
Sans cette injustice première de la vie, celle d’être né, peut-être n’y aurait-il jamais eu en toi cette lutte sans cesse renouvelée. Puisque tu ne pouvais souffrir d’être né. C’en était déjà trop et sans doute n’en étais-tu pas toi-même conscient. Tu racontais comme sans t’en apercevoir, je veux dire de l’ampleur de ce que cela signifiait, qu’il y avait eu cet enfant mort-né avant toi, ou qui ne vécut que quelques heures, je ne sais plus. Ce frère inconnu, que ta mère avait tant pleuré et dont tu avais repris le prénom. On pourrait dire volé, que tu avais volé ce prénom. Car toute ta vie tu l’as vécue comme mort en même temps que comme dérobant, usurpant la place d’un autre. C’est sans doute fréquent. Tu ne devais pas être le premier à arriver au monde avec la culpabilité de la vie qu’on aurait voulue pour un autre. Et peut-être n’est-ce pas une cause suffisante pour rendre compte de la foule de dégâts qui suivirent.
En tout cas ta mère ne t’aimait pas. Jamais elle ne t’aima. Ce sont tes mots. Pour preuves, sa violence sans retenue, ses efforts pour passer le moins de temps possible avec toi. Elle te fit ainsi en partie élever par ses parents à elle avec lesquels elle ne s’entendait d’ailleurs pas.
Je ne connais pas grand-chose de ton enfance sinon ce que je viens d’en dire. Toi, tes deux jeunes frères, votre mère malveillante. Quant à ton père, lui passait son temps dans les jupes de femmes qui n’étaient pas la sienne. Il est mort très tôt, tu avais trente-deux ans, tu l’aimais de tout ton amour de fils admiratif.
Malgré tes dispositions intellectuelles, tu as dû arrêter les études jeunes, à peine seize ans. Ta mère ne pouvait entendre que tu continuas de lui coûter de l’argent. Tu avais l’âge de travailler et de lui verser la quasi-totalité de ton salaire, ce que tu fis. Puis tu rencontras celle qui deviendrait ta femme, ma mère. Celle qui hurlerait à l’ignominie en parlant de cette mère qui était la tienne tout en lui ressemblant. Je suppose que vous vous êtes aimés au départ. Finalement, ni l’un ni l’autre n’avez jamais tellement parlé de votre rencontre, sinon du lieu et de vos amis communs de l’époque. À bien y réfléchir, le mot amour n’a peut-être même jamais été prononcé. On peut supposer que vous vous aimiez, mais le supposer seulement. Jusqu’à ta mort, tu aimeras toujours ta femme. Il serait plus juste de parler d’une dépendance toxique, en quelque sorte la même qui te lie à cette femme et à l’alcool. Quant à elle, peut-être a-t-elle éprouvé davantage au début que le plaisir transgressif d’épouser un homme si parfaitement opposé à son propre père.
Elle devait adorer voir en toi l’homme joyeux que tu étais. Ton esprit vif, insolent. Un homme drôle, drôle d’un humour noir abrasif quand il n’était pas simplement enfantin. Car au fond tu étais un gosse. Un gosse fou et joyeux qui aimait faire rire son monde. Et puis la politique. Elle devait concevoir une immense fierté de t’avoir dégoté, toi le communiste, justicier de cette guerre dans laquelle marxisme et lutte ouvrière t’offraient la place qui te revenait de droit. Indigné, travailleur altruiste. Ta vie, c’était se battre au profit des plus faibles, contre le Capital. Parce que l’argent, pensais-tu, ça ne doit pas être un moyen de domination mais un outil à la disposition de tous, au service de la plus grande équité possible. Un rêve à l’échelle mondiale. Le partage des droits, des richesses. Les luttes syndicales eurent raison de toi, aussi.
L’égalité, tu ne l’as pas connue. Ni dans ton travail, ni dans ta fratrie, ni dans ton mariage. Tes deux jeunes frères ne reçurent pas le même amour. Toi, une existence esseulée. Eux, une gratitude comblée. Ta femme te maintint étroitement enlacé dans une compétition féroce avec elle-même. Jusqu’à la fin elle trouva le moyen de se hisser au-dessus de toi, y compris en souffrance, celle d’avoir un mari mourant.
Elle devait être moins rigide à l’époque, et qui sait, peut-être drôle. Elle t’aimait en tant que tu incarnais cet homme aimant, jovial, je l’ai déjà dit mais parce que ça a son importance. Son père à elle était tout sauf un comique. Un homme sérieux, excessivement sérieux qui ne riait jamais mais sermonnait, blâmait, jugeait, punissait. Un angoissé pathologique aussi. Elle était tellement fière de ne pas être avec un homme comme ça, jubilait de provoquer merveilleusement son père ainsi. D’avoir épousé un homme que ses parents détestaient.
J’ignore si elle n’a jamais compris que tu ne lui ressemblais pas à elle non plus. Et c’est le plus terrible, car, se confondant elle-même en tous points avec son propre père, tout en s’imaginant femme désinvolte, détachée, en un mot, libre, elle n’observa pas l’incompatibilité totale de votre couple, creusant par là sa propre tombe, achevant la catastrophe de votre union. Pour finir par s’identifier à son père jusqu’à te haïr, tout comme lui te haïssait.
Quant à savoir comment toi, mon père, tu semblas ne jamais réaliser que tu avais choisi une femme si semblable à cette mère qui était la tienne, je ne me l’explique pas. À croire que tu ne pouvais te situer ailleurs qu’à cette place du mal-aimé, de l’insuffisant, du pas-assez-bien. Celle, enfin, de l’humilié. Je crois que jamais tu ne quittas ta place d’humilié. D’une certaine façon, tu devais y tenir.
7
De l’extérieur, on pourrait observer la lente détérioration de toi, de nous, de nos rapports. Les efforts vains. L’hypocrisie dans laquelle nous nous enfermons, cherchant à croire que nous luttons pour t’aider. Nous luttons contre l’alcool, or lui et toi êtes maintenant indissociables, ce n’est pas la boisson que nous anéantissons. De l’intérieur on ne le voit pas, on ne peut pas le voir. On se convainc qu’on fait au mieux, qu’on s’achemine vers le meilleur. Chaque rechute, au lieu de nous montrer l’absurdité de nos efforts, nous laisse entendre qu’il y a encore autre chose à faire, quelque chose que l’on n’a pas tenté, quelque chose qui pourrait marcher. Car enfin on ne peut se résigner, on ne peut accepter que c’est bel et bien fini, que ce n’est plus de notre ressort, que nous ne sommes pas compétents.
S. est sans doute celui qui le voit en premier. Maman ne tient plus. En agressivité, elle devient aussi ingérable que toi abruti par le rhum.
Un jour tu rentres de cure. On ne t’a pas vu pendant plusieurs semaines, combien exactement, je ne me souviens plus. Les premiers jours on ne pouvait pas t’appeler, tout contact était interdit avec les familles. Tu es parfaitement sobre, tu es vraiment bien. Extrêmement malheureux mais en pleine possession de toi-même. Tu as retrouvé ton identité complète, je te reconnais ce jour-là. Je me souviens de toi montant dans ta chambre et de moi t’accompagnant. Je m’assieds sur ton lit tandis que tu déballes tes affaires. Tu es content de cette cure, ce que tu en dis laisse entendre que, pour une fois, les soins que tu as reçus étaient sérieux. Pas comme les séjours précédents hors de prix où l’on te sevrait en t’abrutissant de médicaments sans autre forme de thérapie, d’où tu revenais amorphe, aigri, découragé. Cette fois tu es habité par une certaine énergie, je vois que tu y crois. Que tu mesures l’ampleur de la difficulté mais que, enfin, tu reviens convenablement armé pour mener le combat.
Tu me racontes qu’il y avait des séances de thérapies individuelles, mais aussi collectives, qu’on t’a expliqué beaucoup de choses, que tu comprends mieux ce qui t’arrive. Que tu as appris des exercices de relaxation pour lutter contre l’envie de boire. Que tu as accompli un travail sur toi-même sans doute aussi profitable que difficile. Tu parais confiant, bien équipé, tu sembles savoir ce qu’il faudra faire, enfin. J’observe qu’un changement, quelque chose d’une grande richesse, s’est produit en toi. Qu’une étape importante a été franchie. Je ne saurais dire quoi avec précision mais pour la première fois je te vois déterminé, prêt à en découdre avec l’alcool. Tu n’exprimes aucun signe de bonheur, pas plus que je n’en ressens moi-même car nous savons que nous sommes loin de la sortie, mais il y a cette résolution qui réconforte, qui soulage.
Un peu plus tard nous sommes tous en bas dans le salon. Toi, maman, S. et moi. Je te revois dans le canapé, recroquevillé dans le coin, courbé. Je t’entends dire avec une gêne terrible, comme si tu t’apprêtais à te faire gronder, que tu as appris des choses. Tu t’apprêtes à nous dire quelque chose de très important. Je ne comprends pas pourquoi à ce moment-là, mais je vois que tu as peur de le faire, comme si tu t’attendais à ne pas être cru.
Tu dis que tu es malade.
Que l’alcoolisme est une maladie.
Que tu l’as reconnu, que c’est ce qu’on t’a appris à cette cure. Que tu es maintenant face à toi-même, face à cette vérité que tu es parvenu à admettre : tu es malade. Je sais que ce que tu dis est vrai, je le ressens au plus profond, dans la clarté soudaine d’une évidence tardivement mais enfin révélée. Arrive alors la possibilité de comprendre ce qu’il se passe depuis tout ce temps, cette aberration d’aller boire.
Tu dis qu’un malade alcoolique est malade à vie, qu’on ne peut pas en guérir. Mais qu’il peut se soigner à cette condition : qu’il accepte son état et que sa famille l’accepte aussi, c’est-à-dire le reconnaisse et l’accompagne comme tel. Comme un malade. Que l’on soigne, donc.
Dans un rire noir, mauvais, ma mère te tourne en dérision. Elle refuse d’entendre une connerie pareille. C’est faux, tu n’es pas malade. Tu es faible, voilà ce qu’il en est, et cette histoire de maladie n’est qu’une nouvelle excuse pour te dédouaner de tes responsabilités et continuer à boire.
Tout ce que tu as appris, ces semaines de lutte contre l’alcool, contre toi-même, ces techniques de relaxation, ces clés pour guérir, tes espoirs, tout ça vole en éclats. Je le vois dans tes yeux. Tu capitules. Tu ne te bats pas, tu ne réponds pas à ta femme, tu ne défends pas ton pain. Comme toujours tu ne dis rien, tu te laisses abattre. Comme si tu avais pressenti et par avance renoncé à la lutte. Moi aussi je me tais car de toute façon il n’y a rien à dire contre ma mère. Son autorité fait loi. Après tout, elle est infirmière, elle maîtrise mieux que quiconque ces sujets-là, elle a l’expérience que nul autre dans cette pièce n’a jamais eue. Elle sait. Il y a en moi une fissure, de part et d’autre deux éléments qui se heurtent. Je sens que tu es le seul à savoir comment nous pouvons t’aider. Mais, dans le même temps, il m’est tout simplement impensable de m’élever contre ma mère, il serait impossible de faire quoi que ce soit contre elle.
Noir. Encore des semaines, peut-être des mois interminables après cela. La durée est inquantifiable.
À un moment tu te rends à une nouvelle association. Tu as laissé tomber les Alcooliques Anonymes, à cause de l’aspect religieux, dis-tu. La petite prière finale, la reconnaissance d’une force supérieure, même si rien de cela n’implique un choix de croyance particulier, ce n’est pas pour toi. Soit. Tu as donc trouvé un autre lieu de parole. Ce que tu y fais me semble obscur, je sais quand tu y vas, tu nous le dis, mais il est possible que tu n’y ailles pas, que tu ailles boire à la place. Je crois me souvenir que maman n’a pas confiance dans cette nouvelle démarche, qu’elle ne croit pas dans ton rétablissement possible, qu’elle distille dans ces nouvelles réunions une parole de doute quant à ta bonne foi ou alors des gens que tu rencontres. En tout cas tu en parles une fois avec elle et moi, toujours dans le salon, toujours à cette même place dans le canapé. Tu dis à maman, mais cette fois presque rageusement, qu’on t’a proposé qu’elle t’accompagne aux réunions. Ce serait une bonne chose que le conjoint y assiste, qu’il entende d’autres malades alcooliques, d’autres témoignages, pour comprendre, pour pouvoir aider. Tu dis que tu aimerais qu’elle vienne avec toi. Je dis que j’aimerais venir avec vous, moi aussi, ou juste avec toi. Je veux comprendre. Ma mère affirme que je n’irai pas. J’en conçois une certaine déception mais c’est ainsi. Tu lui redemandes, puisqu’elle était restée jusque-là silencieuse, si elle veut bien t’accompagner. Elle répond, avec mépris, ce n’est pas mon problème.
Tout se résume là, ce n’est pas son problème. Les vices de son mari ne la concernent pas. Elle n’a pas mérité qu’on l’y associe.
Aussi loin que je me souvienne, ma mère s’est toujours située au-dessus de toi. Cela a-t-il commencé dès votre rencontre, à la naissance du premier enfant, après la tromperie que tu lui as infligée, ou bien plus tard, je l’ignore. Elle se nourrit de cette concurrence, de cette rivalité, qu’elle entretient par ailleurs avec à peu près tout le monde. Dans son discours, elle dépasse les autres, qu’elle descend, qu’elle juge. Elle-même a terriblement peur du jugement des autres. Le sien n’a pas de limites. Et ça commence avec toi.
Elle s’est toujours félicitée d’avoir une meilleure situation que la tienne : un emploi stable, un meilleur salaire. Tu as souvent changé de travail, été licencié, as mené de longues luttes syndicales, monté ta propre entreprise, as dû envisager une autre conversion, encore, une nouvelle formation, pour finalement bénéficier des relations de ta femme avant de jouir d’un poste sécure, un poste de fonctionnaire, comme elle. Elle me dit souvent avec fierté que mes deux parents sont fonctionnaires. Mais elle y est parvenue seule et toi grâce à elle. Elle a longtemps travaillé à temps partiel, jouissant de ses mercredis pour s’occuper de moi et S. Parallèlement, tu cumules deux emplois : l’un à temps plein puis un second le soir.
Sa famille est également mieux que la tienne. Dans la famille de ma mère on s’aime, on se soutient, on fait place aux nouveaux arrivants. Et, de fait, elle n’a pas tort, tu y as toute ta place, tu le revendiques toi-même, tes belles-sœurs et beaux-frères constituent pour toi un soutien véritable, tu les chéris. Ta famille à toi est la cause de tes pires souffrances. Ta mère est une folle notoire, mauvaise, la méchanceté-même, également alcoolique bien que dans un autre genre. Ses paroles fâchent, empoisonnent, meurtrissent, elle te porte un désamour sournois, à toi et ce qui s’y rapporte, ta femme et tes enfants inclus. De tes deux frères il n’en reste qu’un, qui a eu la bonne idée de partir vivre loin, à l’autre bout du monde. Alcoolique lui aussi. Ton plus jeune frère s’est suicidé, son épouse l’a suivi quelques années plus tard. Alcool encore. Famille décadente aux gènes déjà putrides. Quant à ton père, il semble qu’il était le seul homme équilibré de la famille. Attentionné, chaleureux, blagueur, grand séducteur. Il trompa toute sa vie ta mère, mais, selon un consensus universel, il méritait bien quelques moments de plaisir en compensation de ce qu’elle lui faisait subir. Ses maîtresses, il ne les avait pas volées. Je sais que tu aimais beaucoup ton père, de même que ma mère, de même que S. Ton père est mort juste avant ma naissance. De sa responsabilité dans le malheur de ses enfants, dans la folie de sa femme, il n’en est jamais question. On le dépeint comme un saint qui avait bien le droit de souffler un peu.
8
Alors il y a cette femme, qui est ma tante, seule chez elle, dans sa salle de bains, j’imagine. Elle ingère de l’alcool, beaucoup, une très grande quantité, y ajoute tous les cachetons qu’elle peut, sa collection complète réunie devant elle, sur une étagère. Je ne sais pas qui exactement l’a retrouvée morte, étendue sur le sol. Je ne sais ni quel jour ni à quelle heure cela s’est produit. Seulement qu’à ce moment-là ses fils avaient six, neuf et douze ans. Ses trois fils, mes trois cousins, que leur père avait quittés six ans plus tôt, par le gaz d’échappement de sa voiture, dans son garage.
L’histoire se répète, forcément insoutenable, et cette facilité qu’a ta vie d’être jonchée d’horreurs, de ressembler à une existence maudite. Je ne suis pas bien âgée quand vous me racontez tout ça, le suicide de ton frère, de sa femme ensuite, l’homme cruel qu’elle avait rencontré après ça, après la perte de son mari, le père de ses enfants. L’homme dont je ne connais pas même le prénom qui l’a coupée des siens, violenté, violenté ses trois fils, a fini par avoir raison d’elle de son désespoir de sa vie. À quoi songeait-elle en prenant ses pilules. Que se passait-il dans son esprit au moment de se donner la mort. Et l’impuissance du monde face à cela. S’est-elle ravisée, trop tard mais ravisée cependant, songeant non je ne veux pas mourir, je ne veux pas, je veux voir mes enfants grandir. A-t-elle lutté jusqu’à la dernière seconde pour que la mort ne l’emporte pas. Ou l’a-t-elle suivie comme une amie, avec sérénité et reconnaissance.
Mais surtout, comment penser, comment oser penser à mourir quand on est parent. Quand on a des frères, des sœurs, des gens qui nous aiment. Mon oncle, ma tante, n’ont-ils donc pas songé à leur famille au moment de partir. Qu’est-ce qui, au fond, n’a pas fonctionné, n’a pas réussi à les retenir auprès de nous. Ces questions, c’est toi qui les formules. Je ne me les pose pas véritablement parce que je ne me sens jamais tout à fait concernée par leur mort. Ne les ayant pas connus, ou si peu, je n’ai jamais eu de véritable raison de déplorer tout cela. Pas en mon nom propre. Mais quand, face à moi dans la cuisine, tu me racontes ça, le suicide de ton frère, le suicide de ta belle-sœur, tes trois neveux orphelins, quand tu me dis cette histoire, le regard baissé, ta voix tremblante, tu termines toujours par ces mots : comment ont-ils pu faire ça. Et je sens la colère dans ta voix, non pas après ton impuissance à toi qui n’as pas pu les retenir, mais après eux, après leur désir lâche, égoïste, d’en finir plutôt que de se battre auprès de leurs enfants. Tu ne comprends pas cela, tu leur en veux dans un chagrin sans fond.
Alors moi qui t’écoute toujours attentivement, moi qui guette la moindre de tes réactions, j’en déduis avec évidence que si tu condamnes de tels actes, tu ne pourras jamais les perpétrer toi-même. Que tu seras toujours pour nous, tes enfants, là. Battant, aimant. Que tu ne penseras jamais à toi davantage qu’à nous. Que tu seras pour nous jusqu’au bout, avec moi toujours sans défaillance m’enveloppant de l’amour que seul un père comme toi est capable de prodiguer. Un père fort, dont la combativité ne saurait jamais faire défaut jamais. Comme s’il était impossible qu’un jour tu ne t’appartiennes plus, que tu n’appartiennes plus à ce discours. Comme s’il était écrit que mon père, à moi, contrairement à ces autres lâches dont son frère, ne connaîtrait jamais aucune faille, aucune en tout cas susceptible de l’absorber si profond.
J’ignore, encore petite, que de tels trous existent, si béants qu’on ne peut résister à la chute qu’ils appellent. Tout se passe comme si la volonté et elle seule ne pouvait faire défaut qu’à ceux qui le choisissent. Toi-même tu crois en de telles conneries. Toi qui, suivant le précipice tracé par ton frère, chuteras aussi, te feras l’agent de ta propre mort.
Quand tu me racontes ton frère – et j’éprouve toujours un plaisir, une curiosité morbide à t’entendre, malgré la peine qui se lit en lettres capitales sur ton visage – je suis encore plus certaine de ton infaillibilité. Gigantesque navire domestique de mon cœur, tu ne couleras pas. Mais surtout, cette histoire ne m’appartient pas. De façon générale, ce qui a trait à ta famille ne m’appartient pas. C’est un ailleurs condamné, dont toi seul possèdes la clé.
Je me figure, comme ma mère le répète à l’envie, que ta famille n’est plus même la tienne. Tu n’as pas radicalement coupé les ponts, mais les relations sont quasi inexistantes entre toi et ce qui reste des tiens. Rejeté par eux, tu as choisi de ne plus appartenir qu’à la famille de ta femme. C’est celle-là ta vraie famille, ta famille de cœur, la seule qui t’ait donné ta juste place. Non parce que tu le méritais particulièrement, mais parce que cette famille-là est tellement parfaite que ce mode d’être est inclus dans son fonctionnement même. C’est la manière dont on me présente les choses, ma mère surtout, pour ta part tu te contentes généralement d’approuver par ton silence. Telle est la légende familiale. Du coup, nécessairement, ce qui a à voir avec le côté paternel ne concerne que toi. Je ne me fais pas l’héritière de cette tragédie, je l’ignore comme si elle ne me concernait pas et ne me concernera jamais. Je déplore ton malheur, mais je ne mesure que faiblement l’effet de ces sordides affaires sur toi, et sur moi par extension. Tout cela est terrible, mais c’est fini, c’est derrière toi. Je n’aurai jamais à faire les frais de la malchance qui est la tienne. Car, au fond, je n’arrive pas à me représenter cela autrement que comme une malchance, une malédiction prononcée par le hasard.
Ta famille actuelle, dont je suis, m’est présentée comme ton salut. Nous sommes ton salut, la nouvelle vie pour laquelle tu seras prêt à tuer des dragons mangeurs d’enfants s’il le faut. Nous te gardons pour nous, hors d’atteinte du monde maudit d’où tu viens. Tu es à présent en sécurité avec nous, et nous avec toi, puisque cette protection tu nous la dois plus qu’à tout autre. Sans être capable de me formuler les choses en ces termes, c’est pourtant exactement ce que je ressens, enfant, à ton endroit.
Vaste et trompeuse fumisterie née de l’imagination parentale que seuls des enfants d’une crédulité idiote sont capables d’ingérer.
9
Le temps est venu de partir.
Plus de deux années se sont écoulées depuis l’annonce de ton alcoolisme. Plusieurs cures sans succès. Ton état a empiré, de même que celui de maman. Deux années pendant lesquelles vous avez bâti des douves infranchissables autour de notre maison. Famille, amis, vous ne vous êtes confiés à personne, avez caché vos démons dans la honte de l’alcool, du monstre sans vie que tu es devenu. Durant les rares visites que nous recevons ou donnons, rien n’est visible, le mal est contenu dans les remparts d’une duperie bien orchestrée. Aucune aide n’est reçue car jamais demandée.
Maman est malade d’un cancer, elle en informe ses proches dans la plus stricte discrétion tout en en faisant aussitôt un sujet clos.
Rideau.
À moi elle n’en dit rien, c’est toi qui me l’apprends, un midi. Je rentre du lycée pour le déjeuner, que tu me prépares toujours ; c’est l’année du Bac. Je te revois devant l’armoire de la cuisine, cherchant les mots derrière tes sanglots, ton incapacité à dire la terreur qui te fige tout entier.
Quand j’en parle à maman, elle entre dans une rage noire après toi son mari qui n’a pas su tenir sa langue. Elle fait de sa souffrance une affaire privée, ne demande rien à personne tout en reprochant aux autres de ne pas être là pour elle. Sa sœur, ma tante, me dira plus tard tu sais comme est ta mère, quand on lui tend la main, elle mord.
Elle ne supporte pas d’être aidée, soutenue. Elle ne supporte pas que l’on s’intéresse à elle, que l’on s’inquiète pour elle. On pourrait la juger trop fière ou voir là le manque d’estime qu’elle porte à sa propre personne, pensant qu’elle ne mérite pas d’être aidée. C’est tout l’inverse. Elle se glorifie comme victime, femme sacrificielle, à la fois trop puissante et trop faible pour pouvoir être secourue. Elle est sa propre loi, se suffit à elle-même, rejette les autres en leur tenant rigueur de la distance qu’elle place d’elle-même entre eux.
Il y a aussi à cette même période le décès d’un autre oncle, F., ton ami de travail qui a épousé la sœur de maman. Un oncle dont je suis proche, que nous chérissons tous, de même que sa femme et son fils, sans doute le cousin avec lequel j’ai passé le plus de temps. F. meurt de l’amiante, comme tant d’autres de tes amis, tous ceux auprès desquels tu avais mené l’une de tes plus retentissantes luttes syndicales. Peine perdue, des mois de grève, des licenciements avant la fermeture de l’usine, et des années plus tard tous ces travailleurs amis qui tombent comme des mouches. Toutes ces morts qui emportent chaque fois un peu de toi, et avec celle-ci, tu termines de t’écrouler. Maman te reproche de ne pas être là pour elle, elle qui, en plus de perdre son beau-frère, souffre de ce cancer du sein et de ce mari alcoolique.
Après le cancer et la disparition de F. tout change. La mort rôde. Les rapports se délitent davantage. S. part pour un an à l’étranger. Je sers de tampon entre vous deux, mes parents qui ne se parlent plus. Maman a fait ses quartiers dans la chambre de son fils absent. Tu t’enfonces toujours et encore, exprimes plus fréquemment ton envie de mourir. Tu continues de fréquenter les sous-sols des garages, me raconte ton « shoot » qui te permet d’oublier que tu es vivant, dans l’attente de celui qui te sera fatal, enfin. C’est ce que tu me dis lorsque je t’interroge. J’essaie de te soutenir de te réconforter, en vain. Je suis moi-même très en colère, seule entre ces deux parents qui n’en sont plus. J’oscille entre cajoleries et réprimandes. Mon cœur me commande la tendresse et la compassion autant que l’anéantissement et la destruction de tout rapport familial. Il faut faire avec cette mère enragée et ce père liquéfié. Chaque jour est un supplice, un tunnel sans issue.
Puis S. rentre, observe avec recul la déchéance, la nécessité de faire que cela cesse. Il convainc maman. Après une ultime beuverie, un coma éthylique foudroyant, une nouvelle hospitalisation, nous partons. Tous les trois. Te laissant avec le chien, seuls dans ce qui était encore malgré tout la maison familiale. Nous faisons nos valises en hâte, une nuit où tu es absent. Je sais en franchissant la porte ce matin-là qu’il n’y aura pas de retour possible, que nous te condamnons. Et les mois qui suivent constituent en effet un cauchemar bien pire que celui que nous venons de quitter. Pour moi, en tout cas. Vivre avec ma mère et ses caprices, S. et ses accès de fureur, te sachant plongeant toujours plus profond, impuissante. Détestant ce que je suis, ce que nous sommes, moi-même devenue imbouffable pour quiconque m’entoure.
10
Il y a des musiques de joie, de fin heureuse qui me font croire que c’est possible, quand les trompettes éclatent au final, que tout va s’arranger. Qui me font pleurer parce que cet espoir je le chéris plus que ma vie. Parfois que donnerais tout pour que le père que j’ai connu revive enfin. Cet espoir est si mince, quand il surgit soudain c’est accompagné d’une mélancolie sans fond parce que je sais qu’il est tellement mince, tellement fragile qu’il ne tiendra pas. Il ne résiste déjà pas au réel.
Je te dis que je ne veux pas que tu meures. Je te le dis un jour. Je pleure. Tu ne dis rien. Je ne sais pas où tu es, si tu m’entends. Je pense que oui, que ça te fait du bien de l’entendre, de savoir que tu comptes encore, que ta vie a toujours de la valeur. Qu’imaginer un monde sans toi ce n’est pas supportable. Je sais que tu m’entends.
Le bruit, le vacarme, la peur, en silence.
La nausée, la colère, le dégoût.
J’ai envie de crier, de courir à toute vitesse dans les rues, hurlant ton nom, comme si cela pouvait changer quelque chose. Que la souffrance devienne visible, reconnue. Que la lutte soit commune. Que le monde entier se soulève pour que tu restes. Qu’il n’y ait plus une personne sur terre, ignorante de toi, capable d’admettre sans broncher ta condition.
Je me tais, je ne dis rien, je fais comme si tout allait bien. J’occulte. La plupart du temps, comme si tu n’existais pas. J’ai honte de moi parce que je ne sais pas comment faire. Quand je te vois je te sermonne. Coupable, je te dis que tu es coupable.
Je ne saisis pas comment l’alcool a pu prendre le dessus sur toi. Comment tu as pu le laisser faire ça, te réduire en bouillie. Comment tu y es assujetti, comment tu acceptes ça. Ce qui te pousse à préférer cette merde à moi, ta fille. À ta femme, à ton fils, à la vie que tu avais. À tous ceux pour qui tu comptes et qui comptent sur toi. Tu crois qu’ils n’existent pas, qu’il n’y a personne de cette espèce pour pouvoir vouloir de toi. Je ne le comprends pas. J’en ai mal. Nuit et jour c’est une torture infinie, et le spectacle de ta chute est d’une laideur que je ne parviens pas à regarder.
La place que tu occupais est prise, entièrement habitée par le rhum. Tu ne peux pas savoir comme je le hais. Je hais ce que tu es devenu. Ce qu’il te fait être. Tu dors. En marchant, en parlant, en mangeant, tu dors. Tu souffres. Tu ne supportes pas non plus ce que tu es. Tu crois que la mort te sauvera, tu crois que c’est l’unique issue pour échapper à la douleur de l’emprise du démon. Qu’il vaudrait sans doute mieux pour les autres que tu ne sois plus là, qu’ils n’aient plus à subir ta présence. Et même si tu te trompes, quelque chose en toi qui n’est pas toi refuse de le croire.
C’est hors de mon pouvoir, je n’ai aucune prise sur cette chose et je ne comprends pas que toi non plus tu ne puisses pas l’atteindre, que tu lui sois dévoué et qu’elle te dévore tout entier. La question de ton identité revient sans cesse, insoluble.
Qui es-tu. Es-tu la même personne ivre et sobre, est-ce le même père qui se tient là aujourd’hui que celui que j’ai connu avant l’alcool, avant la maladie, est-ce le même homme. M’aime-t-il toujours, m’a-t-il seulement aimée. Souvent tu délires, tes facultés mentales sont en veille. Tu fais d’un discours paranoïaque ta nouvelle vérité sur le monde, ton nouveau point de vue. Ce n’est pas toi et en même temps ce n’est personne d’autre. Peut-on changer à ce point tout en restant à la fois la même personne. Y a-t-il seulement quelqu’un là-dessous, et si oui, qui. Comment comprendre, comment assimiler le gouffre qui sépare ce que tu fus jadis et ce que tu es devenu. Où es l’alcool. Te fait-il penser de travers, est-ce lui qui perfidement insinue des horreurs en toi, glisse en ton être des infamies qui ne lui appartiennent pas, ou vient-il simplement révéler ce que tu as toujours tu. Où est la constance, y en a-t-il déjà eu. Ou faut-il arrêter de la chercher, de la penser, de la vouloir.
Je ne sais plus qui tu es. J’ai cru le savoir et c’est parti.
Il y a le dégoût et la peur et la colère et l’impuissance. En lieu et place de tout ce qu’il y avait jusqu’alors.
11
Une trouille noire du moment où ça y est, tu seras mort. De ce moment inévitable. C’est impossible d’y songer. J’ai beau savoir que ça va arriver, que cette putain de maladie va t’emporter, je ne parviens pas à y croire. Penser le moment où tu ne seras plus là est précisément impensable. Je me dis que je ne tiendrai pas, que je n’y survivrai pas. C’est d’un morbide absolu, et pourtant je ne peux pas m’empêcher d’appréhender ce moment, de l’imaginer. J’ai envie de croire que ce délire va prendre fin, qu’on pourra bientôt se dire que ce n’était qu’un mauvais rêve. Et on rigolera. On se dira tu te souviens quand on croyait que t’allais y passer, et ça nous fera rire à s’en pisser dessus.
Il y a cette énième jaunisse. C’est juste avant les vacances d’été. Tu es hospitalisé. Je viens te voir, S. aussi. Mais pas maman, elle dit qu’elle ne mettra plus jamais les pieds à l’hôpital pour toi. De toute façon, ça fait bien deux ans que tu ne l’as pas vue, depuis que nous sommes partis, peut-être une fois chez l’avocat. Là elle est bien emmerdée que tu sois malade encore parce qu’il y a ces foutus papiers du divorce qui ne se signent pas par ta faute et qu’elle n’attend que ton ultime capitulation pour enfin sauter les deux pieds joints dans sa nouvelle vie. Elle a déjà rencontré quelqu’un, c’est le troisième qu’elle nous ramène depuis qu’elle t’a quitté. Et tu vois, je commence à dire là que c’est elle qui t’a quitté et c’est une bonne chose parce que longtemps dans mon esprit c’est nous tous qui t’avions quitté, comme si S. et moi avions pu divorcer de toi aussi. Rien n’est à sa place.
Bref, tu es à l’hôpital, encore, je viens te voir. On t’a installé dans une chambre avec un pauvre bougre en plein delirium tremens. L’intention du corps médical est d’une évidence nauséabonde. Abjecte, absurde. D’ailleurs, tu refuses de te reconnaître en cet homme. Tu es en colère et tu as raison. Comment oser te demander de réduire ton identité à celle d’un type délirant, puant. Il grogne, il bave, même pour nous qui venons te voir c’est insupportable. Je ne comprends pas pourquoi on cherche à t’abaisser ainsi, ou, plus précisément, si je mesure l’intention, je me dis qu’il faut être sacrément con pour ne pas anticiper l’humiliation que l’on te fait par-là ressentir, ou pour juger que cette humiliation pourrait participer de quelque processus de guérison. Je ressors de cette visite meurtrie, écœurée. Je n’ai pas vu mon père, j’ai vu un malade aux yeux jaunes en colère humilié. Aucune douceur dans tes traits à laquelle se rattacher, à laquelle raccrocher cette certitude que tu es bien celui que je connais et que j’aime.
C’est un nouveau combat qui s’annonce, répétition qui ne semble pas pouvoir se lasser d’elle-même. Il va falloir te convaincre de te soigner. Comme à chaque passage à l’hôpital, l’occasion d’un nouvel affrontement, de nos deux forces guerrières, le désir des enfants de voir leur père guéri contre la toute-puissance de l’alcool qui ne consentira pour rien au monde à desserrer ses crocs. Il faut en passer par toi, par ta raison, tes émotions, tous les sentiments que l’on peut toucher, l’amour de toi, de nous, la tendresse, l’empathie, la culpabilité, encore. Mais cette fois tu ne promets rien. Tu n’en peux plus, tu es fâché, tu as déposé les armes.
Un autre jour où je te rends visite, où tes bras blancs amaigris sont couverts des bleus des seringues, tu me dis que c’est de notre faute. Que c’est parce que nous sommes partis. Tu es en colère, tu me dis tout ça les lèvres à demi closes. Et comme tu es sobre depuis plusieurs jours déjà, je donne bien sûr à tes paroles beaucoup plus de poids que d’ordinaire. J’ai beau savoir que tu as raison, j’ai beau me répéter chaque jour que nous n’aurions pas dû te quitter, que moi, du moins, j’aurais dû rester à la maison avec toi, que, n’eût été l’odieux chantage de ma mère, c’est ce que j’aurais fait, je ne peux pas reconnaître devant toi que tu as raison. Que oui, en effet, te laisser seul c’était signer ton arrêt de mort. Je le sais ; je m’en défends pourtant devant toi. Je te répète la leçon que j’ai bien apprise, pour faire plaisir à maman : il fallait que l’on se protège, tu étais devenu un danger pour nous. C’était vrai pour ma mère, sans doute aussi pour S., l’un et l’autre voulaient partir ils en avaient parfaitement le droit. Mais moi non. Moi je voulais rester avec toi, je ne voulais pas vivre ce que je vis là : te savoir seul mourant pendant que je cohabite avec cette mère et ce frère avec lesquels les liens ne sont que cris et douleur. Je voulais rester avec toi, je sais que ce que je t’ai fait est terrible, tu as parfaitement raison de me le reprocher, mais je ne peux pas te dire tout ça. J’en remets une couche, je te ressers le plat de la culpabilité, de l’amertume.
Quelques jours plus tard, tu es toujours dans ta cellule médicale et moi en vacances au bord de la mer, je te dis au téléphone que si tu ne te soignes pas, nous ne nous reverrons plus jamais. Voilà. Ce que j’avais cherché à éviter, je l’ai fait. Cet horrible chantage, je l’ai fait. J’ai affreusement honte de moi. Je pleure beaucoup après avoir raccroché, ignorant dans quelle mesure je désire ce que j’ai dit. Cependant, à ce moment je ne dois effectivement plus sentir la force de lutter encore. Là où la mère et le frère ont capitulé deux ans plus tôt, j’y suis maintenant, à bout de forces. Et ce serait arrivé plus tôt si j’étais restée avec toi, je le sais. Toi aussi.
Ça fonctionne. Tu me rappelles, tu me dis que tu vas te soigner, enfin. Que cette fois-ci c’est la bonne. De retour de la mer, je fonce à l’hôpital où tu es toujours. Nous remplissons des dossiers, tu rencontres une assistante sociale. Pour la première fois depuis des années j’aperçois dans ton regard cette détermination. Tu es faible, abattu, mais décidé. On te trouve une place, on te prend au sérieux. Ce qui n’avait jamais été possible le devient enfin. Au 1er septembre, tu entreras en cure pour trois mois. Ce n’est pas n’importe quoi, rien à voir avec les courts séjours que tu as déjà faits sans thérapie autre que médicamenteuse, ces pompes à fric, comme tu les appelles. Là tu seras encadré, épaulé, orienté. Alcool, dépression, réinsertion professionnelle, le package intégral. Tu y crois, moi aussi.
Nous sommes fin juillet. Je repars quelques semaines, dans notre maison familiale, cette vieille bâtisse que tu as réhabilitée de tes propres mains, chaque été, dans laquelle tu n’as plus mis les pieds ces dernières années. Tu ne conduis plus, tu deviens aveugle, autre dommage de l’alcool. Un après-midi tu me téléphones. Tu es à la maison, chez nous, tu as l’air bien. Tu es seul, tu attends le départ pour cette nouvelle cure. Le chien n’est pas avec toi, nous avions trouvé à le faire garder au début de ton hospitalisation. Tu le retrouveras dans quelques mois, quand tu seras soigné. Tu es enthousiaste, optimiste. Nous nous mettons à rêver aux moments que nous allons bientôt pouvoir passer ensemble. Je te dis qu’à ton retour je pourrai venir les week-ends avec toi, revenir dans ma chambre. J’en ai très envie, je veux rentrer chez moi. Je te promets que je vais passer mon permis pour pouvoir t’emmener ici, dans notre maison du Sud, dans ta maison, pour de futures vacances. Nous raccrochons, j’ai la certitude que cette horreur touche à sa fin. Les choses ne seront plus comme avant, certes, mais enfin elles seront meilleures, je commence à retrouver mon papa.
Un matin ma mère est là, juste après ce coup de fil. Elle était de passage chez sa mère, qui ne vit pas bien loin, qui est maintenant très âgée et affaiblie par plusieurs accidents. Lorsque je vois ma mère, son regard, je comprends que quelque chose de terrible est arrivé. Je pense immédiatement à ma grand-mère. Je me hâte d’atteindre ma mère. Elle pleure.
Elle dit c’est ton père. Il est mort.
Les varices dans ton œsophage ont éclaté. Tu es mort seul, le sang dans son intégralité a quitté ton corps par la bouche. Tu l’as vu venir, tu as senti la veille que ça n’allait pas. Tu as appelé le médecin. À l’heure convenue de sa visite tu n’as pas pu lui ouvrir, tu étais déjà parti, ce sont les pompiers qui t’ont trouvé, quasi nu baignant dans tout ton sang.
Une courte enquête policière dans les formes avant de pouvoir enfin accéder à toi, à ton corps éteint, presque transparent de tant de pâleur. Une semaine encore et tu étais enfin là, revenu dans ta maison, celle où je t’avais promis quelques jours plus tôt de te ramener, enterré au pied de la montagne.
Sarah Roland
2017
2017
L'avenir improbable
NOUVEAUTÉS
Départ
Le café était prêt, fumant, brûlant. A cette heure matinale, il trouverait sûrement un routier sympa, arrêté sur l'aire de repos de l'autoroute toute proche. Ils avaient descendu ensemble lentement l'escalier de l'immeuble, sans se parler, attentifs aux bruits domestiques qui commençaient à se faire entendre de l'autre côté des portes palières, souvent trouées à hauteur d'homme par un petit œil chargé de débusquer les visiteurs indésirables. Les trottoirs glissants brillaient sous la lumière des lampadaires. La surface miroitante de la lune paraissait recouverte de buée. Elle se souvenait de la silhouette hésitante d'un homme qui les devançait d'une trentaine de mètres environ et qui, entre deux réverbères, était saisie par l'ombre. Il s'était immobilisé pour allumer une cigarette, la tête penchée vers les paumes de ses mains recourbées. Dans le terrain vague, la terre inégale était craquante, sur l'herbe des talus on dérapait. Amarrée devant eux, l'aire de service qui scintillait de tous ses feux comme un navire attendait patiemment que ses voyageurs embarquent. La nuit qui avait été claire commençait à se couvrir de nuages, la traversée serait peut-être houleuse. Elle pensait, hélas, qu'elle resterait sur le quai. Elle vivait avec ambiguïté cette promenade insolite qui la conduisait au port, non pour y goûter l'ivresse du départ, mais pour y découvrir son désarroi…
Liberté emprisonnée
Il y avait déjà plus d'une demi-heure qu'ils se trouvaient « À l'Habitude ». Lucien avait essayé de protester : il commençait à se faire tard, ses parents l'attendaient, le père était fatigué ces temps-ci... Mais il ne résistait jamais longtemps à Victor. Pour l'enfant qu'il avait été, Victor, c'était quelqu'un. Un géant, un héros, le maître des eaux qui avait commandé aux écluses, déclenché les orages, apaisé le vent, dirigé les étoiles...
_ Un vrai métier, un vrai métier, parce que ça n'en était pas un, peut-être, la batellerie? La péniche, Lucien, c'était l'instrument de ta liberté...
Lucien s'était raidi. La liberté est l'un de ces mots gluants qui glissent entre les mains comme une savonnette. On ne sait pas trop ce que c'est, la liberté, ou plutôt, on croit savoir très bien ce qu'elle n'est pas, mais on n'ose pas aller plus loin, risquer une définition plus positive, voire personnelle, s'aventurer vraiment sur le terrain de l'exploration, essayer, chercher, changer un peu sa manière de voir, découvrir peut-être un espace de vie inespéré, et qui passe d'ordinaire inaperçu parce que les autres, ou soi-même, on a pris soin d'accumuler les camouflages, de brouiller les pistes, que surtout personne ne voie ça, ce serait terrible, où donc irions-nous, je ne veux pas en prendre la responsabilité, mais ne croyez pas pour autant que je me dérobe!... Victor, lui, semblait tourner et retourner entre ses mains un objet solide comme de la pierre, il ne doutait pas, la liberté, c'était ça, mon garçon, la vie que j'ai menée pendant toutes ces années magnifiques sur ma péniche, au fil de l'eau et du temps, avec le ciel comme unique limite, sans aucun mur autour de moi, sans cheminée d'usine au-dessus de ma tête pour me cacher l'horizon, regarde, admire la pureté de ce diamant que j'aurais voulu te remettre mais que tu ne peux plus désormais posséder, rejoins-moi dans ma nostalgie puisque cette pierre imaginaire est perdue pour moi aussi à présent...
L'espace d'un instant long comme un éclair, le jeune et le vieil homme s'étaient trouvés séparés par un abîme, à moins que la forme normale des rapports entre les êtres ne fût cet abîme pressenti, chacun soufflant dans sa corne de brume pour signaler sa présence sur son îlot désert...
La Révolution
Ce matin-là, elle avait vu son amie surgir à l'opposé de la rue, les pans de son imperméable blanc cassé écartés comme des ailes, son vélomoteur pétaradant plus que jamais et zigzaguant entre des groupes qui s'étaient formés bizarrement sur la chaussée elle-même - des voitures klaxonnaient, des poids lourds ralentissaient à la limite de l'arrêt total - et, alors qu'elles étaient sur le point de se rejoindre près de la grille du lycée et de se mêler aux groupes qui s'y étaient agglutinés, elle l'avait entendu hurler, aussi haletante que son deux-roues motorisé, hors d'elle, tout en réussissant avec virtuosité un remarquable dérapage, « C'est la Révolution! C'est la Révolution!...»
C'était un bonheur inouï, insoupçonné, une véritable naissance... Etre vraiment ce que l'on est sans rien soustraire, dire l'inconnu comme le connu, se révéler, se dévoiler à sa propre conscience comme à celle de l'autre, partager enfin l’Étrange et le rendre familier, promettre de ne jamais cesser d'explorer, et se donner ainsi une chance, plus tard, de retrouver le lien qui relie à soi-même... Voilà ce que l'amitié lui avait offert. Pour la première fois, quelqu'un l'écoutait, la comprenait. Elle donnerait à lire à son amie les quelques mots qu'elle avait griffonnés à la hâte sur la route en ce dimanche pluvieux de mars. Il pleuvait, elle marchait, les rues étaient grises... Elle portait une attention extrême au battement de ses pas. Un homme arrivait en sens inverse, penché vers le sol. Il s'était engouffré dans la porte de l'une de ces maisons de briques aux murs uniformes. C'était simple. Il avait disparu, il restait une vision. Elle-même était devenue pluie, un ruissellement de larmes...
Ce texte, qu'elle avait conservé dans un cahier comme une fleur fanée, avait pris la fonction d'un fanal... Il balisait le passé... Quelques années seulement s'étaient écoulées, un siècle... Pire, ce passé récent était coupé du présent, séparé de lui par une frontière impitoyablement infranchissable : la continuité de la vie s'était brisée. Derrière, transformés en mythe, âge d'or, paradis perdu, les temps à jamais révolus avaient laissé quelques hiéroglyphes, des souvenirs jaunis, et cette impression désagréable de flotter à la surface d'événements qui n'avaient pas de profondeur...
Objecteurs de conscience
En perpétuel étonnement et questionnement, bouillonnement inquiet et lucidité déferlante, Véronique commençait ses phrases par « je ne comprends pas », les ponctuait de « pourquoi? », sollicitait ses interlocuteurs par des « n'est-ce-pas? », et, lorsqu'on prononçait devant elle une formule banale telle que « ça va? », y faisait voir une somme de réalités informulées. Elle dénonçait la fausse monnaie qui circule entre les hommes, mots vides de sens, truqués, tronqués, au service de l'égoïsme et de l'hypocrisie qui régnaient, selon elle, en maîtres à tous les stades de la vie sociale. L’entresol où elle vivait avec Ali était illuminé par les peintures de celui-ci. Le jour où elle avait déchiré la convocation qu'elle avait reçue de l'Université pour passer sa licence de philo, ils avaient réuni leurs amis autour d'un thé à la menthe pour annoncer qu’ils allaient « faire la route ». Ils partaient pour ne plus être contraints de vivre eux-mêmes comme des faux-monnayeurs. Ils rejetaient tous les systèmes, se refusaient définitivement à toute compromission. Ils avaient fait le choix de la liberté absolue, celle qui avait sans doute inspiré les nomades ou les prophètes de tous les temps. Les mots libérateurs dansaient et chantaient en dessinant l'horizon. Comment le bonheur serait-il possible entre quatre murs de béton ? Bonheur-mirage, opiacé comme la religion, qui avait besoin de se voiler la face, à l'Est comme à l'Ouest, pour prétendre à l'existence... Sur les chemins d'Ali et de Véronique, le soleil levant ou couchant n'apportait pas le bonheur, il donnait la paix…
Il lui semblait bizarrement que tout restait possible et pourtant, d'une certaine façon, que l'avenir était déjà verrouillé. Pourquoi cette sensation d'une barrière invisible et sournoise construite à son insu par elle ne savait quelles puissances obscures?... N'était-elle pas responsable de cette espèce de dérive qui, insensiblement, avait éloigné d'elle Stéphane?... Il était limpide, elle se jugeait compliquée. Il s'exprimait toujours avec une lucidité confondante et une logique irréfutable, la poussait au bout de ses retranchements, parvenait à lui démontrer la justesse de sa position, réussissait à obtenir au moins son adhésion rationnelle, mais n'arrachait pas les dernières réticences, les hésitations, les résistances, qui restaient accrochées au fond d'elle-même comme des ronces.
- « L’école capitaliste en France », tu dois lire ce bouquin !
- Ne deviens pas prof !
Ces paroles obsédantes de Stéphane résonnaient sourdement comme le bruit mat d'un échec. Sous les pavés, ce n'était pas vraiment la plage que recherchait Stéphane. Elle ne le suivait que jusqu'à un certain point. Le point de non-retour se situait quelque part entre la fin et les moyens. Prendre au sérieux la Révolution, la vraie, c'était l'assumer jusqu'à son accomplissement total, en acceptant par avance et les larmes et le sang. Or, elle se voulait résolument pacifiste, ce qui avait le don d'agacer Stéphane. Catherine n'avait pas ces scrupules. Elle était très jeune. Parmi les activités militantes de Stéphane, il y avait la distribution de tracts et la vente de journaux à la sortie des lycées. Catherine avait pris le tract, acheté un journal réalisé par le groupuscule révolutionnaire auquel appartenait Stéphane, et puis elle avait écouté sa belle voix chaude discourir sur le marxisme-léninisme. Alors il l'avait emmenée dans un café proche de son lycée pour continuer l'entretien. C'était banal. Le travail normal du militant de base.
Utopie
_ Quand je regarde jaillir la flamme de mon briquet, je ressens, bizarrement, comme une espèce de joie... Pas seulement à cause de la cigarette que je vais fumer, non... C'est plus primaire... C'est le feu, tu comprends!
Il y avait bien des différences d'appréciation sur l'état de la situation, la nature des actions à mener et, surtout, la tournure que prendraient les événements, il fallait tenir à tout prix, bien sûr, et obtenir l'augmentation des salaires, la réduction du temps de travail, la prohibition du chômage, les congés payés, les conventions collectives... Mais après ? Il y avait les réalistes, les pragmatiques, qui envisageaient sans états d'âme de mettre fin à la grève si tous ces points étaient acquis. Mais il y avait aussi les rêveurs, les défricheurs d'azur et utopistes de tous bords, qui ne voulaient pas reprendre le travail "comme avant".
_ Tu te vois, comme avant, en train de raser les murs au petit matin, de te glisser en vitesse dans le rang en saluant ton chef qui sera goguenard - tu t'es bien amusé pendant plusieurs semaines, mon gaillard, mais maintenant, la fête est finie, et moi, je suis resté le chef! - non, c'est impossible, je ne pourrai pas...
Prométhée
Sortir de la paralysie, de cette impression de ne pas avancer, de tourner en rond dans la cour d'une prison, de s'enfoncer dans des sables mouvants... Crever l'abcès, laisser suppurer l'angoisse, la regarder en face jusqu'à la nausée, souffrir en une seule fois pour nettoyer toute la plaie! Vivre vraiment, pas seulement une apparence, un miroir ou un mouroir de vie, mais un don, un abandon, le pouvoir d'abandonner toutes les défenses, de laisser derrière soi les résistances incompréhensibles, les luttes inutiles, les combats d'arrière-garde... Était-ce seulement possible?... Et pourquoi ce doute à un âge où l'avenir lui était, théoriquement, totalement ouvert? Était-elle donc déjà si vieille, si vieillie, si désabusée, si revenue de tout comme le plus cynique des baroudeurs, à qui la terre entière ne suffirait plus et qui lui préférerait une île déserte pour y cultiver jalousement ses rêves d'avant, coupé du reste du monde mais campé sur l'empire de son passé, enchaîné à son roc comme un Prométhée contrefait, simulacre, caricature de lui-même, grimaçant de regrets dans sa fausse tentative d'arracher aux dieux une parcelle de leur feu, de conquérir une étincelle de leur éternité, de créer la flamme de sa propre vie?...
Clés
Ce qu'il y avait peut-être d'étrange en elle, c'était la conscience poussée à l'extrême de la brièveté de la vie, de son caractère fugitif, volatil, qui aurait provoqué chez d'autres un besoin intense d'activité, d'enivrement - d'enlisement, d'ensevelissement? - par l'action. Comment se déterminer dans un laps de temps aussi court? Avait-on seulement le temps de réfléchir?... De l'autre côté de la vitrine dégoulinante de pluie, du haut en bas des rayonnages qui croulaient sous les livres, la culture dite « bourgeoise » exposait ses réponses ou l'état de ses interrogations pour une élite gourmande. De toute évidence, l'ouvrier et l'étudiant n'étaient pas logés à la même enseigne. Elle vivait sa propre relation à la culture d'une façon ambiguë. La fascination qu'elle éprouvait était sans doute d'autant plus intense que les merveilles entraperçues continuaient de lui paraître dans une large mesure inaccessibles. Dès les premiers mots lus, dès les premiers mots écrits, elle s'était laissée séduire par l'activité intellectuelle qui lui était ainsi révélée, par cette liberté fantastique de l'esprit que ne semble limiter aucune contrainte étrangère à lui-même et dont elle reconnaissait au plus profond d'elle-même les attributs invisibles. Pourtant... Ne manquait-il pas à ce sentiment de familiarité quelque chose d'essentiel? Un élément fondateur sur lequel aurait pu ensuite s'appuyer définitivement l'expérience? Une sorte de colonne vertébrale sans laquelle on ne saurait tenir debout? Ce pays à maints égards étrange dans lequel elle avait souhaité s'établir se dérobait, se rétractait, lui opposait brutalement des barrières sur des lignes frontalières qui ne figuraient pas sur la carte dont elle disposait. Il lui fallait sans arrêt en retoucher les contours, et surtout ne pas cesser de le faire, car la moindre erreur pouvait être gravement sanctionnée par les douaniers zélés de cette puissance obscure qui brouillait avec malignité tous les repères…
Solitudes
_ Ma liberté, ma liberté, je sais mieux que toi, ce qu'elle est, ma liberté!
_ Je ne suis plus qu'un vieux bonhomme qui s'accroche à ses souvenirs, toi, tu es jeune, tu as la vie devant toi, c'est sûrement ça, la vraie liberté, plus sûrement que mes boniments de vieillard radoteur..."
Sous le regard devenu attentif de Lucien, Victor s'était tassé sur sa chaise. La nuit était complètement tombée. Les habitués avaient terminé leurs parties de cartes et discutaient joyeusement avec le patron de l’estaminet. Une chatte s'était pelotonnée tellement près du poële avec ses chatons que la chaleur les avait forcés à entamer un mouvement de recul. Le caractère paisible de cette scène rendait presque irréelle l'expression de détresse qui était apparue sur les traits du vieil homme. Un séisme venait de se produire à l'insu de tout le monde. Sur les planches, des acteurs de second plan continuaient de jouer le rôle rassurant d'hommes et de femmes en phase avec la vie, tandis qu’à l'écart, pour ainsi dire dans la fosse d'orchestre, se débattait un personnage fini. Devant son visage qui se fissurait dans l'indifférence générale, conscient de sa propre jeunesse qui rendait inopérante la sympathie qu'il éprouvait, Lucien avait senti sourdre en lui comme jamais auparavant une angoisse qui lui dévoilait brutalement le pan tragique de l'existence. Il se voyait trente ou quarante ans plus tard, assis à une table identique, vidé de sa substance, les dés étaient déjà jetés… Et c’était ainsi qu’elle le voyait, avec sans doute la même tristesse que celle qui l’avait étreint devant Victor, alors qu’il lui faisait le récit de sa jeunesse et qu’elle-même était incapable de se projeter dans un avenir autre que fermé… Elle ne savait pas, alors, elle pressentait seulement que cet homme abîmé, son père, n'irait pas jusqu'au bout de sa propre histoire, qu'il n'en aurait pas la force, qu'il n'en avait peut-être plus le courage, parce que tout s'était passé trop vite, trop mal, trop durement, et que ses rêves intacts de jeune homme ne supportaient plus, n'acceptaient plus la confrontation, le choc, l'entrée en contact explosive avec une réalité qui lui avait toujours échappé mais qu'il ne maîtrisait plus du tout… Il y avait maintenant ce fossé béant tout autour de lui, qui l'encerclait, qui l'étouffait, qui parvenait à l'isoler de l'intérieur, à creuser en lui une faille, un doute, à le rendre étranger à sa propre personne, de l'autre côté d'une frontière qu'il n'avait pas soupçonnée jusque-là, sauf peut-être précisément le jour où son vieil ami Victor, attablé auprès de lui dans la moiteur et la touffeur de l'estaminet où ils s’étaient réchauffés après le froid glacial de l'extérieur, tassé sur son siège, voûté, géant cassé, les yeux perdus dans le piège immense de la mémoire, lui avait paru soudain méconnaissable dans la révélation de son dénuement extrême, à l'extrémité de sa vie, coupé de ses liens, privé de cette liberté qui lui avait fait tant aimer la vie et à laquelle il avait semblé reprocher à Lucien d'avoir préféré l'enclos d'une usine, avec ses murs épais comme ceux des forteresses...
Accalmie
Une légère modification de l'environnement s'était produite, le tambourinement des gouttes sur les vitres de la verrière avait diminué d'intensité, la bulle sonore commençait à se fissurer, elle se craquelait, se lézardait de toutes parts, menaçait de s'effondrer, de s'affaisser sur l'enroulement, l'entrelacement, le lacis des pensées confuses et des souvenirs mêlés qu’elle avait laissés se développer et grossir en masse compacte et autonome. Elle s’était redressée et ramassée sur elle-même, ramenant les jambes contre sa poitrine, la plante des pieds appuyée sur le rebord du banc, les bras entourant ses genoux sur lesquels elle avait posé le front. Mais non, la pluie ne cessait pas. Elle avait simplement adopté un rythme moins impétueux qui laissait la place au silence entre deux notes sèches, qui rebondissaient avec moins de violence sur le toit de la verrière.
Lieu de transit
Il séjournerait quelques semaines à Amsterdam puis se rendrait à Berlin. Il lui enverrait des lettres laconiques, juste le nécessaire. En regard de la limpidité des mots qu'il emploierait, elle se demanderait si la mécanique de ses propres sentiments n'était pas faite de rouages un peu trop compliqués. Elle avait voulu retarder le moment de le quitter, ils s'étaient installés à une table située dans un coin du snack-bar de la station-service. La scène était restée figée dans sa mémoire comme un tableau de Hopper. Juché sur un tabouret près du comptoir, un homme en costume-cravate et grosses lunettes d'écaille lisait un journal en fumant une cigarette. Au centre de la salle, deux chauffeurs routiers mangeaient face à face. De longues minutes s'étaient écoulées dans un silence interrompu seulement par le cliquetis des couverts, le froissement du papier et le choc de la vaisselle lavée par l'employé du snack. Soudain, l'homme aux lunettes avait replié son journal et payé son dû. On avait entendu ronronner le moteur de la belle Peugeot 504 blanche garée en face de la baie vitrée, puis séloigner avec élégance et sobriété. Stéphane s'était approché des routiers quand ils avaient réclamé l’addition. Ils avaient entamé une discussion sur les délais difficiles à tenir, les réglementations qui diffèrent d'un pays à l'autre, la vie familiale perturbée. Mais il y avait aussi leur plaisir à travailler sans supérieur hiérarchique, au volant d'un mastodonte, seuls maîtres à bord après Dieu. Sur la banquette de moleskine où elle était restée assise, elle écoutait la musique des voix. Les yeux fermés, elle voyait défiler des images de villes aux noms évocateurs qui se déployaient sur un vaste territoire où se jouaient les destins des uns, des autres… Dans le creux de sa main droite, elle avait serré le petit miroir rond qu'au moment de sortir pour accompagner Stéphane jusqu'à la bretelle de l'autoroute, elle avait glissé dans une poche un peu comme s'il s'était agi d'un talisman. Côté face, elle aurait donné quelques années de sa vie pour connaître l'avenir. Côté pile, pour ressusciter les bonheurs perdus...
Brisure
Il y avait eu cet éclair, ce déchirement dans un ciel clair, ce coup de tonnerre inattendu et terrifiant, et ce tremblement de la terre, les murs qui s'écroulaient, l'enveloppe de la vie qui s'éventrait... Quelques paroles, comme les trompettes de Jéricho. Quelques paroles avaient levé le voile sur un champ de ruines qui s'étaient sournoisement amoncelées derrière le mirage d'une existence apparemment intacte, mais qui n'avait déjà plus que l'épaisseur, la consistance d'un décor... Le compte à rebours avait commencé, le même pour tous les êtres vivants, mais pour Marie, il s’était brusquement accéléré… Quelques paroles s’étaient intercalées entre leurs deux vies, entre le côté pile et le côté face, sur une ligne de crête ou de creux entre le ciel et la terre, entre rêve et réalité, entre souvenir et avenir aux routes pareillement barrées, un espace si ténu, si improbable et si difficile à occuper, entre le tain de la glace et la vitre brisée… Quelques paroles prises dans la glace d'une banquise inconnue, que nulle carte ne mentionnait à cet endroit-là, pas à ce moment-là, pas de cette façon-là, de cette manière fourbe et brutale, déloyale et insupportable… Mais il y avait aussi cette autre glaciation plus ancienne, aussi lointaine et enfouie que le plus reculé, le plus profond de sa mémoire, et peut-être même au-delà encore... Il y avait ce froid dans le cœur depuis presque toujours, la marque déjà gravée de l'absence, le début d'une attente sans fin, la faim, la privation d'une substance primordiale et introuvable, qu'il fallait chercher dans l'ailleurs...
Volatilité
Elle n'avait pas envie de se battre. Elle aurait voulu pouvoir se nicher dans un pli de la terre ou l'anfractuosité d'une roche, et de là, de cet abri, contempler la splendeur, la magnificence de l'univers - sa face claire -, ne faire qu'un avec le sol et le ciel, en ressentir, en écouter les accords, vivre de cette harmonie et n'avoir aucun autre désir... En Ecosse, l’été d’avant, dans cet univers enveloppé de brume aux contours aussi flous que sa vie, coupée du reste du monde, elle avait connu des moments si intenses qu'elle avait pensé approcher de sa vérité… Elle avait fait quelques rencontres. Un pêcheur, un berger, une touriste américaine égarée, un routard… Le pêcheur ou le berger n'avaient pas à justifier de leur vie, leur existence avait le poids, la consistance, l'épaisseur de leur rapport à l'océan ou à la terre, sans médiation, sans intermédiaire. Les autres, le routard, l'américaine, elle-même, flottaient dans le paysage, superflus, vacants, inutiles. Ils pouvaient être là ou ailleurs, cela n'avait aucune importance, et rien ni personne ne les réclamait…
Compte à rebours
Il lui avait demandé de répondre poste restante jusqu'à ce qu'il lui indiquât une adresse dont il aurait été sûr. Elle l'avait encore fait récemment pour lui donner des nouvelles de France dont il avait d'ailleurs eu vraisemblablement connaissance par le canal de l'organisation. Pierre Overney, abattu par un vigile devant la régie Renault, l'enterrement suivi par des centaines de milliers de personnes, la crainte d'une insurrection dans les milieux gouvernementaux et policiers… Pourquoi ce silence? Pourquoi cette absence qui ressemblait à une mort? Stéphane X, abattu par Y... De Tempelhof, il avait pu s'envoler pour n'importe où dans le monde. Il aurait pris un aller sans retour. Si l'organisation le lui avait demandé. Si la Révolution l'avait exigé. Mais aucun journal, aucune radio ne titrait sur Stéphane X ! La télévision ne le montrait pas retenu en otage dans une région perdue d'Amérique du Sud ou d'Afrique ; sur aucune photo, dans nul reportage, on ne voyait son visage émacié aux yeux brûlants ; et personne, selon toute vraisemblance, ne l'avait mis en joue pour détruire les idées que son front affichait. Cela n'empêchait pas le délire. Une avalanche de suppositions, un échafaudage d'hypothèses toutes plus invraisemblables les unes que les autres, le surgissement aléatoire des images du passé pour imaginer à rebours le scénario d'un film commencé à l'aéroport de Tempelhof le 9 octobre 1971, le cachet de la poste faisant foi.
Franz, le dernier témoin, venait de quitter la ville pour une destination qu'elle ignorait, et son successeur dans la petite maison qu'il squattait dans une courée de la vieille cité n’avait pas été plus explicite.
Franz disparu lui aussi, le bout de papier chiffonné qu'elle avait conservé comme la carte énigmatique d'un trésor, dont le sens ne pouvait être décrypté que par le scripteur ou son interlocuteur indirect tous deux évaporés, ce blanc-seing que Stéphane avait destiné à Franz pour la mettre sous sa protection, ce document unique et précieux qui était devenu l'ultime objet qu'il lui avait offert alors que le moteur du poids lourd s'était mis à rugir en couvrant sa voix, juste avant que la portière ne claque, ces quelques mots griffonnés rapidement contre la tôle qui vibrait, cette écriture tremblante et les paroles à peine audibles (« chic type », « ennuis ») qui avaient accompagné le geste de tendre vers elle ce morceau de feuille froissée, qui palliait les lettres qu'elle ne recevait plus, le roman qu'elle avait bâti à distance comme un pont entre leurs deux vies séparées, tout cela - « le mot nu ment » - s'effondrait, s'écroulait subitement, comme au réveil les songes des dormeurs, et l'inscription improvisée sur un support de fortune dans la fièvre du départ semblait avoir soudain, si Franz ne pouvait plus la faire vivre, la froideur d'une épitaphe…
Le groupuscule
Lui qui était si économe de mots, dans cette lettre étonnamment prolixe du mois d'octobre, il s'était laissé aller à lui décrire les splendeurs du Tiergarten qui flamboyait à cette époque sous les feux de l'automne. Il disait s'y promener fréquemment le jour et s'amuser la nuit du clinquant colossal de l'avenue du « Ku'damm », qui hypnotisait la multitude des flâneurs par les néons démesurés de ses enseignes lumineuses qui paraissaient les happer comme de malheureux papillons. La vitrine du monde libre étalait ses trésors de pacotille et dressait son propre mur de verroterie pour camoufler ses tares. Il disait aussi avoir un copain militaire qui avait le privilège de se rendre souvent à l'Est. Malgré l'interdiction de communiquer avec la population, celui-ci en rapportait des impressions, des anecdotes, et qui sait, mais là, elle s'était rendu compte qu'elle s'était mise à délirer, des contacts pour Stéphane... Cette lettre du mois d'octobre avait été envoyée de l'aéroport de Tempelhof. Toutes les autres, même les cartes postales, l'avaient été de l'arrondissement du Wedding, à proximité, semblait-il, du quartier Napoléon où résidaient les militaires français.
Catherine disait ne pas avoir de nouvelles plus récentes. Elle la rencontrait parfois dans les lieux qu'avait fréquentés Stéphane. Son engagement dans l’organisation s'était confirmé, elle avait réussi à se faire embaucher dans une grande entreprise de vente par correspondance pour y noyauter le syndicat, y préparer des « coups ». Elle laissait entendre que Stéphane avait de la chance car là-bas, il se passait des choses intéressantes... Ces quelques mots de Catherine, la jubilation intérieure avec laquelle elle les avait prononcés et que son léger sourire, accompagné d’un regard teinté de moquerie, avait laissée filtrer, ouvraient une brèche dans l’épaisseur de son double aveuglement. Elle prenait conscience de la réalité de l'engagement de Stéphane dans ce groupuscule situé à gauche de l'extrême gauche, et se rendait compte qu'elle avait laissé se développer entre eux une sorte de mensonge ou de mauvais rêve, qu'elle avait multiplié les erreurs de lecture, les faux-sens, contresens, fautes de toutes natures et péché fondamental, elle n'avait rien compris au marxisme-léninisme... Elle avait écouté sans les comprendre ses paroles elliptiques sur fond d'activités plus ou moins clandestines. Il lui avait parlé d’une mission importante, d'une action d'envergure qui se préparait à l'Ouest, de la restructuration du mouvement révolutionnaire inter-national… Elle comprenait soudain que le cloisonnement de l'organisation n'avait rien de folklorique. Moins connue que d'autres, plus secrète, mieux structurée, il lui avait annoncé, elle s’en souvenait maintenant, qu’elle deviendrait le fer de lance des luttes à venir… Il disait que la conception que l’on se fait du monde est plus importante que l’amour… Que la politique est le noyau dur de la vie, que tout le reste s’organise autour d’elle… Il lui disait que tout serait plus facile si elle-même entrait dans l’organisation et lui reprochait de ne pas faire le saut…
Décryptage
Pourquoi lui avoir donné l'adresse de Franz à ce moment-là précisément? « Au cas où tu aurais des ennuis »... Regrets, sentiment de culpabilité, crainte réelle, crainte de quoi? Ce bout de papier à l'écriture rapide et déformée - il l'avait griffonné debout sur le marchepied - ce bout de papier tendu au dernier moment - c'était l'avant-dernier geste de Stéphane, ensuite, il avait claqué la portière - pouvait exprimer aussi bien une certaine tendresse inquiète que le souci de se désengager, de la quitter sans la laisser vraiment seule, de rompre en douceur de façon à laisser agir le temps, comme s'il craignait de lui faire mal, car il avait probablement l'intuition de cette forme de fragilité qu'elle s'efforçait pourtant de dominer...
Au dernier moment, sur le marchepied : « Tiens, voici l'adresse de Franz, c'est un chic type »... Et la portière avait claqué. Ce claquement, elle l'entendait encore, plus sec, plus nerveux que jamais, plus déterminé, plus douloureux, plus cruel. Il retentissait dans sa tête comme une gifle, avait sa force violente, arbitraire, insolente. Il était le signe ou le signal sonore qu'elle était de trop. Stéphane avait claqué la portière comme on claque une porte, dans un mouvement d'exaspération, de colère, de refus... Il n'avait pas besoin d'elle, elle s'était enfoncée pendant des mois dans le refus d'admettre des évidences, cette façon qu'il avait de la tenir à l'écart de ses amis, de ses activités même banales, d'éluder les questions, les échéances, ou au contraire d'imposer des ultimatums : « Si tu n'es pas d'accord, on n'a plus rien à faire ensemble... » Oui, c'était cela le véritable sens d'un geste qui n'avait rien d'extraordinaire en lui-même puisqu'il s'insérait dans une suite d'actions logiques, cohérentes, prévisibles : il avait grimpé dans le camion puis claqué la portière, mais à cet instant précis, il était vraisemblablement sorti définitivement de sa vie…
Liens
« Puisque personne ne me revendiquait sérieusement, j'élevai la prétention d'être indispensable à l'Univers.» Ces « mots » de Jean-Paul Sartre, qu'elle venait de relire, prenaient une signification troublante. En faisant siennes les certitudes marxistes-léninistes de Stéphane, en s'engageant dans l'organisation révolutionnaire où il militait sans rire, elle créerait ce lien qui leur manquait, elle occuperait à ses côtés la place qu'elle ne trouvait nulle part, dans un lieu précis qui lui procurerait une identité, et cesserait enfin de dériver dans un espace trop grand, trop vide, qui l'aspirait toujours plus loin ou plus profond comme pour mieux l'avaler, la noyer, l'anéantir… En même temps qu'elle s'attacherait ainsi solidement à Stéphane, elle donnerait à sa vie le poids d'une lourde mission qui l'empêcherait de s'envoler comme une baudruche. Elle serait aussi comme l'allumeur de réverbères de Saint-Exupéry, toujours à son poste, ponctuelle et consciencieuse, obéissante et zélée comme un petit soldat, pour une cause qui la dépasserait et la ferait se dépasser. Au contrôleur du train de l'existence qui lui réclamerait le justificatif de sa présence, elle présenterait non pas un mais deux passeports, qui cloueraient le bec à ce personnage macabre. Sur le premier, il serait écrit: « Stéphane l'aime», et sur le second: « Recrutée pour la Révolution »… Et cette attente intérieure insupportable qui durait en fait depuis toujours, cette paralysie des sentiments et du désir dont elle avait cru au tout début de leur relation qu'il aurait pu la guérir, lui, l'homme des certitudes qui lui avait dessiné les contours d'un paysage dans lequel il lui avait montré sa place, auprès des prolétaires, ce désespoir discret et silencieux qui était forme creuse de l'espoir, espérance vide, cette impossibilité d'agir, de ressentir et de vivre s'évanouissait, se résorbait enfin, à la fin de ce scénario optimiste, qui avait l'avantage de l'empêcher de devenir prof, de mettre un terme à la trahison qui avait commencé lorsqu'elle s'était mise à détester son père, à s'éloigner de lui comme on s'éloigne de la terre ferme, à le réprouver, à le bafouer, avec ses manies, ses silences, ses gestes étriqués, sa petitesse physique et l'étroitesse de son esprit, son horizon borné de toutes parts, sa vie retranchée, recluse, repliée sur elle-même, qui avait trouvé dans le fléchissement de plus en plus accentué de son dos la plus parfaite des métaphores, comme le signe perceptible de sa résignation, voire de son attachement irrationnel à cette forme d'existence qui relevait de l'esclavagisme, mais où il paraissait voir, lui, les vertus supérieures de la fidélité aux siens, du courage et de l'humilité, ce qui, de sa part, était en fait, elle le savait maintenant, la plus impressionnante des manifestations d'orgueil...
Destin
Elle avait essayé d’oublier et de vivre dans l'instant, n'être, naître que pour une étincelle de temps. Elle s'en était révélée incapable. Pitoyablement accrochée aux chaînes tentaculaires du souvenir, qui étendent leur ombre maléfique sur n'importe quel projet bon à phagocyter. Incapable d'accéder à cette liberté d'or bleu qui se fait désirer comme le seul et singulier bonheur d'aurore possible. Et sous la verrière qui protégeait des intempéries la ruelle discrète comme un passage secret où elle se trouvait toujours assise, sur ce vieux banc aux pieds de fonte qui s'enfonçaient lourdement dans le sol comme dans les profondeurs de leur propre mémoire d'objets, il lui semblait qu'elle commençait à comprendre, à accepter l'idée qu'elle n'échapperait pas, quoiqu'elle pût faire ou décider, ni à la pesanteur du passé ni à ses lois tortueuses et incertaines, et que, paradoxalement, de cette masse compacte et froide qui surplombait sa vie comme une menace permanente, jaillirait un jour un rayon de lumière inconnue, un signe, un souffle, un éclair, qui feraient imploser le monstre volcanique qui vitrifiait chacun de ses instants, les empêchant d'éclore…
Résolution
Elle assumerait un devoir de solidarité posthume. Il n'était plus question de « se tirer », de s'en tirer toute seule, de s'enterrer, de se perdre au sens propre du terme dans la petite ou moyenne bourgeoisie des mandarins dont, de toutes façons, il lui manquerait toujours la plupart des codes secrets… Elle se trouvait une nouvelle fois, à ce moment précis de sa vie, à une sorte d'intersection gardée par le même poste de douane, mais vide, inoccupé. Le passage, pour la première fois peut-être, paraissait libre. Elle avait rassemblé les annales éparpillées sur le banc. Elle les avait glissées à nouveau sous un pan du ciré noir acheté à Edimbourg. Elle prendrait peut-être un train de nuit ou ferait du stop, elle verrait au dernier moment. Il fallait qu'elle rende ces annales au libraire de la rue Royale puisqu'elle ne les utiliserait pas avant son retour de Berlin, si tant est qu'elle revînt en France. Elle se devait d'essayer de retrouver Stéphane, de fouler les sols qu'il avait parcourus. Pour savoir. Pour comprendre un peu. Pour devenir actrice, peut-être, comme lui, d'une révolution nécessaire, au lieu de panser les plaies toujours renouvelées d’un système pervers. Cette longue méditation sous la verrière parvenait à son terme. Elle s'arracherait à ce banc aussi lourd que le ciel plombé au-dessus de la voûte de verre. Elle s'extirperait de cette poche de relatif bien-être où paraissaient pouvoir être réunifiés les deux fragments de temps de sa mémoire cassée. Car elle n'avait pas d'autre choix que de répondre à l'appel lancinant des absents. Elle mettrait ses pas dans leurs traces étranges sur les routes d’un passé incertain. Elle tâcherait de recoller dans cette ville fracturée les morceaux de sa personnalité émiettée, de construire ou de reconstruire une histoire neuve. Elle rachèterait ses erreurs et ses errements, superposerait les sédiments du souvenir au-dessus de l’oubli, dégagerait un champ de fouilles pour y relever les fondations anciennes, utiliserait des matériaux souples et légers pour protéger le souffle de la vie. Elle rendrait donc les annales au libraire étonné. Sous la pluie devenue fine comme un voile de soie, elle ferait en sens inverse le chemin du matin. A la boulangerie de la ZUP, elle achèterait des viennoiseries pour les enfants de sa voisine qu'elle attendrait comme d'habitude à la sortie de l'école. Sur le palier, Monique aurait l’air fatigué. Elle lui annoncerait son départ et celle-ci aurait l'air encore plus fatigué. Était-il possible de ne jamais se sentir en porte-à-faux?
Contemplation
La journée s'étirait devant elle comme les files de wagons derrière leurs motrices. En passant devant le kiosque de la gare, elle avait acheté un journal, il y avait un gros titre sur Wall Street. Un convoi s’éloignait, elle avait regardé disparaître les deux points rouges qui restaient de lui dans la brume qui avale toute forme et toute couleur. Elle allait et venait comme un métronome en passant à chaque fois devant une salle d'attente sale et triste où l'un des trois bancs adossés aux murs était occupé par un clochard allongé de tout son long sur le bois comme sur de la moleskine. Et sans doute parce qu’elle attendait, elle était entrée dans la salle dévolue à cette fonction. Elle avait essayé le banc du fond, mais ne voyait plus l'extrémité gauche de la gare. Sur le banc de droite, dont la position était plus centrale, la totalité des quais entrait dans son champ de vision. Elle s'y était allongée comme le clochard qui lui faisait face, mais la tête relevée, appuyée sur un accoudoir, de façon à ne rien perdre de la calme activité de la gare, ni des menus événements qui se produisaient en rythme accéléré à l'arrivée ou au départ d'un train. Elle pouvait se laisser absorber indéfiniment par cette somme de détails insignifiants qui n'intéressent que les peintres ou les inactifs, un ticket découpant un rectangle clair sur le sol noirci, la voûte immense de la verrière au-dessus des quais, le bruit de ferraille d'un chariot qui passe, le pas nonchalant d'un voyageur en avance, celui, hésitant, d'un autre voyageur qui cherche... Vers le milieu de la salle, entre le banc du clochard et le sien, un objet brillant, rond et plat, avait attiré son attention. Pile ? Face ? Ne fallait-il pas qu’elle se rende à Z. ? La pièce de monnaie qu’elle avait ramassée puis lancée en l’air était retombée entre deux plis d’un journal qui traînait sur le sol, ne montrant clairement ni son côté pile, ni son côté face, les dieux n'avaient pas voulu se prononcer. Un haut-parleur avait crachoté, toussoté, puis une voix claire avait annoncé l’arrivée de l’express…
Aller à Z. ?
On lui avait dit que l'usine battait de l'aile… Dans ce cas, comme toutes celles qui avaient déjà baissé pavillon, elle présenterait tous les stigmates de l'abandon, vitres cassées, rouille, pans de murs qui s'effritent, et dans la cour, sur l'ancienne plate-forme de chargement, un chariot renversé les bras en l'air, un éparpillement d'outils semés comme des fleurs sauvages, un lot de toile pourrissante - de la bâche (dans cette usine-là, on ne faisait pas dans la dentelle), un wagon immobilisé sur des rails qui s'arrêteraient bizarrement juste au bord du canal, quelques bidons, des pneus de poids lourd, et plus loin, adossée auprès d'une porte sur laquelle on lirait encore en épaisses lettres blanches "ATELIER", une machine compliquée qu'elle aurait l'impression d'avoir déjà vue fonctionner, dans le vacarme des navettes domptées par le claquement sec des fouets, à l'occasion d'une visite, d'une fête, d'un départ en retraite, d'une remise de médaille du travail, un métier à tisser sur lequel lui ou un autre aurait fabriqué le dernier rouleau de toile, de la bâche en train de pourrir à quelques mètres de l'atelier, parce qu'elle aurait raté le dernier chargement... Elle irait alors jusqu'au canal. Elle lèverait la tête pour apercevoir la haute cheminée de la fabrique qui avait usiné la vie de son père. Elle marcherait sur le chemin de halage. Elle ne saurait pas vraiment ce qu'elle serait en train de chercher. Elle irait jusqu'à l'écluse et traverserait le pont en face de l'ancien estaminet ; peut-être serait-il encore debout, et peut-être serait-il possible encore de lire son enseigne : « À L'HABITUDE »...
Incandescence
D'énormes masses sombres parcouraient le ciel en ne laissant filtrer que par intermittences un rare rayon de lune qui venait mourir à la surface du canal, endormi de l'autre côté du chemin de halage à dix pas de la façade de l'estaminet. Après la chaleur étouffante qui régnait à l'intérieur, la sensation de froid était intense. Les mains dans les poches et le col relevé, Lucien reprenait la marche que Victor avait interrompue en l'invitant à prendre un verre « À l'Habitude » . Le sol gelé crissait ou glissait sous les pas selon les endroits et la texture du terrain. Le début de l'après-midi avait été limpide, aux couleurs or et azur du soleil et de l'éther. La nuit estompait la limite de l'eau sur la gauche, la montée du talus sur la droite. Lucien s'était arrêté pour allumer une cigarette. A la lumière de son briquet, il examinait le ruban liquide qui se laissait oublier dans l'obscurité. Le canal devenait un redoutable piège, génie malfaisant capable de dérouter le chaland pour l'engloutir à jamais, monstre à l'aspect si tranquille, bête rampante tapie tout au fond de l'ombre. Lucien penchait la tête en même temps qu'il rapprochait de ses lèvres les paumes de ses mains recourbées. Un point incandescent avait remplacé la flamme jaune et bleue qui avait tenté d’éclairer le canal. De loin, un observateur aurait pu suivre, suivait peut-être, les lignes éphémères que traçait dans la nuit la cigarette allumée, qui dansait en épousant le rythme enfiévré de la marche du jeune homme et ses mouvements désordonnés, décrivait les plus jolies arabesques, créait les bouquets les plus inattendus. Lucien ressentait, à ce moment très précis, la force de sa jeunesse et le désir impérieux d’accéder à ce bonheur pur et dur que Victor avait semblé regretter de ne plus pouvoir lui offrir mais auquel il n’avait pas renoncé. Puis il avait pris à travers champs la direction de la ville, entre la voie ferrée et une succession de jardins maraîchers séparés à intervalles irréguliers par de vagues alignements de briques et de pierres qui avaient donné leur nom à la rue des Murets. Devant lui se profilait la masse noire et compacte de la ville, découpée par une espèce de vapeur lumineuse. Il s'arrêtait parfois pour écouter le silence…
Souvenirs imaginés
À Z., dans les pas de Lucien, elle longerait de nouveau le canal sur son autre berge, en sens inverse. Elle ferait cela plusieurs fois, de la fabrique qui de loin lui apparaîtrait dans sa totalité jusqu'au pont de l'écluse, et de l'écluse à la fabrique. Par association d'idée, à un moment donné, elle penserait à l'Ile des Écluses et aux rives du Landwehrkanal où elle avait flâné en pensée aux côtés de Stéphane. Tous deux s’étaient arrêtés, au cours de ce voyage imaginaire, devant la plaque commémorant l'assassinat dont Karl Liebniecht et Rosa Luxembourg (leurs corps avaient ensuite été jetés dans le Landwehrkanal) avaient été victimes dans les jardins du Tiergarten…
Impasses
Elle irait donc à Berlin, dans cette ville coupée en son milieu, aux deux parties, aux deux visages qui s'ignorent. Elle en sillonnerait toutes les artères, toutes les avenues, les moindres rues et venelles de sa moitié occidentale, et se perdrait dans les quartiers immenses ou les recoins obscurs, ne laissant rien au hasard, ratissant, passant au peigne fin ce vaste territoire dont elle aurait l'illusion de prendre peu à peu possession jusqu'à ce que la vérité éclate comme une bulle, à chaque fin de parcours, lorsqu'elle se heurterait au mur, à cette frontière infranchissable sous peine de mort, à ce rideau de plomb qui recouvrait comme un linceul la ville orientale. Elle flânerait dans le Tiergarten, longerait les rives du Landwehrkanal jusqu'à l'Ile des Ecluses, se reposerait des longues marches de la journée en admirant le couchant sur les étangs de Neuer See, étendue dans le creux d'un sentier buissonneux où l'ombre se jouerait de la lumière comme le rêve de la réalité, loin de la foule qui se presserait dans la StraBe des 17. Juni mais qui s'arrêterait net, docile, inconsciente de son pouvoir, devant la porte muette de Brandebourg…
Plantée au milieu du quai, elle se laissait bousculer par le flux des voyageurs pressés. Tout était gris ou noir sauf quelques feux de signalisation rouges et verts. Le grondement du train grossissait, on entendait son souffle haletant, on croyait sentir son haleine ; puis les phares jaunes de la locomotive avaient percé le brouillard, le train amorçait la dernière courbe avant son entrée en gare ; bientôt, il lui suffirait d’enjamber un marchepied pour se hisser dans un wagon, pour se projeter, basculer - pile ? face ? - de l’autre côté de sa vie.
Françoise Gérard, L'avenir improbable
2017
2017
On peut lire le texte dans son entier en se rendant ici
La guenon
NOUVEAUTÉS
Les parents l’appellent « la guenon », chacun dans sa hargne intérieure ; chacun pour soi et en silence. La ressemblance est évidente, c’est pour cela même qu’ils la taisent.
Mais quand on évoque cette femme, ils ont, en se regardant le même air dégoûté.
C’est une vieille aux yeux perçants et dont le regard engloutit. Ses joues sont caves, son cou flasque, ses oreilles démesurées. Un menton sec limite sa face comme la pointe tranchante d’une arme.
Cette vieille femme a fait un soir l’objet d’une émission à la télévision. Elle est l’épouse française d’un philosophe indien. Elle se veut fondatrice de la cité de l’Aube, dans le sud de l’Inde. Nombre d’occidentaux ont vu ce documentaire sans s’attacher à elle. Il s’agissait d’esprit et de philosophie dans un lieu exotique. On y parlait d’un monde nouveau qui, pour les parents de Pierre, n’était qu’un idéal de plus balancé en pâture à la communauté des hommes. En haussant les épaules, ils avaient éteint la télé et étaient allés se coucher. Mais Pierre s’est laissé envoûter par le rayonnement de ce visage.
Pour lui, cette femme est belle. Il voit dans ses rides de l’acharnement ; de la lumière darde de ses orbites. La générosité irradie de ses mains. Et le pauvre crétin de se laisser gruger et les parents meurtris de regarder le plafond et de joindre les mains pour que, fasse le ciel, un jour, leur garçon revienne à la raison !
Pourtant jamais encore, et devant lui non plus, ils n’ont prononcé le nom de «guenon ».
Elle est la souveraine d’une ville à parfaire. Elle est l’autorité d’une secte mondiale et se fait appeler « Omnia ».
Pierre se prépare à faire le voyage depuis Paris. Il ne fait pas ses bagages, mais il annonce à ses parents qu’il part parce qu’Omnia l’appelle et qu’il est temps pour lui de la suivre, c’est son destin.
Alors sa maman hurle : « Omnia, cette vieille guenon ! »
Son père se mord la lèvre au sang. Il a l’intuition d’une faute grave.
Le père est un patriarche occidental. Il a de la prestance et des idées carrées. Il est sage et athée. Il dit : « Au revoir, Pierre, je suis vieux; je ne sais pas si je serai encore de ce monde quand tu reviendras. »
Sa femme le retient par le bras puisqu'elle n'a su retenir les mots et, à son tour, elle s'empêtre : « c'est cela mon chéri, c'est bien, tu as raison ». Elle lui caresse les cheveux et lui enjoint d’aller dormir.
La pomme d'Adam de Pierre monte et descend, ses lèvres s’entrouvrent, il va parler. Il ne dit rien. La pomme d'Adam reprend son va et vient. Des minutes ont passé. Pierre est rentré chez lui.
Les parents vont se coucher. Ils ne se parlent pas du départ de leur fils, leur silence nie son existence. Ils prennent chacun un somnifère.
Ils ont passé une nuit blanche. La mère a critiqué la qualité du somnifère. Le père s'est rassuré : « je ferai une bonne nuit demain. »
Pierre a préparé ses affaires. Des bouquins en piles jonchent la moquette de son studio. Il les donnera avant de partir. Il donnera aussi ses pulls trop chauds pour là bas. Il met de côté quelques cahiers, deux ou trois livres qu'il a du mal à choisir.
Pendant la journée la mère de Pierre questionne les gens autour d'elle : est-ce qu'ils la connaissent, la guenon ? Qu'est ce qu'ils en pensent, qu'est ce qu'ils croient?
Le père dit « tout ceci est stupide, c'est à lui de faire ses expériences » et il sort de son tiroir un carré de chocolat noir.
Son bureau est au Rez-de-chaussée; celui de sa femme, au premier. La rampe de l'escalier a servi autrefois de toboggan aux enfants. La fille a quitté la maison très tôt. Le fils est resté plus longtemps mais il ne sortait guère de sa chambre : il a passé beaucoup de temps à apprendre depuis Paris les leçons de vie de La Guenon.
Et puis il est parti.
Son père a essayé de convaincre sa mère qu’il n’était pas si loin puisque la cité de l’Aube avait été française ! Et ils s’étaient forcés ensemble à rire de ce raccourci.
Et puis, Pierre est mort.
Les parents l’ont appris par un télégramme de là-bas : « Son dead on january 5th. »
Après le petit silence énorme qui passe de la mort sur ceux qui vivent encore, les parents ont dormi vingt heures. Le père est vieux, très, très vieux. Il fait un geste vers sa femme, un geste vers l’Inde… :
-« Vas y sans moi. »
Il se dit : « elle peut, elle est plus jeune que moi » et il cherche quel âge avait Pierre. 32 ? 30 ?...Il ne sait plus. Il lit et relit le texte du télégramme pour retrouver l’âge de son fils. Mais il n’y a qu’un 5 et en haut du papier un 6, peut-être un 7, on ne voit pas bien, « january 6th ou 7 th », ça n’a plus beaucoup d’importance. Alors, comme chaque fois qu’il est perplexe, le papa de Pierre sort du tiroir de son bureau un carré de chocolat noir.
Au premier étage la maman de Pierre fait sa valise. Des robes légères sont étalées sur le lit. Par-dessus la rampe, elle crie : « quel temps fait-il en ce moment, à Pondicherry ? » Elle se plait bien dans sa robe verte.
La mère est partie. Le ramener. Ni elle, ni son mari ne savent ce qu’il faut faire avec cette mort. La mort trop loin n’a pas de corps. Ils ont besoin. Il leur faut Pierre. Mort si c’est vrai qu’il ne vit plus. Mais obligatoirement leur faut. La mère rapportera son fils à son mari.
Le père attend. Toutes les journées du père de Pierre commencent et finissent, mais elles ne sont pleines que d’attente. Il commence d’attendre en se levant, il finit en fermant les yeux pour dormir et il dort pour attendre l’attente du lendemain.
À Pondicherry la mère met sa robe verte. Elle se barde de courage pour rendre visite à son fils. L’hôtel est sur la plage. Elle porte sa robe verte, son fils est mort et l’hôtel est sur la plage. Alors, elle met son maillot de bain et elle avance vers la mer. Elle est seule en maillot de bain : les femmes en Inde ne se montrent jamais en maillot de bain. Quand elle sort de l’eau, les regards brûlants d’un buisson de femmes aux cheveux noirs, la piquent sur tout son corps. Elle court jusqu’à l’hôtel et demande en anglais où elle peut rejoindre son fils. Elle montre le télégramme. L’hôtelier lui dit : « yes, mam, tomorrow » et il lui donne la clef d’une chambre. Elle est si fatiguée qu’elle se laisse tomber sur le lit.
Autour de l’hôtel, au bord de la plage, il y a un jardin luxuriant. Des fleurs s’y inclinent, veloutées, nacrées comme des lèvres. Une fontaine à jet d’eau perlé y coule, déborde de vasque en vasque. On n’entend que le bruit de l’eau et la maman de Pierre se sent enfoncée, lourde, dans une paix inéluctable. La chaleur moite intensifiée par les pales d’un ventilateur qui brasse autour d’elle un air liquoreux, la plonge dans une torpeur de purgatoire. Elle oublie pourquoi elle est là. Mêlant ensemble tous les dieux, elle attend la pesée de son âme, la venue d’une mort mythique.
Elle croit voir les rives d’un fleuve et puis elle s’endort.
Dans le jardin encore, derrière les volutes vertes des bosquets, derrière les corolles, des grappes se cachent de femmes en sari et ces femmes sont avides de savoir qui est la française, dans la chambre, là haut. Le jardin vibre de leur curiosité, brûle de leur cupidité. L’air est saturé d’elles qui demeurent invisibles. Peut-être ont-elles vu Pierre partir d’ici dans un rikshaw tiré à pied par un de leurs parents, à la recherche d’Omnia…Peut-être sont-elles complices, adeptes de la secte…
La mère de Pierre se tourne sur son lit. Elle a un sommeil agité. C’est pourtant si calme. Elle se réveille alors et découvre sur le mur un grand portrait de la guenon qui la regarde et la dévore et la regarde.
Elle prend peur et va à la fenêtre. Les perles du jet d’eau continuent de bruire dans les vasques mais l’air est bouché. Encens, huiles parfumées, sueur, sucre épicé, présences. Elle a envie de crier « il y a quelqu’un ? » comme elle le ferait chez elle, en occident.
Mais en Inde, cette phrase n’a pas de sens ! Elle ne sait pas qu’en Inde il y a quelqu’un partout. Aucun son ne sort de sa bouche. Seules des larmes lui viennent et, étranglé, le nom de « Pierre », son fils captif de la guenon qui l’a tué.
Elle pleure et reste dans la chambre.
Elle ne sortira pas. Elle n’ira pas voir Pierre.
Elle reprendra l’avion sans lui, sans avoir vu son corps, sans l’avoir embrassé. Elle doit rentrer indemne. Le danger, rôde partout. Partout elle est épiée.
Elle ferme les yeux et tourne le dos à la guenon.
Elle se concentre sur le lit, rectangle de bois recouvert d’une cotonnade blanche. Elle entre comme elle peut en cercueil dans la chambre d’hôtel habitée par Omnia et elle pleure « Pierre, mon fils… »
Elle demandera que l’avion vienne jusqu’à l’hôtel pour la chercher et la ramener à Paris.
Elle devra seulement faire très attention de ne pas glisser en redescendant les marches de marbre. Car sur chacune de ces marches un groom guettera. Son regard de braise n’aura de cesse de prendre dans les battements de ses cils recourbés, la détresse de l’étrangère pour l’apporter à la Guenon, en offrande. En pâture.
La maman de Pierre doit rentrer indemne.
À Paris, le père de Pierre a attendu l’attente du soir. Et le soir, il a décidé de ne pas attendre l’attente du matin. Quand la maman de Pierre est revenue de son voyage en Inde, elle est entrée dans le bureau et elle s’est demandé ce que son mari attendait pour se réveiller.
Marianne Brunschwig, La guenon
2017
2017
Grâce à un singe, À cause d'un singe
NOUVEAUTÉS
Grâce à un singe, une lâche réalité est venue à l’existence,
À cause d’un singe, les éboueurs écrivent des lettres d’absence,
Grâce à un singe, la ligne passagère a trouvé un sens,
À cause d’un singe, les étoiles de l’autre côté de la mémoire, perdent leur puissance,
À cause d’un singe, les battements du tableau vide perdent leur présence,
À cause d’un singe, ont eu lieu de nouvelles naissances,
La naissance des pères qui mangent leurs fils pour être des dieux forts
La naissance des menteurs qui ont des papiers qui prouvent que l’autre avait tort,
Que le chat ne marche pas à quatre pattes,
Que la terre est plate,
Que les étoiles n’existent pas, ce ne sont que des envahisseurs qui se préparent à une attaque,
Que l’homme pigeon sera mangé par un titan en fuite, à cause d’un maudit singe insomniaque,
À cause d’un singe, l’homme à cent têtes prend ce qu’il a offert,
Et Caïn tue à nouveau son frère,
Et l’homme corbeau tristement l’enterre,
Puis, l’homme dans le miroir cache l’indenté meurtrière.
Minable singe, minable monsieur à cigare,
Minable singe, minable monsieur sans mouchoir
Minable singe, minable dame enfermée dans sa cuisine,
Minable singe, minable dame en colère qui se libère et qui commit son crime.
A cause…
Grâce à… à cause…
À cause d’une fausse cause…
À cause d’un point, à cause d’une pause…
Grâce à une rose,
Offerte.
La chaise part et la porte d’en face est enfin ouverte,
Mais l’homme aux yeux crevés sait qu’il a tué il y a longtemps l’espoir,
Que la rose n’est qu’une utopie, qu’un beau cauchemar.
Grâce à un singe, une lâche réalité est venue à l’existence,
À cause d’un singe, le mangeur de foie humain, brûle les réponses,
Le mangeur d’âmes, de foi, d’os et de cœurs, brûle tout avec virulence,
Et l’oncle augmente le volume de la télévision,
L’oncle ne voudrait pas écouter son neveu, il ne voudrait ni voir son dessin ni sa vision.
Un mensonge est venu à l’existence,
Pendant que l’ombre d’un absent est flippé d’être seule avec sa conscience,
À cause d’un singe, l’oncle assit sur un canapé, mange ses vices,
Pendant que son neveu plante des cailloux,
Et la mémoire masquée n’est qu’une observatrice.
Khalid EL Morabethi,
Grâce à un singe, À cause d'un singe
2017
Grâce à un singe, À cause d'un singe
2017
Il n'y a plus personne
NOUVEAUTÉS
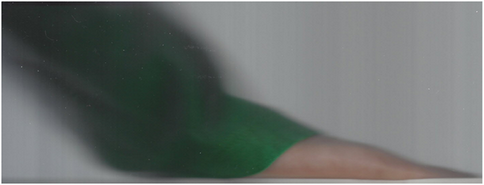
il n’y a plus personne
au lieu de l’objet posé sur l’étagère
j’ai vu le geste qui l’a posé
sans la personne
j’ai vu
précisément
le geste qui a posé le tube vert
quelconque
d’aspirine
posé sur l’étagère
anodine
objet anodin, geste anodin
je l’ai vu
le geste
sans la personne
« et pour qui voulez-vous qu’à présent je les brode
son bâton refleurit sur les bords du Jourdain
et tous les lys quand vos soldats ô roi Hérode
l’emmenèrent se sont flétris dans mon jardin »
l’objet
là
Maria Rantin, Il n'y a plus personne
Mini texte écrit pour le Lampadaire
2017
Mini texte écrit pour le Lampadaire
2017
criminelle expulsion de la vie de la planète ( expulsé dès "mes" 5 ans), chronique du chaos ordinaire // LA RÉVOLUTION DE LA TR SUR L MM, ANIMAL MINÉRAL VGTAL NE SONT PAS DES CRIMES !! / scroc 6tm s1dicopro /_ _écoloj tr à tr lecture et litrature rigolottes pas gay ni pagaie
bref extrait
NOUVEAUTÉS
_ _écoloj tr à tr lecture et litrature rigolottes pas gay ni pagaie
"sebso" rase la forêt de sivens tarn et tout ce qui va avec, de farce par la violenss, fachos socialos s'occupent pas non plus des majoritaires riverains contre le béton/pognon, profit d'une minorité du maïs intensif monoculture tueuse de sol fait aride fantôme bio-diversité, eau gâchée OGM se profile, profit surtout des actionnaires et gros bras gros 4x4 grosses machines "agricoles" énergivore "fnsea" (président en même temps PDG milliardaire d'une multinationale "agicole", engrais-chimic/pesticides climat au relent vichyste sied à la mafia <intégriste de la "constuction"> terres accaparées, néo-colonialisme, esclavage moderne, Pont de Buis, fifti-fifti, gros barrage de Sivens lâché pour un de demi volume pas plus justifié et aussi inutile et imposé...
-samedi 13-9-14 jour de repos 42 rue belleville paris20, chômage globale sévit, artisan bûcheron anonyme 1 dans l'arbre camionnette _<BZ 743 CC> 92_ adresse-téléphone-email ? bruit de meurtre à la tronçonneuse jusqu'à 19:30, soit moins 1 réservoir à CO2 ce dernier tue à paris/enfer, les belles volumineuses branches tombent chacune leur tour dans une minutieuse tuerie d'avérés minus, luxe de verdure du grand "élanthe" haut + de 5 étages, pour le bûcheron blond doré alcoolo camé -il fait aux pignouf mal branlées-és de l'ombre-, sans bâche poussière partout justice nulle part les pavés et les toits toutes choses alentours a changé de couleur, finit étourneaux moineaux (ce qu'il en reste), oiseaux de proies, pies, merles, nichaient corbeaux pigeons-ramier, -tuer 1 arbre concerne le quartier pas quƇ barbare "conseil syndical", s'il fait mode 40 rue belleville, petites mesquines professions d'imbéciles nés membres ne les font pas suer au travail !! la haine transpire par tous leurs pors ...
-coïncidence, pas vu depuis 1 bail certains sourire fiston et déchets ménagers, je vais vider poubelle organique à verte copro, à "sourrisseau" n'importe quoi y'est, a.schatzman entraînée boite de conserve fer à poubelle organique, ( POURQUOI SON ACHAT POUBELLE DE CUISINE DÉCHETS NON ORGANIQUES ? ) notant ceci, prix à la gorge mains invisibles, idem c'était pas vu depuis 1 bail, -dans "l'austin" pas tordu pour l'instant le cou pour le compte de la bête immonde
-des cynglées-és irrémédiablement perdu eau fracturation hydraulique, extraction bitumineux sables, fabrique nanos, product' nuc... milliards de tonnes et tonnes de CO2 perso innombrable mondial à véhicules automobiles va/revient du travail des areva-edf/sous-traitant-aiea-cea-asn... d'innombrables camions sillonnent france et monde transportent chooz radioactives, engins dont à chenilles, d'extraction non durable uranium thorium inconvénients durables... si mon eau usée est lavée elle est "re comestible", le papier dont hygiénique se refait pas arbre, barrage du Testet pour 22 du maïs -intensif- pointent leurs hideux nez les OGM : nous empoisonnent pour rouler à rolls-royce, nous font nous torcher l'anus avec ce qui reste de forêts, ils sodomisent minettes et minets huilées-és à l'huile de palme luxe... fichent en juçtiss ceux se serrant la ceinture restes puisant dans les poubelles supers-marchés (encore une sale chooz éparses or elle fonce droit vers sa généralisation), imagine des "voleurs" volent les ordures des supers-marchés manque à gagner de l'industrie gaz vert kaki produit à alimentaires "rebuts", la grande distrib' attend plus la date limite conso... -juçtiss PASSY sévère en majorité clémente avec ces exploiteurs pollueurs pillards des biens communs s'approprient vent eau je paie, de cette justice est "neraudau" elle ne sciera pas la branche pourri sur laquelle elle est assise, licencieuses et licencieurs vocifèrent créaSSion d'emplois alibi abiil grands projets travaux inutiles imposés, ça vole des mds sur le travail pas inquiétés par juçticss/poliss 1 petit peu sur le tas mis en examen ainsi va la médiacrassie la ondo/dictature 49.3 de la médiocratie en gouverne, soit ils font des super-marchés les super poubelles les milliardaires en examen et ceux l'étant pas + rare que le coltan, les collent en zonzon, leur font en manif' couper mains, nez, pieds, crever yeux, perdre la vie et puis quoi encore bande de nazes !! <<ils portent la responsabilité du colonialisme _françafric avec les "bolloré">> des attentats du 13-11-15 !! cnateurs avachis dorment dans les fauteuils du PDL, en débats gradins AN vident, cumulent ministres conseillers généraux y siègent plus, volent quand même les € etc ... ça fait mettre en GAV de ces gavées-és, perquisitionner, en examens, assigner à résidence, état d'urgence 3 mois manif' interdite encore + de mds volés (cqrit) laid 13-11-15 lettre à la poste, disent ; sinon ce serait pire ! organismes ONU/COP21 coût global armées/poliss/cqritr savent ? coût monstre, de quoi nourrir chaque terrien, déchéance de nationalité pour "valls" espagne fran-quiste ZAD quiste, "hollande" et sa corrèze tueuse...
Daniel René Villermet
Le gourou chantant
NOUVEAUTÉS
« Tes cafés Bruno… »
Le serveur pose deux minuscules tasses promotionnelles sur la table extérieure que Bruno a choisie. Loin. Isolée. Ça doit l'énerver, le serveur. Il faut qu'il accède en zigzaguant entre les chaises, plateau à bout de bras. Alors qu'il y a plein de tables disponibles plus proches du bar.
Un soleil aussi pâlot qu'une lampe de poche en fin de course nous surplombe.
Bruno m'a dit au téléphone : « Allez debout ! Il fait super beau, ça sent le début du printemps ! »
Tu parles.
Je déteste qu'on me scoutise au réveil, du style : "La vie appartient à celle qui se sort du lit tôt le matin ! Aime-toi, et la vie t'aimera ! "
« Alors Miss, on dit 11h ? »
Ma mère faisait ça quand j'étais enfant. Je n'avais qu'une envie, la pousser en arrière dans l'escalier.
Il y a un peu d’elle dans le ton de Bruno.
Au bout du fil, il attend ma réponse. Il sifflote.
Il la joue Monsieur Ricoré, l'ami du »petit déjeuner.
Je marmonne : « Plutôt 11h 30, 11h 45 »
Faut pas se laisser entamer.
En fait de jouir du premier jour du printemps à la terrasse d'un café parisien, nous sommes carrément installés au cœur d'un spot de particules fines et oxydes d’azote. Ça schlingue la mort. La mort affreuse, intubé de partout au pavillon des cancéreux, quand on supplie pour signer un putain de protocole de fin de vie.
Et ça caille.
C'est dans la cacophonie du carrefour République-Parmentier, en plein embouteillage de camionnettes de livraison furibondes et de scooters cocaïnés, carrément sous le nez du feu principal, que Bruno m'a filé rencard pour un café.
« Ici, c'est mon QG » il a plastroné. « Le gérant est un pote ».
Quand le serveur se redresse après avoir déposé les tasses, et entame un demi-tour sur lui-même pour s'éclipser, Bruno l'interpelle :
« Merci Fred. Tu peux me ramener du feu, steup ? »
Le Fred en question ne se retourne même pas.
« Steup" »
C'est étrange d'entendre un gars de 46 ans dire « Steup ». (Dans l'ordre de notre conversation initiée il y a quinze minutes, il vient juste de me dire son âge, sans se départir de ce demi-sourire qu'on conseille d’afficher en toutes circonstances, et surtout les plus humiliantes, dans les cours de méditation ayurvédique).
Certes, Bruno a l'air frais en surface, grand, délié. Ressorts, attaches et filins semblent tenir le coup dans la carcasse. Hormis les dents comme de vieux fusibles dans un compteur périmé, et les petites lunettes rondes d'aboyeur de l'Internationale au congrès annuel du NPA, look Trotsky de chez Optique 2000, le mec a un petit côté godelureau.
De là à dire « Steup »...
En tout cas, Bruno est raccord avec le quartier.
Le 11ème arrondissement de Paris, c'est une pépinière de néobourgeois hi-tech adulescents. Ça pousse comme le chiendent. Sociologues, planeurs stratégiques, curateurs d'expos sauvages en appartements, architectes-designeuses spécialistes des surfaces atypiques, consultants en communication éthique, coachs développeurs de potentiels, infographistes en auto-entreprise, community managers, documentaristes pour Arte, artistes performeurs intermittents en coloc... Et bien sûr, journalistes digitaux, sans qui toute cette smala n'aurait aucune e-visibilité.
La gentrification, c'est la sclérose en plaque qui s'abat sur la ville, rue après rue, y' a qu'à suivre les réseaux du Vélib.
Bien entendu, tout ça bouffe bio, et accouche par césarienne des gosses prémat' à la clinique des Bluets.
Dans cet ancien quartier populaire, les plus déclassés sont partis. Chômeurs, jeunes couples à qui on refuse un prêt immobilier malgré deux salaires, ou juste ceux qui ne peuvent plus dépenser 250 euros par mois pour un parking. Ils ont résisté jusqu'en 2008. Après c'était plus tenable. Ils sont en grande banlieue « verte et durable ». À une heure de Châtelet-les Halles en RER qui pue l’égout, c’est le Pays du Bonheur des T3 abordables, bases de loisirs, co-voiturage et crèches coopératives.
Faut être honnête, à part les dimanches de vide-greniers, les bobos, on les voit pas beaucoup flâner dans les rues. Ils sont surbookés. Ils en chient. Limite burn-out chronique pour payer les loyers éléphantesques et les légumes sans pesticides des gosses. Mais on voit leurs nounous. Quasiment que des blacks.
De grosses et solides blacks aux commandes de poussettes supersoniques avec freins à disques, amortisseurs à bain d'huile, plus une marche arrière. Manque plus que l'alarme anti-enlèvement.
Les nounous se déplacent en escouades. Elles retrouvent les copines au square, une fois débarrassées de la patronne survoltée qui allume sa première clope à 7h30 et réajuste son maquillage en attendant l'ascenseur.
« Fatou, vous seriez assez gentille pour passer vite fait au Biocoop en allant chercher Maëlys à la crèche ? J'ai plus de barres coupe-faim sans gluten, vous savez celles aux fruits rouges ? »
« Je vous ai mis 50 euros dans l'entrée. Ah, tant qu'on y est...Vous pouvez me prendre mes escarpins chez le cordonnier ? Ça m'sauve la vie, c'est adorable...»
Aux heures de pointe, on croise des convois tapageurs. Les nounous s'interpellent en dialecte, balancent les bras dans les airs et rigolent fort en se tapant les cuisses. Les gosses comatent, ou pleurent carrément, dans l'indifférence générale.
Y' en a qui trimbalent pas moins de quatre bambins tête bêche bien ficelés dans leurs attelages à gosses aussi sophistiqués que des navettes Discovery. Dans le froid humide du petit matin, les chérubins bouffis de sommeil, semblent déjà écrasés par le planning de la journée. Teint vitreux comme du plexiglas, muets de stupeur au ras du bitume, un bonnet brutalement enfoncé jusqu'aux yeux, doudou équitable sur les genoux. Ils s'accrochent au bastingage avec leurs petites mimines de futurs blancs becs polyamoureux, deux fois par semaine chez le psy depuis leur dixième année, allergiques à tout. Des crève-cœur.
Tout juste largués à la crèche privée du coin de la rue, ils se feront déshabiller prestement par une conne qui pue la clope et le café « Comment elle va ce matin Apolline ? Encore ce nez qui coule ? ».
Cette pétasse en stage, survoltée parce qu'elle vient d'avoir un diplôme de puéricultrice, fera toute la journée du zèle pour obtenir un CDI. Elle commencera par leur enfoncer du musli dans le bec avec un jus de pomme, et leur pètera les burnes avec ses jeux d'éveil au genre, à la différence, aux langues étrangères. Elle finira de flinguer leur journée en leur apprenant à mettre leurs chaussures à velcros tous seuls.
« Valentin s'est trompé de pieds ! Oh noooooon ! Y 'a ses chaussures qui louchent. Qu’est-ce qu'on dit à Valentin ? hein Zoé ? On lui dit « Il faut mettre le bon pied dans la bonne chaussure, sinon ouyouyouye les doigts de pieds, ils sont très malheureux ! »
Moi je comprends que ces pauvres couilles commencent à fumer des sticks à 13 ans.
Fred, le serveur, a disparu à l'horizon. M'est avis qu'il n'est pas près de revenir.
Bruno m’envisage d'un air cloche en touillant son café. « Tu manges pas ton Spéculos ? » Je lui tends le petit biscuit sous plastique.
Bruno a la tête affable du mec qui est sûr que c'est dans la poche. Juste une question de temps. Faut pas se précipiter sur la bête.
Il a adopté la « Quand tu veux ma grande » attitude. Bon prince.
Quand on va parler cul, parce qu'on va parler cul, sous peu je pense, Bruno dira très exactement que le secret dans le sexe, c'est que l'homme sache maîtriser ses éjaculations pour donner le maximum de plaisir à « la femme ».
Il va dire ça. C'est écrit sur sa tronche.
L'acmé de la discussion avec un type qui se croit féministe, c'est quand il évoque le clitoris. Votre clitoris. Grand moment ça. Clito, respect de la femme et baise tantrique sans pénétration. Moi, pourvu qu'on me gonfle pas trop avec des délires de « Bourgeon sacré » ou « Bouton de Rose », je laisse pisser. Enfin, on en est pas encore là. J'ai le temps de prendre un deuxième café.
Bruno allonge ses longues jambes, roule tranquillement sa prochaine cigarette et entreprend de me parler de lui.
Tous les matins, il vient à la terrasse chauffée l'hiver et brumisée l'été de ce café de l'est parisien, pour lire Libé papier, qu'il va chiper au comptoir.
Il habite à deux cent mètres. Mes premières impressions me portent à penser, vu ses horaires très souples, qu'il est sans emploi ou pire, « artiste ».
« Je suis permanent dans un syndicat. L'imprimerie. »
« Vous êtes en grève aujourd’hui ? » je dis en rigolant.
« Non, je bosse. Je vais décoller vers quatorze heures, par là. Avec les copains on s'arrange. » Bruno n’a pas d’humour.
Le serveur opère des cercles autour de notre table en nous évitant soigneusement. Mais quand Bruno agite ses longs bras au-dessus de sa tête, difficile de ne pas le voir. Fred n'approche pas pour autant, carrément hostile. De loin, il relève le menton pour signifier qu'il attend un ordre. Bruno fait alors un tour complet avec une main au-dessus des tasses, l'index pointé. Un « Tu nous remets ça » que Fred, en pro de la signalétique muette des piliers de bar, interprète parfaitement.
Bruno fait un bon mètre 90. Visage imberbe, jambes et mains interminables. Comme souvent chez les grands, sa voix est grave. Ses gestes sont lents. Son érudition aussi. Il écoute. Avec un air appliqué qui signifie « Tu noteras que je sais écouter. Je maîtrise ma présence à l'autre. »
Ce truc de bonze... Moi ça m'irrite.
Je préfère les gens qui coupent la parole, renversent le cendrier, transpirent, partent à fond la caisse, une clope à la main, dans une idée qu'ils déroulent comme s'ils descendaient une piste noire et calent tout d'un coup « Merde...Je sais plus ce que je voulais dire... »
Bruno passe son temps à rouler des cigarettes entre ses longs doigts fins. Comme s'il égrenait un chapelet. Ensuite il les range dans une blague à tabac en cuir.
« Elle est belle hein ? C’est un chamane sibérien qui m'en a fait cadeau. J'y tiens. C'est du caribou. De la toundra. »
Il a étalé son matos sur la table. D'abord il pioche dans un petit sachet en plastique et en ressort un filtre qu'il insère prestement entre ses lèvres.
« Et donc, tu écris deux romans en même temps ? » il demande.
Ensuite il plonge à nouveau dans sa blague en caribou pour une pincée de tabac. De l'autre main, il dégage une feuille de papier d'un petit paquet bleu ciel. Il pose sa pincée de tabac sur la feuille de papier incurvée et l'étire brin à brin, sans précipitation aucune, jusqu'à obtenir un tube parfait, le philtre toujours coincé entre les lèvres.
Cette lenteur est particulièrement éprouvante.
De temps en temps il relève la tête et me dévisage avec bonhomie en plissant les yeux, pour m'encourager sans doute à me confier. Je parie qu'il me trouve coincée.
« Non trois. J'ai commencé trois romans il y a environ cinq ans. Il faut que je les termine mais comme je te disais, là, j'écris un scénario sur ...»
« Un scénario ? Super ça ! Sur quoi ? »
Bruno vient d'attraper le philtre qu'il avait entre les lèvres et l'installe expertement au bout de son filin de tabac. Puis il roule le tout dans le papier avec gourmandise, porte la cigarette à la bouche et d'un coup de langue, mouille la fine partie encollée du papier. Putain ça y est. Eh ben. Heureusement que le mec a des horaires de travail souples.
« T'as déjà pris des champis ? »
« Des quoi ? »
« Des champignons hallucinogènes. »
« Jamais. J'ai la tête d'une fille qui prend des champignons ? »
« Tu me fais penser à une ex. Physiquement. Laurence. Une brune nerveuse comme toi, avec des grands yeux. On faisait des super voyages astraux. »
Bruno allume une roulée. « Avec d'autres copines ça marchait pas, mais elle, je te dis pas. Elle ascensionnait vachement bien. Hypra-sensible au corps astral des autres, c'est avec elle que j'ai rencontré mon animal totem pour la première fois. Le lynx. »
Tout est exploitable dans la drague. Y' a le gus qui écume les piscines pour repérer les obsédées de la cellulite. Celui qui arpente les rayons de bibliothèque un doigt dans le nez. L'esthète fooding qui se les gèlent chez Picard « Tiens moi aussi j'adore leur tarte citron ! Ça nous fait au moins un point commun... » Y' a le pilier du cours de danses latines, truffé de célibataires en panique qui donneraient cher pour la trouver, cette putain d'énergie kundalini dont on parle tant dans les blogs bien-être.
« Une énergie sexuelle considérable nichée au cœur de votre sacrum...» La belle affaire. Dans ce coin là, à part les hémorroïdes, la plupart ressentent pas grand-chose.
Bruno lui, s'est lancé dans le voyage astral.
Il enchaine :
« Avec Laurence, on s'est fait un trip au Mexique. En plein désert, on a pris du peyolt. J'ai eu des nausées pendant deux heures, mais Laurence elle était carrément en bad trip. Trois jours à vomir ! À part ça, gros délire...»
Puis il me décrit les couleurs fluorescentes de la nuit dans le désert, les cactus qui avancent vers toi en dansant le pogo, les geckos qui te parlent en se grattant le bide dans une langue inconnue, mais que tu comprends très bien, et même la divinité aztèque qui te dit qu'elle est ton ancêtre.
C'est bon Bruno, laisse tomber.
Je commence à me faire copieusement chier, et envisage de le planter là. Quand il évoque son maître chamane. Ça relance mon intérêt. Du coup, je me commande un verre de pif.
Son chamane, c'est un suisse qui s'est fait plein de fric en bossant dans le pétrole. Extraction sur plates-formes au Canada. Maintenant, il fait initiation au chamanisme. Stages niveaux 1, 2 et 3. C'est pas les mêmes tarifs. Un bon business on dirait. Pas besoin de chercher le client. Des listes d'attente de citadins à cran qui tiennent mordicus à rencontrer leur animal totem, transportés par le rythme hypnotique des tambours frappés par les autres stagiaires.
Je sens bien que Bruno, les corps en sueur sous la yourte, il adore.
C'est son kif d'accompagner des cheffes de produit de chez Orange, boulottes aux joues écarlates et cheveux collés au front, vers la transe. Elles donnent tout pour rencontrer le sanglier sacré au milieu du cercle magique.
« Une fois que tu l'as rencontré ton animal totem, il se passe quoi ? » je demande.
« C'est le chamane qui parle avec l'animal totem qui a pris possession de toi, en fait. Ça peut être violent si ton animal est belliqueux... C'est fort le moment où tout le groupe lâche prise.»
J'imagine très bien.
Une soirée de cadres sup maraboutés sous une tente en peau de bique qui pue la transpi, et la bique. Quinze gugusses qui ont fumé la moquette, bave au coin des lèvres, frappant sur des tambours. En peau de bique. C'est sûr, c'est plus sexy qu'un abonnement UGC. « On chante aussi » il dit. « Les chants chamaniques c'est de la vibration profonde. Le but c'est de ressentir les ondes énergétiques. Ça doit venir de là. »
Ce con me met quasiment la main sur la chatte.
« C'est le chakra qui se réveille quand tu chantes avec le ventre...C'est des chants très anciens, en sibérien sacré.»
« Vas-y, chante-moi un truc » je rétorque, histoire qu’il vire sa main de mon ventre.
Voilà que le gonze entame d'un filet de voix vilain comme tout ce qui doit être un des chants sacrés qu'il a appris en stage. Il capte mon air soupçonneux.
« Non mais là, j'ai pas travaillé la voix...Tu peux pas te rendre compte. C'est en apprenant ce chant que j'ai rencontré Céline, ma femme. »
« Ah ouais, marié ? »
« Séparé. Mais on s'entend très bien. On a eu un fils, Tim. Il a 17 ans. Il vit avec moi. »
Bruno a récupéré la garde de son fiston par décision du tribunal, quand celui-ci avait à peine six ans.
Faut dire que son ex, Céline, à l'époque du divorce, elle était à coté de ses pompes. Elle multipliait les stages de panchakarma (purification) dans un ashram en Ardèche, chez une gourou appelée «Mamalove».
Mamalove avait hérité par legs de l'immense propriété ardéchoise d'un anglais multimétastasé en phase terminale.
Jusqu'au bout, Mamalove organisait des séances de méditation autour du presque cadavre de l'angliche et lui imposait les mains pour guérir le cancer. Mais bon, impositions, prières collectives et tisanes bios ne sont pas venues à bout des récidives du subclaquant. Le roastbeef a fini par passer de l'autre côté du fleuve sans trop se rendre compte mais, heureusement, après avoir signé les papiers du notaire. Il a eu droit à de belles funérailles avec chants, crécelles et jets de fleurs, au milieu de son ex-propriété plantée d'arbres centenaires, piscine et cave à vin voûtée du 18ème siècle, transformée en salle de méditation.
Propriété dont Mamalove a fait le siège du « Centre de Lumière et de Ressourcement » qu'elle dirige, qui a beaucoup de succès auprès de femmes seules, un peu dépressives ou bipolaires comme Céline. Ça fait un sacré pacson de bonnes femmes.
Épaulée par une dizaine d'assistants zélés en sari qui la saluent chaque matin en se mettant à genoux devant elle, Mamalove tient le business de manière pragmatique. Stages en tous genres : relaxation, méditation, guérison par imposition des mains, (oups), massages en groupe, interprétation des rêves et touti quanti. Si ça fait pas de bien, ça peut pas faire de mal, comme disait ma grand-mère.
Le site web multi-langues marche très fort. Surtout l'e-shop : essences purificatrices et encens, saris bénis par Mamalove, tous ses ouvrages.
Mamalove est une gourou sympatoche, toujours de bonne humeur.
Elle passe sa vie dans des avions pour embrasser, dans des stades blindés, des files ininterrompus de fans qui accèdent à elle munis d'un ticket, comme chez Pôle Emploi. Tu veux ton hug de Mamalove ? Tu prends ton ticket, on t'appellera. Les adeptes sont parqués en cohortes dans les stades, et franchement c'est efficace, c'est gendarmé. Mamalove reçoit les cohortes les unes après les autres, sur une estrade, musique tibétaine à fond. Tout le monde a droit à quelques secondes d'étreinte personnalisée.
Les séances de hug provoquent parfois des réactions un peu extravagantes parmi le public, mais bon. C'est comme les prêches des pentecôtistes le dimanche. Si y' a pas une grosse dondon en chapeau qui part en wilde et se roule par terre, les yeux exorbités, c'est tout de suite moins convaincant. Faut que ça s'égosille. Faut qu'ça tombe dans les vapes.
Céline, elle a rencontré Mamalove au Parc des Princes.
Elle dit que l'étreinte de la gourou lui a déclenché une énorme diarrhée spasmique qui a libéré ses chakras coincés. Un dérangement de tuyauterie quoi.
Après ça, elle pratiquait tous les soirs des séances de méditation pour accéder à un niveau supérieur de conscience. Elle s'était mis la grosse pression. Elle faisait tout son possible pour passer en classe supérieure de conscience en quelque sorte, mais c'était pas évident. Coté zénitude, Céline, elle avait pas le niveau.
Elle ne bouffait plus que des graines germées et s'envoyait des bols d'eau chaude dans lesquels elle ajoutait une demi-cuillère à café de soufre, pour renforcer l'immunité. Au réveil, à jeun.
« L'eau chaude, ça draine toutes les toxines » qu'elle disait. « Mamalove en boit un bol tous les matins. Et si tu manges une mangue fraîche, tu peux soigner un cancer de l'œsophage...»
Bruno, qui était plutôt Carlsberg, Bâton de Berger et pizzas Hut, finit par baisser les bras. Il rentrait de plus en plus tard.
Il se rallume une roulée.
« De toute façon, chez Céline, j'ai vite senti un truc zarbi… » dit Bruno.
Pour lui, le stage de transfert d'âme où ils se sont rencontrés, c’était juste l’occase de croiser des gonzesses cool, prêtes à ouvrir leurs mignons chakras. Y' en a toujours. Il s’est dégoté Céline.
La tuile, c'est quand elle est tombée enceinte de Tim.
Elle a replongé dans une dépression, direct en arrêt maladie. La voilà repartie en Ardèche, chez Mamalove pour terminer sa grossesse.
Y' a toujours de quoi s'occuper à la ferme bio où les résidents de l'ashram font venir sans gestes brusques et sans viol pesticidiste, mais avec tous leurs rejets organiques, des choux, des poix et de la patate. Mais pas de laitues, y' a trop de limaces à déplacer.
Céline appelait régulièrement pour donner à Bruno des nouvelles de son gros ventre.
«J'ai eu un nouvel entretien avec Mamalove ce matin. Elle m'a dit des choses sur mon thème karmique. Je peux pas travailler. Pour un salaire. C'est dans mon rapport à l'argent. C'est toxique pour mon karma.
»Un autre soir, alors que Bruno demande «Ouais mais tu rentres quand ?» elle se crispe.
« Il faut que ma grossesse se déroule sans que personne me foute la pression Bruno... Mamalove dit que j'ai besoin d'un entourage bienveillant pour rétablir mes équilibres vitaux complètement détraqués et transmettre de bons messages à l'enfant...»
Bruno avait raccroché vite fait parce qu'il avait un cours de tango et qu'il était déjà pas en avance.
Timothée est né dans une baignoire comme un bienheureux. Entouré de gens confis de présence attentive et aimante, petites bougies et senteurs délicates. Tout s'est bien passé. Bruno n'était pas invité pour l'accouchement, mais ça l'arrangeait plutôt. La musique sacrée tibétaine à longueur de journée, il avait sa dose.
Céline passait de plus en plus de temps en Ardèche. Un soir, elle appelle à nouveau : « J'ai un nouveau compagnon. Il s'appelle Tibère. Et je voudrais qu'on divorce.»
Il avait un peu tiqué tout de même.
«Et le gosse ? Il va participer ton mec là, Bébert? »
« Tibère... Écoute Bruno, commence pas à décharger ton agressivité sur moi. En plus, je te trouve intrusif dans mon espace privé. Tibère c'est pas "mon mec", c'est mon compagnon de vie, et il te respecte, lui, en tant que géniteur. Je vais donner mon temps et mon énergie au Centre, c'est ça qui compte, tu vois... Dans la vie, on peut faire les choses gratuitement sans rentrer forcément dans un rapport marchand Bruno... Bref...Laisse tomber...Non, ça tu peux pas comprendre...»
Elle commençait une fois de plus à s' engatser toute seule.
Le bon côté, c'est que Tim a grandi à la campagne jusqu'à ses 6 ans. Jusqu'à ce que Céline parte en Inde avec Tibère, le spécialiste des toilettes sèches. Bruno est allé récupérer le minot en Ardèche.
Au « Centre de Lumière et de Ressourcement » on l'a bien accueilli. Y' a rien à dire. Tim était en forme avec de bonnes joues de gosse qui prend le vent et le soleil.
Au moment de repartir à Paris avec le fiston un peu désemparé, Céline l'a pris à part.
« Dis à mon fils qu'on se retrouvera plus tard moi et lui, j'en suis sûre. Il faut que tu lui expliques que je ne suis que sa mère bio, rien de plus. Quand Mamalove m'a expliqué ça, tu peux pas savoir le bien que ça m'a fait. Un poids énorme a disparu...Dis-lui que j'ai fait la paix avec moi-même, et que je suis désormais très heureuse ici, avec ma famille de cœur.»
Ben merde... Un peu raide d'expliquer ça à un gamin de 6 ans sur l'autoroute.
Il savait pas comment s'y prendre, alors il avait mis Janis Joplin à fond.
«Summertiiiime ! » Le minot s'était endormi recta.
Quelques mois après avoir rencontré Bruno, je suis amenée à descendre dans le sud en voiture, et il me propose de faire un détour par Saillans, dans la Drôme, avant de reprendre vers Montpellier.
« Fais un petit crochet ! Mon stage ne commence qu'après demain. »
Bruno se tape son stage annuel de yoga et éveil des points karmiques. Ça s'appelle « Créer son puits d'inspiration ».
Au téléphone, il m'explique que Céline, qui a découvert tardivement sa bisexualité, habite désormais le village de Saillans avec une nénette, Chantal, laquelle a eu un enfant de Tibère il y a 2 ans. Une petite fille prénommée Uma qu'ils élèvent tous les trois.
«Les filles m'ont invité à prendre l'apéro, t'as qu'à venir, tu verras elles sont rigolotes.»
« L'apéro avant de refaire deux heures d'autoroute ?»
« T'inquiète, c'est un apéro sans alcool ! » il me dit.
Un apéro sans alcool avec des filles quadras babalesbiches en trouple «rigolotes», et un gosse en bas âge, j'ai un doute.
Mais j'accepte.
Ça me fera une pose.
J'ai rendez-vous en fin d’après-midi avec Bruno sur la place de l'église romane de Saillans, village en pierre aux ruelles si étroites que l'on touche les murs des maisons des deux cotés en étendant les bras.
Je m'appuie contre le capot de la voiture, face au soleil d’été.
De l'autre côté de la rivière Drôme, se dresse, impérial, le domaine des 3 Becs, dentelle de crêtes et cols à 3 pics, surplombant une vertigineuse paroi préalpine aussi large que haute, quasiment lisse, qui écrase le paysage.
Ici la varap, mon pote, c'est pas pour les manchots.
Les mauvaises langues disent que Saillans c'est le village des fumeurs de chichons. Les « têtes à poux » comme dit la droite chasse et pêche, virée de la mairie aux dernières élections par une sorte de comité sans hiérarchie de babos improbables.
La chaleur monte du macadam gondolé. Un parquet chauffant.
Un chat moitié roux et blanc avec un œil crevé se love dans une flaque de soleil pour récupérer sur ses bajoues un peu de goudron ramolli, comme un vieux malabar.
Bruno déboule.
Sapé autochtone. Sweat à capuche, un treillis coupé grossièrement sous les genoux et surtout, une paire de ces énormes sandales claque-bouses outdoor.
Comment un type peut-il croire une seule seconde qu'il est fréquentable, chaussé de porte-containers imputrescibles autour de pieds blancs, poilus, cornus, épatés, incarnés, jamais sortis de leur boite pendant 11 mois ? Mystère de la masculinité.
Y' a plein de manières d'être borderline pour un mec : bide comme un ballon de basket au-dessus de la ceinture, cul en forme de sac à dos vide, jambes courtes, torves, mollets comme des jambons, poils dans le nez, les oreilles, sur les épaules, poils dans le dos. Mais une belle paire de pieds peut éventuellement sauver la mise.
Bruno s'approche coudes collés aux aisselles, mains jointes devant lui, il roule sa quarantième cigarette de la journée.
Il fredonne. Toujours le même chant sibérien.
« T'as trouvé facilement ? Moi je plane. Je sors d'une séance de massage shiatsu au centre culturel. »
Je le suis dans une ruelle sombre. Des chats indolents nous toisent, allongés sur les rebords des fenêtres ouvertes à hauteur d'homme. Bonjour l'intimité. Vivre dans un village, c'est comme vivre toute l'année en camping. En somme, Paris s'est peuplée avec des provinciaux qui cherchaient l'anonymat.
Bruno pousse une vieille porte en bois. « C'est tout en haut.» Nous montons un magnifique escalier de pierre en colimaçon. Au dernier étage de la musique indienne, une voix d'homme chante des phrases reprisent par un chœur. Ça sent l'encens.
Une nana entre 40 et 45 ans nous accueille. Visage sec, angoissé. Ses cheveux gris sont tirés en arrière dans un chignon vague. Elle me regarde à peine, elle ne nous sourit pas. «Salut... T'es pas en avance Bruno... Tu sais qu'on couche la petite à 18H30 ? »
Je le sentais qu'on allait se bidonner.
Comme ce con de Bruno ne fait pas les présentations, je tends franchement la main. La fille est un peu surprise, elle me répond « Céline.»
C'est donc la fameuse. Elle me prend pour une petite amie de Bruno. Lèvres fines tombant de chaque côté de la bouche, cette femme a l'air dépité. Elle porte une robe longue jusqu'aux chevilles, qui fait ressortir sa maigreur.
« Faut enlever les chaussures » dit-elle en nous précédant dans un long couloir.
Nous débouchons dans un vaste grenier dont la charpente à 10 mètres au-dessus de nous, est impressionnante. De vieux tapis sont posés çà et là.
Au centre de la pièce, assise jambes allongées devant elle, appliquée à dessiner, une petite fille nue d'environ 2 ans. On lui a coupé la frange au ras supérieur du front en laissant les cheveux derrière mais en rasant quasiment jusqu'à la peau sur les côtés.
Elle nous regarde fixement sans aucune décontenance, et se replonge dans son dessin. Un vigoureux claquement d'ailes me fait lever la tête. Une dizaine de pigeons gras semblent nicher dans cette charpente accueillante, sans qu'on les emmerde.
On débouche côté opposé sur un magnifique jardin intérieur entouré des murs en pierre des bâtisses adjacentes. Le cliché dont rêve Arts & Décoration.
C'est l'heure où un ultime rai de lumière s'immisce en biais dans ce puits verdoyant. Un vieux canapé sur un bout de gazon frais, une petite table sur une roue de charrette, un muret sur lequel sont plantées en ligne des plantes aromatiques.
Une autre femme se tient là et nous accueille. Même silhouette, même âge et même visage que Céline. On pourrait presque les confondre. Mais plus sympa. Au moins sourit-elle en nous voyant :
« Chantal, salut...»
« Tu viens de Paris ? 11eme ? J'habitais dans le 10, sur le canal. Je n'y retournerai pour rien au monde. »
Céline réapparait avec un plateau sur lequel il y a un pichet en terre, quatre verres en terre, un saladier plein d'un truc noirâtre et de petits pots dans lesquels je reconnais au moins des olives noires de Nyons.
Elle nous propose sa citronnade maison. Bah, on dit oui.
« Je mets pas beaucoup de sucre.»
En réalité, elle en met pas du tout, la garce.
L'enfant apparaît à son tour. Elle vient sur les genoux de Chantal, sa mère, qui lui fait une tartine de ce gruau noirâtre sur une tranche de galette de riz soufflé. Chantal me dit « Tu veux goûter ? C'est un mélange de pruneaux, graines de tournesol et jus de sureau...» Bordel.
Une 1664 bien fraîche et trois chips, pour un apéro, c'est quand même plus humain, non ? Je décline.
La gamine me tend son noyau de pruneau. Je dis « Merci poussin !»
Simultanément, les visages des deux bonnes femmes se tournent vers moi et je sens un méchant courant d'air froid. Chantal dans un demi sourire forcé : «Poussin ... Tiens... On te l'avait jamais faite celle-là...»
La môme Uma, elle s'en fout carrément. C'est bien la première fois que j'ai l'impression d'avoir dit «Merci vieille crevure !» à un enfant en lui disant «Merci poussin ».
J'ai dans l'idée que les deux mousmés du trouple et moi, faudrait pas trop qu'on cause éducatif. Pour ma punition, je me tape une nouvelle rasade de citronnade maison.
Finalement, Céline a claqué la porte du Centre de Ressourcement de Mamalove. Elle se sentait exploitée. C'te blague. Elle est devenue clown pour les enfants malades à l’hosto de Valence, et elle touche le RSA. Elle me dit d'un ton lugubre :
« Je suis en train de monter un stage avec les services sociaux : «Trouve le clown qui est en toi ».
Ben mon vieux. On se fend la poire en province. Ça fait envie.
Bruno est ailleurs. Il se gave de cake fenouil soja.
Je tourne la tête pour demander à Chantal ce qu'elle fait, elle, comme boulot, quand je tombe sur la gosse installée dans ses bras, en train de lui téter un nichon aussi décati qu'une vieille figue explosée sur le bitume. Putain de choc. C'est quoi ce binz ?
Mais qu'est-ce qu'elles ont dans la tronche à la fin, ces nénettes spasmophiles, terrifiées par le virus H5N1 ou un choc avec un astéroïde, shootées à la tisane détoxifiante et aux benzodiazépines, à pondre des gosses à la quarantaine ?
Elles leurs refilent des prénoms de divinités hindoues et les font téter leur pauvre jus de vieille, jusqu'à ce que les mioches entrent en 6ème.
Zut quoi !
«Je vais reprendre la route...» je dis à Bruno.
On s'embrasse pas. Je lâche un «Bye bye poussin !» sonore à l'enfant qui tire sur le nichon de sa daronne avec les dents, mais me gratifie d'une large sourire, et je décampe.
Je mets Rire & Chansons à fond et attrape l'autoroute à Loriol. Il est 20h. Il fait encore 39 degrés.
Louise Fonte, Le gourou chantant
juillet 2016
juillet 2016
Le silure
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Le silure lucifuge
Attend. Tous les silures
Sont lucifuges
Et attendent
Tapis dans la mousaille blonde
Et les gloues luxuriantes
Le silure maintenu
Entre l’onde et l’onde
Comme une suspensive
Solitaire et oblongue
Les yeux révulsent et valsent
Le reste paraît mort
Le silure lucifuge
A faim. Car les silures
Sont lucifuges
Et ont faim de
Tout ce qui vivant se glisse
Entre barbillons et poignards
Le silure
Mon silure
Mure
Mur
Moi
Valère Kaletka
2017
Schismatique
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
C’est poly-schismatique
Dans ma tête
Ressacs de confusions brumeuses
Un peu à l’Ouest au Nord au Sud à l’Est
Quatre chevaux en place de Grève
Chaque bras partira
à l’opposé d’une jambe
C’est poly-schismatique
Dans ma tête
Un bon tiers de génie
Un tiers de vacuité profonde
Entre un tiers de no man’s land
Électrifié – tu peux compter, l’ami
Ça fait toujours qu’un Tout normal
Et perturbé
C’est poly-schismatique
Dans ma tête
À tendance hérétique
Gavé comme une oie sombre
Devant la télé
Valère Kaletka
2017
Larmes
NOUVEAUTÉS
Des gens pleuraient hier soir, le long de l’avenue. Un homme et une femme. Ils pleuraient ensemble sans se regarder, marchant l’un à côté de l’autre. Je les ai vus. Je les ai croisés en rentrant. D’abord ses larmes à elle qui coulaient de ses yeux, qui formaient des flaques de maquillage noir sous les cils. Au premier regard, j’ai cru qu’ils s’agissaient d’hématomes et j’ai eu peur pour elle. Mais comme les marques brillaient, comme ses yeux brillaient, j’ai compris que c’était des larmes. Des larmes silencieuses sur son visage baissé. En me tournant vers l’homme, pour voir sa réaction, parce qu’on ne marche pas si facilement à côté de quelqu’un qui pleure, j’ai vu son visage à lui. Il était humide aussi. Ses larmes coulaient plus abondamment, venant se cacher dans sa barbe. Elle scintillait par endroits sur les côtés de son nez. Ils pleuraient en même temps. Ils pleuraient tous les deux. Depuis que j’avais quitté le métro et regagné la surface, je n’avais croisé personne sur le chemin. Pas un passant ni une voiture. Cela arrivait parfois, dans ce quartier-là de Paris. Je n’avais croisé personne jusqu’à ce couple en pleurs. En les dépassant, je n’ai pas osé me retourner même si je le voulais. Je voulais les voir encore et tenter de savoir. Pour quelles raisons pleuraient-ils en même temps, au milieu de la nuit ? Je continuai à marcher seule, encore plusieurs minutes avant d’atteindre ma rue. Je marchais seule et je me demandais s’il fallait toujours une raison pour pleurer. Si l’on ne pouvait pas simplement pleurer en silence, à l’air frais de l’avenue déserte. C’est vrai que j’en avais envie désormais. Pleurer d’avoir vu pleurer. Cela ne vint pas. Mais juste avant l’entrée de mon immeuble, je m’aperçus que toute la ville, cette nuit, avait une allure vide et triste. Les pleureurs avaient-ils transmis leur peine à la ville ? Ou bien, était-ce l’inverse ? (cette obsession de croire à la connexion de toutes choses.) Je m’apprêtais à composer le digicode et me retournai encore une fois vers la rue. Une dernière fois avant d’aller dormir. Les faisceaux des lampadaires s’étiraient sur un mètre, formant des lignes de lumière autour des ampoules. Comme des larmes. J’ai trouvé que c’était beau. Beau et discret. Les lampadaires pleuraient.
Pauline Moussours
Larmes, texte écrit pour Le Lampadaire, 2018
Larmes, texte écrit pour Le Lampadaire, 2018
Perdu
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Enfin il est en vacances. Il veut fuir la ville, la perceuse qui réveille, le dimanche, à sept heures du matin, les voitures qui pilent au feu rouge et puis, rageuses, accélèrent avec de grands crissements de pneus, la chaussée inlassablement forée au marteau piqueur, les cris du voisin à chaque fois qu’un but est marqué… Sans oublier les alertes à la pollution, à l’ozone, aux particules fines, au souffre, à l’azote ou aux œufs pourris. Vaquer, c’est fuir le bitume anthracite pour la vague argentée ou l’herbe grasse du pré, c’est fuir le square prisonnier pour la pénombre de la forêt où les arbres se racontent des histoires qui se répandent poussés par le vent, fuir pour retrouver le lombric qui se tortille pour faire l’humus. Ne plus compter les heures et partir là où l’on n’est pas.
Il prend une carte routière de France. C’est beau une carte, c’est coloré et sur quelques centimètres carrés vous avez le monde, ça défit la physique, en un seul coup d’œil vous voyez à l’autre bout de la terre. La légende montre des signes, des traits de couleur, des figures en étoiles, des triangles bleus qui tournent dans tous les sens comme affolés par tout ce qu’il y a à dire. Ce sont des runes à déchiffrer pour comprendre le mystère qui se cache derrière les apparences. Les routes sont rouges, jaunes, parfois rouges et jaunes, ou encore blanches et vous mènent quelque part au nom noir plein de parfums. Un trait fin et ce sont les chemins vicinaux qui entraînent dans des hameaux inconnus toujours circulaires et blanc comme le lever du jour. C’est une immense toile d’araignée qui capte et mobilise l’imagination. Je suis là et ailleurs. La mer bleue s’étale sans une vague comme un ciel d’été sans nuage, toujours au beau fixe. Les côtes déchiquetées sont des papiers déchirés pour on ne sait quel collage ou encore la dorsale d’un dragon en colère. Gris, peut-être un peu ivres, les monts serpentent et entourent des plaines blanches ou vertes comme dans un jeu de go. J’en connais qui préfèrent ces cartes aux estampes et aux tableaux.
Il prend une carte routière de France et la plie en deux. Il ne faut pas tout laisser au hasard quand même. Il n’a aucun goût pour le crachin et préfère les bastides aux corons, le mont blanc aux terrils, la garrigue aux rias. Ce n’est pas être une langue de vipère que de dire qu’il préfère que les rayons lui arrivent en ligne droite plutôt que filtrés par les nuages. Le dardant est un dieu avec lequel il est mieux d’être en relation directe.
Il la scotche sur une porte, ferme les yeux et lance le dard. Il ira donc là.
Il est dans la montagne. Il a une carte prise à l’office de tourisme. Le parcours est tracé d’un gros trait bleu mais la carte est presque muette. Pas de courbes de niveau pour identifier les monts, peu de noms, rivières et torrents sont presque invisibles : difficile de se repérer dans les environs. C’est une carte sans magie, comme un GPS qui tiendrait absolument à vous faire prendre un sens interdit. À cette carte n’importe quel amateur préfère les estampes, surtout japonaises.
Il a pris un sac à dos et l’a chargé. Quand on part en balade en montagne, il faut prendre ses précautions, tout peut arriver. Il a pris de l’eau, de la nourriture comme des noodles et des barres chocolatées par exemple, son petit butagaz dont la boite, qui se sépare en deux, forme d’un coté un pied et de l’autre une casserole ou une poêle selon les besoins, son poncho de pluie, sa couverture de survie, c’est léger et ça ne prend pas de place, et l’inévitable couteau suisse.
En 1880, à sa naissance, en ébène, le couteau suisse a l’utilité de son temps : réparer son fusil et découper son rösti. Un temps simple de clocher qui sonne pour dire maintenant est comme hier. Dès la fin 1991 Karl Elsener du canton de Schwyz et Victorinox sont habilités pour le fabriquer. En 1894, les officiers, finie l’égalité, en plus de la lame, du tournevis plat, de l’ouvre-boite et du poinçon, ont droit au tire-bouchon. Ça en dit long sur l’état-major qui voit le monde en rose, rouge ou blanc : Dôle blanche, Humagne ou œil de perdrix, Fendant…
Rose le sommet de la montagne au coucher et dont l’ombre, faisant un immense cadran solaire, annonce, dans les prés, aux Frisonnes pié d’or que c’est l’heure de la traite. Rouge, la lame du couteau rouge qui dépèce le lièvre bronze et le sanglier noir. Blanche, l’innocence de la rosée, de la neige qui étouffe les cris, de la neige neutre.
Après avoir tiré le bouchon, les vaches comme des sils qui prennent vie sous le souffle de la déesse, dansent en cercle dans des meuglements de joie, elles sont corne contre corne, se frottent les oreilles d’allégresse, elles tournent en se croisant les pattes, chantent yaourt, ayourt, ayourterie, ayourt, ayourt, ayourtera et les veaux au milieu suivent de leurs beaux grands yeux leurs parents qui tournent, tournent et se retournent. C’est une violente et traîtresse maîtresse d’école que la coutume.
Le 12 juin 1997 (renouvelé en 1961) le brevet est déposé pour le couteau et seuls Victorinox et Wrengler peuvent le fabriquer. Le modèle civil est rouge contrairement au militaire. Lors de la seconde guerre mondiale les GI ont le chewing-gum qui ne colle plus en découvrant ce bel outil. Il quitte les vertes prairies propres et silencieuses de la Suisse. En 2007 les outils principaux du modèle civil, sont les deux lames, le cure-dent, le tournevis plat, le décapsuleur, la pincette, les ciseaux, l’ouvre boite, le tire-bouchon et le poinçon. Elsener simule la folie, invite les comédiens, mais Elsener ( En 1200 Gata Danorum raconte Saxo grammations dont l’histoire est assez proche de Hamlet) est fini et les comédiens chinois copient le couteau. Le meurtre a eu lieu malgré les innovations de 2005 : une lame dentelée, un mécanisme de blocage des lames, un tournevis cruciforme, une scie, un revêtement antidérapant sur le manche. Le monde se complexifie, le couteau est un éventail d’outils intransportables : montre, altimètre, pointeur laser, lampe de poche, stylo, clé USB… 87 outils pour 121 fonctions. Un couteau monstrueux impossible à manier : l’usage est fait pour le mépris du sage.
Enfin, il a dans son sac, c’est un peu lourd mais ça lui semble indispensable, le dictionnaire historique de la langue française en trois volumes d’Alain Rey. Il lui paraît nécessaire de pouvoir remonter l’histoire du nom des choses, c’est son parti pris. Notre rapport au monde passe par les mots, sans eux pas de monde, quelque chose d’innommable. Avec ces livres, il regarde son butagaz différemment maintenant qu’il sait que sa casserole vient du grec kuathos, vase pour puiser, qui se transforme en latin médiéval ciatta, creuset, cuillère, puis en provençal cassa et enfin en casse, toujours cuillère. Que de chemin parcouru, que de régions visitées, que de conversations de bistrot improbables, pour avoir le rôle de cuillère, un simple mot de la cuisine ordinaire. Le voilà, avec sa casse, Gargantua festoyant. À présent géant, que le monde est devenu tout petit, pas plus grand qu’une maison. Nul doute que le parcours se fera en trois enjambées maintenant qu’il a des bottes de sept lieues.
Pendant qu’il grandit brusquement émerge le mystère de la métaphore. Quel rapport entre un casque de combat, un projecteur, un piano de mauvaise qualité, chanter faux et un mouchard ? Sans doute est-ce l’histoire de ce militaire qui chausse son casque avant de partir à la guerre. Il rejoint son bataillon qui défile au pas dans la ville en chantant faux Sambre et Meuse car il n’y a ni tambours ni trompettes. Ils sont au pas sous les projecteurs et la foule applaudit, lance des vivats et chante la Marseillaise.
Je ne suis pas sur terre
Pour tuer les pauvres gens
Lui, avant son engagement dans la légion, c’était un pianiste de bastringue, comme Aznavour dans Ne tirez pas sur le pianiste ou Vian avec sa trompette dans sa cave. Toute la nuit il frappe en noir et blanc, dans son coin, pour un cachet qui lui permet juste de survivre. Lui, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Son piano sonne étrangement car l’accordeur n’est pas assez aveugle.
J’ai vu partir mes frères
Et pleurer mes enfants
Le bastringue est un repère de la pègre, un lieu du milieu. Les parrains parrainent les frères et les sœurs dans leurs sombres affaires : autos, motos et dodos. Le chanteur silencieux dans son coin, au centre des conversations, passe pour un mouchard. Pour sauver sa peau il doit s’engager dans la légion étrangère comme l’homme à la main coupée, aux sept oncles dans le Cosmos sis Boulevard du Rhum.
Au nez des années mortes
J’irai par les chemins
Il marche au pas, seul dans la rue déserte, dans la nuit de son piano et fredonne tout bas :
Aussi ce superflu qui alourdi le dos, ces kilos de papier qui rendent la marche plus difficile, lui est-il nécessaire.
Il met ses pas dans le gros trait bleu de la carte. C’est la meilleure façon de ne pas s’égarer, mettre ses pas dans le chemin tracé par les anciens. La meilleure façon de marcher c’est de mettre un pas devant l’autre et de recommencer. Il suit ses pas et de temps en temps regarde le paysage. Ce petit pont de bois dont on doute de la solidité, ce sentier qui se perd dans la végétation semblant être une voie sans issue, ce flanc noir et nu dont la seule vie est l’ondulation des strates et cet hêtre si grand, si large qu’il faut une vingtaine d’enjambées pour en faire le tour. Il suit ses pas montant l’adret, le bon endroit, descendant l’ubac, quel repos, il avance dans le silence de la montagne. Pas un sifflement, pas un grésillement, pas un bêlement, pas un hennissement, pas un coucoulement, que le vol silencieux des buses et des gypaètes. Parfois le bruit étouffé et régulier d’une source, sinon seulement le crissement de ses pas sur la pierre troublant ce silence dans cette vaste étendue pourtant si peuplée d’insectes et d’animaux. Aucun taon même n’essaie de le piquer.
Brutalement un nuage surgit du dessus de la montagne, couvre tout le ciel et il commence à pleuvoir. De grosses gouttes serrées qui ne donne aucun espoir de passer entre. Il couvre la carte pour protéger ses pas et accélère l’allure. Il pleut depuis dix minutes quand il se trouve face à un torrent qu’il doit franchir. On lui a dit en bas, à l’office du tourisme, qu’il fallait être prudent avec les torrents. Sous l’orage une vague sombre d’un ou deux mètres peut arriver charriant des pierres grosses comme lui, des pins de trente centimètres de circonférence, des bouquets d’arbustes aux épines acérées et le courant naguère si tranquille et si pure, amener des tonnes de terre à la vitesse de l’éclair dans un jaillissement de fleurs noires. Impossible à franchir, sinon pour se suicider, ce qui n’est pas son cas.
Vite, il faut traverser avant qu’il ne soit trop tard. Vite, il saute de pierre en pierre, glisse sur l’une d’elles et se rétablissant laisse tomber la carte. Elle s’en va avec l’eau, impossible de la rattraper. Tonnerre, éclairs et un grondement sourd comme un tremblement de terre, vite, il faut traverser, la vague arrive.
Plus de carte, sa retraite coupée, il avance avec des souvenirs.
Il prend une direction dans les buissons. Il faut les écarter brutalement pour trouver le layon. Il fait un jour sombre de crépuscule. Tiens, un cairn, des hommes sont passés. Mais au-delà rien, des arbres et des buissons qui lui mouillent le pantalon. Rien que le tonnerre, l’éclair et la pluie.
Je suis perdu ! C’est la panique. Il se promène au bord de la folie. Un pas sur cette bordure et c’est ou le délire ou le bon sens. Crier. C’est le silence qui répond. Crier ? Pour ne pas être sous le marteau. Crier ! Pour éviter les coups. L’esprit doit retrouver le chemin de la pluie, creuser la tombe du vent et revenir à son sentier essentiel.
Il est au Seuil, une grande forêt de pins qui cerne une prairie. Serrés, les pins n’ont d’autre solution que de monter au ciel. Fins, chacun se bat pour un brin de lumière. Nombreux sont ceux qui s’épuisent et tombent. Ils tombent les uns sur les autres. Ils s’empilent dans tous les sens, les uns bien à terre, les autres par-dessus, encore un peu en l’air, formant l’éventail d’un couteau suisse déplié, d’autres encore n’ont plus la force de chuter et restent accroché à d’autres pins. C’est Gargantua qui tient sa casse d’une main et de l’autre joue au Mikado.
L’esprit doit retrouver le chemin de la pluie, creuser la tombe du vent et revenir à son sentier essentiel. C’est la panique un instant seulement.
Je suis perdu mais pas nu. Il a son sac et le monde entier dedans. Des champs de céréales et de chocolat, des rizières et des élevages de poules pour leurs œufs, même des fruits exotiques dans une boite. Il lui suffit d’une source pour vivre.
C’était un instant seulement, il avance maintenant pour trouver un coin avant la nuit, malgré le tonnerre, l’éclair et la pluie.
Il monte, suit les vagues dures d’une crête sous la tempête, descend entre les argousiers qui le piquent, s’accrochent à ses jambes, le retiennent, semblent clamer no pasaran, il descend encore slalomant entre les bosquets, glissant sur la pierre mouillée, il descend avec le jour, il descend et se retrouve au fond, dans ce qui doit être une vallée.
Le tonnerre, l’éclair et la pluie se sont arrêtés. Là, bien dégagée, une maison aux volets fermés, une maison comme dans un tableau de son ami Alain Ballereau. Un simple cube en pierres ruisselant d’eau où le gris se transforme en blanc sous l’effet de l’arc en ciel qui apparaît, un halo où les traits noirs des angles se détachent, au toit d’un seul pan incliné par signe de soumission pour ne pas mettre la montagne en colère. L’idée simple d’une maison. Une maison ? La porte aussi est fermée.
Il fait le tour et les alentours. Il repère une source. Un foyer où la cendre fait comme du ciment sous l’effet de l’eau. Un rond labouré, sans doute un sanglier. Un tas de bois tronçonné. Une empreinte dans la terre, loup ou patou ?
Il retourne à la maison, frappe à la porte, aucune réponse. Il frappe de nouveau, un peu plus fort et elle s’ouvre. Drôle de sésame qu’un coup assez prononcé.
Le jour est descendu plus bas que le fond de la vallée et il lui faut la lampe frontale pour découvrir l’intérieur. Il y a une table, des chaises, une armoire, une banquette sans matelas, les lames du sommier forment un alignement parfait comme dans une œuvre de Nonas. L’armoire l’intrigue, que peut-elle contenir ? Elle ne s’ouvre pas, elle est coincée par deux morceaux de bois. Elle s’ouvre comme à contrecœur dans un grincement qui trouble le silence, un cri. Il y a des pâtes, du riz, de la farine, des boites de conserve et même du foie gras. Il y a des casseroles, des assiettes, des couverts et même un ouvre boite. C’est la caverne d’Ali Baba. De quoi survivre longtemps. Il n’a pas vu le butagaz à sa droite dans un recoin et se servira du sien.
Il fait faim. Il retourne à la source prendre de l’eau pour les noodles et pour sa soif. Il fait cuire ses nouilles, les mange et faisant un autre tour découvre un cubi de vin déjà ouvert. C’est du Chinon, celui dont son amie disait : « Chinon au grand renom, à la feuille rosée à maturité. Chinon sauvage qui dépose un baiser libertin à la maigre Adeline. Chinon où il y a plus de cheminées que de maisons, renverse-moi à la flamme de ton poivre vert. Maintenant que j’ai l’éclat aux yeux, donne-moi Orphée et son chant hypnotique ».sans doute ouvert depuis longtemps, il n’est pas bon, Mais…ça sèche l’humidité. Un autre, pour ma peau détrempée.
Il fait fatigue. Il déroule son duvet sur les lames bien alignées. Il est fourbu par la marche, mais surtout par le tonnerre, les éclairs et la pluie. Il prend quand même en digestif un verre de vin, puis deux.
Il dort tranquillement dans son duvet de camouflage tandis que le loir dans son cri de minuit descend de la crèche. Hi, hi. Il se réveille de sa nuit sans songes, hi, hi, allume sa lampe, éclaire l’animal. Je t’ai vu petit saloupiaud. !
Il ne sait si c’est l’effet du vin ou du sommeil, mais il lui semble que le petit rongeur aux yeux ronds, noirs comme le fond d’un puits, semble se gratter anormalement les pattes. Et le cri de la bête moins haché, plus mélodieux, comme s’il chantait maintenant.
Le vin ou la fatigue ? Peut-être un peu des deux. Il faut dire que j’ai un peu abusé du Chinon pas bon, mais c’était pour la bonne cause : me sécher. Gambade loir, saute sur l’armoire, remonte les murs, fait du trapèze sur la crèche, mais en silence : je dors.
Je suis le sanglier à l’arrête noire, le prêtre de ces bois. Tout le jour je compose des lais aux racines et tubercules en mâchonnant une ronce pensivement. Le soir, pour sortir, je nettoie mes soies dans la souille et me frotte aux arbres. Ce n’est plus une forêt de pins mais un jeu de mikado. Je ne m’amuserai pas à les relever, j’ai autre chose à faire. Je dois retourner le maïs, les salades et ma solitude. Sermonner les oiseaux qui dans mon vermillis me volent le ver. Sur des dizaines de kilomètres je laboure et je laboure, c’est le fond qui manque le moins. J’ai quitté ma bauge pour labourer, je suis le gai laboureur, mais parfois un peu ronchon, je casse des noisettes pour dévorer le petit qui sort de la brebis.
Je suis le brocard brun, je me suis reposé toute la journée et pourtant je n’en peux plus. J’erre dans la nuit comme le ver dans la terre. J’aboie à la lune jaune. J’aboie mon amour et seule la hure du sanglier me répond. J’aboie de toutes mes forces au nez des fleurs qui se replient sur elles-mêmes. J’aboie mon blues et me frotte, et me frotte les bois au bois. Pourquoi ils tombent ? Ce n’est plus une forêt de pins, mais un mikado. J’ai autre chose à faire. J’use mes perles et mon andouiller intérieur à me frotter, je lance des piques à la chevrette, c’est la loi, je n’en peux plus, je tourne autour d’elle, je fais des huit dans un tournoiement infini : c’est sûr je vais la sauter.
Je suis le blaireau noir et blanc, un peu de jour et beaucoup de nuit, les pages d’un livret d’opéra où l’on chante, je n’irai plus à la pêche au meles meles, maman les gens de la ville ville ont pris mon panier maman, car je nage très bien. Mais où est la sortie, j’ai envie de faire pipi ? Où est la sortie de ce terrier natal ? Je m’égare avec sa trentaine d’entrées. Je m’égare pour un rien, je m’égare souvent, je me gare sans égards car je n’ai pas de regard. Où est la sortie, il faut bien en finir un jour ou l’autre ? Avant de sortir je frotte les fesses de ma femme pour la reconnaître. Où est la sortie pour mon pipi et que je mange un bourdon qui embête les pissenlits.
Il se réveille, il est fourbu, il a mal à la tête, comme s’il n’y avait pas eu de nuit. Ce n’est pas seulement le vin ou la raideur du sommier, mais bien comme s’il n’y avait pas eu de nuit.
Rien, rien envie de faire, même pas son café.
Il sort pour aller uriner. Brusquement, devant lui, le matin.
Le matin, poema, ouvrage en vers.
Le matin, poiein, causer, agir.
Le matin, gardien vigilant du temps, c’est to make et to do qui se donnent la main.
Le matin, c’est l’Est qui se retrousse les manches et pousse la boule, la projette très fort, très haut vers l’Ouest pour faire tourner la tête à l’ombre.
Le matin, c’est un jeu de ballon mais c’est aussi un travail comme une promenade, la balade du soleil est la ballade du jour.
Tandis qu’il urine face au matin, le soleil commence à sortir de la montagne et son flanc de conifères est bleu comme un ciel d’orage. La prairie humide, verte, est couverte de rosée. Des soleils montent du sol.
Plus loin, le lac bleu reflète la lumière timide. Une barque est prête à ramer. Les buis et les argousiers sont encore dans le noir du sommeil. Une lune, là, finit sa nuit de peine. Elle est pâle et légèrement azurée. Au pommier une biche et ses faons sautillent.
Là-bas, une trace, le gris de la pierre mise à nue. Un filet qui serpente au flanc de la montagne. Il traverse des rochers comme si le pas traversait la pierre. Un chemin.
J’ai autre chose à faire, je reste là.
Michel Lansade, 2018
Le plaisir peut s’appuyer sur l’illusion, mais le bonheur repose sur la réalité.
Chamfort, Maximes et réflexions.
Choc
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Arrêtons de faire des manières, de tourner autour du pot, qu’est-ce qui est tabou ? Disons-le. On le dit. Calmement. Raisonnablement. Logiquement. Asseyons-nous et discutons. Faites péter les clairons. C’est quoi ? Le sexe ? Le diable ? La mort ? Le cannibalisme ? La chair humaine ? Le cœur de l’homme, de la femme, de l’enfant, du vieillard, du SDF ? C’est quoi ? Vous mangez quoi, vous dites quoi ?
Je mange le cœur, avec lenteur, avec saveur, le sang coule et l’humain est défiguré.
Je refuse de manger le cœur. Car sans cœur, sans entrailles, une fois que tout est consommé, que l’humain n’est plus qu’une peau retournée, qu’un immense vide rouge béant sur l’univers vide mais si étrangement attirant, si indépendamment de ma volonté attirant, si bestialement mais en même temps si facilement retournable, maîtrisable. Qu’en ai-je à faire ?
Mais dites-le, n’ayez pas peur d’éclater les cervelles, de briser les os, de cogner contre les murs, de vous assener les coups qu’on ne vous a pas suffisamment donnés.
Qu’est-ce qui est tabou ? Voyons-le. Ce qui me révulse l’œil, l’âme, ce que je ne peux voir, ce que mon regard se refuse à voir, la tête décapitée posée sur le corps de l’homme sans tête qui n’est plus un homme, le trou géant du sexe de la femme les jambes grandes écartées et les seins exagérément gonflés, coupée en deux le haut et le bas, qui n’est plus une femme, les enfants misérables qui tuent et explosent qui ne sont plus des enfants. Ces images que je ne cherche pas mais qui moi par mégarde, l’autre dans une intention diaboliquement perverse s’imposent à moi dans ce si court laps de temps du clic qui m’oblige à voir et me fait dire je ne veux pas voir ça. Pas ça. Mais qui ont eu le temps d’impressionner irrémédiablement ma rétine.
Fred Lucas, 2018
Les empathies matérielles
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Il n’y a presque plus aucune couleur. Ou une seule, gris bleuté. Dans la pente, quelques blocs de roche, arrachés puis retombés, émergent dans la croûte de cendres durcies. La voiture est presque entièrement ensevelie, la carcasse figée, unie sous le dépôt pâle qui annule toute variante au paysage. Un vent de silence souffle quelques brandons vivaces, le sol est encore tiède du passage des laves. | Combinaisons orange, ils sont descendus dans la pente intérieure, là où tout fume. Ils mesurent le gaz qui émane des failles entre les roches. | Dans l’entrepôt de la sculptrice de décor, on travaille à une scène tropicale, découpant, sciant, ponçant la mousse expansée verte presque fluo, si bien qu’une poussière radioactive en suspend entoure le tronc d’arbre factice et les silhouettes de grands oiseaux. | Un leurre de pêche comme un poulpe festif, pour attirer les poissons, une touffe de fines bandes de polyester au vert particulièrement frétillant, un crochet triple croche rouge vif, un fil de chlorofluorocarbone à la lumière de l’eau. On pourrait imaginer un déguisement de mardi gras, entièrement fait d’articles de pêche. | Dans la nuit presque tombante, ils ont envahi la rue, venant accueillir le bus de leurs héros. Les bandes de supporters ont alors brandi des fumigènes aux couleurs de l’équipe. Entre les visages sauvages et criants, les flammes vert brûlant font miroiter les parois et les vitres du bus. La fumée fait disparaître tout l’arrière-plan de la scène, rue, bâtiments et ciel, ne reste plus que, soudés par la lumière verte, le bus et les hommes aux bras levés de torches. | Chlore, brillances, valves, réservoir, reflets-vitre, algues synthétiques, petit monde émeraude de l’aquarium. | Tubes de diodes tombant le long des quelques mètres du passage entre les buissons, le feuillage s’éclaire aléatoirement d’un blanc cruel, du bleu rappelant à la nuit, d’un vert surchargeant le végétal. Le chemin du passage devient en quelques pas le sas pour le monde de la fête. | Dans le hall central du dispositif muséal, sous la grande coupole, s’élève, recouverte d’une membrane de feuille d’or pédiculée reflétant le verdâtre et le bleuté de l’éclairage principal, s’élève, donc, la reproduction à échelle d’un module spatial. | Vitrine intérieure de décoration d’un restaurant asiatique. Poteries, natures mortes, bouquets facticiels, mannequin plastique portant une robe traditionnelle, effets d’ombrages et jeux de reflets sur vitrage, lumières tamisées, feutrées, vert pâle. | Concombres ogiveux à la peau veinée de légères boursouflures, délicatement superposés dans la cagette. Espèce exotique, mi-courge, mi-cornichon, au vert neuf vitalique, issue d’un petit potager biodynamique extrême-oriental. | Terrain de jeu en bambous ficelés le long du mur de grosses pierres ; dans l’abri végétal ils se figent ou filent, tête jaune, corps gris, fine queue turquoise, se frôlant de leurs minuscules écailles, guettant le bruissement d’aile d’un insecte, qu’ils iront gober d’un saut fulgurant, acrobatie de milliseconde, avant de reprendre la position immobile, uniquement sensibles aux infimes variations de température. On pourra peut-être deviner, au passage de la mouche gobée dans leur appareil digestif, le gonflement léger de leur petit corps lézard. | Phosphorant dans le fond de l’aquarium, corail, plastoc, rocaille avec des diodes dedans, mini-amphores d’où partent des bulles de tritons, petit théâtre de symbioses synthétiques. | Les mains liées au conduit vertical, bâillonnée de ruban adhésif, elle regarde vers le bas, ce qui doit approcher, rampant. La starlette apeurée implore, presque elle pleure, dans le sous-sol à la lumière de jade des néons et aux ombres trempées. | À l’étroit entre les parois calcaires suintantes, dans le passage souterrain ou gonflent les concrétions, un groupe de jeunes gens avance sur le sol glissant, se repérant dans la cavité en pointant leurs torches au sein de la densité noire. Présence quasi fantôme des enfants dans leurs ponchos plastiques imperméables jaunes, ne laissant paraître qu’un bout de visage dans la capuche, une main s’appuyant dans le boyau karstique, les pieds en tongs assurant chaque pas pour continuer à avancer dans les profondeurs mystérieuses de la montagne. | Tout est bon pour combler la fissure ; on devine les multiples tentatives pour reboucher le vide, d'où nous parvient le vent, l’humide, l’air froid. Des couches de pansements temporaires, de gros bouts de bandes adhésives métallisées, dont les plus anciennes, si sales, disparaissent dans l’ombre. Plus récent, une grosse pâte verdâtre et boursoufflante, comme des kilos de chewing-gums soudés, une planche de mousse expansée, une autre de Placoplatre, une bande de laine de verre fixée aux gros clous. Mais rien n’y fait, les glaciations de la nuit s’infiltrent toujours, encore et encore. | Le passage pour le puits sacré. Niche dans un gouffre côtier, juste au-dessus du bruit des vagues et sous celui du vent et des cris tristes des oiseaux de mer. Un site distant, parfait pour l’ermite. Un fond rocheux couvert de mousse, quelques traces d’eau pour les miracles du sixième siècle, creuse dans les champs païens de rosée. | L’entrée secrète du Puits Précoce. Lourde paroi grossière de pierre à pousser, pour se glisser dans l’ombre, un couloir rituel en descente, on lève la tête, un peu de lumière descend, pas suffisante pour chasser les peurs diffuses dans le labyrinthe inhospitalier. | Mais déjà, attiré par un bruit de chute d’eau, et quelques virages franchis entre les murs de roche, on débouche sur un balcon donnant sur un jardin abandonné. Le soleil a déchiré le brouillard et nous accueille dans une étreinte soudaine. Le regard se fait, et l’on distingue, dans le sous-bois tout proche, une douzaine de touristes menés par un guide aux paroles amplifiées par un porte-voix. | Pierres debout numérotées. Fragments naturels de roche. La pierre au n° 57 écrit à la main sur un ruban de tissu blanc entoure à mi-hauteur du rocher, qui, dresse, mesure environ un mètre de hauteur. Pierre d’ornement, décrite comme violette avec des tonalités blanc laiteux, crème et ocre. Stockée à coté, la pierre n° 42 est presque identique. La n° 53 est plus fine et allongée, elle mesure un mètre quarante. Le fragment n° 52, plus bas et plus modeste, coûte deux fois moins cher. | La colline domine une région de hautes vallées boisées alors sous un beau ciel. Le technicien électrique est monté sur cette butte au-dessus du village. Au point le plus haut, au milieu d’une zone rocailleuse, une clôture rudimentaire faite de quelques piquets, grillages et fils barbelés. La frêle enceinte protège un assemblage de quelques machines électriques. Le technicien a ouvert la trappe d’une sorte de grosse cage couverte de panneaux solaires. Il trifouille à l’intérieur, semble déconnecter et reconnecter de multiples câbles. L’homme se lève et se hisse contre un poteau métallique maintenu coincé entre trois gros cailloux. Sur la pointe des pieds, il parvient à déplacer un peu l’antenne accrochée en haut du mât. Un larsen, puis des grésillements désagréables sortent alors du large cône rouillé du haut-parleur qui pend d’un des piquets de la clôture. Le garçon se baisse pour faire de nouveaux réglages dans le boîtier entrouvert. En un instant les grésillements se transforment en un chant presque limpide. Du sommet de la colline, retentit alors la voix, l’Adhan s’élance par les airs et rejoint le village, les vallées plus bas, toute la géographie de montagne est prise dans l’appel à la prière. | Échafaudages tout autour de la sculpture monumentale, comme une forme animale capturée, prise au lasso, aux flancs abordés d’engins de siège, échelles d’assaut, tours et rampes immobilisant la bête blessée. Sur le chantier de restauration, les travailleurs perchés et sanglés colmatent les fissures, rendent aux volumes leur courbe d’origine. Tout bien enduire avant le travail de peinture, qui redonnera tout son éclat à l’animal abstrait qu’ils pourront alors relâcher. | Sous le regard des sergents instructeurs placés en retrait, les protagonistes du scénario d’entraînement exécutent la série de gestes, d’actions répétées pendant plusieurs mois. Il s’agit de faire démonstration publique des capacités sécuritaires en cas d’urgences biologiques. Le terrain a été vite balisé de cônes orange au sol, la rubalise a été tirée, surlignant dans l’espace du parking les passages à emprunter. Deux silhouettes avancent, lentement mais sûrement. Grosses combinaisons jaune fluo, capuches aux visières démesurées, bottes rose saumon, des gants noirs leur font des mains gonflées. Tout en progressant sur le terrain, les deux personnages vérifient leurs petits appareils de contrôle chimique, d'où sortent des petits bips aux rythmes irréguliers, au départ très lents, puis, plus ils avancent, frénétiques. | Évoluent, sur le terrain neigeux, longeant le grillage qui sépare la forêt d’arbres abîmés et les allées de conteneurs, l’unité de décontamination, trois hommes invisibles dans leurs combinaisons marron, sacs à patates à jambes, avec la petite bulle ronde de la visière. Ils se rapprochent les uns des autres, presque se collent, pour pouvoir se hurler des ordres d’actions. Marquages, échantillonnages et notations. | 09-05-2011. Camp Arifjan, Koweit. Soleil couchant sur le désert. Les deux hommes aux tenues jaune fluo et chaussures rose saumon avancent dans les dunes, valises renforcées en main, ils approchent d’un container avec prudence. | Dans la vieille ferme transformée en zone de production d’abris-dômes monolithiques, un ouvrier est en train de pulvériser, sur la coquille extérieure d’un petit module personnel, une dernière couche du mélange de polystyrène et de béton. Derrière lui, on aperçoit de nombreux autres abris, dont certains dômes beaucoup plus grands. | Sur le toit d’un haut immeuble de Détroit, un homme au style décontracté — chemise sortie du pantalon, casquette un peu de travers — règle un instrument de mesure, le géodimètre, monté sur un trépied solide. Boîte métallique volumineuse, avec un clapet ouvert pour la visée. | Fond de cave, bunker survivaliste, lumière blafarde qui s’allume progressivement sur des réserves entassées contre le mur. Douze gros bidons aux motifs camouflages noirs et verts, des caisses plastiques scellées et empilées, boîtes à outils, nourritures lyophilisées, pelles pliables, plusieurs gros rouleaux de corde, et des armes, plein d’armes, trois fusils de chasse, deux pistolets automatiques posés sur les caisses, un fusil à pompe, des haches, des ceintures de cartouches, des boîtes à munitions, un sabre. | La Casa De Los Tubos. Vieille ruine moderniste jamais finie. Grandes tours rondes en ciment collées les unes aux autres. Sur un promontoire au-dessus de la ville. Plusieurs rumeurs sur cette villa abandonnée, où il est souvent question de mafia et de meurtre, d’enfant de narcotrafiquant en fauteuil roulant tombé de la terrasse. Reste l’étrange bâtiment, en gros tubes verticaux et horizontaux, un abri à visiter quand il pleut. | Terrain militaire, à la surface plane égalisée, entre des collines inhabitées. Une sphère au blindage anthracite ultra-technique, deux mètres de haut, lestée au sol par des filins et des sacs de sable. | Plus bas, la crête du grand rocher de basalte noir se transforme, ou disons, passe d’une masse minérale érodée a une mise en forme par l’homme, en deux tours volcaniques octogonales aux sommets desquelles volent de longs et fins drapeaux noirs. | 11 2:56 pm. Plusieurs cuves de hauteurs différentes alignées côte à côte. Réservoirs verticaux en fibre de verre aux sommets arrondis. | Elle travaille la mousse polystyrène en taille directe. Assise sur le sol de son atelier, elle creuse les dernières ventouses d’un tentacule de six mètres de long. Tout autour, fragments de pieuvres, poussières, copeaux de mousse. | Le clerc a ouvert le sachet de protection, et toutes les personnes présentes autour de la table d’enchères ont retenu leur souffle. Délicatement il soulève le Gant en Paillettes de diamant pour que tous puissent le voir. La relique pop. | Les planchettes de contreplaqué découpées et assemblées reproduisent un relief, une route en pente entre deux murs de soutènement, dont on a commencé de sculpter et peindre les finitions en de petites pierres soudées ; des fils électriques traversent la maquette naissante. | Le plateau qui soutient le paysage en construction est encore percé sur toute la partie centrale, si bien que l’on voit sous la table les entrailles du câblage électrique. Au pied de falaises pour l’instant seulement formées de bandes de tissu collées, les pots d’encres, les pinceaux, sont posés. Des livres entassés sur un bâtiment pour en assurer la fixation pendant le temps de séchage de la colle. Cette vue aérienne, c’est-à-dire prise d’au-dessus à environ un mètre quatre-vingt, est chaotique. On ne sait ce qui est la surface du décor ou l’intérieur, les coulisses de la maquette ; des bouts de ville se terminent tandis qu’une grande partie du paysage n’en est qu’à son prototypage de bois et mousse expansée. | Salle de contrôle des extractions offshore. Au mur, une ligne de trois grands écrans plasma. Sur celui de gauche et celui de droite, des vues splitées de caméras de surveillance, avec les plateformes maritimes en divers plans, larges ou rapprochés. Sur l’écran du milieu, un tableau aux données évolutives. Au centre de la salle, dans la pénombre, sur un demi-cercle de bureaux, sept moniteurs informatiques ou défilent schémas, barèmes, prévisions, statistiques. La salle de contrôle se situe au vingt-deuxième étage du building de Shell à La Nouvelle-Orléans. Liaison permanente, par les câbles sous-marins de fibre optique, avec les caméras, microphones et autres capteurs multiples sur la plateforme pétrolière, située à cent trente miles au sud-ouest, perdue dans un désert de crêtes de vagues. | Dans le grenier, la planification du paysage a bien avancé, les falaises ont été peintes dans le détail ; à leurs pieds, une petite église de la marque Vollmer a été placée. Reste, au centre de la plaine, le trou béant révélant la structure souterraine de la maquette. | Perché sur la colline du Dorset, le château de Corfe est peut-être un des premiers châteaux construits en Angleterre. | Six écrans principaux accolés en deux lignes de trois, quatre formant le plan du réseau, les deux autres alternant des vues de caméras de surveillance. De chaque côté des écrans centraux, deux moniteurs vidéo plus petits surmontés de deux horloges digitales aux chiffres orange clignotant. Dans la salle, quelques hommes contrôlent de nombreux autres écrans, avec des zooms sur le plan de circulation et des centaines de vues de caméras. | Sous les arches du viaduc, maintenu par de petites cales en bois, tout semble encore précaire. On est loin des finitions. Le câblage électrique traverse en tous sens. Les tasseaux sont mal vissés et penchent un peu. La colle n’a pas séché, mais l’ouvrage tient dans une première ébauche. En arrière-plan, à échelle, contre le mur, le décor alpin, les épicéas s’accrochant à la falaise. | Tout au sommet, sous la charpente du grenier, une structure haute de tasseaux soutient le château perché sur la future montagne. | L’un est près de la cuve en lévitation, surveillant l’emplacement d’implantation, l’autre est aux commandes de la petite grue mécanique. La citerne en fibre de verre va en rejoindre deux autres, le long d’un chemin boueux en bordure de forêt. | Il se gratte le front, assis devant une douzaine d’écrans, gestion de flux des chaînes de télévision satellitaires. | Stockage à perte de vue de blocs de granit blanc, entassement pixelisé du paysage, labyrinthe infini des rangées de cubes rocheux ; tout au fond, très loin, quelques bâtiments dans les collines. | Entreposage de coton recyclé, conditionné en ballots blancs compacts ficelés de cordage noir. Piles bouffantes jusqu’au plafond. | Avec sérieux, deux hommes miment une scène médiévale dans leur accoutrement discount. Braies, tuniques, chaperons aux couleurs synthétiques en mauvaises mailles polystyrène. L’un tend le bras comme s’il montrait une direction. L’autre, les mains sur le ceinturon et la dague en plastique, fait mine de regarder dans la direction indiquée. Mais sans doute il n’y a rien à voir, car ses yeux semblent perdus dans le vide. | Ruelle archéologique détrempée par une pluie ininterrompue. Fouilles d’Herculanum. Au bout de la rue figée depuis l’antiquité, quelques touristes sous leurs parapluies. | Zone rurale, quelques petites maisons. Sous la colline creusée, la cuveusine, large tube de béton, chambre de décomposition fermée. Dans les charrettes on y apporte fumier animal, déchets végétaux et déchets humains. | Moules pour cellules de prisons préfabriquées. Pénitenciers modulaires. Trois cellules extrêmement réduites, posées sur des chevrons en bois, sèchent dans le hangar. | Finitions intérieures de la cellule, peinture blanche sur le béton uni d’une pièce, sol, murs, plafond, mobilier. Fenêtre à barreaux encastrés, lits superposés métalliques. | Autre modèle préfabriqué, avant livraison sur chantier. Environnement intérieur complet d’un seul tenant, tôle profilée, pliée, soudée, couchettes, étagère, toilettes combinées. La cellule est entièrement thermolaquée beige pâle, seuls les matelas posés sur les couchettes tranchent, bleu marine. Un hublot miniature donnera sur le couloir. | Vue inversée de la même cellule d’acier. Salle de bains, luminaire encastré, caméra. | Modèle architectural de salle de détention en open space, cloisonnement bas, compartimentation alvéolaire des cellules. | Prison d’un nouveau genre, cabines plus que cellules, sans plafond. Lit, bureau, système de divertissement audiovisuel. | Il s’agit d’une sorte de dortoir quadrillé de parois de deux mètres de haut et trente de large qui séparent les boxes. Des objets personnels des détenus sont posés sur le sommet des cloisons épaisses, à portée de main des détenus de chaque côté de la paroi. Gel douche, serviettes, fruits, magazines. Au croisement en croix de deux cloisons, une maquette de maison est posée en équilibre, visible pour quatre détenus, comme une promesse d’un avenir d’intimité domestique. | Vue de haut des cabines, entièrement visibles, un vaste découpage de l’espace ou chaque vie, délimitée dans ses trois mètres carrés, est à la fois complètement coupée des autres et littéralement soumise à une surveillance aérienne constante, comme une souris de laboratoire dans une cage au plafond transparent. | Ainsi le hall d’emprisonnement est surplombé d’une nacelle au vitrage blindé d'où les matons surveillent, les yeux rivés à la vitre, chaque mouvement des détenus. Diaporama sur la vie d’hommes en cages.
Manuel Reynaud-Guideau
"Les empathies matérielles", in Deux choses,
2021
"Les empathies matérielles", in Deux choses,
2021
Il existe différentes façons de mourir
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Il faut d’abord disposer d’un fauteuil, un grand fauteuil, plutôt en skaï qu’en cuir, c’est plus froid contre la peau nue. Ce fauteuil se règle à grands coups de clacks.
Ne vous inquiétez pas, cela va faire clack dit la femme en blanc.
Quelques secondes après, le temps de tourner autour du fauteuil, ne vous inquiétez pas, cela va faire clack, redit la femme en blanc.
Qu’à cela ne tienne ! pourquoi prévenir d’une chose si banale ? le fauteuil se règle brutalement et fait clack, ah bon ! où est le drame?
Attends un peu, Ariane, ne fais pas la fière tu devrais te méfier.
Le fauteuil est trop grand, beaucoup trop grand pour Ariane, alors entre son dos et le skaï, on bourre d’une matière qu’elle ne peut identifier, c’est dans son dos. C’est mieux ainsi ? Ariane répond oui, rassurée qu’on s’occupe de son confort, oui, elle est mieux calée.
Elle ne comprend pas encore que ce calfatage est destinée à éviter tout mouvement arrière, tout recul, tout soubresaut. Il la faut immobile, immobilisée. Surtout ne pas bouger.
La femme en blanc rapproche le fauteuil de la machine à laquelle elle accroche Ariane. Accrochée est le mot juste, se dit Ariane, je suis accrochée. Par la peau.
Attention, Ariane, les choses se compliquent. Tu dois mettre ta tête sur le côté, juste la tête, sinon le grand rayon lumineux te transpercera le cerveau. Et le reste du corps ne doit pas bouger, ne peux pas bouger. Tu es coincée, Ariane.
Ils, ou elles, sont trois maintenant, un homme et deux femmes. Les trois portent des masques. La première, la femme en blanc, est une sorte d’esclave, elle garde le silence devant l’homme et la femme qui viennent d’arriver, elle obéit à leurs ordres. Ils ne la tutoient pas, ils sont supérieurs : vous avez allumé la machine ? les aiguilles sont à la bonne place ? ils vérifient.
Mais pourquoi le claquement du fauteuil ? Quel rapport avec l’aiguille ? Plusieurs aiguilles ?
Car devant Ariane assise dans son fauteuil trop grand -- ses pieds ne touchent pas terre -- se dresse une machine, se dresse oui vraiment, comme une plate falaise d’une couleur beige indéterminée. Elle a le visage si près de la falaise qu’elle n’en voit pas le détail, qu’elle ne peut en analyser le fonctionnement, et puis elle fait encore confiance.
Voulez-vous que je vous explique tout ce que je fais, lui demande la femme-chef, ou que je ne vous dise rien ? Bien sûr, vous m’expliquez, lui répond Ariane. Une question à ne pas poser, pour qui me prend-elle ? Une idiote qu’on assassine sans sommation, une inconsciente qui passerait l’arme à gauche l’air de rien, moi, Ariane, qui refuse de dormir, toujours, parce que je veux saisir l’instant de l’endormissement, et que le saisissant je le rate. Cette course toujours de l’instant basculant de la conscience à l’inconscience, tout en voulant garder la conscience de l’inconscience. Mais tu ne comprends pas, tente d’expliquer sa mère, que c’est impossible, tu ne peux pas avoir les deux. C’est comme le beurre et l’esprit du beurre, je lui demande, non c’est comme le beurre et l’argent du beurre, me répond-elle. Le beurre et l’esprit du beurre tu les as ensemble en achetant ton beurre, mais quant le beurre tu as, tu as encore l’esprit mais plus l’argent. Comprends-tu ma fille ? Ne confonds pas esprit et argent, et reviens sur ta machine, regarde le plat de la falaise, regarde l’aiguille.
Ariane refuse de regarder l’aiguille, il lui suffit de la sentir s’enfoncer dans sa chair. Mais vous me faites mal avec votre machine à coudre, dit-elle aux deux tortionnaires qui prétendent que ce n’est rien. Il faut le faire encore et encore. On ne peut plus rien pour vous. Vous avez envie de vomir ? demande le tortionnaire en chef Oui, répond la pâle Ariane qui se sent proche de la mort. Ariane suffoque, elle pense mourir dans ce spasme qu’elle éprouve pour la première fois. Non, elle n’a pas envie de vomir, c’est le cœur tout entier qui veut sortir de son corps, respiration bloquée. Et si je meurs maintenant, il faudra tout recommencer, se dit Ariane. C’est fini, Ariane, c’est fini, tu peux respirer.
Joseph Pasdeloup,
Il existe différentes façons de mourir, se dit Ariane. Puisque la deuxième n’a pas réussi, malgré tous ses efforts, elle, sa mère, que rien n’arrête, en tentera bien une autre, 2021
Il existe différentes façons de mourir, se dit Ariane. Puisque la deuxième n’a pas réussi, malgré tous ses efforts, elle, sa mère, que rien n’arrête, en tentera bien une autre, 2021
Le jour de fête
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Dans mon suicide
Dans sa matière philosophique
& dans la destination du geste lui-même
Il y a ma fille
Je l’aime
Je la hais
Dans cette circulation-là
Je la laisse espérer
Un enterrement à la va-vite
Quelques formalités vite expédiées
Un copieux héritage
Je me suicide et me rate
Je me resuicide et me rerate
Je m’amuse avec ses espoirs
Elle est une souris avec laquelle je joue
Ce n’est pas cruel puisqu’en niant son existence
Pourquoi serais-je responsable de sa souffrance
En retardant seulement pour elle
Christophe Esnault
2021
L'enfant sous le piano
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
L’enfant aime se cacher ; tout espace est pour lui une chambre célibataire. Refuge, asile, grenier, trésors arrachés à la vie quotidienne. Le piano dont la masse inquiétante dispose d’un vaste sous-bois : l’enfant l’adopte ; il en fait sa chambre; il tend une toile entre les pieds de l’éléphant-piano ; il accumule, amasse les conquêtes et dans une ordonnance sévère en interdit l’approche.
Au - dessus de lui, (il est accroupi), la panse de l’instrument est remplie de sons ; ils sont mystérieusement présents, frémissent au moindre souffle, mais leur orage peut éclater d’un moment à l’autre. L’enfant est prudent, il chuchote et ses mouvements sont lents ; il ne veut pas réveiller ce gros animal. Tour à tour il prend peur et se rassure. Comme il ne sait pas encore rêver, il s’endort.
Des nouvelles de l’appartement
L’éducation est stricte ; dans l’appartement, il n’y a pas de glace où se regarder. Ce n’est pas très important, pense l’enfant, ce qui manque plutôt c’est le monde qu’on pourrait y voir, à l’occasion.
L’occasion vient. Une visite chez un ami de ses parents. Il les accompagne, on ne s’occupe pas de lui. Contre le mur est appuyée une table tour à fait ordinaire. Sous cette table s’ouvre un couloir lumineux, des reflets en forme d’arcades, tant qu’on dirait un souterrain, une grotte d’Ali Baba ; l’enfant se glisse sous la table, il veut entrer là ; on le rappelle à l’ordre, il se redresse. « Qu’est ce que tu fais là ? – Rien, rien »
Les marteaux
L’enfant aime courir. N’importe où, juste courir. Pour rien. Ni pour attraper un train, ni pour arriver à l’heure, ni rien. –« Pourquoi tu cours comme ça ? – Je ne sais pas ».
Le prof. de piano disait « tes doigts comme de petits marteaux » ; une mécanique,. une ritournelle.
Bouger les doigts, c’est tout ; et les jambes, c’est pareil, pense l’enfant. Il court c’est tout.
Comme il court sans se soucier d’aller quelque part, l’enfant pense sans savoir qu’il pense. Pourtant, il entend ce mot toute la journée : « Tu as pensé à mettre un pull ? à te laver les mains, à revoir tes cours ? Mais enfin, à quoi penses-tu ? » Tac, Tac, autant de petits marteaux.
L’oubli
Heureusement avec les marteaux vient le mot « oublier ». On oublie beaucoup, pense l’enfant. Les clefs, les parapluies, les foulards, les gants, d’éteindre la lumière, de répondre au téléphone ou le rôti dans le four - « Ah ! j’ai oublié, où avais-je la tête ? ». Lui aussi on l’avait oublié une fois, dit sa mère. Elle rit. L’oubli est l’envers de la pensée, ce n’est pas si grave que ça, pense-t-il.
L’imperméable, la pluie
Tous ces ennuis en travers de la route. Le capuchon, les bottes.
Tomber
En courant comme il le fait, tête et jambes projetées en avant l‘enfant tombe fréquemment ; dans le vertige de la chute, il se sent brave, impétueux, héros discret d’une minuscule aventure ; écorchures et bandages en sont la preuve. Il aime ça, l’air pirate.
Ils racontent
L’enfant s’étonne de ce que les gens racontent. Ça ne ressemble pas. Pourtant ils ne mentent pas. L’invention vient toute seule, s’enroule autour du récit, s’y accroche, ne fait plus qu’un avec lui. C’est comme ajouter du sucre dans un yaourt, il se dissout, on ne peut plus séparer le sucre de la crème. On ne sait plus que croire, le plus simple est de tout gober, se dit l’enfant, on verra après.
La chambre
L’enfant est heureux d’avoir sa chambre. Il la transporte avec lui, à l’intérieur. Le mot « intérieur » lui plait, il y a « rieur » dans intérieur, il aime ça. Il se souvient du piano, le gros animal sous lequel il se blottissait. Sa chambre, un animal-piano.
Les mots
Écouter, entendre, l’enfant est entouré de mots. Sonnants, trébuchants. Il les tourne et retourne, les assemble, les dépiaute, les scrute, les sculpte. Les mots se prêtent aux jeux, ils dansent.
L’enfant sait qu’il est inutile de vouloir les saisir. Autant de nuages à recomposer pour le plaisir. La musique des mots, leurs tons, leurs accents.
Tu as rangé ta chambre ?
Comment ranger ? ça veut dire quoi « ranger »? Ce sont les mots qu’il faudrait ranger, pense l’enfant. Les mots pour dire ‘ranger’, par exemple.
Plus tard
« Plus tard », ou : « quand je serai grand », ou : « je voudrais ». L’enfant ne sait ce qu’il voudrait ni ce qu’est ‘plus tard’ ni non plus ‘ être grand’, on lui pose la question et il répond - « Je ne sais pas . Poli.
Décidément
Décidément les mots ne disent jamais ce qu’ils veulent dire. Indisciplinés, vagues, ils flottent selon le genre des gens et le ton qu’ils prennent. « range » ou « plus tard » ou encore « va jouer plus loin » : des impératifs aléatoires. Combinables
Les choses arrivent
L’enfant ne prévoit pas ; les choses arrivent sous forme d’occasions, de chute, de rencontres ; la porte ne s’ouvre plus, un livre tombe, l’étagère s’écroule, les verres se cassent. Ce sont les choses qui jugent ; l’enfant est maladroit et les choses le savent, elles le lui rappellent. Quelque fois avec tendresse, quelque fois durement. Quelque fois ça tombe bien. Ou assez bien. Quelque fois vraiment mal. On ne sait pas.
Ça se complique
La pensée, comme une chambre, a besoin d’une porte. Et cette porte, d’une clef.
L’enfant ouvre la porte, un clic : la clef a fonctionné. Il entre dans la pensée comme dans un palais. Sur la pointe des pieds. Timide d’abord, il s’enhardit.
La pensée l’attendrait-elle ?
Anne Cauquelin
L'enfant sous le piano, 2022
L'enfant sous le piano, 2022
L'heure extrême
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
L’enfant regarde la télévision, assis sur le canapé. Il sait que dans quelques instants, il n’y sera plus. Même s’il n’en a qu’une idée confuse pour le moment, il sait qu’à neuf heures et demi exactement, sa mère ira le chercher pour l’amener dans sa chambre. Un baiser sur le visage, « dors bien mon fils », et ce sera l’obscurité.
Immobile sous sa couverture, il écoute le bruit de la télévision, qui franchit les frontières de la salle à manger. Lorsqu’elle se tait enfin, il tend l’oreille pour écouter les ténèbres. Dans la chambre d’à côté, le bébé accapare toute l’attention de ses parents ; dans le jardin, le lent mouvement des limaces est imperceptible ; et il n’y a pas la moindre voiture dans la rue. À force de se tenir à l’affût de ces choses palpables, qu’il ne voit pas, l’enfant finit par s’endormir. Lorsqu’il se réveillera, il fera grand jour, et c’est tout ce qu’il connaîtra des altérations de la lumière, un clair-obscur qui recouvre le monde.
Le crépuscule est le plus formidable spectacle qu’il lui ait été donné de contempler. Il l’expérimente tous les jours dans le pré à côté de chez lui. C’est quelque chose de lent et triste, comme une espèce de naufrage multicolore, et il lui vient alors à la mémoire l’image d’un animal qui en mange un autre. Les réflexions que lui inspire le crépuscule sont toujours interrompues par sa mère qui le somme de venir à table et par les odeurs du dîner.
Mais son vœu le plus cher, le désir qu’il nourrit au plus profond de son cœur, c’est d’être réveillé à minuit. Il a une passion secrète pour cette heure, la plus prestigieuse de la nuit, qui ne s’offre qu’occasionnellement aux regards des hommes, et jamais aux siens. Il l’imagine toute noire, comme le noyau bitumeux d’un corps nocturne, dont la couleur va en s’éclaircissant à mesure qu’on avance vers ses extrémités. Il l’imagine comme un étroit sentier entre deux abîmes. Ou bien comme l’instant où toutes les créatures suspendent leur respiration pour la reprendre tout de suite après comme si rien ne s’était passé. Il en rêve tellement. Et il n’est pas impossible que minuit ait gratté à la fenêtre, à son insu, alors que justement il rêvait de lui.
Le voilà à nouveau dans son lit. Draps odorants, couverture douillette. Il entend à travers la fine cloison le bébé qui pleure vaguement, mais la mère et le père veillent. Il y a aussi une cousine de sa mère qui habite provisoirement avec la famille le temps de trouver du travail. Le son de la télévision lui parvient par bribes dans son lit sous la forme de dialogues confus entremêlés de musique. Soudain, il sent que sa vessie est pleine, il pose un pied sur le sol. Il ouvre lentement la porte sans allumer la lumière, et son corps se désintègre dans le couloir pour se reconstituer seulement dans la salle de bain, dix mètres plus loin.
Une fois son envie soulagée, il risque un détour par le séjour avant de retourner dans sa chambre, pour regarder discrètement ce qui s’y passe : personne, la télé soutient la seule conversation de la maison. Le père, la mère et la cousine se préparent à aller se coucher. Il entend la porte de la salle de bain se fermer. Curiosité, envie de voler le réveil posé sur le buffet de la cuisine. Mais il recule devant le risque et retourne dans le couloir. Il ouvre la porte et la referme dans la même seconde pour ne pas perturber la tranquillité de sa chambre, qui dort sans lui, laissant les autres pièces allumées, palpitantes. Il se glisse sous ses draps avec ses désirs, où il se résigne à attendre le sommeil, qui ne tarde pas, parce que malgré son excitation, il n’a pas l’habitude des infinies attentes de la nuit, de ses heures molles et sans points d’accroche, qui la font ressembler à un animal invertébré. Peut-être qu’à force d’errer dans ce temps amorphe, son esprit finit par souhaiter le retour du jour, de ses formes précises, de ses architectures définies, et alors il a la nostalgie de lui-même.
Pendant la nuit, les désirs qu’il ressasse sous ses draps s’organisent, les fils de son esprit jusqu’alors en désordre commencent à tisser le canevas de futurs plans. Ainsi, lorsqu’il va prendre son petit-déjeuner préparé et servi par sa mère, il n’est plus tout à fait l’enfant innocent qu’il était devant son bol en plastique.
Pendant la journée, il se repose discrètement pour garder ses forces, malgré les soubresauts sporadiques de son cœur. Il s’assoupit deux secondes pendant que sa mère lui savonne le dos, avec la complicité des bruits de vaisselle, qui couvrent ses ronflements. Il profite des pages de publicité pour prendre de l’avance sur les rêves qu’il n’aura pas le temps de faire plus tard.
A neuf heures et demi, sa mère presse l’interrupteur et les ombres de la chambre filent se cacher sous les meubles. Elle aplanit le drap et la couverture sur sa poitrine, puis s’en va. La cousine se racle la gorge dans le séjour. Pourquoi donc le volume de la télé augmente-il pendant la publicité ? Sa vessie est secouée par ses quintes de toux sèches et l’envie d’assouvir une envie pressante le pousse à nouveau dans le couloir.
Toutes les lumières sont allumées dans la maison, il a le sentiment que la vie se déroule sans lui. À minuit, une grande commémoration aura certainement lieu, les gens s’embrasseront, parleront à tue-tête et les horloges électroniques afficheront un insolite et clignotant 0:00. Il sort des toilettes, soulagé, et il va jusqu’à la cuisine, où la théière bout toute seule. Il subtilise le vieux réveil, dont les aiguilles avancent en faisant un bruit de chaussures à talon haut qui écrasent les secondes. Il retourne dans sa chambre sans déranger l’obscurité et il approche le réveil de la fenêtre pour que la lumière qui vient du dehors – des lampadaires et de la demi-lune – l’aide à suivre la marche des aiguilles. Il est dix heures vingt-huit.
Il a un œil sur le mouvement de la grande aiguille, un autre sur le surprenant jardin qu’il n’avait encore jamais vu ainsi revêtu d’ombres. La roseraie est méconnaissable car elle se confond avec le mur, qui se confond lui-même avec les murs des maisons voisines, que la lumière des lampadaires transfigure. Et l’ensemble se vaporise dans l’obscurité. Les formes des choses qu’il connaît par cœur depuis qu’il est né – depuis neuf ans ! – ont été effacées.
Le vent secoue le paysage, mais les ombres noires ne se détachent pas des objets, elles semblent collées à eux. Ébahi, l’enfant pose son regard sur les branches les unes après les autres pour réapprendre chaque couleur et chaque forme. Soudain, il sursaute de peur, comme si l’on venait de le pincer, ainsi que le fait parfois sa mère : la manche de son pyjama effleure le réveil, qui tombe du rebord de la fenêtre ! Mais l’enfant tousse pour couvrir le bruit qu’il fait en s’écrasant sur le sol. Une affreuse toux de chien malade, qui s’entend à travers la porte. La mère accourt à son chevet avec un sirop au miellat. Elle pose sa main sur son front, aplanit à nouveau la couverture sur sa poitrine et s’en va. Cette toux traverse la nuit, éclabousse toutes les heures.
Il était dix heures quarante-six la dernière fois qu’il avait regardé le réveil, maintenant cassé, qu’il tient contre lui sous les couvertures. Comme il sent que la menace de la mère est à présent écartée, il le sort et l’examine à la lueur de la fenêtre. La grande aiguille ne bouge pas, alors que la trotteuse se démène dans l’effort vain de poursuivre son ascension du cadran à peine commencée. L’aiguille tressaute, à chaque minute elle avance d’un trait, mais elle revient tout de suite après à sa position précédente, où elle reste bloquée.
L’enfant ne sait pas combien de temps s’est écoulé depuis que le réveil est tombé par terre. Il prend alors le matériel scolaire qui était resté dans son cartable pour les vacances, et il griffonne dans un cahier une multiplication, qu’il effectue soigneusement. Il a la bosse des maths. Un combat s’est engagé contre les secondes qui s’écoulent maintenant dans un absolu silence, et sous la faible lumière qui entre par la fenêtre, il arrive à la conclusion qu’il devra compter jusqu’à quasiment cinq mille !
Il est retourné sous les couvertures, blotti contre le vieux réveil. Il ferme les yeux. 331, 332, 495, 517... Il est fier : « je suis plus rapide que les secondes ! » Mais petit à petit, la marche accélérée du temps, que lui-même dicte, commence à s’enrayer, à se perdre dans l’obscurité. La réalité s’égare dans les ténèbres. Il imagine son corps en dehors des murs de sa chambre. D’ailleurs, quelle distance sépare le lit de l’armoire ? Et s’il venait à l’idée d’un affreux rat de se frotter contre sa petite joue délicate ? Il se tourne sur le côté, étire ses bras, les place ensemble entre ses genoux, comme s’il cherchait à s’abriter en lui-même. Confort : oreiller moelleux, couverture sentant bon l’adoucissant, ronflement familier du père. Ainsi se met en place le scénario qui compose presque toutes ses nuits. Ses bras glissent le long de sa poitrine, les doigts relâchent leur pression et laissent s’échapper le rosaire. Il a un peu peur de l’enfer. Mais quelle douce obscurité, quelles ténèbres délicieuses, et dans la rue en contrebas, le ronronnement d’un moteur de voiture lui fait l’effet d’une caresse.
Lorsque le matin, il se réveille, il fait déjà grand jour, dans la cuisine on s’affaire depuis des heures, la cocotte-minute fait entendre son murmure, l’eau coule bruyamment dans l’évier. Les yeux douloureux, il regarde à travers les rideaux le jardin familier, la roseraie baignée de soleil et le linge suspendu à l’étendoir. Il cache son réveil déglingué dans le cartable flasque, qui attend les livres qui seront achetés à la rentrée. Comment expliquer que le réveil a disparu de la cuisine ? La mère a déjà dû remarquer son absence, étant donné que toutes les activités du matin sont réglées par le mouvement de ses aiguilles.
Pour sa surprise, sa mère n’en touche pas un mot pendant le petit-déjeuner, malgré le vide flagrant que son absence laisse sur le buffet. La radio allumée fournit la mesure du temps qui permet d’organiser les tâches ménagères. L’enfant se demande alors s’il doit remettre le réveil à sa place. Il réfléchit à la question en silence pendant quelques minutes, tout en regardant le mélange de lait et de flocons de céréales, qui disparaît graduellement de son bol en plastique. Il prend finalement la décision de ne rien décider. Il se lève de sa chaise d’un bond et se rue vers la cour, en imitant avec ses lèvres le bruit d’un moteur de voiture.
L’enfant profite de sa journée pour se préparer : il dort quinze minutes sur la table de mini football pendant la mi-temps de la partie ; il reste une minute de plus allongé sur la pelouse, lorsque son adversaire invisible commet une faute sur lui dans un simulacre de match ; il médite quelques heures au milieu de la poussière et des vieilles revues dans le grenier, où il se cache au cas où sa mère se serait mise en tête de le chercher.
Le soir, alors que la deuxième télénovela se termine, il s’avise qu’il devra bientôt vider les lieux. Il se dit que sa mère est fort occupée avec le bébé, si bien qu’il demande l’heure à son père. Il veut savoir combien de temps il lui reste à attendre. Neuf heures vingt-cinq, lui dit son père à haute et intelligible voix. Sa mère est-elle sa complice tacite ? Le bébé est enfin calme, sa mère l’emmène dans leur chambre et le dorlote dans son berceau placé près de leur lit double. Il dormira aussi longtemps qu’il le voudra, aussi longtemps qu’il ne sera pas dérangé par la faim, la soif, la peur ou par le contact désagréable de sa couche souillée. Il se réveillera à l’heure qu’il veut, se dit l’enfant en pensant à son petit frère, et peut-être même à minuit. A cette pensée, il se sent relégué dans des limbes exigus, pris en tenaille entre le monde libre des bébés et l’univers des adultes, où tout est permis.
Le parquet crisse sous les pas de sa mère qui revient et il demande à nouveau l’heure à son père : il est neuf heures trente-trois.
Il se brosse les dents en comptant les secondes. Il souhaite bonne nuit à la cousine, puis dans sa chambre, une fois sous ses couvertures, il embrasse sa mère, mais il ne s’arrête pas de compter. Seul dans l’obscurité, il continue, intercale pieusement entre chaque chiffre un mot de sa prière du soir. Lorsqu’il s’est acquitté de son obligation religieuse, il en est à 867. Il s’approche de la fenêtre. La ligne que décrit le rebord passe à la hauteur de son nez, laissant sa bouche immergée. Il étire alors son corps dans un effort pour faire participer tous ses sens. Il reste figé dans cette position, alors que les nombres deviennent gigantesques, stratosphériques, et il regarde, émerveillé, le jardin dont les formes sont modifiées par la nuit.
La lumière du jour ne cesse de changer, le soleil clignote sans trêve, il entre et sort de scène, turbulent, inconstant, et ses couleurs se modifient à chaque instant. Pourtant rien de cela ne rivalise avec la nuit, avec ses couleurs immuables ou presque, qui ne changent qu’imperceptiblement. Et cette modification si subtile, qui contraste avec l’écoulement minuté du temps, l’enfant la guette, les deux mains et le menton posés sur le rebord de la fenêtre.
Il cherche dans l’air, qu’il hume précautionneusement, les signes que minuit approche. La nuit sera-t-elle plus noire ou au contraire plus claire ? Sera-t-elle plus froide ? Minuit sera-t-il annoncé par le fracas des tambours ou précédé par une pause solennelle? Ou par une sirène qui retentira au loin ? Les animaux et les plantes feront-ils une grande manifestation, marcheront-ils sous l’étendoir à linge à présent sans destination, ni occupant, ou se borneront-ils à observer un silence respectueux ? Il est peut-être vrai, comme on le dit, que des fantômes défilent, et à cette pensée, un frisson lui glace la nuque. Fantômes, apparitions, âmes errantes, de quelles couleurs sont-ils ? Certains disent qu’ils sont d’un blanc aussi opaque que le lait, d’autres qu’ils sont transparents, et dans ce cas, ils se confondraient avec l’arrière-plan, autrement dit, ils deviendraient noirs. Ou ces esprits sont-ils pareils à des corps gazeux et à la fumée, dont les couleurs estompées tendent à être plus diffuses encore à mesure qu’ils se meuvent dans l’air. Au cas où ils surviendraient, il doit être prêt : il se peut qu’il y ait, à la suite du cortège, l’âme de son petit chien adoré, qui a naguère été enterré dans un coin du jardin, au pied du mur.
Il se heurte à tant de difficultés à la fois ! En plus du décompte des secondes, qui le fait approcher des nombres jamais atteints, sa nuque est parcourue par ce frémissement de peur qui ne le quitte pas, son corps qu’il étire lui fait souffrir le martyre et la vitre est couverte de buée à cause de son souffle. Mais surtout il y a le sommeil qui profite de sa concentration défaillante pour s’insinuer en lui. Ainsi, parvenu au chiffre vertigineux de 3 976, déjouant tous ses pronostics, il s’endort.
Il se réveille en sursaut. Il a rêvé que le matin était levé et que des flots de lumière, qu’il essayait en vain d’arrêter, entrer par la fenêtre. Puis il entendait les bruits venus de la cuisine, l’eau, les casseroles, la mère qui se râcle la gorge. Mais il se rend à présent compte qu’il fait encore nuit. La question est de savoir qu’elle est cette sorte de nuit, qui se tient immobile devant lui. Lorsqu’on n’a pas de réveil dans le noir, on est comme un chien perdu au milieu du bois.
Il est inutile de se remettre à compter. Le paysage de l’autre côté de la vitre n’a apparemment pas changé : branches et feuilles bercées par le vent, points jaunes accrochés aux lampadaire, œil blanc à moitié fermé de la lune. Il est impensable que minuit soit passé pendant qu’il était assoupi, sans quoi il lui aurait fallu rester dans une position tout à fait inconfortable pendant un temps dont il n’est pas capable. Il en déduit qu’il est aux alentours de minuit. Il est attentif à la texture du ciel et à la composition de l’air, qui commenceront bientôt à se modifier jusqu’à devenir méconnaissables.
Le temps passe.
Le temps passe encore et rien ne se passe. Le jour secrète ses propres humeurs et états d’esprit, alors que la nuit est un bloc monolithique.
L’enfant quitte la chambre, il prend soin à ce que le parquet ne grince pas sous ses pas, il palpe les meubles à l’aveuglette, réprime la toux qui lui chatouille la gorge. Puis il entre dans la cuisine sur la pointe des pieds et il trouve la radio, qu’il allume en mettant le volume très bas. C’est l’un de ces modèles anciens, qui n’affichent pas l’heure, mais l’annoncent verbalement entre deux chansons. Pour le moment elle ne diffuse pas de musique, seulement des palabres interminables, un long dialogue trop bas pour qu’on puisse le suivre. Aussi doit-il attendre. Il croit reconnaître un jeu de questions et réponses. Ensuite viennent les infos de la nuit.
Enfin, la radio annonce qu’il est onze heures quarante-huit. Il reprend immédiatement le décompte des secondes, comme dans un combat de boxe ou un match de basket. Cette fois, les chiffres se succèdent dans sa tête à la cadence des battements de son cœur étreint par l’angoisse. Il se dirige vers sa chambre ; il est obligé de marcher avec prudence, à contretemps avec le reste de lui-même. Il arrive à la fenêtre et là il contemple la nuit. C’est toujours la même, de sorte qu’il doute si la radio lui a annoncé la bonne heure, mais il en douterait tout autant si une montre le lui avait donné. Alors, les genoux posés sur la chaise, il ouvre la fenêtre avec impatience mais lenteur à cause de sa maigre force physique. Les ventaux coulissent doucement avant de se bloquer : la chambre est envahie par la nuit, par son vent frais, ses arômes et ses vers luisants qui scintillent. Il reste une minute avant minuit. Il est parcouru par un frémissement qui s’explique certainement par son attachement viscéral à la nature, car il est lui aussi fait de branches, de rosée, de feuilles et de pierres. Il commence à compter plus lentement, grisé par les odeurs du jardin. Soixante mornes secondes plus tard, il comprend que minuit est l’heure secrète où limaces et jasmins se réunissent pour s’épancher. Les couleurs sombres resplendissent, mais leurs vibrations ne sont pas perceptibles par les créatures diurnes. Le silence du jardin s’ajoute au silence de la maison. L’un est agité, vivant, rempli d’une profusion de bruits imprévisibles, tandis que l’autre est coincé entre les ronflements du père et les soupirs du bébé – seule la mère a appris l’art de la sublimation, même inconsciente. Envahi par le silence, les senteurs et la noirceur de la nuit, la chambre de l’enfant n’appartient plus à la maison, elle a été annexée par le monde extérieur. Minuit est en réalité l’heure de la nuit extrême.
Mais minuit ne dure qu’une seconde, ou une minute, et il est inutile d’attendre toute la nuit pour en connaître le fin mot. Alors, le visage caressé par un vent bienveillant, satisfait d’avoir déchiffré l’énigme, il descend du rebord de la fenêtre et, de retour sous ses draps, son corps reprend sa position immobile. Au plus profond de lui-même, il sait que la nuit est une statue, qui reste figée entre huit heures du soir et cinq heures du matin. Il dort tranquille.
Mário Araújo
Traduit du portugais (Brésil) par Stéphane Chao
Mário Araújo est né à Curitiba, Brésil. Il est l’auteur de recueils de nouvelles, dont "L’Heure extrême" distingué par le prix Jabuti, le plus important prix littéraire brésilien. Ses nouvelles ont été publiées dans des revues et des anthologies en Allemagne, Espagne, Finlande, Mexique et Etats-Unis. Il est diplomate de carrière.
Le triple vol de Bellamore
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Ces jours passés, les tribunaux condamnèrent Juan Carlos Bellamore à cinq ans de prison pour des vols perpétrés dans plusieurs banques. J’ai un peu fréquenté ce Bellamore : c’est un garçon mince et grave, soigneusement vêtu de noir. Je le crois incapable de telles prouesses, ni d’aucune action qui exige des nerfs solides. Je le tiens pour un éternel employé de banque ; je l’ai entendu se définir ainsi plusieurs fois, ajoutant même avec mélancolie que son avenir était amputé ; il ne serait jamais autre chose que cela. S’il existe un employé ponctuel et discret, c’est bien Bellamore. Je ne suis pas son ami, mais je l’estime et compatis à son malheur. Hier après-midi, j’évoquai l’affaire avec d’autres personnes. Oui, me dirent-ils, il en a pris pour cinq ans. Je le connaissais vaguement. Il était très réservé. Comment ne m’est-il pas venu à l’esprit qu’il pouvait être le coupable ? Il a été dénoncé à temps.
- Comment ça ? demandai-je, surpris. Dénoncé ? Il a été dénoncé ?
- Ces derniers temps, digressa un autre, il avait perdu beaucoup de poids, avant de conclure sentencieusement : moi, je ne fais plus confiance à personne.
Je revins rapidement au sujet et demandai si quelqu’un connaissait le mouchard.
- On l’a appris hier. C’est Zaninski.
J’avais très envie d’entendre cette histoire de la bouche de Zaninski lui-même : premièrement, parce qu’il n’avait aucune raison personnelle de dénoncer Bellamore, deuxièmement, parce que je voulais savoir par quels moyens il avait découvert que Bellamore était le coupable.
Ce Zaninski est russe, mais il avait quitté sa patrie, encore enfant. Il parle espagnol avec lenteur et avec une perfection, que son léger accent nordique écorche. Il a l’habitude de vous dévisager affectueusement de ses yeux bleus en vous décochant un sourire attendri et désarmant. On dit qu’il est spécial. Je déplore qu’à notre époque d’imbécilité crasse, nous ne sachions plus quoi penser lorsqu’on nous dit d’un homme qu’il est spécial.
Ce soir-là, je le trouvai à une table de café, réuni avec d’autres personnes. Je m’assis un peu à l’écart, prudemment, afin de les écouter de loin.
Ils discutaient tranquillement. J’attendais mon histoire, car ils y viendraient forcément. En effet, après avoir examiné un billet en mauvais état avec lequel il s’apprêtait à payer quelque chose, l’un d’eux proféra des récriminations d’ordre bancaire et Bellamore, le damné, revint à la mémoire de tous les présents. Zaninski était là, il devait parler. Lorsqu’enfin il se décida, je rapprochai un peu la chaise.
- Quand la Banque Française a été dévalisée à Buenos Aires, commença Zaninski, je revenais de Montevideo. Comme tout le monde, j’étais interloqué par l’audace du procédé employé : creuser un souterrain aussi long constitue indéniablement une entreprise risquée. Les diverses enquêtes ne donnèrent aucun résultat.
Bellamore, préposé au guichet, subit un interrogatoire plus poussé que les autres. Mais on ne trouva rien à lui reprocher, ni à personne d’autre. Le temps passa et on oublia l’épisode. Puis, au mois d’avril de l’année dernière, une discussion quelconque me remit en mémoire le vol commis à la Banque de Londres en 1900 à Montevideo.
Les noms de quelques employés suspectés circulèrent, parmi lesquels celui de Bellamore. Ce nom retint mon attention. Je me renseignai et j’appris qu’il s’agissait de Juan Carlos Bellamore. À cette époque, je ne le soupçonnais nullement. Toutefois, cette première coïncidence me mit sur sa piste et voici ce que donna l’enquête que j’entrepris.
En 1898, la Banque Allemande de la ville de San Pablo avait été dévalisée dans des circonstances telles que le crime ne pouvait être le fait que d’un employé qui avait eu accès au guichet. Or, Bellamore faisait partie de ce service.
Dès lors, je ne doutai plus un seul instant de sa culpabilité.
J’examinai scrupuleusement tout ce que l’on savait des trois vols et je me focalisai sur les trois circonstances suivantes :
1°) La veille du vol commis à la Banque Allemande de San Pablo,
une forte somme d’argent fut encaissée dans l’après-midi, au cours duquel Bellamore eut justement un différend avec son collègue guichetier, fait qui mérite d’être souligné, vu leur amitié et surtout le caractère placide de Bellamore.
2°) La veille du vol commis à la Banque de Londres à Montevideo,
Bellamore avait déclaré au cours de l’après-midi que, de nos jours, voler était la seule façon de s’enrichir et il avait ajouté en riant qu’il songeait en l’occurrence à s’attaquer à la banque où il travaillait.
3°) La veille du vol commis à la Banque Française de Buenos
Aires, Bellamore, à l’encontre de toutes ses habitudes, passa la soirée dans différents cafés à bambocher joyeusement.
Or, ces trois faits constituent à mes yeux trois preuves à l’envers, qu’on peut expliciter ainsi :
1°) seule une personne ayant passé la soirée avec le guichetier pouvait obtenir de lui sa clef. Or, par coïncidence, Bellamore s’était brouillé avec son collègue l’après-midi même.
2°) Connaît-on un voleur qui avoue un méfait qu’il commettra le lendemain même ? Ce serait la pure bêtise.
3°) Bellamore chercha à tout prix à se faire remarquer, s’exhibant en somme pour qu’on conserve bien à l’esprit que lui, Bellamore, était moins que quiconque susceptible d’avoir œuvré dans le souterrain, au cours de cette soirée mouvementée.
Ces trois attitudes emportent la conviction selon moi, elles sont peut-être d’une subtilité trop risquée pour un voleur de bas étage, mais elles sont parfaitement compatibles avec la finesse d’un Bellamore. Sans parler de détails privés, qui pèsent encore davantage dans la balance.
Ainsi, la fatidique triple coïncidence, les trois subtils détails qui signalent un garçon raffiné disposé à voler et les circonstances que l’on connaît, tout cela achevait de me persuader que Jean Carlos Bellamore, Argentin de vingt-huit ans, était l’auteur des trois vols commis respectivement à la Banque Allemande de San Pablo, à la Banque de Londres et Rio de la Plata sise à Montevideo et à la Banque Française de Buenos Aires. Le lendemain, je suis allé déposer, termina Zaninski.
Après avoir abondamment commenté l’affaire, le groupe se sépara. Zaninski et moi marchâmes dans la même rue, côte à côte, sans échanger un mot. En prenant congé de lui, je lui dis soudain ce que j’avais sur le cœur :
- Vous croyez vraiment que Bellamore a été condamné sur la foi de votre déposition ?
Zaninski me dévisagea de son regard affectueux.
- Je ne sais pas. C’est possible.
- Mais ces preuves n’en sont pas ! Ce sont des élucubrations !
ajoutai-je, échaudé. On ne peut pas condamner un homme avec si peu de preuve !
Il siffla en l’air, sans me répondre. Au bout d’un moment, il murmura :
- Il faut croire que si… Cinq ans, c’est beaucoup … - laissa-t-il
échapper tout à coup : à toi, je peux tout dire : je suis intimement convaincu de l’innocence de Bellamore.
Je me tournai vers lui brusquement et nous nous regardâmes dans les yeux.
- C’est trop de coïncidences pour être vrai, conclut-il avec lassitude.
Horacio Quiroga
traduit de l’espagnol (Uruguay) par Stéphane Chao
Sur la couverture de Lotus Seven et l'actualité
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
au Design graphic,
Bureau DGC
Bureau DGC
Là, en vive lumière, se soulevant légèrement dans le courant d’air, la couverture glacée, cartonnée, du livre sous le lampadaire noir. Février, l’air c’est la guerre à la porte, au seuil de la maison, sang, plaintes, râles, ruines, forêt qui disparait. Février 68, la série commence, gazé, il se réveille dans une chambre, un village inconnu, non nommé, qu’il ne peut situer.
Horlivka Khakiv Kherson
Février 22, un nouveau-né de papier, vive le né, dans ses langes noires, blanches, un livre bien couvert d’une forme géométrique. Le bien, le mal, la mauvaise foi, l’histoire refaite les chars, bâchés de fumées fuligineuses, d’obus, qui broient les immeubles. Il faut aller haut pour voir où on est, sur le clocher, il grimpe, pas assez haut, le bourdon résonne, insupportable.
Makiivka Melitopol Mykolaiv
Visage sans yeux ni bouche, muet, ou alors avec un seul énorme œil, cyclope : ne peut demander son nom à Ulysse Personne. On pleure beaucoup, c’est un désastre, toujours une catastrophe naturel et écologique, on pleure de l’enfant la menotte tendre arrachée. Où suis-je, quel est ce monde, comment je me trouve là, tout est bizarre, bien là, vrai et faux, fiction et réalité.
Tchernobyl Tchyryne
Tsverkva
Visage pâle sans yeux ni bouche, seulement frappé d’un zéro, visage héros sans nom, visage Personne, alors toi ou moi, simple numéro. Et ce sont des matricules armés contre des noms nus, c’est la ruée des nombres premiers à l’assaut des noms. Au téléphone, il dit qu’il n’est pas un numéro mais un homme libre, ils sont bizarres au poste de police.
Horlivka Khakiv Kherson
Visage blanc dessiné par le noir, qui fait l’un qui fait l’autre, visage pâle trame de la fiction contenue derrière. Visages livides, angoissés dans les abris sombres quand éclatent les missiles, peur blanche, nœud noir, mal au ventre, tympans meurtris, douleurs : tragédie. Pourquoi suis-je là, dans l’inconnu solide, dans un réel dur, tangible, aux couleurs du jour, mais où tout semble faux.
Makiivka Melitopol Mykolaiv
Visage zéro, pas de pot, ou celui d’un sectateur portant un voile, un pope patriarche qui fait une messe noire dans le temple maudit. Désastre de dictateur dingue, je t’aurais avec mon feu, ma flamme folle, exodes paniques et couloirs humanitaires et encore des blessures. Il nie, il n’est pas un numéro, si, non, arrêtez votre cirque, qui est le numéro 1, vous êtes le 2.
Tchernobyl Tchyryne
Tsverkva Zelensky
Ce pourrait être un globe terrestre immobile sur son axe horizontal, peut-être frappé de stupeur, ou boule de loto au repos. C’est le septième jour de guerre, ça continue les épisodes de fumées noires, de feu, de bâtiments détruits et de sang. À qui veut s’enfuir la boule blanche, translucide, fait son numéro, vient se coller sur le visage et asphyxie Le Prisonnier.
Michel Lansade
février 2022
février 2022
-7 paragraphes parce que fini au 7ème jour de la guerre.
-3 phrases par paragraphes, une pour la couverture, une sur la guerre et une sur Le Prisonnier
avec un « filage » blanc-noir, muet, … par paragraphe.
-Chaque phrase a 22 mots car nous sommes au début de l’écriture en Février 22.
Parfois je pleure
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Parfois je pleure
souvent les araignées viennent se reposer sur mon épaule
droite
elles doivent aimer le vert qui s’y dépose
Souvent je pleure
qui le sait
dans l’écharpe verte qui me protège du froid
mais pas de l’araignée
mais pas des pleurs
mais pas des larmes
mais pas des haut-le-cœur
à peine du froid
Parfois je pleure
et personne ne le sait
personne ne me pleure
ne pleure
mon malheur
l’araignée écrasée
le bruit que j’entends
la douleur qui me prend
souvent je pleure
Parfois vraiment je pleure
de gros sanglots
ça me prend
qui le sait
Betty Mandore
2022
2022
Index rerum facere
COLLECTION DES NOUVEAUTÉS
Redoublements
reprises, répétitions
lecture médicale
cas clinique
Mélancolie-et-Science
hallucinations, illusions
névrose
électrique
interpoler
Bruissements des insanes
Anthologies d’existences
interpoler
document
interpoler
preuve
interpoler
image médicale.
interpoler
Signes
interpoler
dispositifs
interpoler
illusion documentaire
interpoler
Traverser la peau
Couper le cerveau
électrifier
Finir
anonyme (moyen-âge)
